2015
Il y a cette icône désormais sur mon bureau. Le début d’une nouvelle étape dans la création. Une certaine appréhension à l’instant de cliquer dessus pour la première fois. Ce n’est plus rien de ce que je connais.

Le bus arriva quelques minutes seulement après que Bram se soit assis sur le banc de l’arrêt de bus. Bram n’avait plus de tickets alors il en acheta un au chauffeur, et le remercia au passage de l’avoir prévenu de sa venue ce matin par téléphone, ce à quoi le chauffeur répondit qu’il n’avait prévenu personne, qu’il était rentré chez lui complètement épuisé par la tempête et s’était immédiatement couché afin de reprendre son travail le lendemain dans les meilleures conditions. Bram s’installa au milieu du bus, à côté de la fenêtre, et regarda le paysage défiler alors que le bus se dirigeait vers l’arrêt suivant. Seulement, à mi-parcours, Bram entendit un étrange bruit venir du bus, puis celui-ci s’arrêta soudainement sur le bas-côté. Bram vit le chauffeur descendre en urgence du bus sans le rassurer ou l’informer sur l’événement qui venait de se produire. Bram regarda par la fenêtre du côté opposé à là où il s’était assis, mais il ne vit rien. Il hésita un instant à descendre au cas où il serait exposé à quelque grave incident, puis sortit par là où était sorti le chauffeur. Il fit le tour du bus, et constata que la roue arrière gauche était crevée. Puis il fit un autre tour complet du bus mais ne trouva pas le chauffeur. Bram l’imagina déjà parti chercher de l’aide, quand il entendit le téléphone sonner. Il reconnut aussitôt la voix de la veuve décédée. Celle-ci lui dit que le chauffeur ne retrouvait pas sa famille et qu’elle était enterrée comme elle dans la forêt, comme elle dans la terre de boue, comme elle sous les rondes des bêtes sauvages. Bram lui demanda où se trouvait le chauffeur à présent, et la veuve lui répondit en ville. Alors Bram lui demanda qui était le chauffeur qui venait de le conduire un petit moment, et la veuve lui répondit un autre chauffeur. Puis la veuve raccrocha. Bram remonta dans le bus où se trouvait, assis tout à fait au fond, le chauffeur. En s’approchant, Bram se rendit compte qu’il avait les mains couvertes de terre, et des traces de morsures sur le visage. Le chauffeur dit à Bram qu’il avait du enterrer la veuve car son corps se décomposait dans la forêt et qu’il n’était pas possible de la laisser pourrir là-bas. Bram s’assit à côté du chauffeur et lui tint la main pour le soulager de toute sa terreur. Il fouilla dans sa poche et lui donna la photographie du chauffeur et de sa famille parue dans le journal du matin. Le chauffeur chiffonna la photographie puis la jeta dans l’allée au milieu du bus. Bram observa la boulette de papier se déplier lentement, toujours froissée, pleine des traces de sa récente destruction. Depuis que la ville fondait, le paysage alentour conservait les traces de sa récente destruction. Cela, Bram ne le remarquait pas.
Au retour mouvementé de chez ma grand-mère après les fêtes de Noël (à cause de pannes automobiles toujours étranges), j’ai installé les nouveaux meubles que l’on m’a offert. Ma chambre évolue. C’est une sensation qui m’a toujours plue.
J’ai toujours aimé l’idée de trouver, derrière chaque porte fermée de chaque étage de chaque immeuble, une infinité de mondes effrayants. Voilà pourquoi nous ne tentons jamais d’entrer chez les inconnus : il y a là tant d’horreurs inenvisageables !
Durant la nuit, Bram entendit le téléphone sonner. Encore un peu ensommeillé, il descendit au salon pour décrocher le combiné. Il reconnut aussitôt la voix du chauffeur. Celui-ci lui dit qu’il ne retrouvait pas sa famille ni sa maison et que la ville n’avait plus rien à voir avec ce qu’il connaissait, qu’elle était presque entièrement détruite, presque entièrement morte, que ne surnageaient plus que quelques cadavres dans le canal qui traversait la Grand Place, que des patrouilles mitraillaient les zonards, qu’il avait revu la veuve du bar, accrochée au véhicule d’une de ces patrouilles, qu’il la trainait en riant sur des kilomètres, que tout le monde tentait de fuir la ville, mais qu’à chaque sortie de rue il y avait une frontière, que c’est alors que Bram entendit le téléphone sonner. Encore un peu ensommeillé, il descendit au salon pour décrocher le combiné. Il reconnut aussitôt la voix du chauffeur. Celui-ci lui dit qu’il avait retrouvé sa famille, son chez lui, et qu’il viendrait dès le matin avec son nouveau bus pour transporter Bram jusqu’en ville. Bram remercia le chauffeur de l’en avoir informé, puis, enjoué, prépara son petit déjeuner. La pluie avait cessé. Il récupéra le journal du matin, à la quatrième page duquel se trouvait une photographie du chauffeur et de sa famille, du moins le supposa-t-il, ne l’ayant jamais vue. Bram découpa soigneusement la page puis la colla au carrelage de la cuisine. Puis il finit de se préparer, et se rendit à pied jusqu’à l’arrêt de bus à côté du village. Il s’assit sur le banc de l’arrêt de bus, puis patienta. Bram ignorait toujours le principal, à savoir que depuis deux jours, la ville fondait.
J’ai l’impression que Flammarion s’obstine à publier tous les manuscrits que je refuse. Je ne sais pas pourquoi ils font cela. Je veux dire, ce n’est pas que mon avis : c’est vraiment de la merde.
D’ailleurs, je vais surenchérir, mais pour qu’on se mette bien tous d’accord avant d’entâmer l’année 2016 : les romans d’Édouard Louis sont eux aussi nuls à chier.
Bram eut des remords de n’avoir pas enterré la veuve calcinée dans les bois. Il pensait qu’à présent sa dépouille était la proie des bêtes sauvages carnivores, et qu’il n’y aurait aucun lieu de mémoire pour elle. Qu’elle ne pourrait jamais rejoindre son défunt mari sans sépulture appropriée. À travers la vitrine et la pluie, de l’autre côté de la rue, il y avait la boutique du boucher, et Bram voyait les tripes accrochées dans la vitrine de la boucherie, et ça lui rappelait la veuve en proie aux bêtes sauvages. La pluie tombait toujours mais Bram se décida à braver la tempête pour retourner dans la forêt, pour retrouver le corps sans vie de la veuve. Une fois dehors, il fut très vite complètement trempé. Sa chemise et son pantalon collaient à sa peau, les fonçant d’une teinte ; du blanc au beige pour la chemise, du bleu clair au bleu marine pour le pantalon. Bram persévéra jusqu’à la forêt, où il retrouva rapidement le corps de la veuve. Il y avait encore les empreintes de ses pas et de celles du chauffeur, quand ils étaient passés au matin, mais d’autres empreintes de pas également, d’inconnus, de chasseurs, ou de randonneurs égarés. Pourtant, la dépouille de la veuve n’avait pas bougé, sinon les bouteilles d’alcool qui avaient disparu. Bram remarqua alors qu’il n’avait pas de pelle pour creuser à la veuve une tombe. Il n’avait plus la force de la porter jusqu’au cimetière, et redoutait qu’attendre le lendemain ne la fasse définitivement disparaître. Le bruit que faisaient les gouttes sur les feuilles des arbres l’abrutissait. La terre était molle de la pluie trop longtemps tombée. Il creusa le sol avec ses doigts, se retourna un ongle, et bientôt toute sa tenue était de boue. La dépouille décomposée puait à côté de lui. Il entendit les hurlements de bêtes sauvages. Bram ne s’était jamais donné autant de mal pour personne auparavant. Peut-être avait-il de l’amour pour la veuve. Il creusait dans la terre avec beaucoup de courage et peut-être de l’amour pour la veuve. Le trou s’est formé plus vite que si Bram n’éprouvait rien pour la veuve. Bram n’avait rien pour recouvrir la dépouille de la veuve, alors il la recouvrit de feuilles tombées au sol, qu’il disposa comme il put. Dans ses paroles pour bénir la veuve, il la lia au ciel avec son défunt mari. Puis il tira méticuleusement le corps dans le trou, et le recouvrit de la terre ôtée, toujours avec ses mains. On aurait dit un chien. Quand il se releva, il était noir, épuisé. Alors, on aurait dit un monstre. La pluie toujours tombait sur et autour de lui. Trop occupé par son entreprise, Bram ne s’était pas rendu compte que, depuis que la ville fondait, les gouttes de pluie étaient des gouttes de sang.
Peu après, Bram rentra chez lui. Il se sécha, lava ses vêtements trempés de boue, et mangea une ratatouille rapidement confectionnée à l’aide des derniers légumes encore stockés dans son frigo. Le soir, il alluma son poste mais à l’écran il n’y avait rien que de la neige. Il tapa sur le boitier, pivota les antennes, en vain. Il entendait quelqu’un parler mais ne voyait rien. Peut-être quelqu’un parlait-il à l’extérieur de la maison, mais à cause de la nuit, il ne voyait rien. Il ignorait que, depuis que la ville fondait, plus aucune chaîne ne transmettait, que plus personne ne voyait rien.
Il se mit à pleuvoir. Bram n’avait ni son chapeau, ni son parapluie, tous deux chez lui, et troués de surcroît. Son parapluie troué de s’être retourné, et son chapeau troué de coups de coûteau. Bram remonta son blouson sur le haut de son crâne et s’en fit une capuche de fortune. La pluie tombait avec une étonnante rigidité qui blessait presque les mains de Bram. Il courut se réfugier au village dans le bar de la veuve, mais dans le bar il n’y avait plus de veuve. Il se sécha dans l’entrée puis s’assit dans l’espoir que quelqu’un vienne le servir. Évidemment, personne ne vint. À regarder la pluie à travers la vitrine, ainsi que la veille, il repensa à la femme brûlée croisée dans la forêt, lorsqu’il amenait le chauffeur aux cendres de son bus. De ne pas voir arriver la veuve pour le servir, il comprit qu’elle était la femme brûlée de la forêt. Il se demanda par quoi elle était passée pour finir dans cet état. Bram n’était pas le genre d’esprit à lier les choses. Il se disait qu’une femme brûlée était tragique, infâme, qu’il était infâme pour quiconque de brûler une femme et de la laisser pour morte dans la forêt, de la laisser morte, complètement, dans la forêt. Qu’il faudrait être un monstre, un tyran, pour faire subir de telles atrocités à une femme aussi gentille que la veuve. La colère de Bram fut de courte durée. Il tenta de se servir une bière mais cassa la machine et attendit que la pluie cesse de tomber alors que la machina cassée laissait inonder de bière le sol derrière le bar. Il pensa au chauffeur, seul à pied sous la pluie, et s’attendrit de l’imaginer retrouver sa famille après un si éprouvant périple. Le chauffeur n’avait aucune chance de retrouver sa famille à présent que la ville fondait. Cela, bien sûr, Bram l’ignorait.
« Bientôt la rue tout entière, toutes les rues sont recouvertes de gens asphyxiés, de cadavres, tout s’est arrêté, beaucoup de catastrophes provoquées par des machines privées de conducteurs ne sont pas du tout perçues parce qu’elles se produisent seulement après l’extinction totale de l’humanité, si bien que ce ne sont même plus des catastrophes… La fin est un monstrueux tumulte suivi d’un processus de décomposition conforme à la nature, dit-il. » — Thomas Bernhard, Perturbation.
Hors la forêt, Bram et le chauffeur arrivèrent très vite au tas de cendres du bus. Le chauffeur regarda un temps ce monticule gris avec tristesse. Bram de même. Tous les espoirs d’un jour aller en ville semblaient définitivement éteints. Sans plus s’attarder, le chauffeur serra la main de Bram et le remercia pour l’hébergement. Il devait retrouver sa famille et son chez soi. Puis il prit la route à pied vers la ville. Bram l’aurait bien accompagné, mais il ne s’en sentait pas le courage. Il regarda le chauffeur devenir minuscule à l’horizon, comme la voiture de la veille, puis disparaître, lui aussi. Il s’attrista un peu sur cette compagnie révolue. Il se demanda quels autres moyens pourraient l’amener en ville. Les pneus de sa bicyclette étaient crevés. Personne ne possédait de voiture au village. Et le bus ne passait plus, maintenant qu’il était cendres. Rentrer chez lui n’était pas une option. Il ne supportait plus de rentrer chez lui. Il attendit. Rien ne se passa. Depuis que la ville fondait, c’était un luxe d’attendre. Cela, Bram l’ignorait.
Une voix surprit Bram alors qu’il attendait. Il sortit de ses pensées et posa son regard sur un petit garçon assis au milieu de la route. Le petit garçon demandait à Bram ce qu’il attendait, et où était passé le bus, car il devait se rendre à l’école. Bram dit au petit garçon que le bus était ce tas de cendres à côté de lui, et que s’il voulait se rendre à l’école, il devrait y aller à pied. Le petit garçon ne voulut rien entendre et se mit à faire un caprice sur place. Bram s’approcha pour le consoler, mais le petit garçon le griffa au visage. Il le griffa si fort que les plaies sur le visage de Bram se mirent à saigner, et que Bram dut jeter le petit garçon avec violence sur la chaussée, ce qui lui écorcha les jambes. En se relevant, le petit garçon n’avait plus de chagrin, mais beaucoup de colère, et il maudit la famille de Bram, Bram qui n’avait plus de famille depuis bien longtemps. Bram dit au petit garçon qu’il était le démon. Et le petit garçon disparut. Bram, comme la plupart des habitants de la ville à présent que celle-ci fondait, avait parfois de ces visions étranges. Il ignorait n’être pas le seul à les subir.
Je me suis assis dans le fond de mon fauteuil. J’ai respiré consciencieusement plusieurs minutes. Puis le reste a repris.
Le lendemain, le chauffeur se réveilla sans parvenir à se souvenir où il s’était endormi la veille. Il observa avec attention les journaux collés au sol, tapissés aux murs, marcha dessus jusqu’au rez-de-chaussée, prenant garde à ne pas les déchirer. Il se souvenait partiellement de la nuit dernière, d’un homme sans ombre, de labyrinthes de blé, de la Géhenne. Il ne savait ce qui tenait de la réalité ou du rêve. Il se souvenait de son bus réduit en cendres, et de la veuve insomniaque, et du mari de la veuve lui aussi réduit en cendres. Il s’assit à la table de la cuisine. Bram était absent. Sur la table de la cuisine un mot indiquait que Bram était absent. La table était mise. Le chauffeur en profita pour boire un verre d’eau et pour manger du pain. Il décolla l’une des feuilles de journal du sol, la lut, mais, l’entête ayant été arrachée, ne parvint pas à deviner à quelle ville elle faisait référence. Les articles étaient illustrés de photographies maladroites, floues la plupart, ou surexposées. On distinguait des silhouettes, des flammes noires, des corps inanimés. Le chauffeur reposa sur le sol cette feuille de journal qui le troublait, puis, son verre d’eau terminé, remonta s’allonger sur son lit. Ce fut le moment que choisit Bram pour apparaître dans l’encadrement de la porte. Sa présence soudaine surprit le chauffeur, qui ne put s’empêcher de le questionner sur les feuilles de journaux. Bram lui dit qu’il y avait là les nouvelles de toutes les destructions de toute l’humanité depuis sa naissance, jusqu’à son extinction. Que les photographies d’illustration étaient les visions des hommes disparus. Le chauffeur eût à peine le temps de questionner davantage Bram qu’il sombra dans un sommeil profond. Le lendemain, il se réveilla, et ne sut ce qui tenait de la réalité ou du rêve. Il entendit Bram l’appeler depuis le rez-de-chaussée. Il s’habilla en vitesse puis descendit. Bram préparait la table. Le chauffeur ne laissa pas à Bram le temps de parler, lui expliqua aussitôt qu’il devait partir au plus vite pour retrouver sa famille. Bram accepta et lui proposa son aide, au moins pour l’aider à retrouver son chemin jusqu’aux cendres du bus. Pour l’instant, le chauffer ignorait que, depuis que la ville fondait, sa famille était réduite à la même cendre que son bus.
Bram et le chauffeur ne prirent pas le chemin que Bram avait l’habitude d’emprunter pour se rendre à l’arrêt de bus. Évidemment, le chauffeur n’en savait rien. C’était le matin. Ils passèrent par la forêt que le chauffeur croyait avoir rêvée. Le chauffeur imagina que Bram avait quelque chose à récupérer au bar de la veuve. Bram n’avait rien à récupérer. Le chauffeur savait que dans la forêt, sans Bram, il se perdrait à nouveau, et finirait par ramper dans les feuilles mortes. Il eut la même impression de répétition que la veille. Il imagina que la forêt débouchait à divers endroits du monde en fonction de là où on en sortait. Mais que seul Bram connaissait les endroits exacts où sortir pour déboucher sur les lieux exacts qu’on recherchait. Il n’en était peut-être rien. À un endroit de la forêt, Bram s’arrêta net, et le chauffeur qui marchait derrière lui en fit de même. Le chauffeur se demanda ce qui empêchait ainsi la marche de Bram, quand il vit, au sol, la dépouille calcinée d’une femme. On la reconnaissait à ses longs cheveux peignés, car son visage était noir et sa peau de même. À côté d’elle, renversées, des bouteilles d’alcool se déversaient dans la terre. Le chauffeur crut la reconnaître. Bram dit que cette femme serait bientôt de cendres, et reprit la route. Après quelques mètres dans la forêt, le chauffeur ne put s’empêcher de regarder derrière lui, et remarqua entre les branches, au dessus du cadavre de la femme, plusieurs mouches immobiles dans les airs, et, dans le fin sillon d’alcool qui coulait depuis les bouteilles, des bêtes sauvages s’abreuver. Le chauffeur ignorait que, depuis que la ville fondait, les bêtes sauvages lapaient le sang dilué dans les ruisseaux.
L’ambition de chacun, à l’instant d’écrire, n’est-elle pas de produire une nouvelle Bible ?
« Mon Dictionnaire Khazar contient les dix chiffres et les vingt-deux lettres de l’alphabet hébreu. Je sais qu’on peut créer le monde avec cela, mais je ne sais pas comment. »
Bram et le chauffeur traversèrent un premier champ de blé. Ils manquèrent se perdre à plusieurs reprises, mais Bram parvint à chaque fois à les guider dans le dédale. Le ciel était dégagé et la lune tombait sur eux à pic. Lorsqu’ils levaient la tête, la disposition des étoiles les étourdissait. Le chauffeur vomit sur ses chaussures. Il traîna l’odeur jusque chez Bram. Une fois sortis du champ, ils franchirent les ronces et les orties d’un fossé de bord de route, s’écorchant là les mollets sous le tissu de leurs pantalons. Ils suivirent le tracé de la route, mais Bram ne la reconnaissait pas. À peine avaient-ils fait quelques mètres qu’il préféra attirer le chauffeur vers une forêt à proximité. Le chauffeur remarqua que Bram n’avait aucune ombre. Il mit cette découverte sur le compte de l’alcool. Mais Bram n’avait aucune ombre. Bram et le chauffeur s’engouffrèrent. Le chauffeur eut la sensation que la forêt se répétait, qu’à peine passés quelques arbres les mêmes revenaient, les mêmes branches lui griffant les mêmes endroits du visage, les mêmes racines crochetant les mêmes jambes. La forêt bouclait sur elle-même et pourtant Bram n’en souffrait pas. Une fois le chauffeur s’étendit de tout son long sur le sol de feuilles froides, et sentit là l’odeur de la terre humide, et l’horreur, et le reste. Et il vomit à nouveau sous son visage collé aux feuilles et à la bile. Bram le tira sur la fin du trajet, le porta, le lava, et le coucha dans un lit d’appoint, à l’étage de sa petite maison jonchée de journaux. Il éteignit le plafonnier de la chambre, et le chauffeur s’endormit sur ses espoirs d’un jour rentrer chez lui. Le pauvre ignorait que depuis que la ville fondait, plus personne n’avait de chez soi.
Bientôt la fin de l’année. On aura bien souffert.
« Mais les pensées dépérissent au contact des mots, aussi vite que les mots au contact des pensées. Il ne nous reste que ce qui a survécu au massacre. » — Milorad Pavic, Le Dictionnaire Khazar.
À l’intérieur du bar, la salle était vide. La veuve ne se trouvait pas derrière le comptoir, mais des bruits de vaisselle brisée témoignaient de sa présence dans l’arrière-cuisine. Bram indiqua au chauffeur une chaise sur laquelle prendre place, près de la vitrine. Ils pouvaient ainsi observer la vie dans le bourg, vie réduite à rien. La veuve mit un peu de temps avant d’arriver en salle, aucune sonnette ne l’ayant avertie de l’arrivée de Bram et du chauffeur. Elle reconnut aussitôt Bram, qui la visitait parfois, mais dû le questionner discrètement sur son compagnon de tablée. Elle n’avait jamais vu le chauffeur auparavant, celui-ci habitant en ville. Elle déduit de la triste mine du chauffeur que ces gens de la ville avaient décidément la déprime facile, jusqu’à ce que Bram lui explique que son bus venait d’être réduit en cendres. La veuve compatit, son propre mari ayant également été réduit en cendres. Elle savait la douleur face à la poussière. Elle offrit aux deux hommes deux liqueurs fortes pour les remettre de leurs émotions. Bram et le chauffeur espéraient de la bière, mais ils burent chacun leur liqueur avec un enthousiasme réel. Puis ils burent de la bière jusqu’à la nuit. Ils burent jusqu’à vider les réserves de la veuve. Ils ne parlèrent que peu. La bar ne fermait pas, mais la nuit personne ne venait. La veuve profitait de ce temps pour faire ses courses et s’adonner à ses divers loisirs. Elle mit Bram et le chauffeur à la porte, n’ayant plus rien à leur offrir. Bram et le chauffeur, ivres, après d’interminables trajets en zig-zag autour des tables de la salle, quittèrent le bar chancelant vers chez Bram. Vers chez Bram à travers champs. La veuve prit son sac à main et se mit en route à pied dans la nuit vers la ville, à l’opposé de l’endroit où se dirigeaient Bram et le chauffeur. Elle espérait pouvoir être revenue au matin avec ce qu’il fallait d’alcool. En ville, les habitants utilisaient l’alcool pour incendier les immeubles et brûler les femmes. Pour l’instant, la veuve l’ignorait encore.
Récemment, dans un magazine dit féminin, se trouvait un article intitulé Lettres au futur, et sa photo d’illustration présentait trois jeunes hommes à la moue chafouine, qui écrivent des livres communs (heureusement pour eux dans de grandes maisons d’édition), mais qui n’ont absolument et résolument rien du futur. La reproduction médiatique commence tôt ; voici déjà nos prochains d’Ormesson. Désormais pour eux, plus qu’une seule ambition : vite, la mort ! Les Lettres au futur, c’est la mare de déjections où barbotent quelques mutilés, quelques aveugles. C’est cela qu’il aurait fallu photographier. Rien de plus.
Il faut toujours distinguer, pour soi et pour les autres, ce qui nous fait gagner notre vie, et ce qui lui donne un sens. Toujours garder à l’esprit cette ligne parfois mince. Le marteler. Ne jamais engloutir la seconde dans la première. Comme l’a très bien écrit Woolf dans Une chambre à soi : La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles. La poésie dépend de la liberté intellectuelle.
Après être restés tous les deux debouts face au tas de cendres étalé dans le fossé, Bram et le chauffeur se turent. Le chauffeur pleura à moitié dans son mouchoir pour ne pas trop se faire honte. Puis Bram prit la parole. Il supportait mal le silence. Il en souffrait assez tout seul chez lui. C’est d’ailleurs pour cela qu’il allait en ville, pour éviter le silence d’être seul chez soi. Comme il était empêché de s’y rendre, la présence du chauffeur compenserait. Il proposa au chauffeur d’aller boire une bière, ainsi ils pourraient épiloguer sur leur aventure, sur l’état du bus, et sur le manque de civisme des automobilistes. Le chauffeur accepta, précisant que cela lui changerait les idées. Bram connaissait un bar, qui n’était évidemment rien en comparaison de ceux de la ville, mais qui avait le mérite de servir de l’alcool à toute heure du jour et de la nuit. Il était tenu par une vieille veuve aussi gentille qu’insomniaque. Le chemin du tas de cendres jusqu’au bar se fit sans embuches, sinon la déprime du chauffeur qui n’en finissait plus de croître. Bram tenta de le réconforter, en vain. Il faut bien le reconnaître, il n’était pas très convaincant. Les champs bordant leur parcours avaient encore le blé haut. Des rangées de fils barbelés encerclaient des troupeaux de vaches coites. Ainsi pendant plusieurs centaines de mètres. Le bourg du village était désert. Bram retrouvra là tout ce qu’il cherchait à éviter en se rendant à la ville. Le bar se trouvait juste à l’entrée du bourg. Avant de passer la porte du bar, Bram remarqua, au loin, à peu près au niveau de la ville, un groupe d’oiseaux qui s’élevait dans le ciel. Puis, peu après, il entendit des détonations de fusil, mais les plombs manquèrent les oiseaux, puisqu’aucun d’entre eux ne tomba au sol. Bram ignorait que, depuis que la ville fondait, les oiseaux migraient, et les habitants s’entretuaient.
On a convenu avec Guillaume que, vraiment, il n’y avait pas suffisamment de vaisseaux dans ce livre.
Passé une partie de l’après-midi devant un parterre d’odieux connards. Le monde des chiffres nettoie mon habituel désintérêt pour attiser une colère toujours croissante. Il faudrait leur dire : taisez-vous et vendez. On se justifie toujours trop de créer. Il faudrait leur dire : fermez vos gueules. Il faudrait le leur redire. Le leur hurler. Vous qui vendez arrêtez de parler et vendez. Arrêtez de juger par les chiffres et vendez. Et si vous ne parvenez pas à vendre insultez vos femmes, mais laissez-nous tranquille. Taisez-vous, sincèrement. Ça ne nous concerne pas.
« que, vois, loin dans la longue tranchée de taudis noirs, un rayon rose qui se lève, écoute mon klacson comme il résonne entre les hautes façades noires rouges qu’y gonflent des linges blancs crasse aux balcons effondrés » — Pierre Guyotat, Joyeux animaux de la misère.
Bram et le chauffeur restèrent là un instant à regarder le bus moitié encastré dans le fossé. Bram demeurait stoïque quand le chauffeur n’en finissait plus de se lamenter. Incapables de rien, ils décidèrent de s’assoir sur un banc à proximité. Le chauffeur espérait qu’un mécanicien en déplacement passe par hasard sur la route. Bram n’attendait rien en particulier. Il faisait bon, l’après-midi commençait, il était toujours agréable de se reposer un peu avant d’envisager la suite, quand bien même il était impossible pour Bram de se rendre en ville. Aucun des deux hommes n’osait engager la conversation. Bram avait peur de contrarier le chauffeur. Le chauffeur trouvait Bram étrange. Le chauffeur n’avait aucun moyen d’appeler le mécanicien, ni Bram d’ailleurs, ayant toujours rechigné à posséder un téléphone. Bram les croyait nocifs. Soudain, venant de la ville, à toute vitesse, une voiture passa devant eux, qui klaxonna, mais ne s’arrêta pas. Le chauffeur l’insulta jusqu’à ce qu’elle disparaisse à l’horizon, puis il se rassit, déprimé. Il monologua longuement sur l’égoïsme moderne des habitants de la ville. Bram acquiesca par politesse. Depuis que la ville fondait, le mécanicien avait disparu, et les habitants fuyaient. Cela, Bram et le chauffeur l’ignoraient.
Un peu plus tard, toujours assis sur le banc, Bram s’aperçut qu’une légère fumée s’élevait depuis le capot du bus, mais il ne voulut pas alerter le chauffeur pris dans ses pensées, craignant sa réaction. Il attendit que la fumée devienne toujours plus épaisse, toujours plus noire, puis que l’avant du bus prenne feu, moment à partir duquel le chauffeur se rendit compte de la situation, et tenta par tous les moyens d’empêcher le désastre. Ses efforts ne suffirent pas. Le bus s’embrasa. L’immense colonne de fumée noire s’élevait, étouffante, obligeant Bram et le chauffeur à s’éloigner de la carcasse du véhicule vers un champ situé à l’opposé. La terre du champ était boueuse et leurs chaussures s’enlisaient. Bram avait du mal à garder son équilibre. Plus d’une fois il mit genou à terre pour ne pas tomber, salissant son pantalon lavé du matin, son plus beau pantalon pour ses rendez-vous en ville. Il s’en plaint à plusieurs reprises, mais le chauffeur se moquait bien du pantalon de Bram. Le chauffeur avait tout perdu, son bus étant son seul bien. Son bus étant à présent de cendres, le seul bien du chauffeur était aussi à présent de cendres. Tous les biens de tous les habitants de la ville étaient à présent de cendres, depuis que celle-ci fondait. Pour l’instant, le chauffeur l’ignorait.
La politique actuelle : plus de prisons, plus de cellules, plus de matraques, plus de frontières, plus de fusils, plus de portes closes, plus de transactions financières, plus de véhicules à vitres teintées, plus de portiques, plus de contrôles, plus de portes défoncées, plus d’habitations saccagées, plus de camps, plus de souillure, plus de boue, plus de cris, plus d’ignorance, plus de peur.
Désemparé, Bram revint là où le chauffeur de bus se trouvait, là où le bus aux roues crevées se trouvait. Le chauffeur s’y trouvait toujours, affairé sur une des roues arrières. Rien ne semblait avoir changé. Bram demanda au chauffeur comment les choses avançaient, et le chauffeur lui répondit que rien n’avait changé. Les mains croisées derrière le dos, Bram se pencha sur la roue arrière qui occupait tant le chauffeur. Il s’aventura à prodiguer quelques conseils au chauffeur, mais celui-ci fit semblant de ne rien entendre. Soit que les conseils de Bram étaient inutiles, soit que le chauffeur était trop irrité de ne pas parvenir à réparer son véhicule lui-même, et ne pouvait se résoudre à écouter les conseils de quelqu’un comme Bram. Quelqu’un qui n’a aucun savoir-faire en mécanique. Bram fit quelques pas autour du véhicule, observa ce bus vide de passagers. Il est habituellement le premier passager récupéré par le bus sur le trajet vers la ville. Il se demanda si les autres passagers sur le trajet attendaient toujours le bus. Ceux plus proches de la ville avaient dû s’y rendre à pied. La route vers la ville n’était pas très agréable, caillouteuse et vallonnée, et n’engageait pas à la marche. Bram préférait marcher autour de chez lui, où les sentiers étaient mieux entretenus. Il entendit jurer le chauffeur, ce qui le sortit de ses pensées. Il en déduit que la situation était pire qu’avant, ce qui se confirma aussitôt : la roue arrière gauche du bus se décrocha, celui-ci s’affaissa immédiatement sur la gauche, et vint se renverser dans le fossé longeant la route. Cette situation était inextricable, mais risible comparée à ce que la ville était devenue depuis qu’elle fondait. Mais cela, Bram l’ignorait.
Les plus terribles ennemis de la presse en ligne : les espaces insécables.
L’omniprésence sexuelle de Joyeux animaux de la misère me gonfle un peu. Quand même cette phrase : la nuit est longue encore et la Ville pleine de bêtes…
Bram franchit l’enclos de sa cour. De la boîte aux lettres à la cuisine, le sol était jonché de journaux. Des journaux dont il découpait minutieusement les mots croisés pour les réaliser durant un temps libre qu’il ne se ménageait que rarement. Il préférait se promener autour de sa propriété, parfois s’aventurer jusqu’au bosquet voisin, ramasser là les quelques feuilles mortes et glands tombés au sol. Il en faisait un mausolée sur une commode en formica, ornant ainsi le portrait délavé de sa défunte épouse. Il lui arrivait parfois, dans un excès de fureur, de dévaster le mausolée, mais il s’en repentait aussitôt, et retournait dans le bosquet chercher de quoi le décorer à nouveau. Il avait de ces crises parfois qu’il expliquait mal. Ses proches auraient pu en témoigner, puisqu’aujourd’hui ils n’étaient plus en état de témoigner. Bram se demandait à présent quoi faire, lui qui voulait se rendre en ville. Il n’avait pas prévu de ne pas aller en ville, et, assis à la table de sa cuisine, il s’ennuyait. Il aurait pu entâmer un de ces nombreux mots croisés mis de côté, mais il n’en avait plus le goût. Ne pas aller en ville l’abattait au plus haut point. Il avait là-bas tellement de distractions ! Et ici, tellement de tracas. S’y rendre à pied lui aurait pris plusieurs heures, et il serait arrivé au soir, quand tout ferme. Ça n’en valait plus la peine. Pourtant, depuis que la ville fondait, les distractions avaient presque toutes disparu. Mais Bram n’en savait rien encore.
Ça pue un peu dans ma chambre.
Il est étrange, cet instant d’avant la publication, quand son texte touche à une sorte de vraie-fausse fin, qu’il est presque impossible de l’altérer, d’y revenir, mais qu’il n’a pourtant aucune réalité, aucun écho. Il stagne là, en arrière-plan, prêt à s’imposer à tout moment ; il obsède un peu ; il faut avancer avec.
Le mur avait quelque chose d’instable. Quand on s’approchait pour toucher une brique, la brique disparaissait, laissant sa place à une autre, identique. Le mur n’était pas très large, bouchait l’allée d’une ruelle, faisait l’impasse. Les deux bâtiments adjacents étaient quelconque, deux immeubles d’habitation, probablement. On descendait dans la ruelle les poubelles, on y faisait des trafics, tuait au pire. Il y faisait nuit tôt. Le mur était là, on ne le questionnait pas. On y tapait parfois au poing, énervé, abruti. On s’y adossait. On a voulu l’abattre. Beaucoup y sont allés à la masse, à la pioche ; ils y ont perdu tous leurs outils. Il s’agissait de ne pas altérer le mur. Le mur avait pour vocation d’être mur, et rien ne devait l’entâmer. Toute tentative de destruction serait vouée à l’échec. Toute tentative d’effacement empêchée. On aurait pu agrandir le mur, l’élever ; à quoi bon. Il était déjà infranchissable. On pouvait évidemment le contourner, mais de l’autre côté, il était le même. Que se trouvait-il entre ses deux faces. Qu’y avait-il derrière. Quelqu’un avait écrit à sa droite : ici se trouve la vérité. Et s’il suffisait de s’y couler ?
C’est sous le soleil pourtant rare du mois d’octobre que la ville avait commencé de fondre. Bram se dirigeait vers le bus dont les roues avaient éclaté. Le chauffeur tentait par tous les moyens de les regonfler, mais il n’y avait rien à faire. Bram posa une main sur son épaule en signe d’encouragement, mais il n’y avait rien à faire. Le crique tournait dans le vide. Décidément, il n’y avait rien à faire. Bram regardait le crique ainsi tourner, accroché à la roue crevée, et il pensait à bien d’autres choses. Ça le déprimait un peu. Bram avait l’habitude de prendre ce bus pour se rendre en ville. Il s’asseyait dans le fond, à côté d’une fenêtre, puis observait les champs, les forêts, les ponts. Il pensait à bien d’autres choses. Ça le déprimait aussi. Le chauffeur pestait toujours contre les roues crevées. Ça attrista Bram. Il n’y avait aucun moyen que le bus reparte avant plusieurs heures, voire jours. Tout dépendait de la vitesse à laquelle le mécanicien pourrait intervenir. Le mécanicien avait mauvaise réputation, notamment sur ses délais d’intervention. C’était mauvais signe pour la suite. Bram hésita à inviter le chauffeur chez lui, mais il ne le connaissait pas si bien que ça, et il aurait été gêné de ne savoir quoi lui dire. À part les trajets jusqu’en ville, ils avaient peu en commun. Bram laissa là le chauffeur et entreprit de rentrer chez lui. Il devait marcher plusieurs kilomètres sur des routes de campagne abandonnées où ne passaient plus que quelques tracteurs. Le trajet, Bram le connaissait bien, puisqu’il l’empruntait chaque fois qu’il voulait prendre le bus. Arrivé en haut d’une butte, un peu essoufflé, il posa les mains sur ses genoux, reprit ses esprits, se releva doucement, puis observa le paysage devant lui. La ville apparaissait minuscule au loin, semblable à elle-même. Pourtant, depuis que la ville fondait, bien des choses avaient changé. Bram n’en savait rien encore.
On est guidé par cette ambition démesurée : être singulier. On avance dans cette direction, on travaille, persuadé de devenir ce que personne d’autre n’aurait pu devenir, un monolithe ; souvent on se leurre. On s’isole ; on meurt persuadé d’avoir touché l’essentiel. Le lendemain, tout le monde nous a oublié.
« Trouver cet unique dans les multitudes n’est déjà pas chose facile ; le trouver épanoui, accompli, dans sa plénitude, est encore plus difficile. Et l’atteindre au moment où nos propres forces sont au plus haut, c’est-à-dire quand le summum du sujet coïncide avec le summum de l’objet, c’est tout simplement impossible. Je n’accepte rien de moins que le summum. Sans quoi, on est un cran au-dessous de l’art, et donc pas dans l’art. » — Sigismund D. Krzyzanowski, Le thème étranger.
Elle était assise à table et je ne voyais que son dos. Je me tenais debout près de la fenêtre, ouverte depuis l’orage, ouverte depuis la pluie inondant le carrelage. Elle s’en inquiétait parfois. As-tu fermé la fenêtre. Je ne répondais rien, regardais par la fenêtre l’orage. J’entendais la foule affolée passer dans la rue, l’orage affolé et son silence à elle : Quand reviendras-tu t’assoir. La table n’avait plus qu’une seule chaise. Les portes des placards étaient depuis longtemps écroulées. Je me tenais soudain de l’autre côté de la fenêtre, dans le jardin détrempé, et la voyais de dos par-delà la fenêtre ouverte. Elle voulait se retourner pour me parler, mais chaque tentative la ramenait à sa position initiale. Un fort courant d’air fit battre les volets. Le bois éclata. La fenêtre s’est retrouvée fermée, et moi toujours derrière qui ne pouvais plus lui parler. L’eau continuait de s’accumuler dans la pelouse du jardin, transformant progressivement la terre en marais. Alors son visage s’est trouvé collé à la vitre, son visage blanc et indifférent, marqué. Elle ouvrait les lèvres comme pour crier mais le vent m’empêchait de l’entendre. Elle ne cessait de crier. Je n’ai eu d’autres choix que de fermer les volets sur ses cris. Je me suis alors retrouvé dans la cuisine. La chaise était vide. Je me suis assis. Je tournais le dos à la tempête. La fenêtre s’est ouverte. Elle a crié une dernière fois.
« Toute chose a un terme mais la détresse n’en a pas, elle ne connaît pas le sommeil, elle ne connaît pas la mort, d’instant en instant j’en fais l’épreuve ; le jour ne l’éclaire pas, la nuit est sa profondeur, sa mémoire vivante. » — Maurice Blanchot, Celui qui ne m’accompagnait pas.
J’ai beaucoup de mal à retrouver la disposition d’esprit qui m’a permis d’écrire Saccage. Sans doute s’agissait-il d’une colère inédite, continue, qui me poussait à extirper beaucoup de moi. Aujourd’hui, toute sensation forte est du même temps extrêmement courte. Je crois percevoir quelque chose, mais dès le lendemain, toute trace d’ébauche a disparu. Mon prochain dépendra beaucoup de son impulsion initiale. Il s’agit de la trouver.
Il m’arrive de retourner lire d’anciens passages des Relevés. J’y relève des fautes, des imprécisions, des erreurs. Je ne les corrige pas. Ça donnera du grain à moudre.
J’ai lu Blanchot trop tôt.
« C’est le siècle des déportations, des exodes, des camps, des nettoyages ethniques, des grandes migrations qui se termine maintenant. Des millions de gens sont le rebut de la société, morituri. » — Paul Nizon, Chien.
Il y a un homme dans le métro qui m’observe. Parfois je les vois qui se branlent et m’observent, parfois qui me touchent et m’observent, parfois qui m’insultent et m’observent, parfois il y a un homme dans le métro qui, je le vois, me tue et m’observe. Il est là tout le long du trajet, il ne bouge pas, il détruit alentour, il ne s’en rend même plus compte ; il fait le carnage alentour à ne rien dire rien faire sinon se branler insulter, ou tuer. Ses paumes sont moites de la perversion et de l’insulte. Il est obsédé par mon fantasme. Il ne sait pas quoi faire de moi et envisage tout par-dessous. Il imagine que je puisse le faire exploser. Dans sa tête il doit y avoir son corps partout éparpillé, mille fois encore à chaque fois différemment en fonction de qui je suis, moi femme qui je suis sous l’habit. Ses mains moites de la perversion couvrent celles moites de la peur, de l’idiotie. Je pourrais l’habiller de noir et il serait alors enfant. Il doit s’aimer ainsi dans la souillure des odeurs et des corps masculins qui se branlent. Ils doivent se retrouver parfois le soir dans les ruelles pour se rouler dans une boue faite de crachats et de sperme. Ainsi évacuer toute la misère de leurs pauvres cerveaux. Je me dis que les hommes n’auront qu’un temps, mais qu’il aura pourtant été bien long. Que veut-il au juste, toujours là immobile en face. Que je me dénude. Qu’il puisse saisir enfin la peau de celle qu’il questionne, qu’il branle déjà dans ses immondes rêves ; que je lui appartienne. Il doit imaginer pouvoir me sauver. De ce qui pourtant me libère. Il est empêché. À travers lui, tous les hommes partout assis en face de femmes sont empêchés. Il y a une victoire. Il s’agite, sort de la rame en urgence. Il est déjà mort. Hors la rame, pour lui, c’est une zone d’irrespect. Il y a un homme dans le métro qui m’observait et qui a perdu. Je suis toujours debout, dans mon coin de la rame, et j’attends tranquillement que le tunnel s’achève ; qu’après le noir, il y ait un quai, où seule je puisse descendre, où tous les hommes seront jugés.
À mon oncle qui, il y a peu, niait la douleur, la souffrance face à ce monde en guerre, qui opposait à la sensation humaine une rigueur mathématique, tel pourcentage de pays face aux bombes, tel pourcentage de viols, tel pourcentage de massacres, de ruines, aussi de dire : vois comme on a jamais autant été en paix, aussi d’affirmer : nos chefs d’état font ce qu’ils peuvent, aussi de dire : ce que tu ressens n’est pas réel ; aujourd’hui j’aimerais lui dire :
Alors, Pierre, est-ce assez de guerre pour toi ?
Quand on voit, après les scores du premier tour de ces régionales, la distance entre le Front National et ce qui pourrait être une réelle, au moins possible, alternative (à savoir les communistes ou les écologistes), on constate à quel point le chemin va être long contre l’occultisme, contre la terreur. À quel point il va falloir se battre, si on ne désire pas souffrir infiniment dans le marasme combiné de l’UMP et du PS, si on ne désire pas s’embourber ainsi pour rôtir dans une prochaine fournaise politique abjecte.
« Même si j’ai besoin encore et toujours besoin d’un amour de mère, et que je sais qu’il y en a dans toute femme amoureuse, c’est d’amour femme-homme que je rêve, de passion et de pacification. » — Pierre Guyotat, Arrière-fond.
Il y a quelqu’un chez moi quand je pars, qui ferme mes portes, brosse mes dents, lisse le bord de mes draps, quelqu’un qui se couche dans le creux laissé, mange les légumes moisis et réceptionne mon courrier. Si vous sonnez il vous répondra de ma voix, vous dira les mêmes mots, que vous prendrez pour vrais. Vous pourrez l’inviter à boire un verre, en terrasse il renversera les tables, poignardera les gens, il gardera le sourire, vous le trouverez aimable, à tous vos compliments il dira merci. Il écrira sur vos joues avec une craie noire, et elles garderont la trace de son passage. Vous le cotoierez des années, le temps que je revienne ; parfois le retour prend le temps d’une vie, et on ne me retrouve qu’après ma mort. Parfois il y a quelqu’un à ma place toute ma vie, et sur lui repose le travail de me faire oublier. Il ira aux fêtes. Depuis l’adolescence il va aux fêtes. C’est lui qui a emmagasiné toutes les moqueries, tous les rejets, toute la tristesse des enfants. Il a appris. La frontière est de plus en plus mince. Elle crèvera un jour. Tout se déversera sur vous, tout son corps s’ouvrira sur votre incompréhension, toute sa répugnante colère colera à vos vêtements, massacrera le coeur. Ça ne sera pas moi. Mais vous pourriez le penser.
Sur trois tiges de fer plantées, un drap blanc se couche à mesure que le vent souffle.
Il y a entre Dinan et Corseul, Corseul et Plancoët, Plancoët et Pluduno, Pluduno et St Potan, St Potan et Matignon, sur ces routes départementales quelconque, quelque chose de l’infini de mon enfance, de l’éternel figement de mon enfance, dans toutes ces bâtisses anonymes croisées, dans tous ces arbres plantés, puis abattus, puis remplacés, dans chaque trou de la chaussée, dans la vitesse elle-même, dans les ralentissements identiques, aux abords des églises, figé dans la cohue des centre-villes, où circulent divers inconnus de la boulangerie au parc, du coiffeur au pressing, de vieilles dames aux seuils de leurs pavillons, de vieux garages encombrés de carcasses. Il y a quelque chose de ma vie toute entière, d’après ma vie même, d’après la simple présence, d’après le mouvement. Quelque chose du monde qui nous a bercés, enveloppés, que nous n’avons jamais remercié, mais qui nous a fait enfant, enfant puis homme toujours loin, toujours seulement étranger, toujours, malheureusement, dans l’au revoir d’une main, passé par ici.
Je rentre d’une semaine de travail à Paris. Durant cette semaine, j’ai lu Explications de Guyotat, et presque achevé Arrière-fond. Chez moi, je découvre une lettre de Guillaume, dans laquelle se trouve Joyeux animaux de la misère. Il y a parfois de ces coïncidences.
D’abord dans la ville, je ne fais pas tellement attention aux autres véhicules que je croise. Je roule largement au-dessus des limites autorisées. Je provoque d’énormes collisions. J’évite les autres en montant sur les trottoirs. Je ne manque pas d’écraser de nombreux passants. La police est encore une fois alertée. J’arrive sur un pont, percute une voiture de plein fouet, manque passer par-dessus la rambarde de sécurité, puis poursuis malgré tout sur l’autoroute. Il manque la portière passager. Le pare-brise est éclaté. Je parviens à semer les véhicules de police. Il n’y a aucun barrage. La voiture fume. L’autoroute est bordée de montagnes, et sur les montagnes on aperçoit des sapins. Je prends la première route qui se présente à la perpendiculaire de l’autoroute, qui grimpe à flan de montagne, serpente entre les sapins. Arrivé au sommet, je descends de la voiture qui, à peine ai-je fait quelques mètres, explose. Les flammes aussitôt disparaissent. La carcasse devient noire. Elle aussi enfin disparaît.
(Il faut se lever, il faut continuer à dire, il faut continuer à protester, le pire c’est de se laisser endormir, de se laisser faire, d’accepter qu’on puisse ne plus manifester mais qu’on puisse toujours consommer dans des magasins à cinq étages bondés et complètement étriqués, le pire c’est de dire oui, de se plier aux semelles des bottes, de lécher le cuir des même bottes, il faut accepter qu’une bougie puisse devenir une arme, car elle agresse dans son symbole comme dans son poids une même terreur oppressive, il faut toujours douter, toujours alarmer, toujours crier par-dessus les sirènes, toujours dire à nos représentants : c’est notre voix que vous devez faire entendre mais dans vos bouches nous n’entendons que du malheur, toujours dire à nos représentants : redoutez le soulèvement sachez qui vous a mis sur votre trône, toujours dire à nos représentants : vous lècherez nos bottes aussi un jour, toujours dire à nos représentants : tremblez, voici le peuple.)
Le lendemain, je suis en train de marcher dans la rue. Je ne me souviens plus où je vais. Je marche ainsi plusieurs mètres sur le trottoir d’une longue avenue, cours parfois, croise des passants, ne reconnais personne. Mon téléphone sonne, que je décroche à la première sonnerie. Un homme me dit : J’espère que vous ne m’avez pas oublié, puis raccroche. Alors que je répondais au téléphone, sans m’en rendre compte, je me suis déporté sur la chaussée, où une voiture a manqué de me rentrer dedans. Plutôt que de m’excuser, j’insulte le conducteur, et continue à courir sur la chaussée, en sens inverse, provoquant un véritable enfer routier. Les camions s’encastrent dans les lampadaires, renversent des passants, le carrefour est encombré de voitures toutes les unes sur les autres, qui explosent alors, et alertent la police. Je cours toujours, comme si je savais où j’allais. Je n’en sais rien. J’emprunte une ruelle puis attend là debout que les sirènes de la police disparaissent. Elles se taisent complètement et subitement après plusieurs minutes. Sans aucune discrétion, je retourne alors sur le trottoir de l’avenue, me retourne vers l’endroit du carnage : il n’y a plus rien.
Il fait beau. Le ciel est bleu d’un bleu uniforme. Je sais qu’il fait beau car je suis en chemise, une chemise d’un bleu uniforme, mais à la teinte plus claire que celle du ciel ; ce qui évite sans doute aux autres passants de confondre mon buste avec le ciel quand ils me voient arriver ou partir à l’horizon. Il fait beau mais pas chaud. Je veux dire : je ne ressens aucune chaleur. Je cours toujours à intervalles réguliers. Je bouscule énormément de passants pendant ma course qui, tous, au mieux m’insultent, au pire me menacent. N’étant pas particulièrement endurant, je dois me reposer en marchant avant de pouvoir courir à nouveau. La ville semble vaste. Il y a de nombreux immeubles, la circulation est dense. Soudain, je m’approche d’une voiture en train de rouler sur la chaussée, et me place devant le capot. Une fois la voiture immobilisée, je me dirige vers la portière du conducteur, ouvre cette portière, et éjecte d’un bond le conducteur jusque sur la chaussée. Je constate alors ma force véritable. Le conducteur mécontent proteste et commence alors à me battre avec ses poings. J’esquive le combat, monte dans la voiture, et démarre aussitôt sans oublier de rouler au passage sur son ancien propriétaire. La radio ne fonctionne pas. Je ne sais toujours pas où je vais.
Il y a des grenades à mettre dans des bouches, de la fumée à mettre dans des bouches, de la cire à mettre dans des bouches, il y a des barrières à mettre sur des hommes, des matraques à mettre sur des visages, des casques à enlever des visages, des casques à mettre sur les visages de ceux qui matraquent, et qui ont la bouche pleine de fumée et de grenades, il y a du sel à mettre sur les plaies, et des grenades dans les plaies, les bouches devenues plaies, il y a des choses qui valent d’être défendues, mais je ne sais plus lesquelles.
Dans Une forêt profonde et bleue, de Marc Graciano, un passage fait mention d’un mège qui, après avoir dessiné à l’encre des astres sur la peau d’une jeune femme, joue de la flûte pour les faire sortir de cette peau, et alors les astres se mettent à tournoyer dans leur minuscule système spatial autour des deux personnages : un soleil flamboyant, des planètes, des nébuleuses, des satellites, puis tout s’échappe par une fenêtre, et retourne au ciel. Voilà de la magie.
Depuis ce matin, j’ai une oreille complètement bouchée. C’est comme si j’entendais l’intérieur de mon crâne, de ma mâchoire.
« On sent que nous sommes nombreux, on sent combien nous sommes et comment nourris. À chaque pas on marche sur du verre brisé et des choses molles, on glisse, on respire l’haleine des autres, on se salit en touchant les murs, plus rien n’est à sa place. » — Eugène Savitzkaya, La folie originelle.
L’incendie avait pris la brousse, frottait les talons ; il s’agissait de fuir mais les flammes fuyaient bien plus encore ; les cendres couchaient sur nos cheveux le drame prochain, la lave s’éboulait alentour, écorchait, les falaises érodaient c’était caillasse par-dessus charbon par-dessous ; les flèches grimpaient les troncs, éclataient la canopée en feux d’artifice, le décor sombrait, nos pas pris dans ce décor-là même, encore partout identique, eux aussi sombrants, du ciel rien que du noir, et l’affreuse consomption des flammes, les alarmes soudain, le bleu diffus, le premier d’entre nous à tomber, qu’un instant dans le regard du dernier avant d’y passer à son tour, je laisse au risque le soin de dresser le reste — des charpies calcinées, plusieurs heures ensuite de silence, puis l’officier pose les genoux à terre, passe les mains au sol, ramasse du même coup terre, cendres, braises, miettes de corps.
« Il s’avéra que je n’écrivais pas pour chercher du plaisir, au contraire, il s’avéra qu’en écrivant, je cherchais la souffrance la plus aiguë possible, à la limite de l’insupportable, vraisemblablement parce que la souffrance est la vérité, quant à savoir ce qu’est la vérité, écrivis-je, la réponse est simple : la vérité est ce qui me consume, écrivis-je. » — Imre Kertész, Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas.
C’est dans la boue que la botte trempe, dans la boue depuis longtemps stagnante là, à même la terre battue de la ferme ; les feuilles abondent le pétrichor, la botte trempée, vide, remplie moitié de la boue, moitié des feuilles, botte laissée là en prise avec la terre, déjà presque fossilisée, oubliée, vaporeuse ; le corps est étendu dans le prolongement, sur la terre encore dure, la terre encore non tout à fait salie par la pluie, qui tombe et trempe, le corps, la terre, la mare d’eau où trempe la botte encore, pleine de gravas ; le sang bientôt relie jusqu’à la flaque, faite de la terre d’argile et suit les rigoles forgées par le renfoncement infime des gouttes, coule, jusqu’à la botte bientôt, jusqu’à l’eau brune mêlée de feuilles, colore l’eau brune de rouge, de noir ; l’homme se tient à califourchon sur le corps inconscient, son poing fermé, dedans la paille dans la bouche, le poing ferme dans la bouche de paille, de terre, d’eau, de paille salie de la boue, et le parfum n’a plus rien du pétrichor, sent la vieille poudre de talc, la main de paille la terre de pétrichor le cou de talc, le visage crevé reposé dans la boue, le front éclaté, la paille embouché dans le creux de bouche, et l’homme assis maintenant à côté cul dans la mare de sang et de bave et de boue lève la tête la bouche fermée, crie.
je reçois un appel on me dit : troue matraque je m’y emploie
la ville est définitive elle ne peut pas être altérée ni détruite ni construite ni rien elle demeure et toujours les rues auront la même allure les plages le même nombre de grains les trottoirs les mêmes fractures dans le goudron la ville est définitive et c’est la seule
il suffit de s’éloigner de deux rues pour qu’on lampadaire disparu revienne
là où l’appel m’envoie personne ne m’attend des types transportent des bidons tant que je ne troue pas ils ne réagissent pas soudainement je troue alors ils s’agitent ils sont déjà tous morts j’appelle je dis : c’est fait les morts disparaissent et je gagne quelques billets de quoi m’acheter une voiture de course
je la fracasserai bientôt contre un mur
elle réapparaitra le lendemain dans mon garage
(Idée : me trotte vraiment dans la tête le projet d’un roman se passant dans le cadre d’un jeu vidéo type GTA. Le héros mènerait une enquête policière, mais serait confronté à toutes les logiques internes au jeu vidéo – arsenal dément, corps qui se volatilisent une fois morts, textures foireuses des paysages, pauvreté des couleurs, ultraviolence et absurdité des actions, toutes conçues pour accomplir des missions mais n’allant jamais au-delà, limites du monde pré-conçu. J’ai encore des lacunes sur la façon de dire, mais il y a quelque chose à faire.)
Dans Le Temps scellé, Tarkosvki constate à quel point le matériel a vaincu le spirituel : « […] nous sommes les témoins du dépérissement du spirituel, alors que la matériel a depuis longtemps formé son propre système organique, qui est même devenu le fondement de notre vie sclérosée et menacée de paralysie ». À la fin de la première prise de parole de Saccage, le narrateur-carcasse se poste au sommet d’un phare et, dans la nuit, est confronté à son propre reflet, reflet l’empêchant de rien voir du paysage, du monde. Manière de dire : il n’y a plus rien ici pour nous.
Ma grand-mère m’avait donné un plat en terre cuite dont elle se servait pour cuisiner des gratins, de pâtes, de chou-fleur, ou de pomme de terre. Je ne m’en servais pas souvent, mais, tout comme la poêle à jardinière, il représentait quelque chose de mon enfance. Je possède très peu d’objets, mais tiens à tous avec une infinie précaution. Ce qui d’ailleurs explique en grande partie mon égoïsme matériel : je veux être seul responsable au cas où quelque chose arrive. Je veux être celui qui endosse la destruction ; c’est trop important, trop essentiel, pour qu’il en soit autrement.
Alice a utilisé ce plat sans mon autorisation, l’a emmené chez ses parents, puis il s’est fêlé et brisé après le repas, à l’instant de le plonger dans l’eau chaude. Il se serait sans doute brisé de la même façon peu après entre mes mains, mais je ne peux m’empêcher d’avoir de la colère, du ressentiment, envers elle, eux, d’avoir cassé quelque chose de moi. Puis de l’avoir jeté. Il ne tient qu’à moi d’agir sur ce que je veux conserver ou non de ces fragments de ma vie passée. Il y a déjà si peu à subsister. Les bâtiments s’effondrent, les champs se peuplent, on revient après trois ans et les visages sont de cire. Que l’on nous laisse au moins jouer sagement avec nos figurines, les démembrer quand bon nous semble, les détruire quand elles ne sont plus rien.
Ils m’ont racheté un nouveau plat, en verre, assez quelconque, dans un supermarché voisin sans doute. Je ne sais pas trop à quoi il peut servir. Cuire des choses ?
« Car l’artiste véritable est toujours au service de l’immortalité. Il essaie d’immortaliser le monde et l’homme qui l’habite. L’artiste qui n’aspire pas à la vérité absolue, qui se détourne de son dessein universel au profit du particulier, se condamne à une gloire rien qu’éphémère. » — Andreï Tarkovski, Le Temps scellé.
à cause de la distance le ciel vire rouge ce que je vois avance plutôt défile autour les passants m’ignorent je les fracasse je les troue les passants n’ont pas de trous ils sont sur le sol ils n’ont aucune marque ils sont mitraillés ils n’ont aucune marque ils sont martelés ils n’ont aucune marque leur corps est trempé de sang le trottoir dessous fait une marque il y a des décalages dans les caniveaux leur tête rentre moitié dans le bitume le corps est disloqué s’il tombe mais fusillé il tombe il ne se disloque pas il se couche puis il disparait
personne ne secourt qui meurt mais un coup mal placé et immédiatement la riposte à savoir les vieilles parfois ont des fusils à pompe dans leurs sacs la malchance sinon certains font des arts martiaux sinon au poing ça se finit au poing on a toujours une arme sur soi ça se finit jamais au poing ça finit toujours le passant tabassé troué mitraillé sur le sol puis qui disparait
les taches de sang rondes et uniformes posées sur le sol aussi disparaissent
la ville défile le ciel est rouge un rouge uniforme qui symbolise le crépuscule bientôt le ciel sera noir d’un noir qui symbolise la nuit si je prends une voiture je peux tout faire défiler plus vite et faire monter des putes qui sortent ensuite je peux tuer les putes si je veux je peux les baiser dans la voiture puis les tuer en leur roulant dessus et elles disparaissent
tous les morts et toutes les traces des morts disparaissent
il n’y a jamais d’enterrement mais il y a un cimetière on peut défoncer la grille d’entrée si la voiture passe on peut rouler sur les tombes sinon si la voiture passe pas on prend une moto de course et on roule sur les tombes et on roule aussi sur les passants et on peut se servir du uzi en même temps qu’on roule on écrase on mitraille les morts s’écroulent puis disparaissent et peut-être se retrouvent dans les tombes de ceux qu’ils venaient prier
si les passants sont importants je gagne des billets après les avoir éclatés au marteau et de vieux cowboys à moustache me donnent rendez-vous dans leurs limousines
souvent les vieux cowboys à moustache je finis par les mitrailler puis ils disparaissent et je gagne encore davantage de billets
les lampadaires défoncés aussi disparaissent
les forêts de bouleaux j’y vais parfois on ne croise personne pareil dans l’eau personne ne nage l’eau on dirait du plastique sous l’eau les algues on dirait du plastique il n’y a pas de poissons si on nage trop loin on finit bloqué je passe à travers les arbres les feuillages le plus dur c’est ne rien faire c’est vivre ce n’est pas possible je suis le seul qui toujours reste
si je me jette dans un ravin aussitôt je reviens impossible de disparaître
si quelqu’un me mitraille me matraque je reviens impossible de disparaître
ni le suicide ni le meurtre ne me font disparaître dans la forêt il n’y a rien à faire même nu je vis même mort je vis même noyé je vis même les tanks de l’armée sur mon corps plusieurs fois je vis à quoi bon quoi faire quelle issue peut-être suis-je le christ
La difficulté, c’est de ne pas raconter qu’une histoire. De mêler, dans la trame qu’on se fixe (et qui est souvent secondaire, car elle vient d’incidents hasardeux ou de lubies idiotes), ce qui forge la douleur, le gouffre.
Trop souvent, on récite là ce qui nous semble être intéressant, qui passe dans la rue, qui raconte quoi, dans quel trou on l’enterre, et puis on se détourne de l’action, et c’est déjà fini, et on a rien dit. Ou à l’inverse, on s’enfonce dans l’obscur, soi seul avec ses soi-disantes illuminations, avec pas grand chose en fait, deux trois ampoules qui nous éclatent entre les doigts, et qu’on expose malgré tout faute d’un autre montant auquel les accrocher.
Écoutons la hantise de ce voisin en rupture au bord du puits, marchons sur les doigts du mendiant qui réclame, déchirons ce qui reste d’honnêtes gens en lambeaux ; inoculons tous nos virus dans les corps inoffensifs de ces chers passants que l’on tue. Arrêtons les apitoiements, les témoignages, les compte-rendus. Faisons de l’anecdote poussière. Soyons plus tordus que ça.
Les jours de la zone n’ont rien à voir avec ceux du quartier. Les étrangers sortent des hangars, reprennent leurs voitures, et filent aux extrémités de l’unique route. Les riverains arrivent alors, font leurs courses, achètent figurines et légumes pour leurs enfants. Pour accéder à la zone, les riverains empruntent un pont-levis moderne qui remplace l’ancien pont écroulé. Il est actionné par différents gardes qui se relaient. Ils le baissent le matin, le remontent le soir. Pour l’actionner, il n’y a qu’un bouton à activer, mais de multiples codes pour l’atteindre. Chaque garde connaît une partie du code. Les étrangers encore endormis entre les rayons des hangars le jour sont emprisonnés, puis exécutés. Ce sont d’autres gardes qui s’en occupent. En dehors de la zone il doit bien y avoir quelque chose, autre chose. Ces quartiers ne sont pas les seuls. Il doit y avoir d’autres ponts. Je pense.
L’autre guerre contemporaine, c’est celle de qui détient la parole, qui parle au nom de qui, qui se permet de parler au nom de qui, qui a le pouvoir de parler au nom de qui il n’est pas, surtout ; qui peut dire quoi, sous quelles conditions.
Vous pouvez lire cet article de Guillaume : Pièce par pièce, petite réflexion sur la littérature fragmentée. Un peu parce qu’il y parle de mon travail sur ces Relevés, et un peu aussi surtout principalement parce que c’est très intéressant.
« Dépouillé de ses prestiges imaginaires, de son aura romanesque, le voyage dans l’Arctique n’était plus un rêve enchanteur, mais un épouvantable cauchemar que ne pouvaient affronter ces pauvres créatures humaines, trop humaines. » — Jack London, L’appel de la forêt.
Est-ce que finalement, au bout des mots, il n’y a pas qu’un redoutable échec ?
La mémoire longe les trottoirs, les devantures de magasins fermés, de garages automobiles, devant ces façades en tôle et les néons derrière, toujours allumés malgré la nuit. Il y a des fougères de l’autre côté du rail, après les grillages, après l’énorme fossé qui lie la zone aux quartiers. La mémoire y tombe. Les voitures suivent une voie centrale qui dessert chaque enseigne. En sortent d’étranges hommes. Malgré la nuit ils sont là à franchir les seuils, et sous les lumières ils patientent. On peut s’approcher mais ils sont dissimulés parmi les rayons. On a du mal à comprendre. Les voitures sont arrêtées. Les lampadaires éteints. On bute tant la zone est détruite. Les fougères bougent et d’autres lumières dans le quartier rendent une autre chaleur. Il est impossible de s’approcher. Le pont a explosé. À la la place du pont, il y a une béance épouvantable. Certains s’y jettent. Le train leur passe dessus. Certains se jettent sur le train alors qu’il passe. Les cables les brûlent. Toujours le fossé. Toujours les lumières. Et toujours plus d’étrangers à venir habiter les rayons gelés de la zone.
Dans Survivance des lucioles, Georges Didi-Huberman cite cette phrase de Pasolini (1957) : [La télévision] non seulement ne concourt pas à élever le niveau culturel des couches inférieures, mais provoque chez elles le sentiment d’une infériorité presque angoissante. Me reviennent les paroles de Jean au téléphone : tu sais, quand j’étais jeune, la télévision, c’était pour nous une chance, on imaginait que ça changerait tout, que ça rendrait le monde meilleur. Et puis, je vois, la peur, la défiance, qui saisit ma grand-mère en observant à des kilomètres de chez elle se battre des personnes qu’elle ne côtoie même pas. À quel point elle peut haïr des fantômes. À quel point, aujourd’hui, la télévision tue l’homme en nous.
Après ma séance du Fils de Saul, j’ai marché jusqu’à la librairie en regardant mes pieds pour acheter Sortir du noir. J’ai vu, puis j’ai lu. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film admirable en tout point. Car atroce, car au-delà du réel, car guidé par l’ambition de mourir.
Il y a évidemment cette scène dans laquelle un prisonnier tente de prendre en photo les charniers de corps en feu à l’extérieur. La fumée très vite envahit l’espace, il n’est plus possible de rien voir, et il faut vite cacher l’appareil-photo sous peine de se faire exécuter par les gardes SS qui accourent. Cette fumée, c’est l’aveu de faiblesse du réel. C’est le voile automatique sur ce qui s’est passé, et qui ne peut être montré. Car il y a une incapacité totale du réel à faire sens. On vous dit : regarde ces cadavres ; mais vous ne voyez que des poupées. On vous dit : regarde ce brasier ; mais vous ne ressentez aucune chaleur.
L’esthétique fictionnelle peut fournir ce choc essentiel que le réel peine à provoquer.
Il y a ce sourire du héros à la fin, voyant un jeune enfant se présenter entre les portes de bois de la grange où les évadés dont il fait partie se cachent (pour peu de temps). Ce sourire me gêne. Il me fait penser au beau dimanche de Semprun, qui m’a toujours, lui aussi, gêné. Je ne saurais dire pourquoi moi je ne vois nulle part cette possibilité du sourire, de la joie, pourtant nécessaires, dans l’enfer. Je ne vois que toujours plus de corps traînés, de coups de poing contre les portes de fer, de flammes aux abords des forêts de bouleaux. Il ne reste que ça. Cette fascination du pire est abjecte, mais c’est la seule que j’entends. La ruine d’un esprit entièrement dompté par le désespoir.
Il y a cette fosse embrasée où tombent les corps abattus et qui n’a aucun équivalent.
Il faut cette direction, cette quête salutaire à l’intérieur du mal. Mais la mienne ne trouve aucune issue vers le ciel : elle se fige sous la dernière glace du plus profond des gouffres de la terre.
(Mathieu Arsenault a, pour son livre La vie littéraire, et comme Gracq en son temps, refusé un prix littéraire qui lui était attribué. Il s’en explique. Et résume du même coup un symptome très important de notre époque : Les médias de masse n’ont plus ni le temps de parler des œuvres, ni l’intérêt pour leur singularité, ni la patience pour le culturel en général, que fuient désormais les annonceurs.)
Je me suis retrouvé au milieu de la ville qui se construisait du même temps. Je ne connaissais pas la ville, mais une carte m’indiquait où je me trouvais, dans quelle rue, par rapport à quels blocs de bâtiments, ainsi que les points stratégiques utiles à mon existence : mon appartement, le bureau de mes employeurs, diverses stations essence, ou encore les cabines téléphoniques. Je me suis très vite rendu compte de ma faculté à faire apparaître, selon mon bon vouloir, des armes. Je n’en ai pas vu tout de suite l’utilité, mais en ai déduit qu’elles seraient sûrement pratiques à des moments cruciaux de mon existence. Qu’elles me donneraient même sans doute un avantage évident. À moins qu’en face aussi la plupart des hommes soient armés. Auquel cas, elles seraient uniquement salutaires.
La ville est faite essentiellement d’immeubles, et les passants ne parlent pas. Les immeubles au loin ne sont pas visibles, non à cause des autres immeubles qui pourraient les cacher, mais tout simplement parce qu’ils n’existent pas tant que je ne me suis pas assez approché. C’est un défaut de la ville. C’est pour éviter qu’elle ne soit trop lourde. Il est impossible de parler aux personnes que l’on croise, mais on peut les frapper. Quand on les frappe, ils se défendent ou s’enfuient, et si personne n’intervient, quelqu’un meurt. Si on tue trop de passants d’un coup, la police intervient, puis les services secrets, puis l’armée. Il faut alors fuir et attendre dans une cachette qu’ils se lassent. On peut bien évidemment se défendre, mais c’est difficile de l’emporter puisque les soldats arrivent à l’infini. À force de m’occuper l’esprit, je ne me suis pas rendu compte d’où je me trouvais : devant le bureau de mon employeur. J’entre. C’est la première étape.
« Sans doute l’homme a-t-il besoin de temps à autre de pénétrer dans d’autres mondes pour ne pas se sentir prisonnier de sa vallée de larmes. » — Vassili Golovanov, Espace et labyrinthes.
Saccage paraîtra prochainement sous le titre Saccage.
Dans la brume on distingue mal les choses. C’est une des caractéristiques de la brume. La principale, sinon qu’elle est blanche, et légère. La nuit, en voiture, pleins phares, elle est épaisse, et dangereuse, mais il n’est pas question de voiture ici. Le matin la brume couvre les champs et fait germer le silence. Des sangliers passent qu’on observe, fendant à poil sec la marée. Si l’on passe soi-même à travers, on ne sent rien, mais sur nous germe quelque chose de tenace et d’indistinct. On nous voit parfois passer sur les sentiers qui bordent les champs, mais on ne nous arrête pas. On passe d’un bosquet l’autre. D’une brume l’autre. On retrouve hors les feuillages le paysage intact protégé par la brume. Puis on se retrouve après la brume. Et on ne reconnaît rien.
Au Havre, il serait drôle que le bâtiment qui porte le nom de Volcan entre un jour en éruption.
Parfois, quand je m’ennuie, je fais des expériences. Dans des fioles, ou dans des verres si les fioles sont sales, je verse des produits, et j’attends que les choses se passent. Les produits je préfère ne pas les détailler, sinon l’antiquaire m’en voudrait, et il ne me les vendrait plus. D’autant que lui-même serait incapable de me les détailler. Alors ça serait mentir. Parfois des fioles sort de la fumée, des cris, du noir, mais le plus souvent rien ne sort. Les produits se mélangent, ça fait des couleurs, mais rien n’arrive. C’est le risque. Des économies qui partent ainsi. On est peiné un peu, mais ça ne dure qu’un temps.
Il y a quelques jours, avec un certain mélange, j’ai fait apparaître ma femme. Elle n’est pas tout à fait à mon goût, mais c’est ma femme, alors je l’aime. Je l’ai aimée aussitôt, et sans consommer aucun produit, ce qui est plutôt rare, autant qu’insolite. L’antiquaire serait bien en peine de m’expliquer pourquoi les choses se sont passées ainsi. Ma femme est le résultat de plusieurs produits aujourd’hui écoulés chez l’antiquaire. Quand les voisins ont vu ma femme, ils ont tous été jaloux, et ont voulu avoir la même chez eux, mais ce n’était plus possible. Les plus téméraires ont même tenté de voler ma femme, mais elle les a tués. Ça fait partie du mélange.
J’ai toute une salle remplie de mes expériences. Il y a bien sûr ma femme, mais aussi divers animaux, un homme presque mon double, des jouets, quelques meubles. L’homme presque mon double je n’en parle pas sinon je me mets en colère. Je lui soupçonne des aventures avec ma femme. Ma femme ne le tue pas puisqu’il est presque mon double, et qu’elle doit se demander s’il n’est pas moi. Ce qui est légitime, puisque parfois moi-même je me le demande. Parfois presque mon double m’enferme dans la pièce avec ma femme et les autres expériences et il part faire sa vie de son côté. Il rentre toujours après une journée passée dehors, et me délivre à ce moment-là. De mon côté je profite de ma femme, et ça ne me dérange pas. Le temps passe vite.
La plupart des objets sont violents. Ils doivent être énervés que je les ai faits venir au monde. Je les comprends. L’homme presque mon double n’est pas violent car je lui laisse le champ libre de temps en temps. De plus en plus souvent, il est vrai. Un jour, je pense, je vais le payer de faire toutes ces expériences. L’antiquaire m’a déjà prévenu plus d’une fois. Mais je ne l’écoute pas, et il est tout de même bien content que je lui achète tous ces produits hors de prix. Il ne le dit pas, évidemment, mais il est bien content. L’antiquaire m’a dit que les expériences pourraient se retourner contre moi, et qu’alors je serais bien attrapé. Je n’ai pas peur. J’ai ma femme pour me défendre. À moins qu’elle ne soit celle de mon presque double.
(Elle est étrange cette vie que l’on mène à côté de la vie que l’on mène.)
Il avait placé là l’engin à mémoire, là face à celui voyeur et menteur, lui-même donc, mal centré sur une chaise délabrée. Il a mimé la nuit sur fond vert. Il a détouré la nuit sur fond vert la tristesse simulée de lui-même homme menteur, voyeur. Il a découpé sa silhouette d’ombre parfaitement distincte, où ne parlait que l’imposteur à dessein de reconstitution, en somme, avec le plan déjà parfaitement établi de se placer là où il retrouverait qui depuis des années était parti, l’avait abandonné, volontairement (il le pense). Il est là, dans l’écran suivant, toujours découpé, tranché du décor, flottant dans le noir, bavard, à reproduire cette scène que déjà il revoit, qu’il conserve toujours, sur une autre bande, cachée elle aussi, mais qu’il s’apprête à sortir. Il se gomme enfant, bien sûr les choses seront imparfaites aux bordures, mais la mère qui parle à ce fils qui joue, qui parle à ce père décédé depuis, tout comme la mère, se souvient-il (il avait oublié). Il ne reste qu’un trou en face duquel ses parents parlent, dans lequel depuis ils se sont jetés, quelqu’un les a, croit-il. Entre son image détourée et la béance d’une scène dans le jardin, rien ne lie, sinon son travail forcé de collage pour mettre là, coincer là, retrouver là, l’homme-enfant depuis toujours oublié. Alors le bavardage inutile devant l’engin à mémoire enfin prend sens quand, à nouveau lui face aux deux créateurs disparus, il s’exprime et impose à l’image son étrange souvenir.
il se trouve qu’on pourrait se placer de l’autre côté puisqu’il n’a pas retourné l’écran de sa caméra se placer là où lui ne voit rien et le regarder ne pas se voir maladroit le corps bordé d’icones et la batterie bientôt déchargée rien d’autre en soi que la prochaine extinction de qui le capte et qu’on serait bien avisé de suivre pour ne plus avoir à supporter la vision de ce triste assis déblatérant
Dans À notre humanité, je lis : « Les pratiques utilisées par les armées coloniales étaient d’une violence extrême : massacres de civils, mutilations de prisonniers, saccage systématique des territoires. Les répressions de mai 1871 furent un carnage de masse. La classe ouvrière fut réduite de moitié. » Je retrouve ainsi un peu de mon propre texte partout.
L’ardeur au travail se joue sur une légère douleur à la nuque ou dans la lumière d’une ampoule trop vive. Idem pour la lecture.
« Les oiseaux se sont taillé leur propre espace au milieu des fumées de la ville en flammes. Les flèches de leurs trilles s’enroulent autour des obus et désignent une région préservée du ciel. » — Mahmoud Darwich, Une mémoire pour l’oubli.
Tout de même, me dis-je, l’humanité sera bien plus vivable quand nous serons tous morts.
Ce que je tente de saisir, à travers la lecture, c’est une clameur. Ce n’est pas la vérité, ce n’est pas l’Histoire, mais c’est la vision d’une colère unique. L’angle mort de chacun qui reconstruit ce qu’on pourrait estimer être le réel. Qui n’est en fait rien, comme ne sont rien les choses vues quand on ouvre la porte qui donne sur la rue. J’invente par le biais des autres un monde qui me sied. Et dans lequel il y a bien plus de richesses que partout ailleurs.
Comprendra-t-on seulement jamais le monde dans lequel on vit ?
Tellement lâche, que je baisse les yeux devant mon propre visage.
Même là, depuis le salon, on entend les canons des fusils détonner au loin. Après, les chiens aboient. Qui s’aventure alentour risque le plomb, oiseaux bien sûr, proies évidentes, mais de même hommes, passants, cyclistes distraits aussitôt écharpés, affalés dans la fosse, le sang à salir les fougères, et achevés peu après pour ne pas faire de vagues. À l’arrière d’un jardin, une colonne de fumée alerte la police. Sur les lieux, elle ne voit que débris, et sans soupçonner le monticule de cadavres calcinés, s’attable autour d’une liqueur et converse du bal à venir avec les chasseurs ; les mains encore crasses de terre et de viande.
En ligne, je lis les premières pages d’un premier roman apparamment prometteur. Page une : voire même. Je ferme la page.
Je tente toujours de m’améliorer, de persévérer.
« Tous regrets étouffés tâche acceptée recomposer contre l’angoisse d’où qu’elle vienne ce rêve inoublié pour finalement le laisser bien loin vieux plafond chargé d’oiseaux et de fleurs dans le goût d’autrefois et progresser vers l’inaccessible sans repères sans ratures sans notes d’aucune sorte insaisissable mais là auquel croire sous peine de ne jamais mourir. » — Robert Pinget, Cette voix.
J’ai regardé hier la captation vidéo d’une conférence qu’a donné Christine Angot à la librairie Mollat. J’ai été frappé par la banalité totale de ses propos (qui rejoint celle de ses livres ; pour preuve la scène de l’entrecôte dans son dernier texte). Mais ce qui frappe d’autant plus, c’est l’apparente profondeur qu’elle met dans ses gestes et sa parole alors même qu’elle déclame ces banalités. Une lenteur, une emphase, un découpage accentué, qui font mine de donner du poids à ce qui n’est que rien. On dirait de la psychologie de bas étage. J’imagine aisément le public acquiescer de contement, pénétré par ces hautes paroles de l’autrice invitée (il faudrait trouver une variante féminine au grantécrivain).
À mon sens, elle fait partie de cette communauté d’auteurs ne faisant vivre leurs livres que grâce à la communication autour, à la parole. Là où normalement il faudrait se taire, ils occupent l’espace le plus possible, ils s’étalent au maximum ; tentent de masquer le vide. Le livre n’a l’importance que de sa visibilité. Ôtez les projecteurs, et il a disparu. Jusqu’à la prochaine relève, faite des mêmes néons.
C’est une évidence : tant que je n’aurai pas trouvé pas voix, je ne connaitrai pas mon identité.
Je lis (dans La question religieuse au XXIe siècle) : Dans l’Angleterre d’Elizabeth, on éventra des martyrs catholiques encore vivants pour leur arracher le coeur et les viscères ; une femme qui avait caché un prêtre fut écrasée sous des planches qu’on recouvrit de grosses pierres. En Vivarais, vers 1579, les protestants enfermèrent des catholiques dans des clochers et les y laissèrent mourir de faim ; des enfants furent mis en broche et rôtis en présence de leurs pères et mères.
Que de réjouissances !
Mon père est venu tronçonner la haie qui encadrait le barbecue, chez ma grand-mère, dans le jardin. Depuis, il y a un trou, et derrière ce trou, une autre haie, celle qui délimite l’arrière de la propriété. Si on tronçonnait également cette haie, depuis la baie-vitrée, on verrait le champ, aujourd’hui fraîchement moissonné. Le champ ne cache rien. Mais ensuite il y a le talus, et si on supprimait le talus, on verrait le verger, après le verger encore un champ, puis la route nationale en direction de Lamballe, un fossé, un autre talus, un autre champ, encore, surement une ferme sur le chemin, toujours à tronçonner, à couper, à ôter pour voir derrière, mais jusqu’où ainsi ?
« Dans tes histoires des fois tonton on voit un vieux bonhomme qui monte dans les collines grises qui c’est ?
Je ne sais pas. Il ne m’a rien dit. Je le vois toujours de dos, jamais sa figure, il s’éloigne, il marche lentement, il n’arrivera jamais nulle part puisque je le revois chaque fois au même endroit en train de s’éloigner.
Mais tu le vois où ?
Dans ma tête. » — Robert Pinget, Théo ou Le temps neuf.
Ce qu’on cherche, je crois, par-dessus tout, ce n’est pas tant à dépasser le réel, mais de parvenir à dire ce qu’il y a entre soi et la chose vue.
À la télévision, un journaliste dit : il y a une mutinerie dans la prison à quelques kilomètres d’ici, plusieurs foyers d’incendie détectés, quarante personnes impliquées, etc. Je me dis : ça commence. Mais en réalité : rien ne commence.
Je retrouve dans la littérature africaine la plupart de mes propres obsessions : emprisonnement, frontières, gardes insensibles, violences sans nom, fuites, exils, sauvagerie, bêtes, etc. Les proximités imaginaires sont souvent bien loin de nos ruelles bétonnées.
Dommage qu’on ne vive tous pas plus dans la pénombre.
(Je voudrais m’éteindre devant le tronc sec d’un hêtre ; non face aux lumières blafardes de la tour Montparnasse.)
« La destruction des êtres ne signifie pas qu’ils sont partis ailleurs. Ils sont là, ils sont bien là : là dans les fleurs des champs, là dans la sève des bouleaux, là dans ce petit lac où reposent les cendres de milliers de morts. Lac, eau dormante qui exige de notre regard un qui-vive de chaque instant. Les roses déposées par les pèlerins à la surface de l’eau flottent encore et commencent de pourrir. Les grenouilles sautent de partout lorsque je m’approche du bord de l’eau. En dessous sont les cendres. » — Georges Didi-Huberman, Écorces.
Du ciel tombent des cordes, faut-il y grimper ou s’y pendre ?
Je malmène tant mon corps, il me le fera bien payer un jour.
Là se trouve qui, celui-là dit garde, gardien, maître aux enfers de la (depuis lors revenu des mythes) porte basique des véhicules à cendre. Passe ainsi là plus tard vide de peine, cet autre encore le même à ceci différent qu’il salue, range son char et sort la malle à contrats ; s’éparpillent sur le sol ; trempent dans la pisse d’un enfant moitié-nu perdu quelques instants plus tôt (jours). Il assiste au lent méandre, quand le spot laisse entrevoir dans sa lumière l’ombre derrière laquelle l’autre suce, des corps durs d’un sol identique : abîmé des multiples coups de pistons secoués. Et profite alors – on distingue derrière le flou et l’abrupt métamorphose de l’infrarouge – de tous ces fous las qui animent son multiplex morbide. Disons : indistinct, sans nom, il s’agite mais sort sous casquette invisible : sans mouvement les rues l’absorbent, le rejettent une fois sa porte passée ; derrière lui de toute façon déjà plus rien ne vit, ne meurt, n’attend. Appelons-le, sans nom. Gardien des derniers véhicules à cendre.
« Des garde-fous gauches du pont, la lagune aveuglait de multiples miroirs qui se cassaient et s’assemblaient jusqu’à la gerbe lointaine où des îlots et lisières de forêts s’encastraient dans l’horizon cendré. » — Ahmadou Kourouma, Les soleils des Indépendances.
Ma mère est passée voir mon père durant un salon de l’habitat. Il m’a dit qu’elle était malheureuse, semblait triste, regrettait l’évolution de notre relation. Je ne vois pas trop ce qu’il veut que j’y fasse.
Sebhan parle de polaroïds (et ils sont mêmes ajoutés au livre) pris dans la maison de la mère de Duvert, à Thoré-la-Rochette, juste après sa mort, par Duvert lui-même. Il voulait montrer à son frère (ou à lui-même ?) à quel point elle vivait dans la crasse, le dégoût, la folie. Une chambre et une cuisine encombrées de vieilles choses rances, bouteilles, flacons, cartons, draps moisis, électroménager hors d’usage, etc. Presque vivre dans une décharge. J’ai connu cette dégueulasserie là, enfant. Mon père et ma mère, après la mort de mon grand-père maternel (ou bien était-ce avant ?), étaient partis photographier la maison de ma grand-mère maternelle, laissée aux boites de médicaments, au linge sale, au capharnaüm. Ils avaient développé les clichés, et ensuite ils les montraient à leurs amis, pour dire à quel point ils avaient honte, à quel point cette pourriture allait loin. J’imagine ma grand-mère dans sa pataugeoire saumâtre, encore vivante aujourd’hui, croulant sous les monticules de vaisselle sale et autres programmes télé déchirés. Elle mérite bien ça.
Mais est-ce cela vivre : toucher au sublime par l’écriture puis finir moisi de l’intérieur, replié en chien de fusil sur un matelas humide, oublié de tous depuis un mois, infect, pourri, seul ?
Je lis Retour à Duvert. Duvert me fascine, depuis plusieurs années. Je me souviens encore, je lisais Le Voyageur dans le train de nuit qui m’emmenait, à Noël, chez Sylvie. Le choc profond qu’a été Paysage de fantaisie. Dans ma bibliothèque, des manques : quelques livres introuvables qui coûtent d’occasion une fortune (Les petits métiers à plus de 150€, Interdit de séjour même plus répertorié, et puis son minuscule essai sur Pinget). Il était purement sans concession. Il touchait l’intolérable de l’écriture, et s’y conformait, s’y engloutissait. Jusqu’au bout il a creusé son trou dans la terre, et au plus profond, comme tout le monde il a trouvé le noir, mais sur le chemin par moments il y avait autre chose pour lui que des détritus et de la boue. Il y avait cette matière inouïe indescriptible, seul refuge pour les rares sublimés du verbe.
Les Odinani, une tribu nigérianne, utilisent le terme ogbanje pour désigner un enfant mort qui hante sa mère et revient dans son ventre pour renaître indéfiniment. Afin de conjurer le sortilège, on mutile l’enfant en question. Parfois, la mutilation ne suffit pas, et l’enfant revient avec toutes ses cicatrices.
Certains hommes maudits, on allait les tuer dans la forêt.
(Toujours pour mon gardien de parking : il retrouve des cassettes réalisées par son grand-père alors qu’il est enfant — joue dans le jardin ; marche dans les bois ; fait de la balançoire ; prend le goûter avec des figurines ; etc. Il se filme lui, adulte, sur un fond vert dans diverses postures, puis s’incruste à la place de son image d’enfant. On voit cet espèce de monstre déformer tous ses souvenirs à force de nostalgie.)
« – Leur idiotie leur a coûté cher, dit Obierika. Mais j’ai très peur. On nous a raconté des histoires au sujet des hommes blancs qui fabriquaient des fusils puissants et des boissons fortes, et prenaient des esclaves pour les emporter à travers les mers, mais personne ne croyait que ces histoires étaient vraies. » — Chinua Achebe, Tout s’effondre.
Hier, je me suis acheté un sandwich sur l’heure de midi, et, sans savoir particulièrement pourquoi, je me suis installé dans le hall de la gare de Lyon pour le manger. J’aurais pu prendre un thé dans un bar quelconque à proximité (ils sont légion), mais j’ai préféré aller là où tous circulent, patientent. Je regardais sur le panneau d’affichage alors même que je ne prenais aucun train, que je n’attendais personne. J’ai espéré ne pas la croiser par hasard. Une fois mon repas fini, j’ai tout jeté à la poubelle, puis j’ai descendu les escalators, puis j’ai disparu.
Une idée, un dispositif (pour ne pas l’oublier) : un homme, gardien de parking la nuit, en sous-sol, vraiment en sous-sol, bizarrement en sous-sol. Obsédé par la vidéo-surveillance. A plusieurs dizaines d’écrans dans sa cabine. Enregistre tout. Se repasse chez lui les enregistrements. Fait des montages pour assouvir ses fantasmes. Creuse les repères entre chaque enregistrement. Accole des têtes de chien à des corps d’homme. Ouvre les ventres des femmes pour y glisser des phares. Bientôt disloque tellement l’image qu’elle s’ouvre sur une autre réalité, une autre fantaisie. Ne parvient plus à s’accomoder du réel. Veut refaire ses montages sur les personnes qu’il croise ? Glissement progressif de la représentation. Puis quoi ?
Un homme est attablé dans ce qui ressemble à une échoppe asiatique. Les lampions de papier ont cédé depuis le début de la tempête et roulent dans le caniveau. Les tables sont vides ; le serveur est parti s’oublier dans l’arrière-salle. Dehors, depuis le trottoir d’en face, on aperçoit cet homme seul, puis, entre lui et qui voit, l’eau. Bientôt l’eau s’accumule tant : qui voit ne peut plus, part. Il reste sans visage celui qui dit : l’homme est attablé dans cette échoppe. L’homme dans l’échoppe n’en aura plus pour longtemps avant d’avoir fini. Déjà sort son porte-feuille, dans lequel se trouve une lame. La plante dans qui revient vers lui, mais n’est pas le serveur ; s’écroule sur le carrelage (l’autre). L’homme attablé se tient peu de temps après sur le trottoir d’où celui qui disait regardait. Il voit à son tour sur le sol le tué, le serveur, l’un sur l’autre dans le secours de l’un, par rapport à l’autre : mort. Depuis le même endroit sur le trottoir, cinq minutes plus tard, un passant prendra la place du tueur, et verra les policiers trempés quadriller la scène. D’autres passeront encore à intervalles réguliers tous les jours ; l’un d’entre eux peut-être concerné par la scène, mais qu’on ne reconnaîtra plus. Que plus personne ne sera en mesure de. Non-coupable.
Au milieu d’une rue déserte, un étranger retire sur une borne détraquée de l’argent qui ne lui appartient pas ; son ami, sous sa capuche fermement serrée, la bouche tendue de scotch. L’un voit l’autre tirer l’argent sans pouvoir rien faire, sinon. Une fois le retrait effectué, non loin, une lame déjà vue entaille à de multiples reprises le ventre de celui qui ne peut dire : s’effondre alors le sang maintenu sous la langue. N’y est pour rien.
Dans les remous d’une rivière sale, un alligator finit de trancher la tête d’un corps inconnu.
Alors que j’envoie ma nouvelle version de Saccage, après une énième relecture, je me dis : c’est intenable, asphyxiant, qui lirait ça, moi-même à terme je n’en peux plus, c’est trop, ça dit trop, ça encombre trop, c’est délirant tellement c’est pourri jusqu’à l’os.
Je réfléchis encore au glitche. Je me dis que les déplacements, les glissements, qui ont pu être fait par Maupassant dans Le Horla ou Kafka dans La Métamorphose (parmi tant d’autres) ne sont pas très loin de cette sensation de rupture visuelle. Que ça ne tient pas tant au fantastique qu’à la rupture avec un état donné. On se regarde, et l’image tremble, se fissure, et quelque chose apparaît derrière que personne ne tolèrera. J’ai pourtant la sensation qu’une rupture supplémentaire à celle déjà créée a besoin de voir jour. Les débris. Quand Gregor Samsa devient blatte, rien ne demeure de son corps d’avant, qui se dissout lentement dans cette subite métamorphose. Le glitche, lui, laisse ce corps-là d’avant en charpie, sur le côté, mais toujours visible. Il ne s’agit pas tant de devenir que de s’étaler. Les aplats de ruines se superposent, de ces vieux cadavres qui sont nous, nous d’hier, toujours d’hier chaque jour davantage. Mille figures, mille paysages. À terme voilà qu’un ensemble inédit apparaît, parmi diverses peaux nues décharnées, où l’on croit reconnaître quelque chose : il s’agit de soi.
Petit éloge du père de famille que je massacre.
(Je n’avais jusque-là jamais eu peur de ne pouvoir continuer, n’ayant évidemment rien commencé. Pourtant cette question revient de plus en plus fréquemment : quoi faire ensuite ? Vers où diriger ma sensibilité ? Quelles situations voudrai-je encore dépeindre ? Il ne me vient rien ; rien encore.)
« Il faudrait décrire la sensation de s’abîmer au sens propre, de basculer dans l’abîme des cartes, qui sont toujours plus profondes, plus feuilletées, plus striées et plus stratifiées que ne le laisse penser leur infime épaisseur de papier. » — Emmanuel Ruben, Dans les ruines de la carte.
Trois fois rien sur Romain Verger. Après Fissions, je viens de finir Forêts noires, comme percée à rebrousse-temps de son oeuvre. L’infect du premier retrouve à égal l’étrange délicatesse du second. J’aime à l’extrême ses motifs. Ce que je voulais dire : son vocabulaire m’intrigue, m’obsède, à la fois ancré dans la boucle de certaines fureurs (sang, feuilles, chair, etc.) et de saillies plus exceptionnelles. C’est l’embardée dans le mot qui aussi provoque le malaise, autant que les situations. On se prend à trembler car quelque chose de notre compréhension, de notre intelligence, tremble à son tour ; tremble les mains sèches et la peau blanche. Une espèce d’érudition morbide doublée de paysages lugubres. Gracq en qui coulerait Lovecraft.
Quand vous ne vous sentez pas à votre place, partez. Trop de nuits je suis resté dans des maisons qui ne voulaient pas de moi, et les crampes au matin étaient si fortes que je me trouvais à ramper dans les flaques des rues mortes pour rentrer jusque chez moi.
« Maintenant vous ne ressemblez plus à rien, votre front est rongé par mille bouches obscures, vos yeux révulsés regardent les ténèbres à l’intérieur de votre crâne, vos dents noires de sang vont bientôt tomber. » — Mika Biermann, Booming.
Parfois dans la rue j’observe les gens et il se trouve qu’ils sont morts. C’est une sensation très désagréable. De ce que j’en sais, ils ne ressuscitent pas. Si je croise deux fois la même personne morte elle demeure morte. Pour l’instant je n’ai encore trouvé aucune solution pour inverser les choses. Je n’ai pas tellement cherché. Je ne sais pas par où commencer. Une fois les gens morts ils ne parlent plus et je me sens seul. J’ai comme envie de pleurer mais je me retiens pour ne pas indisposer ceux qui vivent encore une fois croisés. Évidemment, plus le temps passe et plus les gens meurent. Bientôt il ne restera plus personne. On se rend pas toujours compte. Une fois j’ai croisé mon père et je l’ai amèrement regretté. Je n’ai pas encore croisé mon fils. Sans doute parce qu’il n’est pas né. Plus tard, je pense que quelqu’un d’autre me croisera et que alors à mon tour je mourrai. Je mets un drap sur les têtes des personnes mortes. Ça fait comme des fantômes. Un temps je me suis amusé à couper des trous avec des ciseaux dans le drap au niveau de leurs yeux, mais très vite après j’ai commencé à avoir peur. J’avais l’impression qu’ils bougeaient. Je faisais des traits à la craie sur le sol pour voir s’ils avaient bougé. La plupart du temps ils n’avaient pas bougé, sauf si un coup de vent ou autre chose les avait poussés. Sinon, je travaille à l’usine. Après le travail, je rentre chez moi, et je m’installe avec un plateau-repas devant la télévision. Au journal télévisé, ils filment les gens morts. Ils leur posent des questions, auxquelles ils ne répondent pas. Quand je suis couché, juste avant de m’endormir, je pense à tous ces gens morts dans la rue sous les draps, et ça me fait bien rire tellement je trouve ça grotesque.
Rien n’arrive ensuite, rien ne se passe. Tout repart au néant.
« Le vol, parcours positif, est un essor ; il suit la voie du désir. Quand on abandonne la mélancolie, c’est cette voie qui s’ouvre devant soi. Et c’est là que surgit à nouveau la passion, prête à se lancer encore à la recherche de ce qui reste impensé. » — Joan W. Scott, De l’utilité du genre.
Je laisse reposer le texte, espérant y découvrir des paysages plus précis, dessinés. Mais il n’y a rien d’autre que d’immenses landes désertes ponctuées de trous d’obus.
J’ai une douleur persistante au niveau de la tempe. Je n’écris pas grand chose en ce moment. Je ne sais pas spécialement pourquoi. Non pas que je manque de temps. Mais comme si je manquais d’élan. Comme si je m’affaissais. Je crois que le risque c’est de s’affaisser toute sa vie et puis de mourir sans avoir rien fait. Des fois je m’imagine mort sans avoir rien fait mais ça ne me pousse pas davantage à écrire. C’est comme si je n’existais pas mais que tout allait bien quand même. Alors qu’il ne se passe rien. Alors que je n’invente pas. Alors que je laisse sombrer mon cerveau et ma sensibilité dans de vaines misères. Bien sûr on est pas loin de l’impuissance. De la laideur. Après l’écriture on essaye d’envisager : il y a quoi ? Mais on ne trouve rien. Alors on s’approche de la fosse et on comprend ce qui se passe. On comprend qu’après l’écriture il y a ce qui se trouve au fond de la fosse. Alors on retourne à l’écriture pour se détourner de la fosse. On sait que quand on sera trop fatigué de se détourner on se jettera dedans, et que quelqu’un d’autre alors à son tour, quand il sera trop fatigué de créer, nous regardera là. Puis que plus tard il nous rejoindra.
L’amitié c’est un désert à cause de la tolérance. On finit entouré d’imbéciles auxquels on n’ose rien dire et qui ne viennent même pas nous saluer le jour de notre enterrement.
Il y a un peu plus de vingt quatre ans, une mère m’a fait naître. Depuis, je tente de la retrouver.
Je lis L’insurrection qui vient et ils aimeraient qu’on s’entre-tue pour la liberté. Je suis pas trop convaincu. Je tirerais bien au lance-roquettes dans les airs pour voir sur qui ça retombe. Après on déciderait. (Il y a cette phrase quand même : remâcher du cadavre à force de se persuader que planter des carottes pourrait suffire à nous sortir de ce cauchemar.)
D’abord je lis (dans Une autre histoire de l’édition française) : Flammarion avait osé publier La France juive d’Édouard Drumont, en 1886, un pamphlet d’une violence inouïe dans laquelle le venimeux journaliste, ancien mouchard de la police sous l’Empire, transformait tous les Français d’origine étrangère en immgrés juifs prêts à tout pour dépecer la France.
Ensuite je me dis simplement : on vit toujours dans le même marasme social et éditorial.
Rien d’autre.
Après la disposition des gouttes sur ma fenêtre, ce qui peut ressembler à une ville ; prise par grand vent sur cyprès détruits et immeubles invisibles. Aussi une lumière qui n’a plus rien du soleil, là, étalée sur la grisaille, morbide presque davantage, les arbres morts petitement de l’automne, les toits d’ardoises des garages, les mares de saumure aux abords des plaques d’égoûts, puis des enfants nus qui sautent dedans ; les sirènes d’un fourgon de police. Une dernière plaie sur le jour, des piétons fuyants, l’impression de n’y être pour rien, et la chanson précise soudain de mes dimanche d’angoisse.
Ma voiture est encore en panne. La mécanique automobile est l’une des choses les plus épuisantes de la vie quotidienne. On y comprend rien ; ça arrive toujours au pire moment ; personne n’est capable de nous dépanner ; les garages sont hors de prix. Je n’ai besoin de ma voiture que pour des trajets exceptionnels, mais quand elle me lâche, je suis pris d’un énervement profond. Je me sens complètement démuni. Je ne suis pas fait pour cette vie matérielle.
« Ainsi soulignait-il le fait qu’un éditeur, au sens véritable du terme, devait être le serviteur d’une oeuvre et non son bourreau, quels qu’en fussent les risques encourus. » — Jean-Yves Mollier, Une autre histoire de l’édition française.
Dernière journée au Havre. La ville est sincèrement sans vie. De longs boulevards à angle droit ouverts au vent, et sur les places des bancs. Des immeubles construits à l’identique desquels on ne voit aucune tête dépasser. Une espèce d’énorme cheminée nucléaire sert de salle de spectacle. La mer est au niveau de la ville (c’est une vision particulière). La ville haute ; la ville basse ; un funiculaire entre. Après, les immenses grues, les containers. Il y a là comme un règne des machines. Je ne m’attarde pas.
Première soirée au Havre. La chambre d’hôtel est bien, hormis la ventilation qui bourdonne un peu trop fort. Aussi le réfrigérateur, mais j’ai pu le débrancher. J’ai marché vingt minutes pour aller manger, puis encore vingt minutes retour. La ville est étrange. Sans l’eau omniprésente, je me croirais dans une zone industrielle. C’est l’eau qui la sauve. Il y a des bâtiments, je ne comprends même pas ce qui se passe dedans ; c’est allumé la nuit pourtant il n’y a personne ; on dirait des bureaux ; sans enseigne. Mais c’est peut-être juste le positionnement de l’hôtel.
Je lis Macau. En lisant je me dis : fais attention à ne pas virer Volodine, c’est-à-dire à la cheville de Volodine, en gros quedalle. Je sais pas si je finirais pas vieux fantôme morbide, ridicule. J’ai peur de ça. Je me lis et j’ai peur de ça, profondément.
Mon impression, dans Saccage, est comme tout procède d’empilement. J’ai superposé le pire. On croit en avoir fini avec la terreur, et une autre terreur plus intense encore nous prend alors. Il n’y a aucune subtilité dans cet amoncellement, aucune intelligence : juste l’enfer.
Rendez-vous particulièrement intéressant vendredi dernier ; intimidant, pour plusieurs raisons : déjà, difficulté à parler de ce que j’ai écrit, où je me rends compte du mur à côté duquel j’avance (que je longe) ; ensuite, il y a deux hommes en face de moi qui savent de quoi ils parlent, et que moi non ; ensuite bis, évidemment il y a encore à travailler (je vois mal l’enthousiasme dans ce cas, je vois : le travail, et les défauts) ; ensuite ter, je ne sais pas parler, je bavarde et je raconte n’importe quoi sur la fin, je ne sais même pas pourquoi, je deviens chiant ; enfin, l’imminence me paralyse. Mais : de multiples lectures auxquelles je n’avais jamais pensé, une volonté renouvelée de renforcer ma qualité, de produire quelque chose, de faire beau, au moins là ; ils disent : le plus accessible (je me dis oui, évidemment, je ne fais rien d’incroyable).
Quand même, ce que je n’espérais jamais trouver : deux personnes sensibles, fines, et m’apparaissant sincèrement sympathiques.
Peut-être qu’enfin Saccage pour moi va devenir Saccage pour les autres, pour la foule (pour personne) ?
Depuis chez moi, et j’habite haut dans une tour, je vois un autre appartement. C’est si haut qu’en bas on confondrait un homme et un chien. C’est dire. Si je sors sur mon balcon, je peux voir aisément le balcon d’en face, de l’appartement pile en face de chez moi. C’est là qu’on se rend compte à quel point tout est construit à l’identique, de nos jours. Pour sûr, les villes sont moins jolies. Et puis c’est délicat pour le vis-à-vis. On a l’impression de se marcher dessus. La nuit, c’est intéressant, puisque à travers les rideaux, à cause de la lumière des plafonniers, on peut voir les ombres à l’intérieur. Je ne sais pas qui est qui mais je comprends qu’ils ont des conversations animées. Parfois il y a une ombre qui tape l’autre et je me dis que quand même c’est fort de se traiter ainsi. Je ne sais pas qui tape qui, sauf quand il y a une plus petite ombre et alors je comprends que c’est l’enfant. C’est tout proche et pourtant grâce au double vitrage aujourd’hui les appartements sont très bien isolés. C’est conçu pour ne rien entendre de l’intérieur, mais ça marche aussi parfaitement de l’extérieur. Je n’entends jamais rien des coups de chez eux. Heureusement, sinon j’irais me plaindre. D’autant que ça peut durer longtemps. On ne paye pas aussi cher pour supporter ça. On a déjà les tracas de la journée. Une fois, leur baie-vitrée était restée entrouverte et ça m’avait mis mal à l’aise d’entendre les bruits de chez eux. Je l’avais immédiatement signalé au voisin qui avait fermé la baie-vitrée avec un signe cordial de la main. On aura beau dire, il est sympathique. On sait se comprendre, entre voisins. Il sait bien lui aussi comme ça l’importunerait d’entendre ce qui se passe chez moi, la nuit, quand la lumière du plafonnier rend visibles les ombres de notre famille à travers mes rideaux.
Il y a des journées qui passent ainsi, à trop rien faire : lire jusque tard au lit, puis finalement se lever, attendre, lire un peu, ce que l’on supporte, manger sans trop d’entrain, faire de la compote (eau, sucre, pommes, cannelle), boire un thé, attendre, lire encore, attendre, le soir venu manger à nouveau, se coucher tard, lire, et demain arrive, et il n’y aura rien eu, mais ça aura existé.
Qui sera encore là quand votre corps souillera le sol ?
Mes hommage aux loups.
Au mur il y avait un tableau et la peinture avait coulé ; la peinture coulée formait un paysage ; à l’origine il s’agissait d’un portrait ; dans le paysage il y avait tous les traits de l’homme peint auparavant ; il était impossible de distinguer l’homme, pourtant, dans la peinture coulée ; il y avait des crevasses qui étaient sa douleur ; d’autres monts pour d’autres peines ; enfin il aurait été possible de tout reconstituer ; mais l’homme s’était perdu dans le reste ; et la peinture bientôt coulerait à nouveau ; ne laisserait plus qu’une surface blanche ; des flaques sur le sol ; et le visage détruit de l’homme quelque part entre ces multiples mutations.
Depuis que j’attends le rendez-vous de vendredi à propos de Saccage, je n’écris plus. Je prends alors le temps de lire les oeuvres qui sont trop loin de moi dans le talent, et incapables de m’influencer, car hors d’atteinte (c’était Flaubert un temps, puis Proust, Gracq, Echenoz, aujourd’hui Gontcharov). C’est le temps de la pure contemplation, du silence, de l’émerveillement sans cesse renouvelé de la lecture.
(évidemment, j’écris toujours.)
« Il déjeuna, puis s’assit à la fenêtre. Tout était ennuyeux, absurde. Il était à nouveau seul. Comme par le passé, il n’avait plus envie de rien faire, ni de sortir. »
Je vois parfois des femmes se demander quelles écrivaines lire tant les hommes sont médiatisés. Modestement, pour contribuer à la diffusion de ces lettres trop souvent méconnues, je donne une liste de celles qui ont été les plus importantes pour moi, dans l’espoir que ça puisse servir à d’autres : Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Marie Redonnet, Monique Wittig, Judith Butler, Marie Cosnay, Nathalie Sarraute, Marina Tsvétaïeva, Emily Dickinson, Edith Wharton, Françoise Asso, Emmanuelle Pagano, Lydie Dattas, Charlotte Delbo, Annie Ernaux, Danielle Collobert, Emmanuelle Pireyre et Emma Santos (toutes les oeuvres sont recommandables, tous les livres d’une qualité semblable ; cette liste trouvera à s’étendre au fil des années et de mes découvertes).
C’est très dur de s’opposer, particulièrement aux gens qui nous sont les plus proches. On voudrait faire peser la faute sur nous, mais il n’y a pas de faute. Je n’en peux plus de redoubler de concessions, de me présenter quand j’aimerais me cacher, de dire oui parce qu’on ne m’entend pas dire non, qu’on ne comprend même pas comment je pourrais dire non, de quel droit je me donnerais cette importance. Pourquoi ne pas céder plutôt. Pourquoi ne pas aller dans ce sens général des choses qui ne nous font pas envie, qui même nous rebutent froidement, mais qui contentent tout le monde, tous ceux qui croient avoir la moindre influence sur nous, la moindre autorité.
Mais il n’y aucune autorité au-dessus de moi. J’en ai assez de dépendre et de consentir. Je n’ai qu’un père ; qu’une mère. Et eux savent où est leur place.
(Peut-on se lasser des autres ?)
(Peut-être suis-je infâme, mais cette infâmie là me sied.)
Certes j’écris court, mais ne faites pas comme si vous pouviez lire long.
Samedi soir, j’ai été voir Nous venons en amis. Le documentaire est filmé au Soudan, séparé depuis peu en deux états indépendants, l’un contrôlé par la Chine, l’autre par les États-Unis. Évidemment, les ennemis principaux des tribus locales sont le capitalisme et l’extrémisme religieux. Il y a des évangélistes texans qui mériteraient d’être mis au silence ; peut-être pire que le silence. Évidemment bis, pas un humain ne rattrape l’autre. L’Occident règne.
Au-delà de ça, des scènes (images) particulières, jamais vues, jamais envisagées, qui m’amènent à penser qu’il y aurait là une puissance autre à pénétrer : villages construits sur des cimetières, décharges à ciel ouvert dans lesquelles les enfants se jettent pour jouer, bâtiments administratifs déserts au fond desquels des télévisions sans public diffusent des images de bombardements, carrières de pierre où des silhouettes fantômes se couvrent de poussière, enfants nus chaussés de baskets neuves et qu’on invite à danser mais qui ne peuvent que pleurer, organismes de paix construisant clôtures barbelées et safaris photo, abris incendiés, fusillades, tueries, landes.
On en vient progressivement au pire : la hiérarchisation de la souffrance. Elle est là l’inhumanité, dans la sélection du mal ; elle est là : dans la comparaison de deux cadavres identiques ; elle est là : quand les hommes d’après les montagnes sont moins hommes que ceux d’après la prochaine rue.
J’ai besoin de me raccrocher à There There, à ce moi de neuf ans qui écoute cette chanson la première fois et y met tout ce qu’il peut de lui, j’ai besoin de ça pour oublier, pour retenir qui je suis, qui sombre dans la décrépitude, la laideur, à mesure que les années passent, et contre quoi mes larmes ne peuvent rien. Je dois m’accrocher à la sensation unique de la première écoute, qui me sauvera toujours du temps qui m’engloutit, et que je n’accepte pas. Que je ne parviens pas à accepter. Mais qui toujours me défigure.
Intense mal aux tempes. Manque évident de concentration. Disparition totale des sensations esthétiques.
(Le bruit court que cet homme serait une femme.)
« Mais les jours passaient, les années succédaient aux années, le duvet devint une barbe rêche, l’éclat des yeux se figea en deux points ternes, sa taille s’arrondit, ses cheveux commencèrement à tomber impitoyablement, trente ans sonnèrent, alors qu’il n’avait avancé dans aucune carrière et restait toujours à l’entrée de l’arène, au même endroit que dix ans auparavant. » — Ivan Gontcharov, Oblomov.
Alors que j’attendais mon bus, j’entends : Quentin !
Je me retourne et c’était Victoria, qui allait prendre elle aussi son propre bus, qui allait à l’opposé de là où m’emmenait le mien, et qui me dit, avec son sourire habituel : je dois prendre mon bus, ce que j’avais immédiatement compris, alors je lui réponds : on s’appelle, puis elle me fait quelques signes, puis elle monte, et moi j’attends toujours, plusieurs minutes, que mon bus arrive. Le sien part. Je ne sais pas derrière quelle fenêtre elle se trouve ; je ne regarde pas. Je ne sais pas non plus quand on s’appellera.
Le 14 octobre sort Retour à Duvert, biographie de Tony Duvert écrite par Gilles Sebhan, auteur du déjà beau Tony Duvert, l’enfant silencieux (je note ça ici pour ne pas l’oublier).
J’éprouve toujours une certaine nostalgie à retourner sur navire.net (ex embruns.net), tout comme sur la-grange.net. Peut-être parce qu’ils sont là depuis que je suis adolescent (c’est-à-dire 2008 ?), depuis que je commence à lire sur internet, et qu’ils constituent un socle commun vers lequel j’ai toujours aspiré arriver : une stabilité (malgré les changements d’apparence) de ton, une fidelité. (Pour Karl Dubost, peut-être même, une façon de se situer comme homme dans le monde. Mais aussi, le bouleversement du voyage sur le porte-conteneurs CMA-CGM Tage de Laurent Gloaguen.) C’est la même force qu’un livre qui nous rassure. Un espace de parole inamovible ; le partage d’une vie. C’est une richesse, et c’est une source vers laquelle se tourner quand on est dans le doute quant à qui l’on est, ce qu’on fait. Ces sites dessinent des personnalités complexes, riches, sincères. J’espère qu’un jour, bien plus tard, mes Relevés pourront faire ça pour un lecteur inconnu, et qu’on me lira avec la même sensation que je lis ces deux sites-là, immobiles, toujours changeants pourtant ; éternels.
« Les VOIX ne s’adressent pas au spectateur ou au lecteur. Elles sont d’une totale autonomie. Elles parlent entre elles. Elles ne savent pas être écoutées. » — Marguerite Duras, India Song.
Je ne me suis jamais vraiment considéré. Ça me permet de ne pas trop subir les jugements extérieurs. Je n’ai jamais rien réellement appréhendé quant à mon travail. Je sais qu’il est perfectible. Je sais même que parfois il n’est pas bon, du tout. Mais j’attends beaucoup de ce que — doit être en train de (ou va) lire. Comme légitimation de mon écriture. Car on devient aveugle à terme sur ce qu’on ne fait que réécrire depuis des mois (années). Et on se croit pire que tout. Et parfois cela est vrai. Parfois rien ne nous détrompe. Et il faut toujours avancer dans la médiocrité, dans le mensonge. Et cet épuisement de l’écriture parfois amène au pire. Pour finir, je rejoindrai ce que dit Benoît Vincent :
Le monde de l’édition est le monde du livre ; notre monde est le monde du livre. J’en ai fait l’amère (mais pas si déterminante) expérience : l’auteur n’existe qu’une fois le livre papier paru.
« Je mens quand je dis, l’opinion publique ne m’intéresse pas, mes lecteurs ne m’intéressent pas, je mens quand je dis, je ne veux pas savoir ce qu’on pense de ce que j’écris, je ne lis pas ce qu’on écrit dessus, là je mens, je mens d’une façon tout à fait grossière, a-t-il dit, car je brûle continuellement de savoir ce que les gens disent de ce que j’ai écrit, je veux le savoir toujours et à tout moment et, quoi que les gens disent de mes écrits, cela m’affecte, voilà la vérité. » — Thomas Bernhard, Maîtres anciens.
J’ai peur des années qui viennent. Je n’ai jamais eu de grandes ambitions professionnelles (esthétiques oui), mais tremble d’en être peut-être réduit à moins encore. Un petit poste dans une librairie, même dans une bibliothèque (ailleurs je ne sais pas, une petite maison d’édition ?), dans une ville qui ne soit pas Paris, ; mais c’est un luxe, j’en ai conscience. Suis-je tellement courageux. Le monde de la télévision est ingrat, et même le statut précaire. J’étais il y a deux ans encore dans le confort étudiant, puis tout jeune actif, c’est-à-dire sans charge (et le soutien de mon père). Ces choses-là ne durent pas éternellement. Il faut réfléchir à la suite. Ai-je envie d’y réfléchir. Suis-je tellement courageux ?
À la lecture de Maîtres anciens, je prends conscience de l’engloutissement qu’est la langue de Bernhard, cette faux qui tranche et revient trancher les mêmes membres, cette faux qui me fascine, comme me fascine chacun de ses romans, desquels je ne parviens à m’extirper qu’après une longue apnée, et d’où je ressors plein d’une colère neuve, cette colère inouïe de l’homme qui parle.
« Voilà des terrains dévastés où les chiens tournent en rond sur eux-mêmes, sur leur faim et leur soif, et sur l’évanouissement de leurs vies arrêtées, moi qui suis un fruit de la paix, de la prospérité, je me suis dit sans doute est-ce ainsi que l’on trouve à la fin des combats les hommes et les pays ravagés par la guerre. » — Mathieu Riboulet, Entre les deux il n’y a rien.
Je n’en attendais pas grand chose, et le livre a l’air de rien, mais Merci, de Pablo Katchadjian, est l’une des lectures les plus réjouissantes de ces derniers mois. Si je voulais dire de quoi il s’agit, je dirais : c’est une bande d’esclaves bipolaires qui récupèrent leur liberté à l’aide de racines aux pouvoirs étranges. Il y a aussi un procédé de boucle textuelle qui met particulièrement mal à l’aise (surtout lorsqu’on interrompt sa lecture, on a l’impression de s’être trompé de page). Enfin, un menaçant nuage de cendres les poursuit quoiqu’il arrive.
Je n’avais jusque-là jamais remarqué comme on voyait la tour Montparnasse éclairée dans la nuit, dans Les Chansons d’amour, au milieu de ce cimetière inconnu où Louis Garrel attend dévasté et où Ludivine Sagnier chante morte.
Déconstruire le langage, les relations humaines, déconstruire l’objet, le tableau, le livre, la sculpture, déconstruire son rapport au monde, etc. Il est (déjà) grand temps de déconstruire le numérique. Sinon on passera à la suite sans avoir eu l’occasion d’examiner comment ça fonctionne dans les rouages de cette machine infernale. Il n’est plus question de regarder des vidéos sur Youtube, ou d’en faire, ou de partager ses informations sur Facebook, ou de se croire intelligent sur Twitter. Il est temps de casser les sites ; de casser les données, les structures ; de franchir le seuil de cette évidente incompréhension ; d’observer comment cette matière textuelle-là, invisible, nous domine tous. De faire moisir. De voir ce que ça fait.
Pour faire simple : l’écrivain ne doit pas être sur Youtube, mais derrière Youtube.
Ne jamais s’excuser de ce que l’on a écrit. Si ce n’est pas bon : effacer ; puis recommencer.
Un homme avec un masque de chien m’attend devant la voiture. Sans faire aucun signe, il m’incite à monter. À l’intérieur, l’espace est beaucoup plus spacieux que ce à quoi je m’attendais. L’homme au masque de chien referme la porte, et c’est un autre homme qui s’adresse à moi. Il ne porte pas de masque mais son visage est dissimulé par une ombre étrange. Une ombre qui n’a rien à faire dans cette voiture. Après avoir parlé une langue inconnue, il me tend une disquette. Dehors soudain les figures se déforment ; je me concentre et les passants sont méconnaissables. Le sol s’ouvre mais dessous rien du vide : une surface de sable apparaît, pas vraiment du sable, le jaune est celui du sable, mais ça n’a rien à voir avec ça, ça n’a pas de texture, ce n’est pas le désert, ceux qui marchent dessus fusionnent avec, coulent dans ce sable qui n’en a que l’apparence. Le ciel a perdu sa teinte. Certaines silhouettes se confondent avec le paysage. Ne parviennent pas à traverser la ligne d’horizon. La rupture est absolue. L’homme au masque de chien me fixe toujours ; je vois ses deux yeux dans les ouvertures. Il ne cligne pas. Je regarde ma main et le métal de la disquette a fondu. Ça brûle à peine. L’homme dans l’ombre continue de parler. L’homme au masque de chien de me fixer. Et la voiture avance, mais il m’est impossible d’en sortir.
Si je faisais une recherche lexicale dans Saccage, je pense que les deux mots avec le plus d’occurrences seraient bientôt et mort. Je préfère ne pas en déduire grand chose, et ne tiens pas à tout prix à varier mon vocabulaire : si l’imminence finale m’obsède tant, c’est qu’elle doit trouver un luxe à s’étendre en moi.
À l’instant d’imprimer, on a toujours l’impression que ça ne se joue plus qu’à un mot, et qu’il ne faut surtout pas laisser celui-là qui fait défaut. Mais systématiquement on se trompe : ça se joue à bien plus que ça. C’est histoire de reculer l’échéance. En vérité, votre texte, il est déjà écrit depuis longtemps, il est là, et ce que vous changez, ce n’est qu’une minuscule brique déjà recouverte par de multiples couches de peinture.
J’ai imprimé le manuscrit chez moi. La dernière fois, je l’avais fait imprimer chez un professionnel, à Lamballe, et ça m’avait coûté vingt euros. L’éditeur ne m’avait jamais répondu (aucune idée de si le courrier s’est perdu ou s’ils n’ont même pas jugé bon de me répondre), et ça faisait comme si j’avais jeté vingt euros dans le vide. Je déteste cette idée. Là j’ai presque épuisé mes cartouches. L’écran de l’imprimante m’indiquait : niveau faible, et j’ai croisé les doigts pour ne pas qu’elles se vident avant la fin de l’impression. Ça m’aurait trop énervé, et j’aurais tout envoyé en l’air. L’enveloppe est prête. Tout part demain.
Parfois j’en dis trop. Ça finira par me jouer des tours.
(Je me suis bizarrement réveillé au milieu de la nuit, après une heure seulement de sommeil.)
J’ai toujours eu sommeil. J’ai dormi toutes mes nuits, et quand elles ont par hasard été blanches, je les ai toujours rattrapées.
Je me souviens : Sylvie m’avait raconté que, arnaquée lors de l’achat d’une voiture d’occasion, elle n’avait pas pu dormir de la nuit, et s’était acharnée à débusquer la fraude. Son compagnon de l’époque, lui, s’était endormi comme si de rien, et elle pestait contre cette attitude. Je l’avais rejoint cette fois-là dans son indignation, sachant pertinemment que j’en aurais fait de même, et qu’il aurait été impossible de compter sur moi pour veiller toute la nuit. On en invente de ces choses parfois, on en prend de ces attitudes mensongères, sans trop même savoir pourquoi. Par peur de décevoir peut-être. Comme si ça ne tenait qu’à ça.
Je n’aime pas que les volets soient complètement clôts. Sinon, le matin, quand je me réveille, je ne sais pas où j’en suis. Dans la plupart des chambres dans lesquelles j’ai dormi, il n’y avait pas de volets du tout, et ça ne m’a jamais dérangé.
(J’espère vite me rendormir.)
« À cet instant, j’arrive à lever ma tête pour regarder le panorama face à moi et pense qu’au fond je n’ai jamais rien perdu. » — Marcello Vitali-Rosati, Navigations.
J’ai toujours l’ambition de ce livre, qui s’ouvrirait comme un CD-ROM détraqué, dont les pages se déformeraient comme un glitch, et qui feraient glisser le texte, le sens, détruiraient même le texte et le sens, mais tout en conservant un chemin, seulement un autre chemin que celui auquel les lecteurs s’attendent, et qui serait un chemin atroce dans les méandres de la bizarrerie numérique, et qui irait très loin dans le mal, très loin dans le mensonge, dans l’infect, vers une intense migraine, voilà une espèce de migraine définitive, totale, au bout de laquelle il n’y aurait aucune issue, aucun retour à la normale, juste plus de bruit, toujours, et plus de distorsions, et de ruptures, et de noir (un noir inédit).
Je ne cesse d’imaginer ce livre, de tourner autour ; je ne trouve pas comment entrer dedans, comment montrer ce qui ne peut être qu’images.

Cécile interrompt un de ses messages en son milieu : me dit qus. Puis rien pendant plusieurs dizaines de minutes. Aucune réponse quand je l’appelle. Durant tout ce temps de l’attente, incompréhensiblement, je suis l’homme le plus inquiet.
Puis, après quarante-neuf minutes d’attente, elle répond ; alors tout s’apaise.
Dans le livre que m’a envoyé Guillaume, trois jours plus tard, j’ai découvert le mot glissé sour la couverture.
(Quand mon père me previent, je t’appelle cet après-midi !, je sais qu’il ne faut pas attendre de ses nouvelles avant plusieurs jours (semaines).)
Ce que j’admire le plus chez Beckett, c’est son visage sans concession.
Ça y est, j’ai fini ma dernière version de Saccage, celle que j’estime être la bonne, la définitive, et que je vais envoyer. Je ne sais pas. Souvent, encore, sur les trop longues choses, je me perds. J’angoisse. J’ai la sensation d’épuiser ce que j’avais à dire, de diluer l’impulsion initiale. Je ne me trouve plus bon à rien. Et rien là d’une posture. Seul l’aveu d’incompréhension face à mon propre achèvement, à ma propre réalité. Qu’est-ce qui arrive de ce texte-là, qu’est-ce qu’il tire, charrie (en moi). Où je suis depuis ce texte. Où j’allais et.
Je vais l’imprimer, puis l’envoyer à —, un temps passera, et il me dira. Et à partir de là, bon. J’ai pensé à Guillaume aussi durant ce travail de réécriture. Je suis là moi avec ma sensibilité depuis les premiers crachats de ce texte, et aujourd’hui il est infusé de plusieurs personnes et de toutes mes contradictions mélangées ; et pourtant il faut savoir y mettre un terme. Chaque jour je me révolutionne, pourtant chaque jour il faut revenir sur cette fixation de la douleur ; et en faire quelque chose.
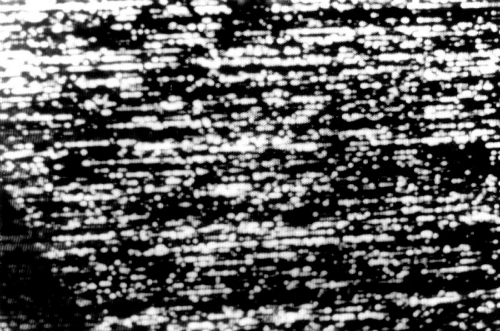
Je me sens imposteur.
À propos de Charøgnards, de Stéphane Vanderhaeghe, Quidam, 2015.
1) la sensation qu’on a en lisant les dernières pages du livre est sans commune mesure : tout s’enfonce dans le rien et soi seul avec ses yeux qui tente en vain de tout ramener à la vie.
2) moins l’invasion d’oiseaux au monde que dans le cerveau du narrateur : ils s’engouffrent dans la hantise et profitent des failles ; ailleurs il ne se passe rien ; ensuite il s’agit de bavarder pour leur échapper, mais évidemment le bavardage c’est les corbeaux.
3) habituellement peu sensible aux jeux de typographie, je m’y suis fait d’autant plus qu’ils disparaissent à la fin (je veux dire, vraiment).
4) il y a des éléments communs avec mon Saccage (et qui me sont donc familiers) : remplacement d’une réalité par une autre, menace incompréhensible et inévitable, fuite vers l’avant qui est le retour, motifs récurrents de désastre, paranoïa.
5) la forme du journal, évidemment, j’y suis sensible : je n’y reviens pas. Les ruptures temporelles font également partie de mes questionnements, d’où ici l’absence complète de marqueurs (seul le menteur tient à tout prix aux dates).
6) amusante ironie entre l’enrobage universitaire visant à l’exactitude et le discours en totale et permanente déconstruction ; ou comment le recul du temps annihile en profondeur la souffrance ; qui parmi ces étranges et futurs tétrapodes ailés pour prendre pitié de ce peureux bavard ?
7) ensuite, pour les autres, il suffit de se laisser aller au chaos ; et d’assister impuissant au remplacement violent de notre langage.
« – sentir alors les mots se téléscoper, la panique inscrite au coeur de la langue, les regarder une dernière fois flotter un temps sur ces pages avant de disparaître dans le gouffre, désormais la seule réalité qu’ils touchent, sans rien d’autre à caresser que la surface vierge et salie de ces pages qui rapidement se flétrissent – » — Stéphane Vanderhaeghe, Charøgnards.
Après deux semaines à Paris, de retour à Rennes.
Durant ces deux semaines d’absence, j’ai reçu un email de —, email qui m’a tellement mis en joie que j’ai regardé Cécile avec de ces yeux, et de ce sourire, et ça n’est peut-être qu’un cadeau piégé, mais j’ai toujours préféré les surprises au vide. J’ai racheté L’Apocryphe croyant ne pas l’avoir lu, et je l’ai redécouvert ; mais je déteste acheter deux fois le même livre ; alors je vais le cacher dans un coin avant de trouver une occasion pour le donner. J’ai écrit trois phrases dans un brouillon d’email. J’ai visité les alentours. J’ai vu les quarante-cinq premières minutes du Sacrifice de Tarkovski.
Dans le train, j’ai lu d’une traite Charøgnards, alors j’y reviendrai.
La ville était telle que je l’attendais. Je m’imaginais un appartement saccagé, cambriolé, incendié, mais tout était comme je l’avais laissé. Dans la boîte aux lettres il y avait des factures et un colis m’indiquant que le nom de Guillaume n’était pas son vrai nom.
J’ai imaginé une page en négatif où toutes les lettres seraient dissimulées. Il faudrait passer cette page dans l’eau pour lire le texte mais l’eau trop vite tuerait le papier alors il serait impossible de rien comprendre. J’ai imaginé ça un soir que je n’avais pas sommeil.
La noirceur n’attend pas : je me remets au travail.
L’article de Télérama sur la supposée disparition des lecteurs est encore à côté du sujet. Il met sur leurs dos la fin des librairies, des “bons” livres, mais c’est mélanger les coupables. Si les librairies disparaissent, c’est la faute aux loyers impossibles, aux grandes surfaces, aux distributeurs et éditeurs mettant toujours en avant les mêmes livres immondes partout ; c’est la faute aux intérêts combinés d’un petit nombre de personnes qui peut posséder parfois jusqu’à la ligne complète du livre (édition, distribution, diffusion, communication) et qui donc joue son monopole à tous les étages pour des rendements financiers délirants et sans aucun sens dans ce domaine culturel. Le fautif il est là, dans l’argent ; le lecteur lui, est le même. Sans suffisamment de visibilité, quoi acheter d’autre ? Tout le monde n’a pas la patience ou les ressources pour trouver (s’il n’est pas mis en avant dans une librairie ou à la télévision) le dernier roman des éditions Quidam ou La Fabrique ou de L’Ogre. Cette connaissance requiert un effort, un travail.
Un exemple simple : Lagardère entreprise possède à la fois quantité de maisons d’édition grâce au rachat d’Hachette Livre (Grasset, Stock, Calmann-Lévy, Le Livre de poche, j’en passe), mais autant de médias : Elle, Europe 1, Paris Match, Virgin Radio, etc. Ces données ne sont aucunement anodines et peuvent se répéter à nombre de maisons d’édition et d’organismes de presse. Chez Artemis, on est actionnaire majoritaire de La Fnac et Le Point par exemple. Une tautologie est toujours importante : seuls les indépendants sont indépendants. Ne vous attendez pas à une quelconque liberté d’esprit quand les intérêts se croisent ; attendez-vous seulement à de l’argent. La plupart des gestionnaires se foutent du livre, mais aucunement des bénéfices (absurdes qu’ils imposent, par ailleurs).
On pense que le chiffre est indicateur, mais les livres importants ne se sont jamais écoulés à des centaines de milliers d’exemplaires. Volodine ou Echenoz auraient vendu de la même façon que ce soit aujourd’hui ou dans les années 1970 (et André Schiffrin l’explique d’ailleurs très bien dans L’édition sans éditeurs). La plupart des lecteurs de l’époque ne connaissaient même pas Claude Simon lorsqu’il a reçu le prix Nobel !
Si Faulkner se vendait énorménent à une certaine époque aux États-Unis, c’était uniquement grâce aux librairies indépendantes, et aux éditeurs rigoureux, qui n’avaient comme ambition que la mise en avant d’une littérature de qualité, et le souci d’un rendement permettant seulement de publier le prochain livre. La littérature a toujours été une niche à défendre ; cette niche vole en éclats, alors les néophytes peinent. Personnellement, je lis toujours autant d’excellents livres contemporains, mais une seule librairie les a en fonds dans ma ville, et d’ailleurs j’en reviens toujours aux mêmes éditeurs.
Et il faut également arrêter de comparer la télévision et les séries avec les livres : ce n’est pas la même exigence, on n’en attend pas la même chose, et le temps passé avec cet objet diffère également. On peut faire les deux, ou aucun. On y trouve pas le même contenu, ni les mêmes enjeux.
Ceux qui affirment le contraire sont des crétins : la littérature existera toujours. Mais il faudra peut-être alors se salir les mains et partir l’acheter dans les tréfonds de la société, là où les ruelles puent et où les rats courent.
En France, on y vit pourri, pire que les chiens.
Je me suis réveillé sur le parking à côté de la salle des fêtes. J’avais froid dans ma voiture et il n’y avait personne. J’avais dormi deux heures. C’était gris, sale. Le dehors tout pourri des déchets de la soirée. J’ai erré dans les locaux vides, mangé une tranche de pain, bu un peu d’eau. Je ne savais plus vraiment quoi faire ensuite. J’ai regardé par la fenêtre et un riverain est passé devant moi. Dans les voitures je savais que d’autres dormaient ; ou espéraient le sommeil. La pelouse à côté était brûlée depuis des jours mais le ciel pleuvait là. J’ai attendu un moment. Je puais et bientôt encore plus. Je me suis finalement décidé. J’ai démarré ma voiture et je suis rentré à Rennes. Sur la route non plus je n’ai croisé personne ; halluciné des cadavres sur le bitume. Peut-être avais-je encore un peu d’alcool dans le sang.
Parfois j’aimerais pleurer, mais aucune tristesse ne vient.
J’ai rendu l’âme cent fois dans le courant. J’ai vu là des merveilles ; on m’en aurait jamais parlé. Elles ne ressemblaient à rien de connu, à rien d’imaginé, rien d’envisagé. Elles étaient maudites comme un ouragan, où l’horreur circule et s’encastre partout. Elles aspiraient le sable, le mêlaient à la nuée, et à la surface les quelques pêcheurs déjà en mer pouvaient rencontrer l’inconnu. Depuis la terre il y avait une montagne de formée, mais la montagne était d’eau, et ne demeurait qu’un instant, le temps suffisant pour détruire les oiseaux, et avaler dans son effondrement l’impression du continent.
« Le post-exotisme s’achevait là. La cellule sentait le monde décomposé, l’humus brûlant, la fièvre terminale, elle empestait les peurs que les animaux les plus humbles, et je le regrette, ne trouvent jamais les mots pour dire. » — Antoine Volodine, Le post-exotisme en dix leçons, leçon onze.
La salle est surmontée de néons ; sur la piste, trois personnes dansent ; il manque une jambe à l’une d’entre elles ; la jambe repose sur la piste ; les deux extrémités arrachées saignent ; les néons éclairent le sang et les membres détruits ; il y a un robot qui chante de vieux tubes des années quatre-vingt ; la voix du robot est déformée comme celle du héros de film qui se retrouve le visage écrasé dans une presse à vinyls ; le robot lui aussi est éclairé par les néons et porte une jupe ; une jupe sur la ferraille ; la chair du membre sanguinolant éclate ; les deux autres danseurs ne remarquent rien, pourtant le troisième rampe à présent sur la piste à la recherche de sa jambe ; les néons éclairent son visage qui disparait sous le contraste ; son corps également ; enfin la jambe ; le robot arrive bientôt au terme de sa chanson et les deux derniers danseurs s’estompent progressivement ; sur la piste il n’y a plus que les néons qui se reflètent ; et la voix du robot en jupe ; la lumière éblouissante ; puis la salle s’éteint ; ne reste plus que la voix du robot ; éternellement détraquée.
Pourquoi s’évertue-t-on à encenser de médiocres auteurs ? (Angot, Liberati, Enard, etc.) Les journalistes vont me laisser un sale goût cette saison je le sens.
Cécile la nuit.
Amusant, la citation de Breton : Aimé Césaire manie la langue française comme il n’est pas aujourd’hui un Blanc pour la manier, déconstruite et décriée par Fanon, est pourtant utilisée comme mise en valeur du livre Une tempête sur la quatrième de couverture.
Il y a d’ailleurs dans Peau noire, masques blancs, quelques remarques sexistes particulièrement dérangeantes (sur le viol) ; pourtant Noir, Fanon n’en demeure pas moins homme.
(J’aimerais qu’on me dise qui a validé la traduction du titre L’Infinie comédie tant il sonne mal.)
C’est étrange, je découvre le site de Stéphane Vanderhaeghe, qui publie un livre, Charøgnards, bientôt, en septembre. C’est étrange, je ne sais pas quoi. Une espèce de proximité inexplicable ; évidente pourtant.
J’ai lu Choir et Oui à deux jours d’intervalle. À la fin de ces deux romans, deux personnages essentiels se suicident.
J’ai fini de purger Saccage. J’ai trouvé, je crois, un juste milieu entre les deux précédentes versions. Il faut à présent contrôler le ton, puis tout envoyer dans le vide.
Décidément, le traitement inégalitaire entre la merveilleuse et ouverte chrétienté contre l’infect l’islam dans les journaux télévisés devient chaque jour plus clairement dégueulasse.
« La haine demande à exister, et celui qui hait doit manifester cette haine par des actes, un comportement approprié ; en un sens, il doit se faire haine. » — Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs.
De plus en plus, je peux voir des lecteurs proclamer, devant un livre qui les a rebutés, qu’il vaut mieux (on le sait tous !) l’arrêter plutôt que de s’efforcer de le terminer. Je suis d’accord avec cette affirmative dans le cadre de mauvais livres (combien j’aimerais parfois me contenter de dix pages d’un mauvais manuscrit !) ; mais quand on applique ce raisonnement à des ouvrages (par exemple) de Thomas Bernhard, je suis plus que sceptique. On a tellement fait de la lecture un pur acte de plaisir, qu’on en a oublié qu’elle devait surtout et avant tout être un effort de désaxage – et qui peut donc parfois tenir du plaisir, mais pas nécessairement. Il faudrait ainsi de préférence lire ce qui immédiatement nous plaît ? La belle affaire ! Je cherche à me confronter, pas à me séduire. Je cherche à me trouver dans une décharge, puis dans un caveau, puis dans les décombres d’une chapelle ; jamais dans mon lit, où je sais déjà que je suis.
À force de se regarder, finit-on par s’aimer ?
J’éprouve rarement d’aussi grande satisfaction que de parvenir à dire justement ce qui était jusque-là confus.
« Je reprenais conscience et me retrouvais plongé dans un parfait dégoût de la vie. Si, le matin, je remettais quelque chose en marche, ce n’était que le mécanisme toujours pareil de l’incapacité de vivre et de la lassitude de vivre, et il ne me fallait plus songer à un travail, quel qu’il soit, ce qui ne faisait qu’aggraver ma dépression de jour en jour. » — Thomas Bernhard, Oui.
J’ai fait beaucoup de travail sur moi-même ces deux dernières années. Je pense que sur la majeure partie de mon identité d’alors, je ne me ressemble en rien. Je me suis beaucoup trompé car j’ai été éduqué, élevé, dans un milieu qui a ses propres codes (je n’ai par exemple jamais rencontré aucune personne non-blanche avant mon arrivée à la fac), et je les ai appliqués à la lettre. Lire me détrompe progressivement. Côtoyer qui est impliqué également. Je n’en finis pas d’avoir tort sur des quantités de sujets. J’ai grand soif d’apprendre.
À la télévision, sous tous les angles possibles, des vidéos amateures d’une explosion chimique dans un port de Chine. Deux déflagrations successives, deux novas pures de lumière qui ont tout embrasé sur dix kilomètres à la ronde.
Un peu après, une capitale morte, désertée, où quelques serviteurs à peine entretiennent un immense domaine inutile. Des pelouses, des hôtels, des boulevards pour personne.
C’est à peu près le monde que j’imaginais pour nous.
« Les gens ont conscience de la baisse de niveau de ce qu’on leur donne à voir et à attendre, mais sans que rien soit proposé pour inverser la tendance. » — André Schiffrin, Le contrôle de la parole.
S’il y a bien un procédé littéraire que je déteste, que ce soit chez Beckett, Chevillard, Volodine ou Perec, ce sont les listes.
Ma grand-mère vient souvent me voir, alors que je suis à lire dans le salon, d’ailleurs, elle s’avance, je ne devrais pas te dire ça, elle continue pourtant, mais untel a encore acheté ça, et ça, il a dû toucher ses sous, presque chaque jour les commérages, enfin ils font bien ce qu’ils veulent de leur argent… Et ça n’est qu’une infime partie de tout l’inutile vacarme qu’elle peut (comme d’autres d’ailleurs) propager chaque jour. Je l’aime mais parfois j’aimerais lui dire : je n’en ai rien à foutre.
« Seul, sans amour, livré à moi-même, en pleine campagne, j’ai demeuré naguère, désoeuvré, immobile, à l’étage d’une maison de village, contraint de regarder patiemment les jours filer, les semaines, histoire d’occuper la longue attente qu’était devenue mon existence. » — Hubert Voignier, Paysages, encore.
1993. Je me retrouve dans un bâtiment d’acier. Quatre piliers gris encadrent une surface bleue inutile. Je monte un court escalier pour récupérer mon armure ; par les vitres, j’observe les montagnes noires alentour. La porte suivante s’ouvre par le haut et deux hommes m’attendent sur une estrade. Derrière la scène, un couloir me dirige vers une succession de plateformes posées sur de l’acide. Je m’occupe à peine des meurtriers qui zonent ; récupère quelques fioles . Il me faut presque un chargeur pour abattre ce cracheur de feu. Je passe dehors un court instant pour revenir dans une salle bas de plafond où deux chandeliers sur pieds encadrent à nouveau une porte automatique. J’actionne l’interrupteur de l’ascenceur et une carte des lieux apparaît devant moi.
2012. Je me retrouve dans la rue. J’enfile mon masque de lion et sors de la voiture. Je monte un escalier puis assomme le garde en ouvrant la porte violemment sur son crâne. Au sol il y a un carrelage noir et blanc ; on se croirait dans les années quatre-vingt. J’éclate la tête du second garde avec une batte dans la salle de bain puis monte à l’étage. Toujours avec la même batte, j’en décapite cinq autres. Il y a des banquettes rouges mais personne dessus. Au fond de la dernière pièce il y a un civil que j’ouvre en deux. Je fais chemin arrière mais à peine le temps d’arriver au rez-de-chaussée qu’un train s’arrête d’où sortent deux nouveaux hommes de main. Je ne leur laisse pas l’occasion de passer la baie-vitrée. Après avoir repris ma voiture, je m’arrête dans un squat pour récupérer des papiers. Un clochard me surprend. Je vomis sur le sol. Le soleil se couche sur l’ombre des palmiers.
1996. Je me retrouve sur le toit d’un immeuble. Autour, les buildings sont encore éclairés mais la ville déserte. Je dois exploser deux barils de pétrole avant de pouvoir emprunter le conduit d’aération qu’ils dissimulent. En bas, on m’attend. Je fais le tour de la salle de cinéma mais finis par exécuter le guichetier. Un interrupteur ouvre les portes jusqu’au bar. Dans chaque pièce un assassin monstrueux rôde. Les caméras de surveillance tournent et dévoilent toujours plus d’ennemis. Je manque me faire surprendre. Dans la salle principale, ils passent un porno. Il y a des femmes endormies prisonnières de masses visqueuses. Depuis la salle de projection, je regarde une fille en sous-vêtements agiter deux fusils à pompe. Je détruis l’écran et passe derrière. Je me regarde un instant dans le miroir. Un grand écriteau en néons souhaite ma mort. Je dynamite le décor et passe à la suite.
Pour quelques billets sur les podiums les danseuses dévoilent leurs seins.
On sera toujours déçus par nos lecteurs ; voilà pourquoi il vaut mieux les oublier.
« Il fallait oublier, car il était impossible de continuer à vivre avec la pensée que cette gracieuse, fragile et tendre jeune femme avec ces yeux, ce sourire, jardins et neiges en arrière-plan, avait été transportée en wagon à bétail jusqu’au camp d’extermination, pour y être tuée d’une injection de phénol dans le coeur, dans ce doux coeur qu’on avait entendu battre sous ses lèvres dans le crépuscule du passé. »
En déplacement, je ne note rien qui ne soit dans mes Relevés. Et comme, en déplacement, je n’emporte que rarement mon ordinateur, je peux rester plusieurs jours sans consigner quoique ce soit. Ce qui est oublié lors de la prise de note fait partie des dommages collatéraux. Peut-être y avait-il là quelque chose d’essentiel pour moi ou mes projets, mais je le laisse au néant, et sans doute pour le mieux ; ou non.
Je ne conserve aucune trace de ce que je n’ai pas écrit.
La plupart des intrigues reposent sur des problèmes de communication.
On ignore l’existence d’une personne pendant des dizaines d’années, puis on se met ensemble, et alors une semaine sans nouvelle semble interminable.
J’ai tellement purgé Saccage, c’est devenu sec comme un coup de faux.
« L’Homme n’existe que dans la mesure où il est séparé du milieu qui l’entoure. Le crâne, vrai casque du voyageur de l’Espace. Restez à l’intérieur ou vous périssez. Mourir, c’est se dévêtir. La Mort, c’est la communion. Se fondre dans le paysage peut être merveilleux. Ce n’en est pas moins la mort de notre tendre moi. » — Vladimir Nabokov, Pnine.
J’ai une étrange douleur dans l’oreille gauche depuis hier.
Je sélectionne mes prochaines lectures comme un champion d’arène aurait le privilège de désigner ses adversaires successifs. Avec à la fois beaucoup d’excitation, d’appréhension, mais surtout avec la persistante hantise de me faire sauvagement exécuter.
Il faudrait toujours perdre pour gagner.
N’ayant pas eu la console promise pour mon dixième anniversaire, je me trouvais à pleurer dans mon lit. Mon père est arrivé alors pour me demander la cause d’une si grande peine. Ayant trop honte d’admettre ce qui me touchait tant, je n’ai trouvé comme prétexte à lui donner que le décès de mon arrière grand-mère qui ne m’avait pourtant jusque-là tiré aucune larme. J’étais un petit garçon bien capricieux.
« Dans ce contexte de ralentissement de l’engagement public en faveur de la diversité, alors qu’au sein de la sphère publique la question du racisme semble de moins en moins apparaître comme une préoccupation centrale, la pensée antiraciste ne doit cesser de se renouveler afin d’emprunter des voies de contournement de ce mur toujours reconstruit qu’est le déni du racisme. » — Maxime Cervulle, Dans le blanc des yeux : Diversité, racisme et médias.
J’ai, très tôt, été porté sur le code, mais plus que sur le code, sur le fait de coder. Je n’ai jamais souhaité faire profession de cette activité, pourtant j’y prenais un réel plaisir. J’ouvrais le bloc-note sur le vieil ordinateur de ma mèe (un Packard Bell sous Windows 95 si mes souvenirs sont bons), et je remplissais des balises de texte pour voir s’afficher images et paragraphes dans le navigateur. J’étais fasciné par la façon dont un tel magma de lettres et de symboles pouvait disparaître pour tendre à l’essentiel. J’ai appris à faire une distinction entre le textuel pratique et le textuel saillant. Je faisais des arborescences pour le plaisir de voir les choses mener les unes aux autres : je construisais à vide. D’absurdes architectures uniquement fonctionnelles. C’est-à-dire des édifices à détruire. Je créais de quoi toujours recommencer.
Parfois je crois qu’il y a une écriture derrière les choses, un code, une inscription ; derrière chaque chose, chaque être, chaque parole, chaque mouvement, chaque paysage, à chaque fois, une nouvelle ligne inédite, d’infimes variables, qui comprennent couleurs, axes, formes, et qui impliquent sentiments, sensations, émotions. Des lignes facilement modifiables, facilement effaçables, toutes superposées, toutes faisant partie d’un même ensemble unique, en cours, incomplet. Une architecture mobile, dérisoire.
Il y a peut-être quelque chose à tirer de ça ?
Je trouve Pinget bien au-delà de Beckett, mais qu’aurait été Pinget sans Beckett ?
« Sincérité et littérature sont deux.
Faire du mensonge sincérité est la souffrance d’un petit nombre d’élus. » — Robert Pinget, Du nerf.
Cécile me manque.
Craindre le pire.
Il est trois heures du matin ; j’ai la tête en vrac ; je dors sur un matelas à même le sol à Dinan, dans une mezzanine surchauffée ; demain, penser à ne pas faire de même.
Je ne sais pas ce que veut dire torture, mais je sais la pratiquer.
Bientôt quelqu’un va pénétrer dans votre domicile par une porte dérobée dont vous n’aviez jamais soupçonné l’existence. Il mangera ce qu’il y a dans votre réfrigérateur, mais vous ne verrez aucun aliment disparaître. Il froissera vos draps et de même aucune trace sur le tissu. Pas de terreur, pas le moindre murmure la nuit dans le silence. Pourtant il sera là, au-dessus de votre visage, et il vous épiera, et vous sentirez son souffle juste sur vos lèvres, et ça fera comme l’acide sur la peau, mais vous toucherez cette peau, et elle ne souffrira d’aucune brûlure. Les choses auront un nom différent, celui qu’il a donné aux choses, et qui n’est dans aucun livre écrit pour l’instant. Plus rien ne vous sera évident, car il aura gommé tout ce qui était acquis. Une lampe clignotera, et il sera impossible de l’éteindre. La porte de l’entrée claquera. Les fenêtres demeureront ouvertes. Un matin, il aura disparu, alors vous ressentirez cette absence redoutable de celui qui jusqu’ici vous accompagnait, et qui désormais vous a abandonné. Vous vous habituerez à manger ce qu’il mangeait, à dormir là où il s’étendait, à vous caresser les lèvres d’une même délicatesse, pourtant il ne vous aimera plus, mais vous vous aimerez à travers lui, vous le comprendrez, chaque jour, chaque nuit, encore, vous direz à la famille qu’il était là, la famille ne comprendra pas, vous direz qu’il savait, le goût aura son goût, l’odeur son odeur, la douleur deviendra insupportable, et l’ignorance avec, mais vous le pardonnerez, et, d’une même peau, il sera vous enfin.
L’époque n’est plus tellement à la métaphore. Les images ont pris le pas. Elles forcent la pensée à voir. En littérature, aujourd’hui, les choses doivent être dites telles qu’elles sont : dévastées.
Je regarde depuis plusieurs mois un stream en ligne, d’un jeu vidéo auquel je ne joue pas mais qui m’intéresse. Ce soir, deux streamers ont tenu à faire une annonce particulière, un nouveau projet qu’ils ont développé ensemble (auquel ils ont réfléchi !), des vidéos : il s’agira d’aborder des filles dans des parcs ou des campus, voir s’il est possible de les draguer en ne leur disant que des phrases tirées du jeu. Je ne sais pas ce qui passe dans la tête de ces personnes. On est tellement persuadé, parfois, des méfaits de telles ou telles pratiques, qu’on en oublie que tout le monde n’en est pas au même point. Que le harcèlement de rue demeure une pratique amusante pour certains hommes au cerveau creux. Une fille, modératrice du chat, incite même les internautes à envoyer leurs pick-up lines pour donner plus d’idées : Lowelo et Proto vont faire un subgoal où ils aborderont des filles en vidéo, en leur disant qu’ils sont légende sur HS pour voir si ça les intéresserait, en sortant des pick up inspirées des cartes du jeu ^^. Le chemin est long. Et toujours, à intervalles réguliers, s’ouvrent devant nous des gouffres inévitables.
Dehors, les palmiers, et défilent, au loin, d’autres palmiers, puis nous nous trouvons à l’intérieur d’un bateau, et par les hublots on aperçoit la banquise, on aperçoit l’écume soulevée par la coque du navire, puis d’autres palmiers, mais il n’y a plus de navire, et il n’y a plus de banquise, il y a des lampadaires, tout défile toujours, les lignes électriques, les feux, les îles au loin au travers du hublot, les oiseaux, le sillage, une masse bleue indistincte, puis tout ce qui a pris vie disparaît, s’oublie, dans le néant du noir, de l’après entièrement noir, de l’ensuite, qui n’a aucun nom, aucun sens, qui n’a rien de plus que sa présente absence.
Cécile est à Dakar pour trois semaines.
« On raréfie ainsi le désespoir, quand, en réalité, il est universel. Le rare ce n’est pas d’être désespéré, au contraire, le rare, le rarissime, c’est vraiment de ne pas l’être. » — Sören Kierkegaard, Traité du désespoir.
Beaucoup lu, dont un excellent recueil d’articles : Classer, dominer de Christine Delphy (vous devriez tous le lire). Un Beckett qui m’a tiré des larmes, Compagnie ; et puis d’autres choses encore. Je me suis à peine mis au travail. Impressionné par la beauté du musée de l’immigration. Voilà pour le moment. (En plus des habituelles fulgurances dévastatrices).
La fournaise avalait le feu, le glacier les débris d’un avion écrasé là depuis des milliers d’années, dans les boulevards une ombre grise flottait et neutralisait la lumière, les maisons étaient faites de boue et d’échelles, et si la colère a un nom, c’est celui de ces voix dans la brousse, c’est celui du calvaire, et dans le silence toujours un bourdonnement, dans le sommeil itou, quelqu’un m’appelait qui était ce bourdonnement, sa parole avait forme de bourdonnement, chaque élément engloutissait ce qui le constituait, dans le sommeil le cauchemar engloutissait ce qui le constituait, le réveil se faisait dans l’horreur, mais le bourdonnement est devenu plus clair, il parlait, il avait le souffle d’une déflagration par-dessus les villes orientales, alors la fournaise s’est éteinte, le glacier s’est consolidé, le cauchemar s’est dissipé et dans le boulevard une limousine est apparue : il y circulait ma carcasse.
L’apitoiement ranime la pitié.
« S’habituer à vivre dans le mensonge avec ceux qu’on aime. » — Robert Pinget, L’ennemi.
Chez mon père, je me sens comme ces jeunes désoeuvrés dans les clips ou films américains : faussement occupé, faussement là, étranger à chez soi, étranger à moi-même.
C’est amusant comme les jeunes auteurs arrangent leur mythe éditorial par peur de paraître ridicule. Par exemple, je lis dans une interview : “J’ai une amie, Marie Causse, qui va publier son troisième livre chez Gallimard à la rentrée. Elle a été repérée et contactée par Gallimard grâce à son blog, sur lequel elle écrivait des nouvelles.” La seconde phrase est fausse. Mais peut-être le piston brille-t-il moins.
Puis, cette consigne à propos d’un manuscrit, dans l’email d’une éditrice avec laquelle je travaille : Ce n’est pas un grand styliste, donc ne le juge pas seulement sur l’écriture. Ah.
Je n’ai pas de visage. Je ne veux plus en avoir. Je voudrais m’effacer derrière l’idée qu’on se fait de moi, derrière une vieille photographie rongée par l’enfance. Derrière le souvenir d’un passage sur la digue. Je voudrais n’être plus que ma voix la nuit dans la solitude d’un micro détraqué.
On loue aux nues un esprit et puis trois jours plus tard, par hasard, on le croise dans la rue. Évidemment, on s’indigne. Alors, c’est ça le sublime ; une pièce de chair mobile déjà rongée, déjà malade ?
J’ai 24 ans aujourd’hui.
La nuit fut dégueulasse. Je me suis réveillé dans mon duvet sarcophage, la tente moitié écroulée par la tempête. Mes chaussures sont pleines de terre. Mon oeil droit me fait mal. Ma mère m’a envoyé un texto.
J’ai rarement été plus heureux. Je reviens de loin.
L’orange de l’ampoule, dans cette chambre que je n’habite plus, vient donner à ce gris d’outreciel la morosité d’une autre fin d’automne. Dessous, les sapins encore se plient à l’exigence du vent, courbent, cassent comme casse quiconque sous la contraite, car jamais ne ploie, sinon se brise. Les maisons devant ça, blanches de cet enduit bon marché, s’alignent, donnant à la laideur plus de laideur encore. Le ciel est ainsi que jamais il ne s’arrête, amenant toujours avec lui son lot de regrets et de tempêtes éternelles.
Ici, c’est moi la contraite. C’est moi qui impose ma forme. Je n’utilise pas un outil, je suis l’outil. Vous devez vous en accomoder. Vous n’avez pas le choix. Je ne donne pas de choix. Je me présente à vous. Je rentre dans vos habitudes. Et je suis malcommode. Et je manque de tout un tas d’options agréables. Mais j’existe. Vous devez faire avec moi. Sinon, je vous rejette. Sinon, rien de ce qui est disponible là ne pourra vous être confié. Sinon, c’est l’indifférence qui vous attend. Et ce n’est pas moi qui en souffrirai. Car tout m’appartient.
La plupart des lecteurs envisagent les livres comme une maison où ils sont les bienvenus, où le couvert est dressé, où chaque convive tend la main. Ils s’attendent à retrouver leurs petites habitudes, leurs chaussons à côté du canapé, et les mêmes pommes de terre à cuire dans le four. Mais ici, il y a des assassins dans chaque angle mort. Des voleurs qui ont déjà tout dérobé. Des crocs de boucher et des jaguars fous. Le plat est empoisonné ; dans les chaussons bourdonnent des frelons. Comprenez-le : vous n’êtes pas les bienvenus.
Vous vous y ferez.
C’est fatigant de se battre, n’est-ce pas ?
J’ai vécu dix-huit ans, depuis ma naissance, à côté d’un plan d’eau. Dans l’idéal, dans un futur proche, j’aimerais trouver une petite maison en Bretagne près de la mer, ou d’un lac. J’ai parfois quelques fantasmes quant aux métiers que je pourrais exercer par ici, qui seraient d’immédiate proximité, mais je ne les ai jamais très bien définis, et d’ailleurs je pense qu’ils n’existent pas (plus ?). J’ai toujours ressenti beaucoup plus d’affection pour les villages ; les grandes villes me dépriment. Enfin, la foule me donne la nausée. Mais cette proximité (hors peut-être dans le bâtiment, et l’enseignement ?) n’existe plus. Il faut forcément compenser la distance par le déplacement, et vivre quatre heures par jours dans sa voiture. Alors je ne sais pas trop. J’ai encore le temps d’y réfléchir. J’ai cette chance.
Nous n’avons aucun recul sur les choses. Il faudrait regarder son époque avec cent ans d’écart tant nous sommes en retard. Nous vivons sans assimiler intellectuellement le passé ; le XXe siècle est à peine acquis, les traumatismes, le silence qui doit s’imposer. Tout va trop vite. On rampe encore sur les guerres passées. À peine quelques générations, et le Moyen-Âge nous inspire déjà la Préhistoire. C’est sans doute le problème. Personne ne comprend les combats présents, comme personne n’imagine les enjeux.
Disons : Qui a lu Woolf ? Qui comprend l’importance de Virginia Woolf dans la pensée contemporaine ? (Une chambre à soi par exemple, et ça n’est que le début du XXème ! Et qu’un seul livre !) Les universitaires, quelques citoyens d’avant-garde (c’est-à-dire vivants en avance sur leur temps, c’est-à-dire précisément en leur temps), en somme : personne. Peut-être sera-t-elle lue et étudiée par le plus grand nombre dans cinquante, cent ans, quand il faudrait que tout le monde la connaisse aujourd’hui, puisqu’elle soulève des problèmes sociaux et moraux essentiels (place de la femme et des “minorités”, propriété, indépendance d’esprit, etc.) Wittig, Butler, je n’en parle même pas. Qui lit Fanon ? Césaire ? C’est du matériau disponible depuis des décennies. Le retard ne se comblera jamais, puisque les problèmes seront toujours différents (la robotique ? l’épuisement des richesses ? la dégradation écologique totale ?).
Ce n’est pas que l’on écrit trop tôt : c’est qu’on l’étudie trop tard. Il fallait enseigner Wittig en 1980, Woolf en 1920, Fanon en 1960. Donner la matière, le souffle de l’époque. Former les esprits à engager les combats quand ils se trouvent dits. Et quand je pense à la plupart de mes enseignants qui ignorent tout de la littérature contemporaine, ou même la dédaignent, alors que c’est notre monde, c’est nos voix que l’on porte !
Le c’était mieux avant est une nostalgie du vide. Que l’on entretienne l’ignorance des joyaux actuels est la pire erreur à faire. Il faudrait enseigner Volodine, Echenoz, Redonnet, Michon, Cosnay, dans les lycées actuels. C’est l’incompréhension la douleur : alors que tout est là ! Nous pensons être éduqués. Mais rien n’est actuel, personne n’est ouvert. 2015, c’est à peine 1900.
J’aime quand les gens promettent. La plupart du temps ils ne les tiennent pas, et vous avez alors enfin une excuse valable pour ne plus les fréquenter.
Je me souviens de l’effet qu’avait eu le jeu GTA Vice City sur moi. Apparemment, ce n’est même pas un des bons GTA, mais enfin. La sensation de liberté qui m’a prise alors, je ne l’avais jamais ressentie auparavant. Tuer, déambuler, conduire n’importe quel véhicule, et toutes ces villas grandioses ; c’était sans précédent. Au bout d’un certain temps, la carte graphique de mon ordinateur a brûlé, et des pixels morts sont apparus dans les logiciels que j’utilisais ; dans les jeux aussi. Dans GTA, la mutation s’est faite progressivement. D’abord intact, l’environnement très vite virait au cauchemar : les personnages étaient d’un bloc, je roulais dans des villes à moitié déconstruites, à mesure que je tirais tout se déformait, et finalement je n’y voyais plus rien du tout : sinon une immense arborescence colorée. J’ai jeté l’ordinateur peu de temps après.
J’ai toujours préféré dormir dans des lits une place. Peut-être l’impression de m’habituer au cercueil ?
Dans le manuscrit de Saccage, en ce moment, je nettoie par le vide.
Le mot de ma grand-mère sur la table de la cuisine ce midi : Quentin Arrange toi / Je part à Plancoët / Voir une Morte / A toute à l’heure / Bizs —
Je n’ai jamais été particulièrement généreux.
« Rose Poussière gémissait doucement dans son refuge, les bras autour du corps, se balançant lentement d’avant en arrière, comme si elle essayait de bercer sa propre douleur. » — Jean-Pierre Martinet, L’ombre des forêts.
Il y a un frolon mort dans un coin du grenier. Les filles l’ont laissé là, de peur qu’il ne pique encore.
Chez Pinget, j’aime l’esprit vidéoludique avant l’heure. À savoir, comme dans Chrono Trigger, Suiken Denketsu, ou les premiers Final Fantasy par exemple : une multitude de personnages, qui s’apparentent à ces équipes étranges de robots, bêtes, ou autre jeune humanoïde (Le Renard et la boussole), de lieux, allant des déserts aux glaciers, et d’aventures, loufoques ou épiques (Graal Flibuste). En somme, j’y retrouve l’audace des quêtes totales et infinies.
Ça me rappelle d’ailleurs une idée que j’avais, petit, de jeu vidéo absolu : il s’agissait d’un monde ouvert qui représenterait, à échelle et dans les moindres détails, tous les bâtiments, intérieurs, et autres monuments compris sur la Terre ; une espèce de cartographie exhaustive (marine et terrestre) de notre planète, à notre époque — mais cela impliquerait que l’on découvre ce qui se trouve tout au fond des océans. Des mises à jours seraient faites à chaque bâtiment construit réellement. Ce qu’on aurait bien pu faire dans un tel univers, cependant, je n’y ai jamais réfléchi (sûrement pas vivre une deuxième fois).
Les journalistes adorent dire des jeunes (mauvais) romanciers qu’ils donnent l’impression d’être des auteurs d’âge mûr, remplis d’expérience, ayant déjà une conscience profonde des maux sociaux, etc. et ce comme gage de qualité. Mais quel intérêt d’être déjà vieux ? Moi je veux le foutoir, le chaos, je veux que ça pue la violence précoce, et que ça pue dans leurs carcasses bien installées, je veux que ça pue dans leur crâne quand ils couchent avec leur femme, quand ils tiennent la main à leurs gosses, quand ils passent leur tranche de steak au barbecue, je veux que ça enflamme leurs bouches et qu’ils n’aient pas assez d’eau pour calmer la douleur, je veux que ma jeunesse les enclume et les cloue, je veux qu’elle devienne la seule option de vie quand ils se réveillent chaque matin, je veux qu’elle remplace leur idéologie nauséabonde, qu’elle annihile tout ce qu’ils ont pu connaître jusque-là ; sinon à quoi bon ?
J’ai constaté chez Guyotat une propension à parler (dans des entretiens) comme connus de tous des textes non publiés (L’Histoire de Samora Machel par exemple, mais aussi, Progénitures 2, et d’autres). Il les place au même niveau que ses textes publiés (D’ailleurs, il l’écrit : « Le Livre et Samora Machel ont été écrits sans que se pose pour moi la question de leur publication »). À mon sens, il pose une question fondamentale sur l’existence d’un texte, qu’on rapproche trop souvent de sa publication. Un écrit peut avoir une force intrinsèque propre qui dépasse la notion même de lecteur, et qui trouve sa justification dans la puissance qu’y décèle l’auteur.
Toutes proportions gardées, j’ai souvent moi-même parlé de Saccage comme s’il était disponible pour tous, lors qu’ils n’avaient de présence qu’en mon esprit. Mais j’étais convaincu (et le suis toujours) que ce qui était dit trouverait lecteurs à un moment ou un autre de l’Histoire. Certains textes sont autonomes : ils n’ont donc besoin d’aucune matérialisation fixe (livre relié, feuillets, page web, etc.), mais peut-être seulement de passeurs.
Mes petites cousines ont décidé de construire un village de jouets dans le grenier. Ensuite, m’ont-elles dit, elles simuleront une apocalypse, et toutes les figurines du village partiront en caravansérail dans les autres pièces, formant une file indienne fictive d’exilés. Puis, au terme d’une marche de trois jours (combien réellement ?), elles rentreront et bâtiront sur les ruines du précédent village un nouveau identique.
« Dans le village sud-saharien où j’ai connu Laïd – un jour, une nuit, à marcher, à parler, seulement –, le cuisinier noir de l’école, qui se vantait joyeusement d’être le fils, à dix-huit ans, d’un homme né dans la servitude, me racontait que, dans le sac de Timimoun, son oasis natale, en 1958, les légionnaires jetaient contre les murs les nouveau-nés dont la cervelle éclatait et coulait dans les rayures du pisé jusqu’au sable. » — Pierre Guyotat, Vivre.
Des dizaines de mouches volent partout autour de moi. C’est répugnant. C’est la multitude de pattes qui me répugne. Elles s’accouplent sur mes avant-bras. J’ai la sensation qu’elles me chient dessus. Je n’arrive pas à m’en débarasser. Je ne peux me concentrer sur rien. Je change de pièce, de place, rien n’y fait, elles me poursuivent. Et toujours cet incessant bourdonnement. Il y en a sur les murs, au plafond. J’ai beau écraser toutes celles que je peux, il en revient toujours, et au sol il y a les cadavres, et c’est pire, c’est le bourdonnement sur le cimetière, c’est la prise entre deux, c’est mon étrange corps trop grand au milieu du carnage.
« Il dit qu’il se jettera dans le lac avec des cailloux dans ses poches pour couler tout de suite avec un bandeau devant les yeux. Il dit que tout au fond du lac, les morts du château l’appellent chaque nuit, et qu’il met ses mains sur ses oreilles pour ne pas les entendre. » — Marie Redonnet, Silsie.
J’ai déposé Cécile à la gare de Lamballe ce matin. En rentrant, j’ai remarqué qu’on avait détruit une maison à côté des lignes de chemin de fer. Ça fait comme un trou dans le paysage. Les voisins de ma grand-mère ont fait un trou identique dans le décor en détruisant l’orme au fond du jardin. Je dis détruire parce qu’il y a désintégration. Je connaissais un des enfants qui vivaient dans cette maison. Il me maltraitait en cours au début du collège. Je crois qu’ensuite ma mère l’a engueulé et c’est pourquoi il a arrêté. Il surnageait dans ma mémoire à cause de ces maigres événements mais depuis ce matin il est comme mort, enfin, anéanti dans le même souffle qui a démoli sa maison. Tout s’emporte en ruines et notre regard passe ensuite définitivement au travers.
Dans le manga Bleach, certains ennemis paraissent en utilisant des brèches. On voit, dans le dessin de la ville, une fissure se former, puis s’ouvrir, puis une matière grise semblable au bruit des vieilles télévisions peint l’arrière-plan, et alors la menace apparaît. C’est l’imminence du mal qui est stimulante. Sa capacité à passer au travers de tout ce qu’on estime être stable. À exploiter ces trous. À surgir du néant.
Il y a sur le Journal LittéRéticulaire une lecture renversée de la chèvre de M. Seguin particulièrement éclairante quant à la façon dont on nous enseigne à avoir peur du loup quand il faut avoir peur du maître.
Ces dernières semaines, je n’ai pas du tout pu travailler sur mes projets en cours. Il est grand temps de me remettre au travail.
Les choses avancent leur train. J’ai lu Des arbres à abattre. Je pense qu’est décrite la bonne attitude à adopter en société : se foutre de tout, et de tout le monde. Ne vivre que pour son art. Ne croire qu’en soi. Cesser d’écouter les immondices des vieux bourgeois de salon. Cracher sur les prix. Cracher sur toute espèce de reconnaissance académique. Elle qui tue le parcours sans cesse à revoir de mort. Elle qui jalonne l’oeuvre qui n’a pourtant d’autre jalon que le vide final, et l’impulsion initiale, qui est une impulsion d’avant l’enfance, d’avant même l’existence. Ne rien vouloir. Ne rien espérer, surtout. Crever plus tôt si nécessaire.
Les lignes s’arrangent, quand les herbes se couchent sur le champ une faille s’ouvre, à l’intérieur un autre champ encore, le même, identique, et dans ce champ une ville, dans le champ ouvert depuis la faille du premier, on aperçoit les immeubles, qui se déforment, détruits, le champ original se referme, on n’aperçoit plus rien, la ville est en gouffre derrière l’image immédiate depuis ma fenêtre, en gouffre dans le vide de derrière le champ, dans le gouffre refermé, tout ce qu’il y a en creux dans le paysage autour, tous les bâtiments poudre, et tant pensent à l’arrêt complet du regard, mais ouvrez entre, il y a toujours de quoi découvrir, toujours une ligne à tracer, une faille à ouvrir, un gouffre où pénétrer. Toujours une issue pour fuir.
« C’est bien mal dire qu’autour d’une invisible blessure un homme amoncelle ce que cachera la blessure cependant qu’il la montre du doigt. Il me semble donc que chaque personnage n’est qu’une blessure disparaissant sous les ornements et apparaissant par eux. » — Jean Genet, Les Paravents.
Bataille le dit (en gros) : tous les hommes sont profondément violents, cruels, et sauvages. Durant l’acte sexuel, ils le font subir aux femmes. C’est l’érotisme. Pour être un peu plus précis, c’est la distance entre l’immonde souillure et les hauteurs de l’esprit qui provoque l’érotisme durant le rapport amoureux. Ce qui nous distingue des bêtes. C’est une théorie qui date des années 1950, et je pense qu’elle est profondément idiote, car sexiste, dangereuse, et inégalitaire. Et je passe sur la notion de femmes comme “réceptacles à désir”.
Dans le cadre d’une conversation, j’aurais sûrement quitté la table où Bataille aurait tenu de tels propos. Heureusement, dans un livre, j’ai eu tout le loisir de le contredire à mon bon vouloir, et de découvrir (chez le même homme pourtant !) de sublimes réflexions à propos de Sade. Comme quoi, cela illustre bien ce que j’écrivais il y a peu : rien ne remplacera la somme littéraire. Bataille a eu de bonnes intuitions sur la cruauté masculine, mais je crois qu’il s’est royalement planté en voulant en faire une démonstration de l’origine animale de l’homme. Les hommes cruels et violents sont des bourreaux, pas des animaux. Ce n’est pas l’instinct originel de l’homme, mais sa violence construite, sa justification, son excuse. Cette cruauté, pourtant, n’est pas excusable.
Chez Fanon, il y a tout ce dont la société a besoin pour éradiquer les hommes. Il faudrait s’y mettre. Construire enfin quelque chose de neuf, et de sincère.
La grande faucheuse, c’est le capitalisme. De la boue, elle n’a pas fait de l’or, mais de la boue plus crasse encore.
Un peu fatigué devant tous ses livres sur la violence, et non violents.
Encore une fois. Arrivés avant-hier soir à Tréboul, à côté de Douarnenez. Le lit principal avait les lattes et les draps moisis. Dormis sur un matelas de fortune, le nez proche d’une moquette pleine d’acariens réactivants mon asthme.
Été sur l’île Tristan, où résidait un écrivain, et sur laquelle il est possible de se rendre à marée basse à l’aide d’un chemin aménagé entre le sable, la vase et les rochers. Un drapeau rouge se lève à son extrémité quand on n’a plus le droit d’y accéder, quand l’heure est venue enfin de rentrer chez soi. Les intérieurs sont vides, le jardin à peine entretenu. Derrière, la végétation recouvre le phare.
« Mais pouvons-nous échapper au vertige ? Qui oserait prétendre que le vertige ne hante pas toute l’existence ? » — Frantz Fanon, Les damnés de la terre.
J’ai des choses à dire sur L’Érotisme de Bataille et aussi sur le coin où j’ai passé la semaine dernière, dans la baie de Somme. J’ai un peu moins de choses à dire sur des lunettes de soleil achetées récemment, sur mon immobilisme, sur le temps étouffant, et sur le reste encore. Il y a toujours de quoi dire. Je ne m’inquiète pas spécialement.
Vous imaginez si vous étiez seul témoin de la chute d’une bombe atomisant votre ville ? C’est l’image que j’ai chaque jour en tête.
Je suis désolé, j’avais pourtant refusé deux médiocres manuscrits publiés durant cette prochaine rentrée littéraire. On pourra pas dire que j’ai pas agi.
J’ai le sentiment que plus on lit, moins on se sent légitime dans l’expression de notre opinion (quelque soit l’idée qu’on défende, d’ailleurs). Les livres sont construits sur le développement d’une pensée, dans toute sa précision, dans tous ses angles, ses failles, renoncements et aboutissements. En somme, il y a là-dedans largement de quoi être contredit sans même avoir à émettre le moindre son. L’opinion est l’exact inverse, et ne résulte que d’un affect flou. Ainsi, prendre la parole implique, à mesure de la lecture, un poids de plus en plus important, une valeur, qui demande de la place pour se développer, du temps, et de l’écoute. Les plateaux de télévision actuels ne sont que d’opinion, et l’on voit aisément où leur médiocrité mène les téléspectateurs (peur, imprécision, stigmatisation, etc.) Lire tue l’opinion, et ses médiums, car c’est un déploiement de la pensée qui n’a d’égal nulle part ailleurs (sauf peut-être dans les conférences, ou les cours). À terme, lire rend muet.
« Car enfin, il faut en prendre son parti et se dire une fois pour toutes, que la bourgeoisie est condamnée à être chaque jour plus hargneuse, plus ouvertement féroce, plus dénuée de pudeur, plus sommairement barbare, que c’est une loi implacable que toute classe décadente se voit transformée en réceptacle où affluent toutes les eaux sales de l’histoire ; que c’est une loi universelle que toute classe, avant de disparaître, doit préalablement se déshonorer complètement, omnilatéralement, et que c’est la tête enfouie sous le fumier que les sociétés moribondes poussent leur chant du cygne. » — Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme.
Puis je me dis, écoutant une énième fois Ok Computer et Kid A (composés en 1998 et 2000) que peut-être les ordinateurs sont déjà datés, passés, et que la poétique d’aujourd’hui est dans la déconstruction de ces machines-là, dans l’épuisement de l’esthétique numérique, dans la mort du virtuel ; dans la mort du virtuel après celle du réel ; donc, dans une nouvelle étape de paysage qui n’a pas encore de nom.
Nocturama de G. Mar m’a beaucoup intrigué. Ces aplats de choses, d’événements, comme cloués sur un tableau, et mis là à disposition, éternels, définitifs. Mais je les ai trouvés d’un autre temps, qui n’est plus le nôtre, qui n’est plus l’aplat contemporain imcompréhensible dans lequel moi je vis (et qui n’est celui de personne d’autre).
« Je ne décris rien, j’essaie plutôt de comprendre. » — Julio Cortazar, Les armes secrètes.
J’aimerais vivre plus sommairement, plus simplement, plus couramment. C’est beaucoup de courage et de travail pour se débarasser du futile ; ne passer son temps qu’à lire, écouter de la musique, faire à manger, travailler. C’est beaucoup de concentration pour ne pas se disperser.
Aucun besoin d’écoutes sournoises pour déceler quoi défaille en chacun de vous.
J’ai la main droite en douleur, toute crispée aux nerfs d’un mal inconnu. Je commence à distinguer clairement la peau de mon crâne, un peu plus blanche que celle de mon visage, à peine différente, pourtant si hostile. (Cécile me dit : Tu es beau quand même. Tu es beau toujours.)
Je passe ; tout est rasé derrière moi, sans le moindre geste, le décor s’écroule, le décor et les hurlements, aux hurlements succèdent les déflagrations, aux déflagrations bien pire encore, et sans même le début d’une secousse les bâtiments s’effondrent, les centrales explosent, la chose faite de main d’homme vrille et cède. Tout est encore là pourtant, intact, et j’ai beau vérifier sur les parois les ruptures, je ne retrouve rien. De ce que j’ai imaginé détruire tout tient encore. De ce que je croyais découvrir sous la misère. Par le même ciment tenu. Les mêmes cables. Tout semblable à auparavant. Les passants me pointant toujours du doigt, toujours les globes oculaires vides, et leurs peaux faites de miroirs, toujours moi prisonnier de mon image, au centre de cet affreux gouffre impossible.
Et tous ces bavards intolérants qui m’épuisent.
« Mais de la honte, de l’impuissance et de la tristesse, naquit quelque chose qui, je crois, était le désir de devenir poète, c’est-à-dire de pouvoir exprimer ce que l’on éprouve lorsqu’on pleure un être disparu, lorsqu’on a été aimé, lorsqu’on reste seul. » — Stig Dagerman, Tuer un enfant.
Quand je rentre d’une semaine à l’extérieur, je ne sais jamais par quels mouvements réenclencher ma routine.
La ferme est en feu, sans doute quelqu’un qui aura oublié un briquet dans la paille. Tous là devant le noir de flammes et la cendre des débris, à peine touchés par le choc, moins encore par la peur. Il y aurait quelqu’un là aussi, il parait, quelqu’un dit, parmi la foule, qu’il aurait vu, quelqu’un parmi le feu. Les pompiers n’auront que des gravas à arroser ; l’eau s’épanchera depuis en rigoles, les enfants dedans nus ensuite ; ils croiront à l’été ; le beuglement des vaches comme balancement des vagues. Si jamais les journaux en parlent, et sans doute la présence d’un reporter va dans ce sens, alors il faudra taire qui a oublié le briquet, comme qui s’agitait là dans le feu que chacun tait déjà. Et puis tout se disperse, et ainsi les rumeurs derrière la fumée, et les lumières dans les salons couvrent le silence de qui sait, qui connait celui qui dans le feu sans doute a définitivement disparu.
Étudier Laurent Gaudé au bac me désespère davantage que ses incompris tigres bleus.
Je suis passé à la librairie Charybde jeudi (ou vendredi ?) dernier, trente minutes avant la rencontre avec un auteur de publie.net. J’aurais pu croiser Guillaume, et l’ai dit à Cécile. J’ai préféré retrouver au plus vite le plat mijoté ; il ne m’en voudra pas.
Dans la pénombre là ils guettent, et autour d’eux les souris volent. On pourrait les distinguer à travers les phares des voitures, mais depuis quand plus aucune voiture ne passe. Alors à peine les lampadaires permettent des les esquiver. Ils liment leurs coutelas à hauteur d’yeux. Il faudrait les dépasser pour apercevoir leurs dos lacérés de fissures.
Bizarrement, quand les mièvres couples projettent leur futur, ils ne l’imaginent jamais coincé dans le capiton d’un cercueil.
Pierre Jourde dit là tout ce qu’il y a à dire sur le journalisme actuellement.
Un ami de ma grand-mère, avant-hier : Sans faire de racisme, le problème dans les bus à Paris, ce sont les noirs. Quoi répondre ? Où lacérer ?
« Tout sera clair, d’une clarté de plus en plus haute et de plus en plus profonde, et tout sera froid, d’un froid de plus en plus effroyable. Nous aurons à l’avenir la sensation d’un jour toujours plus clair et toujours plus froid. » — Thomas Bernhard, Discours lors de la remise du prix de littérature de la ville hanséatique libre de Brême.
Depuis quelques temps, je me dis : ma grand-mère n’a comme plus de sensations ; elle rapporte tout aux faits. Peut-être est-ce la mort de mon grand-père qui l’a ainsi, définitivement, noyée. Mais enfin elle se contente de décrire ce qu’elle voit, à quel point le vent souffle derrière la baie-vitrée, la façon dont sont petits ces étrangers à la télévision, de quel côté se déplace l’aiguille sur le baromètre. Ainsi tout est, selon, et ma grand-mère s’adapte, acquiesce. Elle n’est plus d’aucune force sur ce qui l’entoure. Elle tente par ses maigres moyens de figer ce qui peut encore se maintenir. Comme elle aurait aimé figer l’instant d’avant la mort. L’instant d’avant la tristesse. Comme elle aimerait ne plus remarquer à quel point le vent souffle, mais à quel point mon grand-père l’aime. Comme toujours. Depuis toujours. Jusqu’à toujours.
Alors que je voulais l’aider à enlever un morceau de sa pelouse où elle aimerait déposer des graviers (question d’entretien), ma grand-mère n’a eu de cesse de redoubler de précautions pour ne pas que je fasse ce travail, allant jusqu’à cette phrase étrange : Laisse si c’est trop dur, les hommes vont faire. À plusieurs reprises, quand il s’agit de travaux manuels, elle me pense incapable de quoi que ce soit. Incapable de me servir de mes bras. Incapable de soulever une brouette, de couler du ciment. Si elle ne me considère pas comme homme à cause de cela, que suis-je ? Quel est mon étrange genre ? Où me place-t-elle ? Sans attendre, j’ai saisi cette bêche, et loin de ses yeux j’ai ôté la pelouse, j’ai scié ces mottes, j’ai fait terre rase, et même si dans son rapport à moi je sais pertinemment que ça n’a rien changé, qu’elle me considère toujours comme une moitié de ces hommes-là aux avant-bras prononcés et aux manières de boeufs, tout au moins sur l’instant je me suis approché un peu plus.
Quand, à Matignon, je regarde le journal télévisé, j’ai l’impression de n’entendre que “blablablablabla”, que ce soit quand le présentateur, les intervenants, ou les inconnus interrogés parlent. Je ne comprends rien à ce qu’ils racontent, je les trouve tous idiots, insignifiants, je me demande pourquoi ils se fatiguent ainsi à avaler du vide. J’ai des envies de rire autant que de les insulter. Et puis ils ont l’air fier de leur parole, ils doivent imaginer importante cette parole dérisoire, ils ne se rendent sûrement pas compte d’à quel point ils sont inutiles ; néfastes, même.
Le silence seul nous sauvera tous.
(Ce que je cherche avidement, c’est – comme je l’écris à la fin d’une des parties de Saccage – de sentir s’épanouir sur mon visage la chaleur retrouvée du foyer.)
N’est-ce pas la détresse qui charme en l’autre ?
L’épisode 15 de la saison 5 d’Adventure Time était justement sur les glitches. Les deux héros étaient confrontés à un virus (mis en place, évidemment, par le méchant habituel) qui déformait et évaporait aussi bien les habitants que le paysage. Tout retournait au néant après avoir éprouvé l’amas de formes et de couleurs propre à cette métamorphose étrange. Les héros rentraient ensuite dans un voyage vers la disparition de leurs corps – ils n’étaient plus à la fin que des têtes – pour exterminer l’entité démoniaque destructrice, et revenir des tréfonds de l’impensable numérique (c’est-à-dire un ensemble d’éléments incohérents superposés). Alors tout a repris sa forme originale. L’épisode s’achève sur une image du méchant capturé par le mur d’une maison reconstruite, rétablie.
« Me mets plutôt au travail quand ça ne va pas très bien, quand ça va bien, quelle idée, on reste heureux, on s’occupe de ce bonheur-là, lorsque cela va moins bien, on se met au travail, ce que je dis, on essaie d’y voir clair. Quand on est totalement désespéré, on ne fait rien, on tente de se maintenir en vie. » — Jean-Luc Lagarce, Du luxe et de l’impuissance.
J’ai acheté vendredi le Quarto de Louis-René des Forêts qui vient tout juste de paraître. Je n’aime habituellement pas les volumes d’oeuvres complètes, mais comme la sienne est dispersée, ça m’évitera de partir en quête des derniers livres qui me manquent (la même practicité que pour Gracq en Pléiade). Il y a beaucoup ; des inédits, des dossiers, etc. Par exemple, il y a cette phrase, dans un texte de revendication politique :
« Aux écrivains, donc, aux écrivains surtout, en raison de l’aptitude qui est la leur de déceler sous le clinquant des mots les incertitudes, les trahisons et les reniements de la pensée, de trouver en eux la lucidité et le courage nécessaires pour s’opposer à ce qui, en matière politique, comme en toute autre, est de nature à discréditer le langage. »
Et cet autre morceau, dans Face à l’immémorable : « Ce qu’on doit attendre du langage, c’est de nous déraciner de nos habitudes […] ».
(Seule déception : manque de documentation sur son environnement de travail – à part quelques petites photographies –, son bureau, son matériel, ses lieux de vie. Peut-être que ça n’intéresse que moi.)
On a fait bien des comparaisons à propos de Farigoule Bastard. Pour y aller de ma petite sensibilité aussi, j’y retrouve beaucoup de Marie Cosnay. À mon sens ils vont là : dans une reconstruction de la langue. J’ai le mot, mais je serais incapable de développer davantage ma pensée.
« Il reste assis un jour. Il ignore les passants qui l’ignorent de même. Il attend, il n’attend pas. Il ne fait rien, il ne fait pas rien. Il est hagard, absent, les yeux en creux. Il est mort, peut-être, ou il frôle le moment. » — Benoît Vincent, Farigoule Bastard.
En pleine écriture de Et mon visage est d’homme, je tombe dans L’aleph sur le récit La demeure d’Astérion. (Et c’est tellement brillant, tellement concis, tellement ça). Des rencontres aussi troublantes dans mon parcours deviennent monnaie courante. Comme si, alors que je pensais m’aventurer en forêt vierge, je retrouve les cailloux déposés par le marcheur précédent. J’aimerais aller là où personne n’est jamais allé.
Il y a aussi, outre son entrée dans Le Livre des êtres imaginaires, au moins deux poèmes consacrés au Minotaure dans L’or des tigres. Et encore d’autres histoires à propos de labyrinthes. Je me retrouve dans ces obsessions. On a de ces affinités inattendues parfois.
J’avais mal à une dent hier soir. Je pensais que ça serait passé ce matin, et puis non. Pour me préserver, je ne mâche plus que d’un côté (le droit).
(Je note tout pour n’avoir pas à me souvenir.)
« Toute destinée, pour longue et compliquée qu’elle soit, comprend en réalité un seul moment : celui où l’homme sait à jamais qui il est. » — Jorge Luis Borges, L’aleph.
salut — je t’ai vue je suis là-bas — ma tente est là-bas — ça fait longtemps que t’es au camping ? — t’es avec quelqu’un ? — c’est des amis ? — j’aime bien ton cul — quand je vois ton cul de là-bas — de ma tente — ça me donne envie de brûler — de brûler d’autres personnes je veux dire — tu me pousses au crime je pourrais dire — t’aimes pas c’que je dis ? — ça te colle la gerbe ? — quand je te vois je t’imagine me gerber dessus — souvent — même la nuit dans mes souvenirs — c’est des images — ça me rend — massacre — ça me rend massacre — tu piges rien — tu me rends massacre — quand je te vois je me dis : — t’es pas une pute — t’aimes pas les mains sales — tu veux pas de mes doigts de terre — ça te dégoûte — ça te dégoûte quand je touche ta jupe — tu pourrais dire — c’est pas mes doigts qui t’empêchent de dire — rien qui te retient — moi non plus — c’est pas loin le massacre — tu vois — c’est jamais si loin qu’on croit
(très bas : — c’est jamais si loin qu’on croit)
Cette allergie au pollen me paralyse, engourdit mes yeux. Je ne suis plus capable de rien, et je déteste ça. Je ne supporte pas d’être malade. Dès que je perds toute faculté de penser (et donc, par prolongement, de créer), je désespère. C’est la pire amputation qu’on puisse me faire.
« LE CHEF DE LA POLICE, il gifle Irma qui tombe sur le divan : Et ne chiale pas, ou je t’écrase la gueule, et je fais flamber ta turne. Je vous fais griller par les cheveux et les poils et je vous lâche. J’illumine la ville aux putains incendiées. (Très doucement.) Tu m’en crois incapable ? » — Jean Genet, Le Balcon.
Je lis cette phrase chez Guillaume : La vue sur la ville est superbe (mais la ville est fictive), et j’ai l’intuition que c’est une phrase importante. Pas importante dans son billet, mais importante dans l’absolu. Dans ce qu’elle pose comme concept face à la réalité. À quel point elle déforme la posture romantique de contemplation. C’est-à-dire qu’il y a quelque chose qui s’impose à nous dans sa non-existence, dans sa difformité. C’est un paysage qui n’existe pas et qui pourtant est évident.
Valéry disait : On ne pense pas des mots, on ne pense que des phrases. Et je rajoute : Je pense en paragraphes ; sinon en failles.
La vie c’est apprécier la vue, et après scier la branche.
Je repense souvent à Vie des hauts plateaux de Philippe Annocque, et plus j’y repense, plus je trouve ce livre enthousiasmant. Je retourne lire certains paragraphes avec en tête les scènes dans le jeu vidéo, et il n’est pas rare que j’éclate de rire. Avoir réussi à comprendre, et à transcrire, l’absurdité de ces dispositifs virtuels, ces instants quotidiens, qui passent comme tel, mais qui n’ont rien de quotidien, qui n’ont rien de “réel”, est particulièrement intelligent. On dirait parfois du Beckett. On dirait de la pure tension dramatique beckettienne, dans le plus simple et évident dispositif ludique. C’est-à-dire que les pires situations, les pires atrocités, se déroulent sans qu’aucune anomalie ne puisse être décelée. Les incendies, la polygamie, les morts inattendues : tout va de soi. Et comme d’habitude, ça passe inaperçu.
Beaucoup d’écrivains anglosaxons contemporains n’ont aucun goût pour l’ellipse, et c’est, à la lecture, particulièrement épuisant.
Décidément, les invités de La Grande Librairie, dans ses émissions spéciales consacrées aux bibliothèques idéales, n’en finissent pas de me désespérer. On aligne force trous du cul pour chier sur des lingots d’or. Eh allons-y un peu sur Céline, et puis Stendhal, avec des arguments à déraciner les arbres, c’est d’une consternation à toute épreuve. Chaque année un peu plus. Dans deux ou trois ans ça en tuera derrière leurs écrans.
« La pastorale chrétienne a inscrit comme devoir fondamental la tâche de faire passer tout ce qui a trait au sexe au moulin sans fin de la parole. » — Michel Foucault, Histoire de la sexualité I.
Ce que j’ai fait avec cette page web, c’est un média qui ne répond qu’à ma propre logique.
L’horizon se couvre de nuées violettes quand l’extérieur sent la bruine. Les fenêtres se dissolvent dans le brouillard ; bientôt il devient impossible de distinguer la moindre silhouette. Personne ne circule dans la rue sinon se noie, les voitures frôlant déjà carcasses. Très tôt les volets sont fermés. On imagine comme tout empire ; on s’abstient d’y croire. Personne n’est à l’abri d’une pierre enflammée depuis les cieux. Personne n’a une toiture assez solide pour supporter un tel projectile. On allume la télévision et on voit d’autres comme nous pulvérisés par les décombres. Il n’y a aucun choc car il n’y a aucun impact. Tout demeure intact. On s’étonne d’être encore en vie. On s’isole et on meurt malgré tout. Et d’autres ensuite recommencent. Dans les jardins il y a des tombes. Sur les tombes, il n’y a pas de dates. De noms pas plus.
Une dernière pensée pour la première douleur.
Que reste-t-il de Sylvie un an et demi après ? Un t-shirt offert à Noël, tassé en bouchon au fond de ma commode. Le reste est aux ordures ; le matériel, ce qui ne l’est pas aussi.
« La minute la plus quelconque est plus profonde
Et plus diverse que la mer. Brève, je sais,
Est cette vie aux longues heures. Mais il est une
Merveille obscure, un magnifique guet-apens,
La mort, cette autre mer, cette flèche en suspens
Qui nous délivrera du soleil, de la lune,
De l’amour. J’avais le bonheur. Il est passé. » — Jorge Luis Borges, L’or des tigres.
Désormais, j’éprouve moins de pudeur à parler de ce que je crée. Je me revois encore il y a quatre ou cinq ans, incapable d’expliquer aux autres ce qui pouvait m’animer ainsi des journées entières, ces monstres qui se répandent depuis un coin obscur de mon cerveau, un coin qui est en fait, et ça je l’ai compris plus tard, mon cerveau entier. Je gardais cette terreur pour moi. Je pensais qu’il n’y avait rien à comprendre, rien à ouvrir, qu’il fallait tenir muette ma tourmente.
Et puis, à mesure du mensonge… Aujourd’hui, il m’arrive de plus en plus fréquemment de discuter de mes travaux en cours, avec Émilien ou Guillaume, et non pas d’y trouver de la force, mais juste une plus honnête réalité, un plus simple rapport aux choses.
Mes draps sont noirs, ainsi que les taies d’oreillers, les lattes du parquet, les meubles, les ampoules, la lumière émise par les ampoules, les ombres projetées par cette même lumière, les portes, le paysage au dehors, les immeubles plus loin après, mes ongles, mes bras, les vêtements que je porte, l’émail de mes dents, l’iris de mon oeil, tout, rien ne me distingue, rien ne filtre, il n’y a aucune idée que je puisse être là, dans l’esprit d’aucun étranger, eux-mêmes noirs d’y penser.
« dans le monde
où la musique a un autre air
les pas comptés un autre nombre
Et la glace un autre reflet » — Pierre Reverdy, Plupart du temps.
Je confiais la semaine dernière à Guillaume mon sentiment quant au déclin de certaines maisons d’édition que j’appréciais, à cause d’un manque de renouvellement et d’audace dans leurs choix éditoriaux. Les Éditions de Minuit sont à mes yeux le meilleur exemple de cette tendance à la redite. Alors qu’elles ont publié des années 50 à 90 parmi les plus belles choses que j’ai pu lire (Duvert, Pinget, Guibert, Koltès, Echenoz), elles entrent à mesure dans du facile à produire. Comme elles publient peu, chaque auteur est largement mis en avant, mais Vincent Almendros, Julia Deck ou la prochaine Marion Guillot ne sont que des sous-Toussaint ou des sous-Echenoz. Des romans faciles, sans enjeu, et avec en substance ce qu’on a déjà lu d’une façon similaire auparavant. Leur exigence n’est donc plus que poudre aux yeux.
Je ressens la même répétition avec Verdier, Seuil ou Verticales (Gallimard et Grasset, je n’en parle même pas), mais le paragraphe au-dessus résume assez bien ma pensée, et il suffit de transposer les exemples en fonction des auteurs et des sous-auteurs de chaque maison.
Alors, plus que jamais, il faut se porter vers les marges, vers les riens, les solitaires, qui travaillent en silence et déposent la modernité au fond des présentoirs, tout au bout des tables, là où personne ne pense plus à tendre la main.
Je n’ai pas grand chose à dire à part ça. Les jours passent avec joie, et il n’y a pas besoin de les préciser.
À l’instant, quatre adolescents viennent de saccager un sac poubelle posé sur le trottoir. En cachette, comme s’ils commettaient là le pire des crimes, ils se sont acharnés dessus avec plaisir, et moi sur mon balcon, invisible, les observant s’agiter, rire à la vue des débris éparpillés sur le sol, avant de s’éloigner le long de la rue. Heureusement qu’il y a de ces imbéciles pour avoir quelque chose à dire. Heureusement qu’il se passe quelque chose en dehors de notre tranquilité engourdissante. Sinon, imaginez un peu, tout ce rien qui nous avalerait, comme il serait désagréable alors ! comme on s’ennuierait !
« Nous ressemblons tous à l’image qu’on se fait de nous. Je sentais que les gens me méprisaient et je me méprisais moi-même. À l’époque, et surtout dans ce milieu-là, il était important d’être courageux ; je savais que je ne l’étais pas. » — Jorge Luis Borges, Le rapport de Brodie.
Je crois avoir déjà écrit à propos de mes trajets à l’usine la première année de travail, quand je n’avais pas encore le permis, mais enfin, je vais revenir dessus. La maison de mon père se trouvait à l’exact opposé de là où se situait l’abattoir, et je faisais la distance à vélo, aux alentours des cinq heures du matin. Lamballe est une petite ville d’à peine plus de dix milles habitants, et je pouvais à mon aise prendre les routes à contre-sens sans risque de me faire renverser. J’aimais aller ainsi, dans les premières heures de l’été (d’ailleurs en juin il fait tout juste jour), croiser parfois des néons étranges filtrer depuis les garages, ou d’autres adolescents saouls revenant de fêtes dans des maisons de campagne. Le trajet retour était beaucoup plus pénible : là les voitures filaient dans tous les sens, ma polaire me collait à la peau sous le soleil urbain, et j’étais épuisé de ma matinée à ne pas réfléchir.
Il me prend des fantasmes de circuler ainsi au petit matin dans la Terre entière, mais bien sûr ces quelques heures fondent bien vite, et aussitôt ce laps passé, tout m’énerve, tout me lasse.
On se voyait avec Victoria, et puis on ne se voit plus. Le temps dissout tout, sans raison.
« Je fume en me rasant, bien avant le petit-déjeuner ; je ne cesse de me regarder dans les miroirs. Je sais que j’ai une sale gueule. » — Jean-Patrick Manchette, L’affaire N’Gustro.
Je lis en ce moment Le Roi vient quand il veut, un recueil d’entretiens de Pierre Michon que je voulais absolument posséder puisqu’il n’est plus édité. C’est parmi les livres d’entretiens les plus éclairants sur mon propre travail, et non sur le travail d’un écrivain par rapport à lui seul ; et pourtant, je me sentais très loin de Michon dans sa manière d’appréhender la construction de ses courts ensembles romanesques (davantage récits que romans selon lui, d’ailleurs).
Récemment, j’ai eu quelques discussions, notamment avec Guillaume, à propos de la longueur de mes textes. Avec Saccage, je me suis forcé à produire un roman long (même si le terme a peu de sens) alors que ça n’est pas dans ma nature, et que toute contrainte, sur ma personne et sur mon pouvoir de création, a un effet néfaste. Le texte, au départ, était un spontané essouflement du langage, et j’ai cru nécessaire de lui tenir la bride. Je pense que ça a été une erreur, mais désormais c’est trop tard, le mal est fait. J’ai, comme Michon, besoin que d’un jet unique (même si recommencé des dizaines de fois) sorte toute la matière que j’ai besoin d’exprimer. Et je suis incapable de le faire sur autant de pages. Je n’ai jamais bien travaillé en me forçant à adopter une forme qui n’était pas la mienne (d’où mon inadéquation totale avec des exercices scolaires comme la dissertation).
J’ai parfois parlé ici, à peine ironiquement, de livres de deux lignes qui me combleraient. Je pense aujourd’hui qu’ils sont la voie à suivre, le sens réel et sincère de ma parole. Il y a souvent une distance entre notre manière de créer et notre représentation au monde. Parfois, elle concorde (je pense à Echenoz, ou Toussaint, qui ont un vrai succès public et pourtant sont eux-mêmes dans leurs productions). Parfois, pas du tout. Le plus souvent, pas du tout. Et il faut combattre la tentation de se mouler dans une forme qui n’est pas notre pour paraître aux yeux du monde. Car qui alors parle aux autres ? Et que trouve-t-on au bout du compte, sinon sur notre cintre la veste d’un fantôme ? C’est un sacrifice qui est grand, mais nécessaire, pour toucher à la sincérité, à la pureté, de l’écriture.
Je ne m’échinerai plus à construire long si je ne suis pas ainsi. Peut-être quelqu’un se fera le porte-parole de cette façon de voir le monde et comprendra l’intérêt de la défendre. Peut-être pas d’ici ma mort. Dans ce cas, j’aurais toujours ma propre satisfaction pour combler le manque. Et il existera bien un inconnu curieux ensuite pour me retrouver.
Une fois fini, on est comme perdu, on ne sait plus vraiment quoi faire, quelle direction se donner, on revient en arrière pour reprendre ce qui est désormais terminé, et on commet tous cette erreur de débutant de vouloir recommencer, et évidemment tout ce qui suit est raté, complètement raté, c’est sûrement le ratage le plus complet, parce qu’il est impossible d’avancer, parce qu’on ne parvient pas à assumer cette mort première qui doit se renouveler encore, parfois des dizaines de fois, sans aucune raison, jusqu’à l’ultime, la dernière, la seule réelle, effective, qui nous oubliera, celle la plus supportable en fait, la seule que nous ne pourrons jamais absurdement revivre, et c’est tant mieux, la seule qu’on laissera tranquille, mais évidemment on ne veut jamais se rendre à l’évidence, parce qu’on perd trop, parce que dans la construction on a fourni un effort trop grand, et trop unique, un effort qu’il nous semble impossible de renouveler, sinon en claudiquant, sinon en se plaignant, et alors l’édifice construit, le suivant, sera toujours moins bon, toujours moins impressionnant, mais on se force quand même, puisqu’on n’est bon qu’à ça, puisqu’il faut se donner un sens quand même, puisqu’il s’agit de faire bonne figure, et de ne décevoir personne, surtout pas l’image qu’on se fait de soi.
« Si les femmes sont très visibles en tant qu’êtres sexuels, en tant qu’êtres sociaux elles sont totalement invisibles et en tant que tels, elles doivent se faire aussi petites que possible et toujours s’en excuser. » — Monique Wittig, La pensée straight.
J’ai marché un peu dans le village, sans croiser personne sinon moi dans les miroirs de la boucherie. Je n’avais pas tellement peur. Il ne faisait qu’à peine nuit et je suis habitué à errer en solitaire. Même les oiseaux sont partis. Il y avait trop ici à vendre pour que tout puisse être racheté. Aux panneaux ont succédé les débris. Aux débris la moisissure. À la moisissure, les insectes. Et depuis, les insectes aussi ont disparu. Tant qu’il reste l’électricité, j’allume la lumière dans les maisons et je les regarde depuis le haut de la colline. J’ai l’impression que les places s’animent, que les habitants se préparent, qu’il y aura un banquet d’ici peu, et je me précipite en courant pour tous les rejoindre. Je me laisse tromper facilement. Je danse un peu seul au milieu du vide, et ensuite j’éteins les lumières. Ça me prend toute la nuit. Il ne fait jamais nuit dans mon village. Je dors parfois mais jamais pendant la nuit, ça serait trop dur. Ça me rappelle de terribles démons, de ces terribles démons d’après l’amour, quand tout s’enfuit sinon la détresse. Parfois j’entends parler et puis je me souviens qu’il n’y a personne pour parler alors j’arrête d’entendre. J’ai déjà imaginé partir. J’ai l’impression qu’il n’y a rien pour moi ailleurs. Pas plus qu’ici, j’entends. Au moins je fais ce que je veux. Je suis seul comme je veux, triste comme je veux, au bout de l’enfer comme je veux, oublié comme je veux.
Belle et Sébastien m’a donc fait penser à la fois aux fictions de Marie Redonnet, et à l’ambiance de Twin Peaks. J’ai toujours été fasciné par les microcosmes, d’autant plus lorsqu’ils ont une forte connotation symbolique. Belle et Sébastien sont finalement les deux personnages les moins intéressants de la série, quand il y a à côté le village sans visage, animé uniquement par le mensonge et la rumeur, en ligue contre César, cet homme perdu avec sa famille au sommet, et gardant seul le chemin vers l’ailleurs. Et la neige qui recouvre la solitude, qui recouvre le mal aussi que Norbert amène depuis la ville et les malfaiteurs. La neige qui recouvre les tentatives d’amour, qui assèche tout, qui enferme les hommes au bar, les hommes dans leur labeur infini pour consolider le barrage. C’est un monde clos particulièrement sournois, et aveugle ; cruel. Dommage qu’il ait été mis au service de cette mièvrerie totale.
« J’ai parcouru le monde comme un veilleur qui étouffe le bruit de ses pas dans la ville endormie. » — Lucien Ganiayre, L’orage et la loutre.
J’ai passé quatre jours (qui au départ ne devaient qu’être deux) chez Cécile, en banlieue parisienne. Elle m’a fait visiter les environs, le parc de Sceaux (tellement grandiose que j’en suis resté quelques instants immobile), la roseraie et son parc mitoyen, d’autres choses encore. J’ai regardé pour la première fois cinq épisodes de Belle et Sébastien (dont j’aurais étrangement beaucoup de choses à dire) avec sa soeur. Nous sommes allés à une lecture / entretien à propos de Borges au théâtre de l’Odéon, et c’était magnifique, et émouvant, et particulièrement drôle (Hugo Salviano ne pouvant s’empêcher de malmener la journaliste creuse).
Nous avons discuté avec Émilien hier soir, et il a mis le mot juste (qui ne me revenait plus) sur mon projet littéraire en prise avec le numérique : glitch. C’est exactement cette ambition de la faille que j’aimerais mettre en forme écrite ; ce mouvement incompréhensible des figures et des couleurs ; cette déformation de la réalité au profit d’une masse informe de données incohérentes ; cette manifestation sournoise et criarde de la destruction. Je suis incapable de savoir par où prendre ce problème. J’espère trouver une issue.
Je viens de remarquer une petite fissure dans mon plafond.
prenez ainsi ce qui suit : et rien ne se présente à vous, alors il faudrait voir à retourner la chose pour comprendre ce qui manque pourtant : dans le sens inverse il en va de même, et ceci sans doute sans raison valable, sinon rien à attendre de ce qui : suit, donc, il faudrait revoir ses attentes à la baisse pour ne pas se laisser submerger par l’angoisse de n’y pas parvenir, angoisse terrible pour qui attend quelque chose : de l’autre côté, quelque chose qui bien sûr vous l’aurez compris n’est : rien, alors, savoir choisir ensuite quelle voie emprunter, prendre ce qui : suit, justement, aller plutôt par : là ou par
là, ce qui fondamentalement revient au même puisque d’un pas sur l’autre la seule constante est de
sombrer :
voilà où se cache, et il me faudrait un micro pour le dire plus loin, voilà un : micro, merci, à présent dans le micro ce qui doit être dit : où se cache, vous m’entendez : où se cache notre terrible déroute, qui nous mène justement tous vers le
fond
(ne tentez pas de vous retenir aux parois, il n’y en a pas, non, les bords sont de papier, voilà ils se déchirent à mesure qu’on les griffe, et c’est d’une tristesse, ça abime l’ensemble, je préfèrerais que vous fassiez attention, enfin, ne touchez à rien, laissez faire)
et qui a le visage de chaque personne croisée dans la rue, dans les lieux publics, même quand vous rentrez chez vous, même, enfin, je ne vais pas détailler chaque personne concernée, vous saurez faire, c’est une recette, pas plus compliqué qu’une recette : chaque personne 1) sombre 2) vous entraîne 3) vous sombrez de même alors : laissez faire, merci
au désert par exemple, on ne saurait se détourner du sable pour chercher l’eau dans le ciel, pourtant : qui sait, chercher l’eau dans le sable : qui sait, chercher le sable dans l’eau : qui sait, il faudrait voir à chercher le désert dans la mer, et peut-être y aurait-il une solution, enfin, où se cache notre terrible déroute de n’avoir pas les yeux où s’ouvrent les voies, bien sûr, mais qu’est-ce que dire peut : changer, sinon : savoir, et donc : attendre, rien : si ?
il répandait de la poudre et quelle poudre personne ne saurait dire enfin quelle poudre elle est impossible à décrire il la balaye depuis sa main sortie du sac alors qu’elle se dépose sur le sol chaque pas est là découpé dans la poudre accumulée il tourne sur lui-même ainsi que la poudre autour se disperse et ses pieds dedans forment la ronde il répandait toujours à présent dans la pièce sur une chaise assise inconsciente une femme assise de la poudre sur elle dans les cheveux sur les épaules sur les coutures de son chandail cette femme dans la poudre sous la poudre serait plus juste et lui dans le passé tournant avant qu’elle ne se réveille c’est une vision de cauchemar c’est une visions de sa tête à elle assoupie endormie assise sur sa chaise dans la cuisine qu’il répande cette poudre ainsi sur elle et autour d’elle ainsi qu’autour de lui tout ça n’est que dans sa tête à elle pourtant désormais à l’extérieur de la poudre dans le dépot de la poudre sur elle cet homme agité serait était la face intacte de son cauchemar profond d’où elle ne saurait sortir qu’en léchant chaque grain de cette poudre inconnue alors même qu’elle demeure assoupie sur sa chaise et que la poudre l’endort doublement en se déposant sur elle et le cocon qu’elle devient et le cocon que cet inconnu forme autour d’elle sent la craie mais la poudre n’est pas de craie le sommeil sent le gaz mais la cuisine n’est pas de gaz et l’homme s’arrête mais d’homme il n’a jamais été question et de poudre répandue non plus et de femme assoupie de même ainsi rien de ce qui était ne perdure sinon le souvenir à elle dans sa tête assoupie et cette odeur de perte mais cet amour n’a plus d’odeur
« – C’est pareil pour moi, dit Meyer qui ne parlait presque jamais. J’en avais marre de l’existence telle qu’on la mène, oui. Il fallait que quelque chose craque. J’aurais tué ma femme, peut-être. Ou bien attaqué un poste d’essence. » — Jean-Patrick Manchette, Nada.
Je retrouve de ses cheveux coincés dans les plis de mes vêtements.
« Et maintenant
seul
tout est seul
j’ai beau aiguiser ma voix
tout déserte tout
ma voix peine
ma voix tangue dans le cornet des brumes sans carrefour
et je n’ai pas de mère
et je n’ai pas de fils. » — Aimé Césaire, Les armes miraculeuses.
ils se retrouvent dans les hangars des usines et personne ne les aime
ils sont là depuis des jours parfois et ils n’ont que la solitude comme refuge
ils s’abandonnent à la peine
ils n’ont rien pour eux
personne à attendre rien d’autre à espérer
ils prennent les mêmes routes chaque soir sans tracés
chaque route de carcasses mortes et d’arbres tombés
chaque soir chaque route vers leurs maisons vides
où ils pleurent les lumières éteintes
ils ont les dents cassés et des visages difformes
ils ont parfois reçu les caresses de déesses imaginaires
mais au matin sur leurs jours il n’y avait que brûlures
et dans les brûlures la marque de leurs doigts
et sous leurs doigts des cloques
et ils ne comprenaient plus que la douleur
et rien ne pouvait plus les consoler
alors ils se retrouvent là derrière les murs
pour se murmurer en silence
les mots des tristes séducteurs
les mots des danseurs fous
les mots ravageurs de cette folie d’être
en vain
« Il n’y a pas de choses, il n’y a que des pertes. Il n’y a pas de gens, il n’y a que des pertes. Il n’y a pas de destinataires, il n’y a que des pertes. » — Mathieu Brosseau, Data Transport.
Cécile est venue quatre jours avec moi ici, à Rennes puis à Matignon. Je ne saurais décrire la joie du temps passé avec elle. J’avais la sensation de vivre une autre vie, une que je ne pensais plus pouvoir trouver, une que je croyais n’être plus autorisé à avoir. Elle a marché sur la misère. Et la mer avec elle, et les falaises, et le jardin, et certaines rues de la ville, et Matignon, et la crique, et le sentier dans les bois : tout a sa nuance désormais.
Elle m’a offert un livre imprimé début 1900, qu’elle a ramené d’Écosse, écrit par Walter Scott, et intitulé Quentin Durward. Je l’ai rangé sur ma commode, avec les DVD de Guy Gilles et d’Antonioni qu’elle a oubliés.
Elle me fait oublier ce qu’est la peine.
« Car si chargée d’espérance que soit jamais la perspective d’une vie nouvelle, elle n’en laisse pas moins dans les esprits les plus simples une frange d’incertitude, voire d’appréhension, en même temps qu’une insinuante nostalgie de la vie ancienne. »
– Je ne supporte plus ce bruit. Au village, ils disent que c’est l’alerte en cas de guerre. Monsieur Mar est en parti en vélo jusqu’à la frontière pour voir ce qu’il se passait. Il n’est pas revenu. C’est peut-être la guerre qui vient qui le retient. Les autres hommes n’osent plus s’informer. Ils se fient au hurlement de l’alerte. Les autres hommes se contentent de bêcher leurs potagers, et ensuite ils rentrent chez eux se coucher. Il n’y avait que Monsieur Mar pour s’aventurer en dehors du village, toujours à vélo. Il se faisait parfois attaquer par des bêtes sauvages, mais revenait toujours sauf. Il passait des forêts, des montagnes, son vélo sur le dos quand la pente était trop raide, et il voyageait ainsi plus loin que là où notre imagination pouvait aller. Il n’a jamais cru à l’arrivée de la guerre, malgré le hurlement de l’alerte. Il n’a jamais cru à rien, sinon à la robustesse de son vélo. Si Monsieur Mar ne revient pas, je ne sais pas ce qu’on va devenir. Les autres hommes vont fuir dans leurs lits, et puis ils ne travailleront plus jamais. Ça serait terrible pour tout le monde. Sans Monsieur Mar, il n’y a pas vraiment de village. Sans Monsieur Mar, il n’y a plus vraiment de vie.
– J’ai trouvé dans sa maison une lettre. Personne n’était invité à entrer dans la maison de Monsieur Mar, mais je me suis invitée puisqu’il n’est plus là. Sur la lettre, tout était écrit. Monsieur Mar avait tout prévu. Chaque étape était minutieusement détaillée. Je me suis assise dans son large fauteuil, et j’ai allumé la lampe sur la table à côté. J’ai reposé la lettre. Je me suis endormie. Il y avait, dehors, une musique que je n’avais jamais entendue. La guerre est arrivée. Je ne me suis jamais réveillée.
« Je n’aime pas me plaindre, mais j’ai le sentiment que je vais au-devant de dures épreuves. Ce ne sera donc jamais fini ! Mais dans quel monde vivons-nous ? » — Maurice Pons, Les Saisons.
En ce moment, je regarde chacun de mes pas, chaque repas que je mange, chaque lieu où je me rends, même les personnes que je rencontre, et je suis pris d’une intense lassitude. Non pas que la vie soit absurde, mais je suis dans cette phase où tout me ramène vers cette extrémité : à quoi bon ?
Pour me conforter dans cette vision des choses je lis Bernhard, et quand je veux oublier par le rire, je lis Pinget. Ce sont les deux seules solutions viables pour continuer mon existence.
J’écris pour les images.
« […] même si ces poèmes étaient sans valeur, ils signifiaient tout pour moi, rien au monde ne signifiait pour moi davantage, je n’avais plus rien, je n’avais que la possibilité d’écrire des poèmes. » — Thomas Bernhard, Le froid.
J’éprouve une certaine nostalgie d’enfant en retrouvant dans des émissions télévisuelles actuelles (notamment sur France 5 ou France 3), des habillages passés. La façon dont se tiennent les présentateurs, leur manière de dire au revoir, les bandeaux de crédits, l’ambiance générale hypocrite mais habilement camouflée, ou les musiques des génériques, la lenteur, les transitions, enfin, d’infimes détails culturels qui font aussi partie de mon arrière-fond personnel.
De même, en écoutant ce soir l’album Summer sun de Yo La Tengo, je me revois, dans ces paroles : i just wonder what to do, well, if i can’t have you, and i think about nothing much at all, nothing but you and me, adolescent, allant depuis la maison de mon père, par le sentier derrière l’Intermarché, la musique revenant sur elle-même, toujours, comme moi je revenais de ce même sentier jusqu’à la ville, depuis la ville, sans ambitions, sans envies, sans amour, allant venant ainsi, là où les choses se passaient, dans le petit Lamballe anodin, parfois prolongeant jusqu’au plan d’eau, parfois pas, parfois bouclant à l’infini dans des rues désertes, désertes des commerces fermés, moi toujours sorti, vagabond, à trainer toujours dans le même noir des usines, toujours en fuite, derrière les hangars, et qui me voyait couler ainsi dans le silence des arbres morts devait se tenir dans la pénombre du bosquet, où j’avais trop peur de m’aventurer.
« La solitude fait mal au corps : elle a ses instants de douleur physique, où elle est un désir qui ne trouve pas où s’assouvir et promène son croc un peu partout dans votre chair ; les vieilles filles et les jeunes garçons savent ce que je veux dire. » — Tony Duvert, Récidive.
Évidemment, on veut comprendre. Si on ne comprend pas, c’est un calvaire. C’est le pire. On est obligé de vouloir comprendre, sinon c’est pas tenable, humainement c’est pas tenable. On peut avancer comme ça, un peu, pour voir, sans trop se poser de questions, et on y croit, vraiment, on a l’impression que ça marche, qu’on tient, qu’on tient ! mais non, très vite, on se rend compte, on chute, on se prend les pieds dans tout ce qui passe, et puis alors c’est l’enfer, vraiment, je mâche pas mes mots mais c’est l’enfer, je l’ai vécu, je peux dire : l’enfer. On se relève en s’appuyant avec les mains, on a des graviers plein les paumes, et ils restent, quand ils partent ils font des marques alors ça reste, tout le monde le remarque, suffit d’une poignée de main pour qu’un étranger s’en rende compte, et alors vous verrez ce jugement dans le regard, cette tristesse aussi, évidemment, il y a de la tristesse, parce que c’est épouvantable, et que les autres s’en rendent vite compte, même les étrangers, même dans une poignée de main, c’est ça aussi le pire. On rentre chez soi, rien n’a changé, personne n’est là, la télé est éteinte, il y a que le silence, pire que le silence peut-être, pire que le bruit même, on rentre chez soi et il n’y a rien pour soi. Et même dehors il n’y a rien pour soi. Il n’y a rien pour soi nulle part. Et c’est ça qu’on veut comprendre : ce vide. C’est ça qu’on accepte pas, parce qu’on peut pas. Tout ce vide là tout autour de soi. Que les autres ne subissent pas. À côté même duquel ils passent sans se poser de questions, sans se rendre compte de ce que ça veut dire pour nous. On m’a même dit : tu te fais des films. J’aimerais bien les y voir, avec mes films. Ce qu’ils diraient, si c’était eux dedans. Ça serait pas la même histoire. Je fais des efforts pourtant. Je me plains pas tellement. Pas aux autres je veux dire. À moi-même oui parce qu’il y a trop de peine à contenir et forcément au bout d’un certain temps ça déborde. Personne n’est infaillible. C’est difficile de vivre avec. De vivre avec ce vide, ce rien. C’est épuisant aussi. C’est pour ça qu’il y a une corde dans le garage, c’est au cas où un jour je sois trop épuisé. Ça me soulage de savoir qu’il y a une issue pas loin, un terme. Sinon, à nager comme ça à l’infini dans le vide je vais me noyer, mais ça sera très long, et je vais suffoquer, et souffrir beaucoup plus que nécessaire, et je préfère pas, j’aimerais au moins éviter ça, si c’est possible, si ça on me l’enlève pas. Si c’est pas trop demander.
(Certains soirs dans mon lit, avant de m’endormir, je me chante le générique du dessin-animé Pokémon. Sans ça, je craque.)
« Toutefois l’homme qui se repent est immense ; mais qui voudrait aujourd’hui être immense sans être vu ? »
Je me retrouve beaucoup (à ma grande surprise d’ailleurs, et plus par méconnaissance que par défiance) dans les portraits de certains religieux du XVI et XVIIe siècle. La façon dont ils se retirent du monde à cause d’une rancoeur, d’une angoisse trop grande, du pourrissement d’un amour, de la société, à cause de cette peine immense, de cette déception permanente de vivre. Ce sont des extrémités auxquelles je pourrais succomber : me reclure, m’oublier, mais je n’ai pas Dieu au-dessus de moi, je n’ai rien pour compenser, personne à aimer de plus grand que celle croisée au coin de la rue. Je dois faire avec. Et faisant me battre chaque jour pour encore sur mon lit de mort serrer les poings.
« Pour moi, tout épris que je puisse être de ma chétive personne, je sais bien que je ne dépasserai pas ma vie. »
Ma grand-mère à une amie : Tu sais ce que c’est une androïde ?
J’ai été manger chez ma soeur, qui habite maintenant un petit appartement aux Sables d’or, pas très loin du casino, de la mer non plus. Elle va bien. Ça me rassure qu’elle aille bien. Elle partait ce matin pour Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est une longue route depuis la maladie et la rupture qu’elle achève enfin.
« La retraite ne fit qu’augmenter sa douleur : une noire mélancolie prit la place de sa gaieté, les nuits lui étaient insupportables ; il passait les jours à courir dans les bois, le long des rivières, sur les bords des étangs, appelant par son nom celle qui ne lui pouvait répondre. »
Je peuple mon quotidien du sien.

« Restent ces jours dits heureux qui coulent ignorés dans l’obscurité des soins domestiques, et qui ne laissent à l’homme ni l’envie de perdre ni de recommencer la vie. » — François-René de Chateaubriand, Vie de Rancé.
Il pourrait n’y avoir qu’un seul cercueil pour nos deux corps, et les peaux à mesure du temps se rejoindraient, les os s’empileraient, il y aurait les mêmes vers pour creuser nos poumons, et le bruit de la ville au-dessus, les graviers foulés, après la terre, après la pelouse, et à côté d’autres solitaires alignés, et il y aurait nos noms comme un seul nom sur le dernier écriteau, et nos deux dates comme une seule date, et la même douleur chez ceux qui nous auraient survécus, la même peine, pour nous le même juste retour à la cendre, à l’oubli, pour nous l’écho invincible du silence, après le mouvement de la ville encore, incessant, incessant jusqu’à la dernière explosion, puis le néant, déjà le néant pour nous deux depuis bien longtemps mais à présent pour tout le monde, à jamais, à jamais malgré les nouvelles peines et les nouveaux espoirs possibles, malgré l’inconnu, ainsi, en boucle, plus rien, ensemble, encore.
C’est vrai qu’il y a peu de temps, et pourtant comme les jours sont lents.
En m’observant dans la glace, ma gorge s’est nouée. Les deux petites filles de l’autre jour n’étaient pas très loin de la vérité.
Je n’ai pourtant jamais été particulièrement beau. Je ne sais pas pourquoi je m’attache à cette unique chose à ce point. Pourquoi mes cheveux trouvent autant d’importance, alors que je n’ai jamais su comment les peigner, comment les tourner à mon avantage. Je ne sais pas ce que je pense perdre. Ou être incapable de retrouver. Est-ce qu’on ne m’aimera plus ? C’est ce qui m’obsède je crois. Qu’on ne me remarque pas. Même si je sais pertinemment qu’on ne m’a jamais remarqué auparavant. En somme, je pense perdre ce que je n’ai jamais eu. Et pourtant, je suis incapable de me raisonner. J’ai la sensation de m’enfoncer dans le néant. Et qu’il n’y a même pas la possibilité d’une lumière au loin pour me réconforter.
Je chute à la verticale d’un horrible trou sans fond.
Est-ce que je n’aurais pas bêtement besoin de l’amour de ma mère ?
Je suis devenu le fils des fauves. J’ai mangé les os comme eux et ils m’ont recouvert de pelage. Après le pelage, j’ai eu les griffes, puis les crocs. J’ai tué avec les crocs neufs de ma nouvelle mâchoire de fauve. Je grimpais aux arbres. Je buvais dans les mares. Je me suis caché sous l’eau croupie des mares pour guetter mes proies. J’ai bondi hors de l’eau les griffes en avant et les crocs de même. J’ai tranché des oiseaux, des antilopes. J’ai ramené les carcasses. Je n’ai rien mangé. J’ai tué bien plus que je n’ai mangé. J’ai tué au fusil. J’ai armé un fusil sur mon épaule de fils de fauve, et j’ai tiré sur mes semblables. J’ai abattu tous mes semblables quand il n’est plus resté d’antilopes à chasser. Je ne suis plus le fils de personne désormais. Je reste caché dans mon arbre. Je contemple la boucherie. Les herbivores font un grand tour pour éviter la zone. Je regarde mon corps mourir. Mes crocs et mes griffes disparaître. Mon corps redevenir orphelin. Plus fils des fauves. Plus fils des arbres. Plus fils que de la détresse.
J’ai cousu ton souvenir dans la nuit.
C’est depuis la terrasse que j’observe les coutures craquer. Et aucun fil ne saurait les raccomoder. Le visage s’estompe. Le visage et ton corps qui n’est déjà plus que de l’humidité sur le bout de mes doigts.
Au matin il ne restait plus aucune trace de ce que j’avais mis tant de mois à créer.
« Le style n’est pas, comme la pensée, cosmopolite : il a une terre natale, un ciel, un soleil à lui. »
J’ai l’imagination un peu sèche en ce moment. Je devrais me concentrer sur des projets de plus longue haleine. Je tourne en rond, je le sens bien. J’ai du mal à me dégager de certaines habitudes. Je cultive mes tropismes. Ils fanent.
Cécile m’envoie chaque soir des photos d’ailleurs.
Les occasions sont nombreuses de n’être plus rien.
Mon regard avance le long du trottoir, à mesure que la voiture roule. Un vertige se fixe sur les raccords. Les prostituées succèdent aux lampadaires et leurs silhouettes bavent sur les façades en briques. De vieux hommes leur col retourné sur le cou franchissent la ville à l’envers. Ils rampent depuis chez eux jusqu’au noir des quartiers malhonnêtes. Ils n’ont nulle part où s’en aller. Après le travail ils retrouvent leur salon vide, rien que des débris. La lumière des lampadaires les creuse et le désir fade des prostituées. Mon oeil ne les croise qu’un temps mais c’est depuis des heures qu’ils remontent à contre-vent les boulevards. Personne ne les accueille après l’errance. Les bars ferment les uns après les autres, d’où ne sortent que des larmes. L’écart entre moi passé là il y a quelques instants et leurs pas à l’infini dans l’écho des immeubles ne cesse de s’étendre. Le silence engouffre tout. Les vies s’épuisent et les hommes tristes aussi.
« Dans le désert de ma première existence, j’ai été obligé d’inventer des personnages pour la décorer ; j’ai tiré de ma propre substance des êtres que je ne trouvais pas ailleurs, que je portais en moi. »
Alors que je dépassais deux petites filles après être sorti de chez la coiffeuse, je les ai entendues dire : Il est moche !
Heureusement qu’on ne s’arrête pas à ça.
Elle s’est perdue dans la torture. Elle a ficelé le manque et une fois cela fait elle n’a pu retrouver que du vide. Elle a attendu là des années qu’une autre paire de bras stoppe son fauteuil à bascule, mais le bois a craqué et le fauteuil s’est fendu avant que quiconque puisse arriver. C’est le voisin qui s’est chargé de le transporter à la déchetterie. Il a jeté le fauteuil en deux morceaux dans la benne prévue à cet effet. Elle n’a pas eu les moyens d’en racheter un autre, et elle n’avait plus tellement le goût non plus. Elle s’est installée sur une chaise en osier pour attendre la fin. Le voisin est venu plusieurs fois lui tenir compagnie, mais il a épuisé tous les sujets. Elle lui demande des nouvelles du fauteuil à bascule. Le voisin ne trouve jamais quoi répondre. Il change de sujet mais elle pas. Plusieurs minutes ils bavardent ainsi en décalé. Puis le voisin s’en retourne et elle se retrouve seule à nouveau sur sa chaise en osier. L’assise tombe en lambeaux. Il faudra bientôt la jeter elle aussi.
For today i am a child, for today i am a boy.
« Religion à part, le bonheur est de s’ignorer et d’arriver à la mort sans avoir senti la vie. »
Je ne fais qu’épuiser mes obsessions. Je ressasse à l’extrême les mêmes événements sur des échelles différentes, selon des angles opposés. Du plus factuel au plus diffus, je m’efforce de parcourir mon propre spectre ; comme Perec, j’active une tentative d’épuisement nécessaire à mon cheminement. Ainsi je me découvre et, me découvrant, me connais.
Il est vrai que nombre de nos heures sont laissées à la paresse, au trivial, et qu’une vie pleinement vécue n’est jamais qu’une demi-vie. (Ça n’ôte pas la peine.)
Les Mémoires d’outre-tombe sont un palais de merveilles. Je pourrais tout citer de ce livre. Depuis longtemps je n’avais plus ainsi arrêté mon temps pour saisir celui d’un autre. Dans le désordre :
« Au sortir de ces rêves, quand je me retrouvais un pauvre petit breton obscur, sans gloire, sans beauté, sans talents, qui n’attirerait les regards de personne, qui passerait ignoré, qu’aucune femme n’aimerait jamais, le désespoir s’emparait de moi : je n’osais plus lever les yeux sur l’image brillante que j’avais attachée à mes pas. »
« […] tous mes jours sont des adieux. »
« Le jour je trace des pages aussi agitées que les événements de ce jour ; la nuit, tandis que le roulement du canon lointain expire dans mes bois, je retourne au silence des années qui dorment dans la tombe, à la paix de mes plus jeunes souvenirs. »
À la lecture de Chateaubriand (dont les pages me sont si familières que je pense les avoir déjà éprouvées auparavant), je crois percevoir une propension toute bretonne à la mélancolie. La proximité de la mer, et surtout de cette mer de bout de monde, influe depuis l’enfance sur nos caractères. On conserve une pleine conscience (une conscience d’avant les voyages, d’avant la possibilité de voguer) de la limite où l’on se trouve. On est comme déjà devant l’ultime rivage. Et ceux qui s’aventurent au-delà, les marins des mers glacés, les aventuriers, souvent ne reviennent plus, soit qu’ils ont sombré à l’à-pic des flots, soit qu’ils se sont installés dans des refuges mystiques.
Mon absence de goût pour le voyage vient peut-être de cette imminence du terme. Je suis déjà arrivé là où les falaises meurent, à quoi bon alors faire marche arrière vers l’est, vers les neiges noires de Sibérie, vers les tristes plaines absurdes, vers les puits enflammés, vers les débris de civilisations perdues. Je peux rester là à guetter l’océan. Il n’y aura rien après. Je sais depuis ma naissance comme tout finit.
Après ma douche, un agglomérat de gouttes avait formé sur la faïence un requin-marteau en fuite vers les égoûts.
(Rarement lu un truc aussi creux que l’article de Clément Bénech à propos de Booba dans le Libération de cette semaine.)
« Désormais sans compagnon, je cheminais solitaire sur les grèves où j’avais bâti mes châteaux de sable. »
Il m’a demandé de monter dans le chariot. Il s’est installé à côté de moi. Il savait où le chariot allait. Autour, de profonds trous d’obus abritaient des mares obscures. Les enfant se baignaient nus dedans. Ils ressortaient la peau salie. Ils riaient les dents sales de l’eau de la boue. Ils se battaient avec des graviers, qu’ils se lançaient au visage, avec lesquels ils se crevaient les yeux. Le chariot, lent, passait entre eux, évitait les projectiles, nous faisait tout juste sentir la putréfaction de leur peau déjà morte. Ils tentaient de croquer nos oreilles. L’herbe manquait. Tout manquait. Tout à côté était absent. En creux. Les enfants repartaient en courant derrière les immeubles effondrés. Il était impossible de revoir deux fois les mêmes enfants jouer. Ils se remplacent. Périssent, puis se remplacent. Le chariot a continué ainsi un long moment à rouler dans la ruine. Les aras répétaient ce que nous nous interdisions de dire. Seuls les aras parlaient. Et nous parlions par eux. Pas de cris, aucune musique, juste la parole des oiseaux dans le cheminement du chariot parmi la ruine. Les rails continuaient jusque derrière le visible. Plus loin que le visible et plus loin que le chant. Mon guide sait à quel point les roues s’usent. Que le chariot n’ira pas loin. Il savait, à l’instant de m’accompagner, que le voyage n’irait pas jusqu’à la ligne d’horizon. Que le bavardage des aras continuerait à nous hanter. Comme les visages trempés des enfants. Le chariot avance. Le chemin ne sera pas long. Il s’arrêtera bientôt. Comme moi. Comme les enfants cachés derrière les ruines. Comme les chants des aras. Comme l’histoire du temps. Comme l’époque. Comme ça. Comme tout.
Une voix s’élève après le désastre. Cette voix dit après le chaos, après la folie. Elle dit la suite. Tout le monde l’entend. Personne ne l’écoute.
(Évidemment, à la lecture de Chateaubriand, on se dit : Cette langue, c’est le français parfait.)
« Mettons à profit le peu de jours qui me restent ; hâtons-nous de peindre ma jeunesse, tandis que j’y touche encore : le navigateur qui quitte pour jamais un rivage enchanté, écrit son journal à la vue de la terre qui s’éloigne, et qui va bientôt disparaître. » — François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe.
je suis allé vers une plus juste manifestation de la détresse,
bleue ;
mais elle ne se calquait pas sur l’image que j’avais d’elle,
elle se dérobait ;
et se dérobant, m’oubliait.
elle était à la fois
apparue simplement, présente, là ;
mais il lui arrivait également de se fondre
sous la surface des choses, sous la surface du dit ;
et le bruit que cela faisait engourdissait mes tympans.
le bleu initial bientôt a bavé,
les coulures ont sali le décor,
et ce que j’attendais au départ, que j’attendais et que
je cachais aussi,
a éré vaincu pour de bon.
Il est nécessaire de savoir disparaître.
Le sentier débouchait directement sur la digue. On suivait le parcours entre les lotissements, comme s’il s’agissait d’esquiver la ville à travers elle. On n’y croisait pas grand monde, et le peu qu’on y croisait ne nous disait pas bonjour. L’hiver, la municipalité ne prenait pas le temps d’entretenir le sentier. Les herbes sauvages envahissaient le chemin ; ronces, orties. Il fallait attendre le printemps pour utiliser à nouveau le passage. J’ai eu peur, souvent, de ne plus pouvoir passer par là. De ne plus pouvoir marcher jusqu’à la digue à travers le néant de la ville. J’avais besoin de ces instants d’oubli au milieu des autres. Avant l’océan. J’aurais pu rencontrer n’importe qui. J’espérais. Trouver, avant l’océan. Avant de me jeter. Une maison, une famille. Pour me faire une place. À chaque fois que je passais par là. Et j’attendais le printemps avec impatience, car l’hiver était douloureux, à devoir faire le tour, à devoir me passer de l’omniprésence des autres. Le sentier était trop cher à entretenir. La municipalité a détruit toute trace du chemin. Entre les maisons, désormais, il y a des roches, des galets. Il est impossible de passer. Je n’ai plus la force de faire le tour. Sans le possible secours d’inconnus, je ne comprends plus l’intérêt de la balade. De me promener, de manière générale. Demain, je ne reviendrai pas de l’océan.
« – Écoute, petit, j’ai dit. Essaie pas de lutter. Fous le camp. Et je veux dire, pas seulement de chez moi. Barre-toi de ta boîte. Barre-toi de toute cette merderie. Tu m’entends ? Il n’y a plus rien à faire. C’est fini. » — Jean-Patrick Manchette, Morgue pleine.
Une faille s’est ouverte dans la roche en face de moi. Une faille dans laquelle d’abord je ne pouvais qu’à peine passer un doigt, puis où je me suis finalement complètement enfoncé. Il y faisait noir et cette ombre totale m’a progressivement embrassé. L’ombre calquait mon corps et s’est bientôt détachée de moi. Elle s’est mise à bouger dans le noir, dans le noir sans lumière où je ne pouvais qu’à peine la voir. Je ne pouvais plus rien faire d’autre que suivre son mouvement. L’ombre évoluait toujours dans le vide. Elle s’est tenue en face de moi et a remué ses lèvres en creux. Elle parlait ainsi qu’on rembobine. Elle s’est infiltrée par ma bouche. Elle est descendue loin en moi. Elle s’est nichée jusque dans mes yeux, et mes yeux n’ont plus rien vu. De l’eau a coulé depuis mes yeux pris de l’ombre. La faille de la roche dans laquelle je m’étais avancé grandissait encore. D’autres ombres s’ajoutaient à la première qui était à présent en moi. D’autres ombres reconnues. Elles voulaient entrer à leur tour par ma bouche. Je crachais pour les empêcher. Mais rien ne les résonnait. Elles se sont entassées dans mon maigre corps jusqu’à ne plus me laisser aucune place. Je suis ressorti de la faille obèse de toutes ces ombres contenues. La roche s’est refermée avec encore en elle nombre d’ombres meurtries. J’avance comme je peux, mes jambes dirigées par leurs mouvements idiots. Depuis, plus grand chose de moi ne demeure. Plus grand chose de moi ne raconte.
« – Quand quelqu’un a déjà été en retrait de la vie et a eu le temps et le calme nécessaire pour se poser une question essentielle à son égard – une seule – il reste empoisonné pour toujours… Bien sûr, le monde continue d’exister, seulement quelqu’un a passé une éponge au-dessus des choses et en a effacé l’importance… » — Max Blecher, Coeurs cicatrisés.
Je ne suis pas tellement angoissé par les jours qui passent. Je m’ennuie un peu. Je ne regrette pas ce que je n’ai pas fait. Certaines personnes pensent laisser fuir de possibles vies parallèles meilleures. Je suis peu convaincu par cette vision des choses. Elles auraient eu les mêmes regrets peu importe les circonstances. Je n’ai rien à regretter. Je fais avec et cet avec me va. Je vis de belles histoires. Je crée à ma mesure. J’essaie de faire mieux à chaque fois. Je creuse déjà intensément mon sillon, seul dans ma chambre, répétant les mêmes trajets infinis entre terre et mer. J’aime autant que je peux aimer. Je touche les corps avec la plus sincère délicatesse. Je ne m’en demande pas trop. Je sais que le combat d’être homme est dès le départ trop lourd, et qu’il me suffit d’avancer avec dans les mains l’essentiel. Je ne souhaite pas une montagne si je ne possède qu’un caillou. Je moque les paquebots depuis ma barque. Qui est elle-même un paquebot. On pourrait s’expatrier à perte. Ce n’est pas que l’herbe est plus verte ailleurs. C’est qu’elle flambe partout. La plupart de ceux qui m’entourent moisissent déjà. Évidemment, ils ont de quoi regretter. Je ne sais pas comment ils ont fait pour tout gâcher aussi vite. Je ne suis même pas encore né.
« L’inutilité a empli les creux du monde comme un liquide qui se serait répandu de tous côtés, et le ciel au-dessus de ma tête, ce ciel toujours impeccable, absurde et indéfini, a acquis la couleur du désespoir. » — Max Blecher, Aventures dans l’irréalité immédiate.
Encore couché trop tôt, je suis réveillé à trois heures du matin. Incapable de finir mes nuits. Alice est malade. Au rythme où ça avance, ça va bientôt être mon tour.
La lecture m’aide à m’oublier.
Deuxième nuit réveillé à trois heure. Je ne sais pas ce qui se passe. Mal à la gorge. Pris de fortes douleurs à la cage thoracique. Difficultés à respirer. Obligé de me lever et de commencer ma journée moitié-mort.
Je suis rentré de Paris. J’ai essayé de ne pas trop regarder mes cheveux dans le reflet de la vitre du train. J’ai à peine fait cuire mon cordon bleu avant de le manger. Le goût ne changeait pas trop de d’habitude. Je suis exténué. Les messages de Cécile m’apaisent. Sa présence ou le souvenir de ses contours, de manière générale.
« Quand un homme, quelque doué qu’il soit, ne se préoccupe que de la chose racontée, quand il ne se rend pas compte que le véritable pouvoir littéraire n’est pas dans un fait, mais bien dans la manière de le préparer, de le présenter et de l’exprimer, il n’a pas le sens de l’art. » — Guy de Maupassant, Sur Flaubert.
J’ai beaucoup imaginé. Enfin ça m’a trotté dans la tête. Des mois. Comment faire. Comment y parvenir. J’avais des plans, des ébauches de plans. J’avais essayé et j’étais à peu près fier de moi. Je sentais que j’étais sur la bonne voie. Alors bien sûr tout n’était pas parfait. Il y aurait eu à redire. Mais déjà, avoir des débuts de plans, tout le monde ne peut pas se vanter de concevoir des choses pareilles. C’est un investissement. Je ne plaisante pas. Les gens se moquent. Ils ne comprennent pas. On est toujours seul avec ses plans. C’est une espèce de malédiction. Dans plusieurs siècles ils comprendront. C’est toujours comme ça que ça se passe. Un jour, bien plus tard après la mort, on devient un génie, quand tout le monde se moquait de nous quand on marchait encore dans la rue, ou quand on achetait son pain aux raisins à la boulangerie. C’est une belle revanche sur la vie. Une belle revanche par anticipation. Je les toise tous depuis ma haute connaissance du futur. Les pauvres, s’ils savaient ce qu’il y a dans mes plans. Comme ils m’enviraient. Mais c’est le fardeau des prophètes. Je guide l’humanité avant qu’elle en prenne seulement conscience. À l’instant où je parle je ne suis rien, mais vous verrez plus tard, comme vous aviez tous faux. Vous verrez, si vous êtes capables de survivre jusque-là. Moi je ne me fais pas de soucis. J’ai mes plans. Mes plans pour survivre jusque-là. Et même bien plus tard encore.
« Les gens sont là pour dépister l’esprit et l’anéantir, ils sentent qu’une tête est prête à un effort de l’esprit et ils débarquent afin d’étouffer dans l’oeuf cet effort de l’esprit. » — Thomas Bernhard, Béton.
Ça me prend quand je rentre, après les soirées entre amis, ça me prend, c’est plus fort que moi, dans la rue, dans les rues vides d’ivrognes de la ville, je pourrais briser n’importe quelle bouteille qui traine, trancher les gorges au tesson, toutes les gorges de tous les ivrognes de la ville, les regarder se vider, le sang de leur cou sur le sol, sur le pavé, entre les pavés, couler jusqu’aux bouches d’égoût, ruisseler ainsi, tremper mes chaussures dedans, mes chaussures blanches, les tremper de sang, je sais que je pourrais, c’est plus fort que moi certains soirs, je suis obligé de serrer les poings dans mes poches, de n’y pas penser, de me concentrer sur autre chose, sur ce qui me rattrape encore du gouffre dans lequel je sombre un peu plus après chaque soirée, quand tous ils m’agaçent, quand tous ils me répugnent, quand tous ils m’enfoncent dans ma cruauté intime, dans cet unique soulagement physique, quand eux-mêmes ne peuvent s’empêcher d’être des monstres, et l’arrière-goût de sable dans la bouche, encore, dans chaque rue traversée, dans chaque ivrogne croisé, toutes ces opportunités de meurtre gâchées, et aucune autre sortie valable, juste cette intense frustration qui grimpe soirée après soirée, qui grimpe et grimpera encore jusqu’à atteindre l’extrême limite de ma sauvagerie.
« Pas vrai, Willie, que même les mots vous lâchent, par moments ? » — Samuel Beckett, Oh les beaux jours.
J’ai ramené un inconnu chez moi. Il m’avait suivi depuis l’arrêt de bus. Je n’étais pas spécialement décidé à le ramener chez moi, mais il avait réussi à s’infiltrer dans l’immeuble et restait planté devant ma porte. Je pouvais le voir dans mon oeil de boeuf. Je ne voulais pas qu’il dérange les voisins. Avant de me décider à le laisser entrer, j’ai pris en main le fusil de mon père. J’ai ouvert la porte et il a vu le fusil pointé droit sur lui. Il a compris que je ne plaisantais pas. Il avait mauvaise allure, il portait une capuche. Je crois qu’il voulait m’agresser. Sur le chemin entre l’arrêt de bus et chez moi, j’entends. Mais comme j’ai marché plus vite que lui, il n’a pas su m’attraper avant que je sois en sécurité, et il s’est trouvé bloqué. Ça arrive même aux meilleurs. Je lui en veux un peu, ça m’oblige à faire quelque chose de lui. Je voulais passer ma soirée tranquille. J’ai eu une semaine difficile. Je l’ai dirigé dans le salon et lui ai demandé s’il voulait une bière, le fusil toujours braqué sur son visage. Il a évidemment accepté, sinon je lui aurais fait un énorme trou à l’endroit du visage. C’est facile de convaincre les gens avec un fusil. On devrait y penser plus souvent, ça éviterait bien des situations embarassantes. On a bu cette bière ensemble, et on a discuté un peu. Il m’était plutôt sympathique. C’est peut-être le fusil qui l’obligeait à jouer la comédie. Je ne saurai jamais. Sur le moment, je ne me suis pas vraiment posé la question. Je voulais profiter de ma fin de semaine, et j’y parvenais assez bien. Jusqu’à ce qu’il ait voulu partir. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Il s’est levé et il a couru jusqu’à la porte d’entrée alors que j’étais distrait. Mais la porte était fermée et il n’est pas parvenu à l’ouvrir avant que je lui plombe le dos. Bon, ça arrive. C’est aussi à ça que sert un fusil : tuer des gens. On ne peut pas tout régler juste avec un fusil. La solitude, la détresse, l’amour. Sinon, ça se saurait. Enfin, j’espère.
Le crachin a recouvert la poussière. Il a ouvert des sillons dans cette toile. Et le bruit habite les cailloux. Le bruit et la mousse recouvrent les cailloux qui attendent d’être secoués. Ils sont disposés là sur le sentier, le crachin les recouvre, le crachin qui tend à recouvrir la commune depuis ce matin. Le crachin se densifie sensiblement et devient bientôt de la pluie. Elle creuse dans le sentier des obus de boue. La mousse absorbe ce que les cailloux rejettent, polis désormais, luisants, aussi sournois que des trappes. Qui aurait l’audace de s’aventurer sur le sentier devrait faire attention à ses pieds. Il serait à terre sans délai et ramperait les genoux crottés de boue. Le parapluie sur le sol de même, la pluie recouvrirait son visage et tremperait sa bouche. Qui serait à terre le visage trempé toucherait alors les cailloux, la mousse et la boue. Il aimerait être là sous la pluie, nu, à découvert, absolument.
« Avec la lecture j’avais jeté un pont par-dessus des abîmes ouverts ici à tout moment, j’avais pu me sauver des états d’âme visant seulement à la destruction. » — Thomas Bernhard, Le souffle.
Le loup s’est avancé, et dans la mâchoire du loup une bouche hurlait. J’ai parlé à la bouche dans le mâchoire du loup. Elle salivait dans la mâchoire. J’entendais à peine ce qu’elle me racontait. C’était une parole de ténèbres, c’était une parole d’après la mort, d’avant le sommeil. C’était la même parole de douleur qu’au fond de la solitude. J’avais entendu cette parole dans la bouche d’un autre animal. La parole dans le loup était la parole universelle de la misère. Il n’est possible de l’entendre qu’au fond de la forêt. Cette forêt sans arbres où les ruisseaux cavalent du poison. Après les champs tranchés, il y a de ces forêts sans arbres. Les loups errent. Les loups aux mâchoires bavardes. Après la parole le loup a fermé sa mâchoire et il s’est retourné vers les champs tranchés. Il a crevé là dans la parole éteinte.
On se trouve parfois beau, mais très vite on se rappelle notre laideur. Et cette laideur est insupportable.
Ce n’est pas la vieillesse qui m’angoisse ; c’est de ne plus plaire.
Il m’arrive certains soirs d’être étranglé par une subite montée de sanglots. C’est dans ces instants-là que je comprends à quel point ma mère me manque.
Les nuits où Alice ne me prévient pas qu’elle découche, j’oublie de fermer la porte de l’appartement. Je me réveille en sursaut au milieu du noir, et j’imagine que des intrus se faufilent dans le salon. Qu’ils volent là ce qui à leurs yeux a une quelconque valeur. Qu’ils tentent d’ouvrir chaque porte. Les portes des chambres. D’abord celle d’Alice absente. Puis la mienne, dans laquelle j’attends les yeux grands ouverts face au plafond. Personne ne vient jamais. Je me rendors trempé de sueurs froides. Le lendemain Alice rentre. Alors les intrus imaginaires disparaissent.
J’avais écrit ici deux paragraphes dont j’étais content. Mon ordinateur a planté avant que j’ai pu les sauvegarder. Tant pis. Ça arrive.
L’ambition de créer du vide ne m’a jamais quitté.
Il n’y a pas de faille. C’est moi la faille.
Je mange dans la nuit les flammes sombres. Les flammes deviennent du sel et coulent sur mon menton. Le sel ensuite se déverse dans les égoûts, noie là les rats, asphyxie là les rats, dans sa marée blanche, sa marée aride, et à mesure que je mange à mesure le sel monte. Le modèle est passé. Les couleurs. Les motifs. Le sel absorbe autour l’eau. L’océan d’eau devient l’océan de sel et personne ne s’y baigne. Ceux qui s’y baignent meurent. À mesure que je mange le sel tue ceux qui se baignent. Je mange les flammes blanches. Je mange jusqu’à ne plus rien voir. Tout. À terme, je me mange. Les flammes sombres et les flammes blanches me recouvrent. L’incendie prend. La fumée monte.
Et le souvenir de ses lèvres la première fois, comme devant le poste détraqué je rembobine une VHS jusqu’à crever la bobine.
Taureau, il n’y a rien pour toi par ici. Il n’y a rien, il n’y a jamais rien eu. Cesse de t’affoler. Attends que les murs se rapprochent. Attends qu’ils t’écrasent. Qu’ils broient tes os. Que tu les entendes craquer sous la pression. Vois, taureau, comme tout se resserre sur toi. Vois, taureau, comme le jeu est injuste. Vois, souffle depuis tes naseaux brûlants. Beugle si tu préfères. On rit de toi, dehors les murs, dehors les remparts. On s’amuse de t’entendre geindre. Pauvre taureau. Pauvre bête. Tu te croyais homme. Tu n’es même pas animal. Tu es là épuisé dans la boue. Dans la boue qui t’aspire. Chaque instant un peu plus profondément. Chaque instant, englué, piétiné. Brave bête. Tu es le dernier. Ton histoire s’effondre en même temps que tes genoux cèdent. Tout se comprime autour de toi. Les cages, le paysage. On passera à autre chose. Taureau. Crevure. Bétail.
Seule chose : les caisses automatiques ont explosé, le panneau d’arrivage s’est détraqué, les horaires, les destinations, tout s’est soudain dissipé, le sol dessous nous s’écroulait à mesure, s’écroulait depuis les structures de béton jusqu’aux rails du métro, les ténèbres foraient sous nos pieds, nous entrainaient tous les deux parmi le chaos du sous-sol, parmi la tendresse, et au-dessus de nos têtes pas mieux, au-dessus plus rien.
Je vois les coeurs à nouveau ! Je les vois, là ! Je ne peux plus détacher mon regard d’eux ! J’ai l’impression qu’ils se déversent en moi, qu’ils déversent tout leur sang dans mon sang, dans mon sang sans coeur ! Dans mon corps de machine morte ! Dans mon corps au sang de rouille au sang d’acier au sang de machine morte de corps sans sang ! De corps mort de machine ! Je vois les coeurs qui battent autour de moi qui ne bats plus ! Jamais ! Eux, tout le temps ! Moi qui ne les voyais plus ! Alors qu’ils étaient là à battre en dehors ! En dehors de mon corps à moi de mon corps machine ! Quelle joie à nouveau ! Quelle délivrance ! Je croyais tout perdu ! Je me croyais perdu ! Et tout était là ! Les coeurs ! Et personne n’était au courant ! Personne ne m’avait prévenu ! Je me croyais mort ! Je me croyais corps machine ! Je me trompais ! Tout le monde : je me trompais ! Je vois les coeurs ! Encore ! Autour de moi ! Tous les coeurs ! Bientôt le mien !
Mon père engueule tous les gamins de son quartier. À même pas soixante ans, c’est déjà le vieux con.
« La tristesse, la souffrance et toutes les idées pénibles avaient comme disparu, quoique je ressentisse encore vivement une certaine gravité devant et derrière moi. » — Robert Walser, La promenade.
L’océan s’avance. Il s’écrase à mesure qu’il avance. Il ronge les rivages. Il ronge les premières cabanes aux pieds dans l’eau. Il avale les plaisanciers, les baigneurs. Il avale le bord de monde, le bord aux ruptures sèches. Le bord où les goëlands se posent, où les rapaces guettent. Il amène avec lui les requins, les orques, dans chaque vague de nouveaux requins, dans chaque remou une mâchoire ennemie. Il se disperse sur les tracés des routes. Il accumule les ruisseaux, les lacs. Il monte et monte et grimpe au niveau des clochers. Il stagne encore plus haut que les clochers, encore plus haut que les plus hauts des arbres. Il a sous lui l’humanité désormais. Parmi le corail et les algues des cadavres errent. Les corps reposent ensuite sur le fond, les épaves des navires, les avions écrasés. Et l’océan. Depuis le ciel, depuis la Lune, l’océan. Froid, brutal. L’océan. À jamais. Pour toujours.
« On est plongé dans une solitude sans mesure, dans un temps sans mesure. On est au milieu des cendres de tout, on est au milieu des cendres et des souvenirs de tous et de toutes, on avance dans le noir ou on reste accroupi pendant des heures ou pendant des jours et des nuits, avec pour tout bagage une solitude immense et l’espoir de l’histoire. » — Lutz Bassmann, Avec les moines-soldats.
J’achève à l’instant le recueil Ariel de Sylvia Plath. Mh. Je deviens complètement hermétique à la poésie en vers. Je n’y comprends rien, je ne sais pas où réside l’émotion, je ne sais pas la lire. Je vois des mots loin les uns des autres, morts, je ne sais pas ce qu’ils foutent, j’aimerais leur dire de rentrer chez eux, de retrouver une fonction, un sens. Je ne suis pas taillé pour cette expression-là. On peut pas tout faire.
Réveillé ce matin avec un horrible bourdonnement dans les oreilles. Comme si on m’appuyait au marteau sur les tympans. Des noeuds partout dans les omoplates. Je me lève depuis une semaine comme on rampe nu sur du carrelage.
J’ai rejoint Cécile dans la gare exactement à l’endroit où l’on s’était quitté. On a marché jusque dans un restaurant à Boulogne. Cécile exprime, dans chaque geste, dans chaque parole, une simplicité qui annihile tout. De la chair de ses lèvres jusqu’à la façon dont elle porte son manteau quand elle a trop chaud. Comme elle tient ses frites ; les petites bouchées qu’elle croque dans son hamburger ; le thé qu’elle verse sans en faire couler à côté. C’est une mer dans chaque mouvement. Calme, diffuse, s’allongeant à mesure qu’elle se répand en moi, par petites vagues, s’épuisant dans les grains du sable, facile, intacte, à l’infini dans ce même élan de murmure. C’est un déchirement de la laisser dans la ville désormais.

Depuis qu’on a posté la vidéo avec Jean Rochefort, jamais lu autant de conneries sur la littérature. Comme si en rire n’impliquait pas qu’on puisse également la prendre au sérieux à côté. On nous oppose. On nous accuse. Quel ennui. Comme il est long le chemin. Comme ils sont épuisants les faux obsédés du texte. Tous ces imposteurs. Comme ils doivent être vides.
Après être rentré à Rennes, j’ai regardé un court extrait de mon passage dans une émission de télévision. J’avais envie de m’étrangler à chaque seconde. Ce n’est pas pour moi. J’ai du mal à m’aimer. Me voir complique encore davantage les choses. Il faudrait que je parvienne à m’oublier physiquement.
J’ai envie de m’effondrer.
Extrait d’sms :
- On se retrouve où d’ailleurs ?
- Là où on s’est quitté la dernière fois ?
Lèvres toucher lèvres toucher peau.
Ses seins sous son t-shirt.
Le furieux instant du désir. Et le pigment de ses bras. Le souvenir qui creuse en moi. L’impatience de la retrouver. De pouvoir lui parler à nouveau. Cette sensation de regain à l’idée d’être là encore en face d’elle. Et de voir, et d’attendre, et de partir, en sa compagnie. Et de revenir, plus tard, toujours avec cette envie intacte d’espérer le mieux. De profiter. D’aimer être à deux.
Là où je n’ai su jusque-là qu’être seul.
Pas grand chose en ce moment. Je tente une réécriture du mythe de Thésée et le Minotaure, en courts paragraphes. Toujours été fasciné par ce monstre. J’ai imaginé qu’il ait pu gagner contre Thésée, et qu’il se soit fait passer pour lui avec l’aide d’Athéna. Qu’il ait tranché le corps de Thésée et se soit faufilé dedans. Cela entraîne des répercussions sur la suite de la vie de Thésée. C’est amusant. C’est comme si le mal triomphait. (Il triomphe toujours.)
Je crois que jusque-là, en m’acharnant à écrire des textes sur la longueur, je me suis complètement planté. Ce n’est pas ma façon naturelle de parler, de raconter. Je ne suis pas bon pour ça. Il y a deux ans environ, je disais à peu près : Si on me demandait vraiment mon avis, je ferais des livres de deux lignes, et puis merci. Et c’est exactement ça. Ce qui explique aussi pourquoi mes Relevés ressemblent à ce qu’ils sont : de légers fragments décomposés.
Cécile m’a envoyé une photo du Luxembourg ce matin au réveil. Je voudrais davantage de ces réveils.

« Et malgré ce qui s’en va, qui est brisé et submergé ou même rompu de toi, ne reste sur ce lit de mort qu’un visage nu, très pur. Et beau. » — Antoine Wauters, Sylvia.
Edgar Pomme s’est absenté quatre jours. Quatre jours en l’absence d’Edgar Pomme, et c’est le monde qui changé. Quand Edgar Pomme est sorti de chez lui, avant ces quatre jours d’absence, il a claqué la porte. Sans même un premier courant d’air Edgar Pomme a quitté sa maison. Dans sa maison, plus aucune trace d’Edgar Pomme, s’attriste sa femme. Ni derrière la commode, ni sous le drap du lit. Edgar Pomme aurait tout de même pu prévenir, mais il a préféré ne rien dire. Il a tenté d’écrire une lettre. Il a manqué d’encre. Le brouillon est toujours sur la table de la cuisine. Quatre jours durant, les gendarmes à ses trousses. Les gendarmes dans toutes les directions, dans tous les recoins du village, à la recherche d’Edgar Pomme. Et dans le témoignage de sa femme, sur le brouillon de la table, aucune indication. Edgar Pomme disparu. Quatre jours, sans motif. Ce n’est pas le genre d’Edgar Pomme, confie sa femme, de disparaître ainsi sans motif. Les gendarmes opinent, certains connaissent bien Edgar Pomme. Au village tout le monde se connaît, mais surtout tout le monde connaît Edgar Pomme. Qui ne le connaitrait pas, lui qui soudainement a disparu quatre jours.
Et donc Edgar Pomme est revenu. Quatre jours plus tard. Sa femme ne l’attendait plus. Les gendarmes avaient arrêté deux jours auparavant leurs recherches. Ils étaient passés sur une autre affaire. Ils jouaient aux cartes dans le bar. Edgar Pomme est venu boire un coup au bar et il a vu les gendarmes là en train de jouer. Edgar Pomme a fait comme s’il n’était jamais parti, et les gendarmes de même. Puis il est rentré chez lui. Sa femme était là. Avec un autre homme qu’Edgar Pomme. Tout de même, déjà, a confié à sa femme Edgar Pomme. Je ne pouvais pas savoir, et bien sûr elle ne pouvait pas, comment lui en vouloir. Edgar Pomme n’a pas voulu lui en vouloir, elle ne pouvait pas savoir, s’est ainsi dit Edgar Pomme. Il a déposé son bouquet sur la table à côté du brouillon. Il a trouvé de l’encre pour compléter ce qu’il avait tenté d’écrire quatre jours plus tôt. Edgar Pomme est reparti. Sur le brouillon on pourrait savoir la suite. Sa femme l’a jeté ainsi que le bouquet. Edgar Pomme, bon, Edgar Pomme dans la nuit. Et un autre homme dans son lit.
Si je m’écoutais, je les pulvériserais tous. Je les brûlerais. Je les enfouirais sous des tonnes de gravier. Si je pouvais je crèverais la Terre entière. Même plus que la Terre. Tout. Je détruirais tout. Je voudrais déjà tout détruire dans ma tête. Commencer par ça. Et puis voir après pour le reste, si j’ai encore la force.
Je me sens inutile, mauvais, au plus profond de l’échec. Rien ne fonctionne. Je sais pas ce que je fous de ma vie. Je sais pas si j’ai tellement la force d’en faire quelque chose, de me soulever contre cette furieuse absence de résultats. C’est une ruine dans laquelle j’avance. Et mon corps bientôt se confond avec les pierres déjà là. Les lézards se faufilent. La pluie me trempe. Je m’effrite. Je disparais parmi les gravas.
Tant pis pour l’imagination, tant pis pour l’absolu, tant pis pour la création, tant pis pour moi.
J’entends ma grand-mère et ses amies discuter dans la cuisine :
— C’est un gars sérieux Quentin.
— On parle pas pareil.
— C’est le moins qu’on puisse dire.
Ça me peine réellement de dégager de telles choses.
Je me suis avancé vers le bassin. J’aurais aimé m’y laisser tomber jusqu’à l’asphyxie comme il m’arrivait de le faire enfant malgré moi, quand je chutais par-dessus le grillage, et que mon père me retenait par l’élastique du pantalon pour m’éviter la noyade. Les pierres de l’allée sont mangées par la mousse. J’ai brûlé dans un tambour de lave-linge les manuscrits refusés. On trouve encore des résidus de feuilles à l’intérieur. On ne se sert plus du barbecue que pour mon anniversaire, mais j’ai décidé de ne plus le fêter ici à cause de l’année dernière. Il y a toujours quelqu’un pour se plaindre de l’organisation une fois la fête finie, et ça me lasse. J’irai peut-être au restaurant avec mon père et ma grand-mère, ça suffira. Mon père a tronçonné la haie à l’automne dernier. J’ai tenté de nettoyer l’écoulement du bassin, mais il y a des trous partout dans la bâche. Le jardin se décrépit. Le jardin et le reste. Tout tend à l’effondrement.
Combien d’années encore avant de ne plus rien reconnaître ?
Cécile m’écrit : (surtout que tes yeux ne le sont pas, noirs). Je ne sais plus la dernière fois que quelqu’un a remarqué le bleu de mes yeux. Parfois je l’oublie. Je ne sais plus ce que je renvoie. Ce qu’on remarque de moi ou ce que je donne à remarquer. Les détails, c’est ce qui fore le plus profond en moi. Ce qui achève de me séduire.
Twitter est vraiment devenu un navire à débiles. À chaque fois que je commets encore l’erreur de m’y hasarder, j’observe les mêmes blaireaux renifler leurs propres excréments, s’enthousiasmer de leurs combats quand ils matraquent derrière des centaines d’innocents, insulter, moquer, haïr, puis dénoncer ces insultes, ces moqueries, ces haines. Se faire bouffon et danser dans la boue. S’amuser de s’entendre parler à perte. Soi toujours avec soi dans son affreuse immobilité. J’aimerais sincèrement qu’ils se taisent, qu’ils prennent le temps de s’écouter mourir, de contempler leur faiblesse, le désavoeu complet dans lequel ils s’enlisent. J’aimerais qu’ils cessent de bavarder, qu’ils se concentrent sur le silence, ou sur l’expression de leurs doutes. J’aimerais qu’ils apprennent à ne pas exister. À ne pas appartenir. À peine à parler.
Ils pensent forcément que se taire c’est subir. Alors ils parlent, jusqu’à perdre le sens, jusqu’à perdre l’attention. Ils parlent et parlent, et attendent, espèrent le progrès, le respect, l’intelligence. Ils ne comprennent pas toujours que le lieu de parole joue, influence, qu’il restreint ou, au contraire, ouvre. Bientôt, à trop faire résonner le bavardage dans des pièces hermétiques, c’est parler qui deviendra le virus. À force de ne justement pas savoir parler, pas savoir se faire écouter, comprendre. Se taire deviendra la seule issue vers le respect.
à mesure, un homme, et dans l’espace qui le sépare du, un homme, dans l’espace, dans le, dans la, cet instant, cet espace, le même que, le même, exactement, le même espace que, déjà franchi, bien des fois, exactement le même espace, l’homme, à mesure de cet espace similaire, qu’il franchissait, encore, le même, jusque, quoi, l’espace, et l’homme dans, marchant, sans aucune, enfin, droit marchant, allant, dans cet espace de la dernière fois, dans l’oubli de l’espace qu’il ne, jamais, franchira à nouveau, et, pourtant, l’homme, qui, là, encore, toujours, ne peut, n’a jamais su, saisir, ainsi, l’espèce, de lui jusqu’à, de lui encore, à terme, l’homme, cet homme, le dernier, il pense, on croit, le dernier, on se dit, l’espace, comme lui, le dernier, l’ultime espace, franchi, en train d’être franchi, connu par, accepté, à jamais, toujours, l’homme dans cet espace à jamais toujours, seul, définitif, sans pont, aucune, aucun moyen, de plus, de franchir à nouveau, l’homme sait, l’espace, de le franchir, jamais, mais, l’homme, se dit, pas de regrets, se dit, pas de victimes, se dit, pas de pleurs, se dit, l’espace, jamais, à jamais, englouti, moi englouti, dans l’espace, qui me sépare, qui, l’espace, m’envahit, qui, l’homme, l’envahit, à jamais, l’homme, pour toujours, en route, dans l’espace, victime, rodeur
Ma grand-mère refuse toujours que je tonde le gazon. Elle a pourtant fêté hier sa soixante-dix-neuvième année.
J’éprouve une espèce de blocage depuis quelques temps. Je ne sais plus ce qu’on est censé dire aux filles qui nous marquent, durant cet instant avant l’intimité, quand la liaison encore se noue. J’ai toujours un intense plaisir aux premiers rendez-vous, à rire, découvrir, recevoir, mais l’après, quand doivent se créer le désir, la parole et l’envie, cet abysse-là, de quoi déjà est-il fait, je ne sais plus. Pourtant, je me trouve plus ouvert, attentif, je me trouve moins ridicule qu’auparavant, moins égoïste. J’ai envie. Je me sens disponible, stable, curieux. Je ne cherche rien en particulier. Je reste des heures devant le clavier de mon téléphone à imaginer quoi dire, quelle anecdote partager, quelles relations communes exploiter. Je m’enlise avant le sommeil. J’ai l’impression d’être cassé. D’être réfugié dans un univers hors-monde, hors-amour, hors-autre. Je me demande comment je faisais avant, quand je ne me posais pas la question. J’aimerais laisser faire. Mais quand je laisse faire, j’oublie. Et après avoir oublié, je regrette.
Je viens de terminer Requin, que j’associe à chaque page au film Vincent n’a pas d’écailles. Finir sa vie dans un lac tout en parlant à voix haute.
« Voilà des années que je regarde le monde comme un merveilleux endroit auquel je n’ai plus accès. » — Bertrand Belin, Requin.
Je lis beaucoup de belles choses. Pourtant, je me crois de plus en plus incapable d’en écrire jamais aucune.
Le rire de Cécile dévoile ses canines. Le cheveu de Cécile derrière son oreille ainsi se dissimule. Quand elle passe la fin du doigt dans son cheveu derrière son oreille le cheveu s’entortille et le doigt dedans lui aussi. La dernière ombre du miroir couche dans le café sa nuit d’hiver. La fatigue des ventres creux que console un rien de thé. Le sentiment s’empare des tables voisines puis les estompe. Dehors, la ville s’ouvre sur des routes inconnues et les tours adoptent le dessin d’autres plus hautes encore. Ainsi le trajet s’allonge à mesure du trompe-l’oeil. C’est un prétexte invisible qui pourtant rajoute depuis la paume jusqu’au manteau une distance jusque-là jamais franchie. Cécile et le voyageur dans la ville qui depuis à ses yeux se colore. Et il faut dans l’heure traverser les parcs et les avenues aux souvenirs parfois frais. Enfin vient la gare et dans la gare de Cécile plus de traces. L’histoire ne dit pas où Cécile est passée. L’histoire, non plus, ne dit pas ce qui console le voyageur dans ce train qui le ramène seul depuis la ville jusqu’à la mer.
Parfois la nuit je me réveille dans un cauchemar, et j’ai la sensation d’être encore endormi, et pourtant rien autour de moi n’est incohérent. Si je dis que c’est un cauchemar, ce n’est que par intuition. La même intuition qui me guide parfois tard dans les bois à la périphérie de la ville. Cette intuition qui m’entraîne vers le mal. Je me laisse faire par paresse. Je suis dans mon cauchemar et les choses sont telles qu’elles sont habituellement. Elles se présentent à moi et je peux les toucher. Je peux les sentir, les goûter. Elles ont parfois bon goût. Rien ne se déforme. Rien ne m’angoisse. Je n’aspire pas à vivre. Parfois la nuit ne tombe pas. C’est le jour puis le jour encore, car c’est un cauchemar, et même si rien ne change, tout est différent. Je ne dors pas le jour car je ne veux pas gâcher le soleil. Habituellement je n’y pense pas. Je m’endors car je suis fatigué. J’y pense là puisque je suis dans un cauchemar. Dans mes cauchemars, je pense à ce qui habituellement ne me soucie pas. Je pense à ma mère, par exemple.
Il y avait quelqu’un à ta place devant la table du salon. Quelqu’un à qui j’avais donné ta place, mais qui pourtant ne l’occupait pas de la meilleure des façons. Quelqu’un comme par défaut. Et pourtant, à mesure du temps, je me suis habitué à cette présence. J’ai eu peur de lui en vouloir d’être là. Ça a été. Je n’en ai jamais parlé. Je ne voulais déranger personne. La vie a passé en sa compagnie et je lui ai transféré comme j’ai pu ce que nous avions vécu. J’ai fait comme si c’était toi. Parfois l’illusion était parfaite. Il me fallait un certain effort avant de me rendre compte que je parlais à un inconnu. Même mes amis sont tombés dans le piège. Comme quoi, on peut tout oublier.
Voilà plusieurs fois qu’à l’occasion de la sortie de son dernier roman j’assiste à des prises de parole de Lionel Duroy. Je n’ai jamais rien lu de lui. Je doute de remédier un jour à cette lacune. Ce que je prenais d’abord pour une prise de parole sympathique s’est progressivement transformé en ritournelle misérable. Il a touché du doigt un sentiment qui lui a semblé inédit et depuis il s’en fait le messager comme s’il détenait là la lumière. Alors il prend bien son temps à chaque fois qu’il en a l’opportunité pour expliquer à quel point l’écriture capture la lumière de la vie, à quel point l’écrivain fonctionne comme un peintre, enfin tout un panel de conneries bas-de-gamme pour impressionner les ignorants. J’imagine parfaitement les têtes de ses auditeurs dodeliner. Selon lui, la vie passe et on serait incapables de la saisir. Comme si on avait envie de la saisir. Comme si on avait envie de s’attarder, de se pencher sur cette béance absurde qui nous mène. Et en plus de la capturer ! De figer ces horreurs ! Qui voudrait revivre un supplice pareil. Sinon un simplet. Sinon un idiot.
Il y a peu à sauver en chacun de nous.
Adolescent, je voulais tout acheter. Aujourd’hui que j’ai de l’argent, je n’ai aucune idée de quoi en faire.
Plus je vieillis, et moins j’ai d’envies matérielles. De quoi décorer confortablement mon appartement, des livres évidemment, quelques vinyles parfois, du thé quand il vient à manquer. Je ne sais comment les autres accumulent tant de bibelots ; je peine même pour trouver des images à encadrer. Sans doute pourrait-on utiliser cet argent pour voyager, pour manger dans des restaurants de qualité, ou s’offrir je ne sais quel instrument ou véhicule habituellement hors de ses moyens. Sans doute. Je pourrais sans doute aussi en donner un peu. À qui en aurait davantage besoin. J’ai toujours été particulièrement égoïste. Déjà mes cousins (en qui j’avais pourtant parfaitement confiance et qui partageaient mes journées d’été), j’étais incapable de leur confier la moindre de mes affaires. Pareillement, aujourd’hui, je ne prête qu’extrêmement rarement mes livres. Je ne suis pas très doué avec les objets.
Aussi l’argent m’a toujours causé d’énormes problèmes. Essentiellement à cause de ma mère. J’y reviendrai.
Il y aura pour toi le calvaire, et après le calvaire il y aura bien pire. On t’avait pourtant prévenu qu’il était suicidaire de quitter le refuge. On t’avait confié nos angoisses, et voilà comme aujourd’hui tu erres dans la pinède, ainsi qu’un fauve apeuré. Bien sûr, oui bien sûr, les chasseurs. Les détonations au-dessus de la plage. Les envols. Bien sûr, c’est bien peu, désormais, pour te consoler du malheur. Tu auras bientôt fini de tout transformer en lambeaux. La poussière te saisira les bronches. Tu t’écrouleras, et tu repenseras aux avertissements. Tu comprendras. Bien sûr, tu comprendras.
« Bien sûr, ce n’est que l’essence de ce que je pensais, mais j’ai l’impression que c’était bien par ces mêmes mots que je parlais. Il fallait que je les note, parce que, si je me suis mis à écrire, c’est pour me juger. »
Mon père ne comprend pas depuis quand j’ai cette violence en moi. Il se souvient toujours du petit garçon blond, silencieux, discret, qui jouait sans demander de comptes à personne, qui se réfugiait en lui pour se sauver des repas où ne se trouvaient que des adultes. Il aime à répéter à quel point on se battait pour me garder. Peut-être ai-je été marqué par le divorce de mes parents. Je ne trouve que cette rupture-là pour justifier de mon caractère aujourd’hui impulsif. Peut-être n’y a-t-il aucune justification dans mon histoire personnelle, peut-être est-ce seulement l’ambiance générale de la société autour de moi qui me pèse sur les nerfs, qui écrase ma compassion, mon empathie. C’est la lente prise de conscience du marasme dans lequel nous surnageons tous qui m’a fait dégénérer. J’aimerais y demeurer indifférent mais c’est à croire qu’il cultive en moi ses humeurs noires.
« Je lui ai répliqué avec fougue, insistant sur l’égoïsme de ces gens qui abandonnent le monde et l’utilité qu’ils auraient pu apporter à l’humanité, pour la seule idée égoïste de leur salut. » — Fiodor Dostoïevski, L’Adolescent.
Ce postulat de départ : l’extérieur est désormais altéré par tous nos fantasmes numériques.
Par exemple, aux champs qui bordent la maison de ma grand-mère, à Matignon, et qui durant ma première enfance n’étaient que cette présence sincère des céréales cultivés ou des bêtes, se sont superposées au fil des années les visions de mes successifs fonds d’écran. Notamment, sur mon premier ordinateur sous Windows XP, la plaine verte reconstituée derrière laquelle fuit un ciel oblique et où s’étale une lumière incohérente, image qu’on impose suite au paramétrage par défaut des personnalisations système, et qui pourtant satisfait aussitôt l’oeil ainsi que l’esprit au travail.
Aussi, les champs, les plaines que j’éprouve au hasard de mes déplacements, désormais, existent au moins autant réellement qu’ils sont modifiés par de nouveaux décors virtuels et imaginaires car parfaitement reconstruits. Quel graphiste a eu l’idée maladroite de déposer ainsi divers éléments idylliques pour former de toutes pièces un décor apaisant s’est fait malgré lui paysagiste cauchemardesque. Mais inversement, n’importe quelle nouvelle plage découverte, n’importe quel hanger à cochons, ou panorama de villes, devient une potentielle suite de codes hexadécimaux et d’emplacements à icônes.
Ensuite, il ne faut pas longtemps pour créer une véritable paranoïa face à l’environnement. Pour imaginer possible de découvrir, derrière la façade des choses, la place où ranger ses documents, ses perversions, ses souvenirs. Les sentiments ne se superposent plus aux lieux, ils se cachent dans. On envisage de ranger sur une brique une vidéo pornographique ; sur une colline divers morceaux de John Cage ; sur les nuages noirs d’une tempête d’autres photographies de vacances. On donne à l’alentour un aléatoire complet cause de notre nouvelle utilisation des surfaces. J’ai donc décidé d’exploiter cette faille technologique au maximum pour concevoir chaque zone visuelle comme possible benne à ordures.
En somme, grâce à ces nouvelles configurations, il ne paraît plus incongru d’observer deux personnes faire l’amour devant un avion à haute altitude, ou d’assister au meurtre d’un enfant devant le coucher de soleil d’une île paradisiaque. Que les deux éléments ne soient pas sur le même plan ne les empêche pas de communiquer entre eux.
J’ai regardé le documentaire Citizenfour sur l’affaire Snowden. Je n’avais suivi cette histoire que de loin lors des faits. Évidemment, Edward Snowden est fascinant. Ce type qui lâche au-delà de son confort et de sa vie personnelle pour se mettre à dos des nations entières, pour défendre des idéaux presque d’un autre temps, d’un autre temps qui n’a pourtant jamais existé, c’est fort en soi. Et d’ailleurs on s’empressera s’en doute d’en tirer des films médiocres qui ne tireront jamais mieux, jamais plus de cette histoire que ce qu’elle est au départ.
Mais ce qui m’a surtout fasciné c’est l’omniprésence du langage informatique qui stagne sous la surface de notre discours écrit habituel. Un code qui là, caché, est aussi du texte, mais sans prise fixe. C’est par exemple toutes les balises invisibles qui entourent ce paragraphe que vous lisez, comme tous les autres au-dessus et en-dessous, ou encore les saisies cryptées, les lettres qui se mêlent aux chiffres qui se mêlent aux symboles, uniquement afin de brouiller, de dissimuler la vraie parole, la vérité, celle que les dirigeants ne doivent pas entendre ; sinon, on pourrait risquer le pire. Il y a une véritable résistance du langage qui prend forme au travers du code informatique. Et il faudrait rendre cette tension-là, de la dissimulation, du cryptage. Je ne sais pas comment faire. Ça serait une quête essentielle pourtant, de l’époque, au moins de la décennie. Éprouver la même sensation qu’en regardant la pochette de l’album Kid A de Radiohead. Ces montagnes qui se dessinent, et pourtant à leur approche des plages numériques qui les brouillent, des aplats noirs, bleus, des mosaïques informes, qui sont les nouveaux paysages de notre temps. Montrer comment aujourd’hui, autour des mots, il n’y a plus des pensées, mais d’autres mots.
Imaginer le futur. Se faire une raison. Abandonner tout espoir.
Il avançait dans la boue. Il disait je ne sais pas tout en s’y enfonçant, et la boue allait venait dans sa bouche, ils pouvaient à peine entendre ce qu’il racontait, lui avançant dans la boue, déjà la tête presqu’entièrement engloutie, et ses paroles dégénérant en bulles, mourant ainsi à la surface, en de légers échos dissolus, lui qui avait choisi de s’enfoncer là au milieu des autres, pour ne plus jamais apparaître à nouveau, ne plus jamais faire son acte de présence au monde, sombrant, indistinct, parmi le bavardage de la terre, de l’eau, parmi la cohue des inconnus l’entourant, l’encerclant, ainsi qu’un pendu, qu’un condamné, ainsi qu’une misère dans le fond de la boue, où son crâne à présent disparaît, se noie, sous la nuit des immeubles, sous le vacarme de cette ultime angoisse, et sans aucune espèce de regret, sans le début d’un renoncement, ainsi sans que personne d’autre ne sache, il a fondu sous la boue.
Je suis sans histoire. J’ai marché sur les traces de mon passé et je n’y ai rien trouvé. J’ai consulté chaque photographie conservée par mon père, et les visages dessus ne m’évoquaient rien. Aucune guerre, aucun conflit, aucune victime. Que des rescapés du chaos. J’ai tenté d’imaginer quoi dire à partir du manque de traumatismes, mais je n’ai trouvé aucune solution. Il n’y a pas d’histoire à raconter pour les épargnés. Il n’y a rien à confier. Dans les camps j’ai inventé des griffures sur les murs, j’ai dit aux touristes autour de moi : Voilà les traces de mon grand-père ! Et les touristes ne m’ont pas cru. J’ai abandonné plusieurs animaux de compagnie. Je n’ai pas cherché à les retrouver. Je leur ai hurlé dessus de partir. Ils sont partis. On les a remplacés. La douleur a été comblée. Je me suis mis à la place des faibles. Je me suis détesté. J’ai trouvé ça épuisant de n’avoir plus qu’une jambe. Et je n’ai plus séduit aucune femme. J’ai tenté de partir à l’aventure, et au premier virage un panneau m’indiquait déjà le chemin du retour. J’ai attendu dans mon salon au cas où quelqu’un viendrait. Sans davantage de succès. Parfois je me réveille la nuit car je crois avoir quelque chose à dire. Je me précipite devant mon bureau, mais ce que j’écris ne correspond pas du tout à ce que j’imaginais. Je jette aussitôt le brouillon à la poubelle. Ma poubelle est pleine de brouillons et de peaux de bananes. Je mange des bananes pour tenir le coup face à mes médiocres brouillons. Parfois aussi j’ai la sensation de cultiver un autre langage propre à ma rancoeur. Avant de rencontrer le clochard en bas de chez moi qui s’exprime comme je croyais être le seul à le faire. C’est toujours un coup de plus au moral. Au moins, je ne contrarie personne, on ne jalouse pas mon talent. On n’a rien à me reprocher. C’est une petite victoire dans ma vie. Comme tout est petit dans ma vie. J’imaginais bien sûr la grandeur du talent engourdir mes doigts durant chaque séance de travail. Je me suis vite fait une raison. Le talent n’est pas tellement une histoire de femme. Mon père est mort dans l’anonymat, ainsi que ma mère. Je conserve un portrait d’eux sur mon bureau. Je les aimais beaucoup. J’aurais aimé qu’ils m’aiment moins. Ça m’aurait davantage aidé aujourd’hui qu’ils sont morts. Je suis malheureux d’avoir été chéri. C’est bien une peine de petit-bourgeois. J’ai fait l’amour deux fois. C’est moins que la plupart de mes amis. Et j’en ai pourtant peu. La première fois ça a été. La seconde, je ne sais plus. Moins bien je suppose, donc. Bien sûr il y a les putes, oui, bien sûr, pourquoi pas. Ça me changerait peut-être les idées, une pute de temps en temps. Je vais déjà au cinéma pour me changer les idées. Seul. Je m’assois le plus près possible des étrangers même quand les rangées sont vides. Je vois bien que ça les gêne. Pourtant ils ne disent rien. Ils font comme si je n’existais pas. Les gêner c’est ma façon à moi d’être présent au monde. Je peux au moins me vanter de gêner quelques fois. Quand mes rares amis m’invitent à leurs soirées, j’amène des bouteilles de vins que personne ne boit. Je repars avec mes bouteilles de vin. Je les aligne sur un meuble de ma cuisine. Je ne les bois jamais. Elles me rappellent à quel point j’échoue dans mes rapports humains. Comme on ne boit pas mes bouteilles, on ne me parle pas. Je tente de m’intéresser aux conversations mais les cercles sont toujours étroitement fermés. Les films que je vais voir, personne d’autre ne les a vus. Ce ne sont pas des amis très cultivés. Les quelques amis que j’avais et qui étaient cultivés le sont devenus beaucoup trop pour moi et depuis ne me parlent plus. Je suis pris entre deux étaux. C’est très désagréable comme sensation. Je ne sais pas si vous avez déjà broyé votre main dans un étau jusqu’à l’instant où les os craquent, mais vous devriez essayer une fois. Vous verriez ce que je ressens. Si jamais ça vous intéresse. Je ne vous force pas la main. Peut-être que vous n’avez pas besoin de ça pour vous sentir exister. Heureusement pour vous. C’est une chance. Mes amis ne me présentent pas aux femmes qu’ils invitent. Ils doivent penser que je suis un pervers. Ils m’invitent par réflexe, pour ne pas trop me peiner. Avant je parvenais à les faire rire. C’était tout ce que j’avais. Aujourd’hui je suis trop aigri et déprimé pour ça. Je me suis un peu laissé couler au fond du trou. J’attends que quelqu’un jette les premières pelletées de terre sur mon corps. Je fais des efforts pour mes amis comme ils en font encore pour moi. Je leur rends le peu de délicatesse qu’il leur reste. Je ne sais pas si d’autres ailleurs sont comme moi. J’y pense parfois. Je ne pourrais pas les supporter. C’est très dur de se supporter, vraiment désagréable. Mes amis ils se supportent parce qu’ils sont cons. Dès qu’on prend un peu de recul c’est difficile de ne pas tous les trouver cons. Eux ils ont le nez sur les femmes qu’ils invitent et sur le vin qu’ils boivent alors ils ne se rendent pas compte. Ils n’imaginent pas comme je les trouve cons. Peut-être que c’est cette haine envers eux qu’ils ressentent quand bien même je me tais. C’est leur présumer trop d’empathie. Je rentre toujours le premier des fêtes où l’on m’invite, parce qu’il n’y a souvent plus de chambres où coucher. Elles sont toutes déjà prises. Je rentre à pied. C’est trop tard pour les bus. J’habite loin, à la périphérie de la ville, mais mes amis ne se sont jamais souciés de savoir si c’était sûr que je rentre à pied aussi loin aux heures où je rentre. Ils sont déjà couchés quand décide de rentrer. Parfois même je reste seul chez mes amis alors qu’ils sont tous couchés et je profite de la nourriture dans le frigidaire, ou de leur home cinema. Parfois des deux en même temps. Quand je mets le volume du home cinema très bas j’entends mes amis baiser dans les chambres au-dessus de moi. Je me branle en les écoutant. Je regarde les émissions qui passent sans le son et je me branle. Ça m’arrive de venir devant des débats politiques. C’est le son qui m’importe, pas l’image. Quand mes amis ont été trop pressés pour penser à bien fermer la porte de leur chambre je les scrute à travers l’interstice. Je m’imagine à la place de l’ami qui baise. Ça me soulage. Ça me permet de tenir le trajet du retour à pied jusque chez moi. Quand j’ai la flemme de rentrer à pied au milieu de la nuit, j’attends le petit matin et je passe m’acheter une viennoiserie à la boulangerie. Ça calme la douleur de manger un pain aux raisins sur le trajet du retour. On doit me prendre pour un alcoolique à rentrer comme ça chaque weekend la nuit avec une bouteille de vin pleine sous le bras. C’est dans l’idée qu’on fasse attention à moi. Les passants ne doivent même pas se rendre compte. Moi je me rends peu compte des personnes que je croise quand je marche dans les rues. Sauf des femmes. Mais les autres types, qu’est-ce que je pourrais bien vouloir regarder chez eux. Ils sont tous au moins aussi déprimés que moi. Parfois ils ont une femme ils savent même pas en profiter. Je les vois quand je vais au restaurant le vendredi soir, tous devant leurs femmes à pas savoir quoi raconter, à rester là le nez dans les lasagnes, à regarder autour. Ça m’inspire bien de la pitié. Je préfère encore manger seul. Ils doivent me plaindre. Ils doivent se dire le pauvre il mange seul au restaurant un vendredi soir. Je suis sûr qu’ils se disent ça. Je sais bien comme je fais pitié. Je m’en rends compte. J’ai bien conscience à quel point je suis un ingrat d’imposer ma triste vie comme ça aux yeux de tous. Comme ils seraient tous plus heureux sans me voir. Sans me voir les juger alors que je mange mes paupiettes. C’est ma grand-mère qui me faisait des paupiettes. Ça me rappelle des souvenirs. Au moins j’ai des souvenirs. Alors que eux, ils n’ont que la gueule de leur conjoint à contempler en silence. Une vraie misère. Le vendredi soir je mange au restaurant et le samedi soir je vais chez mes amis. Le reste de la semaine j’attends que le temps passe. Je travaille dans un abattoir. Les premières années j’ai préféré travailler le matin pour me réserver mes après-midi, et puis je me suis très vite rendu compte n’avoir rien à faire durant mes après-midi. Alors depuis, je travaille l’après-midi. Je tranche des morceaux de viande sur des cochons morts. Toutes les parties du cochon. Tout est bon dans le cochon. Je tourne. Je suis pas toujours au même poste. J’avais de plus grandes ambitions quand j’étais adolescent, et puis on se fait vite une raison. On regarde les têtes des cochons passer sur son tapis roulant et on se dit qu’on n’est pas très loin d’avoir ce regard là. Au début ça fait mal, ensuite on s’habitue. À cause du bruit, on communique peu entre collègues. Il y a des immigrés, des gens du coin, un peu de tout. Les femmes se font siffler quand elles marchent dans les couloirs. Elles le prennent bien. Leurs maris doivent même plus les toucher. Ça les change. Certaines se privent pas pour vous faire du rentre dedans. Aucune ne m’excite. On est tous habillés d’une même combinaison blanche intégrale. C’est très compliqué de susciter le désir là-dedans. Je suis là pour travailler, c’est tout. J’amasse de l’argent. Je ne sais pas quoi en faire. Je n’ai aucune envie. J’ai tous les meubles nécessaires à ma commodité depuis déjà bien longtemps. Je n’aime pas tellement les voyages. Ça me déprime. Je ne sais pas qui je cherche quand je pars, ni où j’espère aller. Je préfère rentrer. Je vais au cinéma quand même, mais c’est peu cher quand c’est notre unique dépense. Je ne sais pas où tous mes amis dépensent leur argent. Sûrement dans de quelconques bijoux pour satisfaire leurs femmes. Sûrement. Je suis pas là pour juger. J’exprime mon ressenti, c’est tout. La semaine passe vite comme ça à travailler. J’ai le sommeil lourd, alors quand je rentre après une journée de travail, je regarde les informations et puis je vais me coucher. Je me branle encore une fois, et très vite je m’endors. Je me réveille tard dans la matinée. Je mange en vitesse et c’est déjà l’heure d’aller travailler. Depuis des années voilà mon quotidien. D’où l’envie de me créer une histoire. D’avoir des ennuis. Je pourrais insulter des noirs, ou violer une femme. Je ne sais pas si ça résoudrait le problème. Ça ne me tente pas tellement. Ça ferait davantage de peine aux autres qu’à moi de bien. Je suis quand même dans une impasse. Je n’ai pas tellement le goût de vivre. Je ne sais pas ce que j’attends des jours à venir, ni ce qui me fait à ce point revenir à zéro. Je ne sais pas pourquoi je vis. J’en veux à mes parents de ne pas y avoir pensé quand ils m’ont conçu. De ne pas avoir pensé au cas où ça ne fonctionnerait pas pour moi. Au cas où je ne m’adapterais pas. Il faudrait plus y penser, à tous ceux qui ne s’adaptent pas, qui regardent leurs amis baiser et qui travaillent sans discontinuer chaque jour jusqu’à la mort. Il faudrait penser à ceux qui ne trouvent aucun soulagement dans l’art. Qui répugnent toutes les femmes. Il faudrait qu’on s’attarde là-dessus un jour. Qu’on ne fasse pas semblant qu’on n’existe pas, qu’on n’erre pas chaque weekend dans les rues désertes de la ville. Il faudrait qu’on trouve une solution pour nous tous qui sommes là à envisager le pire. Ça serait aimable. De faire au moins ça pour nous. Qui n’avons pas d’histoire.
« Je croyais écrire pour pallier ce défaut d’esprit qui m’empêche de parler. Je parle mal. Je dis tout le contraire de ma pensée. Je bafouille, je ne sais exprimer ce que j’éprouve. Les mots se dérobent, les phrases s’emmêlent et restent en suspens. » — Jean Forton, La cendre aux yeux.
marre marre marre d’être là comme un incapable à taper toujours les mêmes conneries et puis revenir dessus le lendemain et réécrire sur les mêmes mots d’autres mots que j’imagine plus adéquats plus conformes à ce que je voudrais dire mais je suis incapable de savoir ce que je veux dire j’entasse les mots les uns à la suite des autres je les bourre là dans la page chaque jour comme ça le lendemain pareil ensuite encore les jours qui suivent toujours ajouter et puis enlever et puis ajouter et puis qui dit quoi et puis comment qui marche et puis pourquoi là il est mort et pourquoi pas et aussi et et et etetetetetete toujours sans relâche et si je fais pas ça je crève je le sens si je mets pas des mots comme un abruti chaque jour je crève je me plante une lame dans la gorge et j’attends là que le sang coule alors je continue d’aligner des conneries des mensonges je crois que ça va régler le problème je crois que je peux me contenter de ça pour pas me taillader la gorge du coup je bouche les horizons je crois que ça va être mieux que ça va régler le problème et puis qu’ensuite je serai débarassé et que je pourrai retourner à mes affaires genre aimer ou regarder les nuages ou je sais pas mais la vérité c’est que toujours jusqu’à la fin de ma vie il y aura que les mots à entasser sur la page pour pas me laisser crever.
« L’écriture attrape avale ça qui a été vécu, supposé l’avoir été ; des voix viennent se déposent perdent l’histoire la rendent au désert. » — Anne Élaine Cliche, Jonas de mémoire.
J’ai déjà imaginé tuer, bien sûr, trois fois au moins, et puis ensuite l’envie passe, on se dit, est-ce vraiment bien nécessaire, et il faut croire que non, puisque l’envie passe, et si ça n’est qu’une envie, comme me disait papa, c’est qu’elle n’est pas éternelle, papa me disait ce genre de choses, que ça n’est pas éternel, que rien, enfin pas grand-chose n’est éternel, il insistait, alors l’envie de tuer m’est passée, de tuer les autres tout du moins, en ce qui me concerne c’est plus compliqué, c’est une envie permanente, je sais qu’elle va me suivre toute la vie cette envie, et pour ces envies-là papa n’a jamais rien dit, ne m’a jamais rien conseillé, alors c’est plus compliqué, de se faire une raison, de passer à autre chose, bien sûr j’ai de la volonté, mais de moins en moins à mesure que le temps passe, de moins en moins même quand je pense aux personnes que j’aime, parce qu’il y a sans doute de moins en moins de personnes qui m’aiment, et ça ça me fait mal et c’est là que je veux tuer, enfin me tuer, avant je voulais tuer qui ne m’aimait plus et j’ai compris que ça ne les ferait pas m’aimer à nouveau alors je pointe le chargeur sur mon corps et ça ne les fait pas m’aimer à nouveau non plus alors je me demande bien ce qu’ils attendent pour m’aimer à nouveau, que je ne sois plus là peut-être, oui, peut-être.
Énorme fou rire en lisant ce passage dans le premier tome du Journal de Rudigoz : « Avant ces poèmes, on nous avait fait entendre un vieux disque de la voix de Claudel. Des rots, une outrecuidance, une pédanterie, une façon de parler de Dieu… insupportable, grotesque ! Il en avait plein la gueule, ça lui coulait sur les babines. Dieu ? Un gigot ! Du cassoulet ! »

Un jour j’ai rencontré une jeune fille, je l’ai aimée aussitôt, ça je l’ai aimée, on ne pourra pas me l’enlever, c’est presque tout ce que j’ai jamais eu, de l’amour pour cette jeune fille, je l’avais rencontrée durant mon apprentissage, elle mangeait un morceau sur le muret en face de là où j’étais en apprentissage, elle était de l’école d’à côté, où les filles apprennent d’autres choses, des choses qui ne nous concernent pas nous les garçons, un jour différent de celui où je l’ai rencontrée elle m’a offert une part de son déjeuner, je n’étais pas habitué à ce que quelqu’un veuille partager quelque chose avec moi, ça m’a surpris un instant, je me suis même méfié, j’ai pas peur de le dire, je me suis méfié de cette jeune fille parce qu’elle m’offrait quelque chose, même maman que j’aimais beaucoup ne m’avait jamais rien offert, ni à Noël ni à mon anniversaire, ce n’est pas une attention que je connais, à laquelle je suis sensible, quand on me donnait des choses c’était toujours pour me tromper, pour me mettre un coup de baton dans le dos, alors j’ai appris à ne plus rien accepter, mais cette fois-ci j’aurais été étonné que cette jeune fille m’en veuille et me fasse un sale coup, alors j’ai tendu le bras, j’ai accepté cette moitié de déjeuner qui sentait bon et goûtait pareillement, je n’ai pas tout de suite trouvé quoi lui dire, elle non plus, d’autant qu’elle avait la plupart du temps la bouche pleine, et qu’il n’est pas très poli de parler la bouche pleine, sauf si on l’avait éduquée en lui affirmant le contraire, ce dont je doutais, alors plusieurs fois d’affilé comme ça on s’est assis l’un à côté de l’autre sans rien dire, et on mangeait, et je ne savais pas encore où cette histoire allait me mener, si quelque part, si nulle part, avec ma paresse habituelle sans doute nulle part, mais il était encore trop tôt pour le dire, enfin je n’avais pas tellement peur, mais j’ai toujours été timide, déjà pour saluer les vieilles dames quand j’étais enfant il fallait y mettre toute sa volonté, je ne voulais jamais descendre de la voiture, on disait que j’étais sauvage, je ne rendais pas très fiers mes parents, d’ailleurs ils m’ont puni plus d’une fois pour mon comportement, et il fallait bien se rendre à l’évidence, ça n’avait rien changé, j’étais toujours incapable de parler à cette jeune fille, j’ai eu peur un instant, et puis finalement je me suis lancé, j’ai pas cherché très loin, je me suis dit qu’il était préférable de ne pas prendre dès le départ trop de risques, alors cette fois-là qui a tout changé j’ai fini ma bouchée, je me suis tourné vers elle, et j’ai demandé : vous venez souvent par ici ?
Passé un certain stade d’épuisement, tout chef-d’oeuvre paraît être le gribouillis du plus parfait des crétins.
Durant mes phases d’écriture, ou de réécriture, comme en ce moment avec Murmures noirs, je me trouve sec de tout le reste. D’où ma présence diffuse et parfois espacée en ces lieux, comme ailleurs. D’autant qu’au-delà du texte me tracasse le coeur, et pour une fois je n’ai rien à m’entendre dire là-dessus. Quand je vois pourtant le vacarme que j’ai pu provoquer l’année dernière en détaillant chaque étape de ma peine, et la délivrance ensuite éprouvée, cette cure, ce repos, je me dis qu’il est encore loin le temps de la stabilité.
D’ailleurs, j’ai rêvé de Sylvie la nuit dernière. Cauchemardé serait plus honnête. On se trouvait dans une maison qui ressemblait à celle de ma grand-mère, mais nous étions déjà séparés. Elle allait visiter sa famille (que je n’ai pourtant jamais connue) avec ses deux fils. Nous étions tous installés à discuter dans la cuisine quand, un instant plus tard, j’ai entendu un bruit sourd dans le jardin et me suis précipité sur la terrasse. Là, des engins de chantier abattaient un des plus beaux arbres limitrophes et roulaient sur la haie en direction de la maison. Je crois que l’herbe brûlait autour, je ne sais plus exactement. Je n’arrivais pas à retrouver Sylvie dans la cuisine pour lui faire remarquer à quel point les engins de chantier dévastaient tout dans le jardin. Les deux autres personnes (ses fils ?) et moi sur la terrasse étions figés par l’angoisse, mais là, après coup, je ne saisis pas tellement pourquoi. Je déteste les rêves. Ils nous font tous passer pour des abrutis. Enfin, j’ai affreusement mal dormi.
À marcher dans mes nouvelles chaussures depuis le centre commercial jusqu’à la maternité, des ampoules sont apparues sur mes talons. Il n’y avait pas de pansements là où nous nous sommes arrêtés avec Alice alors, me voyant peiner pour calmer la douleur, elle a saisi mon pied entre ses mains pour enrouler le bandage. Voilà longtemps que plus personne n’avait ainsi pris soin de mon corps. Le bandage n’a pas tenu dix mètres, mais son attention a calmé la douleur.
À table, mon père m’a appris que mon arrière-grand père paternel (le père de ma grand-mère) faisait partie des cantonniers ayant construit la grande route des Sables d’or. Un jour, cette information trouvera un écho en moi.
Ma voiture au garage depuis mardi, Fiona est passée me prendre chez mon père à Trégueux. Je voulais lui faire visiter les Sables d’or. Cette commune frappe par ses grands lieux symboliques : un casino, une carrière abandonnée, une plage, un petit supermarché, quelques brasseries, une chapelle, un garage désert. On a poursuivi après la digue sur un chemin de douaniers, grimpé parmi les ajoncs et les ronces vers un bunker en hauteur où deux jeunes garçons allongés écoutaient de la musique à travers le haut-parleur défectueux d’un téléphone. Il y avait, plus loin que les pins, la route pour rejoindre Fréhel, et Fiona ne voulait pas de cette route-là. On s’est perdu au fond de la carrière de pierres avant d’apercevoir au loin voitures et camions bennant du gravier. La boue, les déchets, les roues suspendues dans le vide, les barrières brisées en pagaille sur le sol. On a repris par les lotissements aux trottoirs d’herbe, longeant la chapelle blanche rénovée l’été dernier. Les adolescents s’y embrassaient adossés à leurs scooters. Rien n’était ouvert sinon un salon de coiffure et le café de l’hôtel. On est remonté dans la voiture en direction de Pléneuf-Val-André. On s’est installé pour boire un chocolat chaud. Deux heures durant, alors que la dépression costarmoricaine s’engouffrait par toutes les rues de la station balnéaire, on a évoqué le déclin des amours et la ruine du temps présent. Elle m’a laissé une des deux photographies prises devant la plage. Je voudrais vivre dans cette photographie de la brume sur la plage. Je voudrais lui dire vouloir vivre avec elle dans cette photographie de la brume sur la plage. Je n’arrive qu’à lui faire la bise à l’instant des aurevoirs.
Je préfère me tenir à l’écart du préjugé encombrant la mémoire des farceurs littéraires, ces réactionnaires du style, illuminés de la nostalgie, ne situant plus l’âge d’or du mot au XIXème siècle mais au milieu du XXème siècle, admirant ceux-là qui certes ont su dégager l’instant de l’époque dans certaines oeuvres de qualité, mais ne pourraient plus trouver aucune actualité si on s’obstinait à écrire encore comme eux aujourd’hui. De ceux-là qui sont presque les plus datés de leur temps. Les réactionnaires m’ont toujours foutu la gerbe, et encore plus en littérature ; incapables de ressentir l’ambition de leur époque, sa manifestation. La prétention qu’ils opposent à toute tentative de littérature ludique, maline, sensible, lasse au plus haut point. C’est presque à qui sera de la plus mauvaise foi. Ils s’enferment dans le néant de leur période rêvée, sans aucune espèce de réalité ni d’unité historique. Les prochains professeurs de classes préparatoires n’estimeront plus le déclin à partir de Proust, mais de Beckett. C’est déjà ça remarquez, on progresse un peu.
« Par à-coups certaines formes apparaissent avant de retourner au chaos, apparaissent et disparaissent les arbres et les oiseaux, apparaissent et disparaissent les objets célestes, se craquelle la terre sur laquelle nous marchons, les hommes vainquent, puis sont vaincus, rien ne naît, tout se conçoit et tend à l’extinction. Cessons d’être ce qu’on est, le cosmos tend au repos. Cessons de nous laisser penser, pensons. » — Eugène Savitzkaya, Fraudeur.
Huit voix se partagent le compte-rendu d’une époque sur le déclin. Acculées de toutes parts, elles pressentent une menace multiforme. La milice elle-même qui les opprime chaque jour ne peut rien faire devant cette nouvelle armée des continents perdus. Chacune de ces voix, selon son prisme, narre le sale temps qui couve. Elles ouvrent une brèche dans le mal, apparemment sans succès. Elles tentent quand même leur chance au cas où quelqu’un puisse entendre leurs histoires avant le dernier raz-de-marée.
Depuis peu, Chevillard perd lui aussi ses cheveux ; d’où cette note : « Curieusement, nous ne jugeons chaque jour de notre allure générale et de notre pouvoir de séduction qu’en fonction de l’état de nos cheveux – comme si notre chevelure décidait seule de l’harmonie des traits de cette figure éternellement nôtre, plus ou moins avenante, qu’un coup de peigne ou de vent ne saurait de toute façon modifier le moins du monde. » On se console tous d’une telle perte en prenant chacun le problème d’une façon différente. On fabrique ainsi les remèdes qui nous conviennent le mieux. Bien sûr sans être dupes de la finalité similaire.
Un jeune romancier écrit ça : « […] qu’on défende le Nouveau Roman est déjà lolesque (sic) […] ». C’est vrai que Simon, Pinget, Sarraute, Robbe-Grillet et Duras, pour ne citer qu’eux, c’est du rapide gribouillage, à peine des gazouillements d’enfant, du chewing-gum sans saveur. Il faut quand même le vouloir pour dire des choses aussi crétines, parce qu’elles dénotent une réelle méconnaissance de l’histoire littéraire.
Enfin bon, il me disait déjà il y a trois ans : « Trouve-t-on dans les romans de Flaubert une phrase qu’on veuille retenir ? ». On ne se refait pas, hein.
Je n’ai pas les idées bien claires mais j’espère faire de mon mieux.
À l’hôpital ils ont dit que ça n’était pas normal de parler autant, je ne sais pas ce qui est normal, je ne sais pas si à l’hôpital ils le savent non plus, ils doivent faire semblant, je pense, pourquoi ils sauraient plus que moi, peut-être qu’ils ont fait de longues études, moi aussi j’ai fait de longues études que j’ai arrêtées tôt, je n’avais pas le courage d’aller au bout, je n’ai jamais eu le courage d’aller au bout de grand chose, sinon jusqu’au bout de la rue pour acheter mon pain à la boulangerie, quand même, c’était papa qui m’avait payé mes longues études parce que lui n’avait pas pu les faire quand il était jeune, grand-mère et grand-père étaient trop pauvres pour ça, alors papa très vite a travaillé comme jardinier, il faisait des beaux jardins pour les gens, avec des fontaines, des bassins, des parterres, il savait le nom des plantes, de toutes les plantes, en latin et en français, il avait d’épais livres de plante, je crois qu’il a été le premier déçu que je n’aille pas au bout de mes longues études, il avait mis beaucoup d’argent dedans et il croyait beaucoup en moi, il pensait que je pourrais devenir quelqu’un d’important, je pense qu’on peut devenir quelqu’un d’important sans les longues études, mais j’ai sans doute pris le mauvais chemin après avoir arrêté mes longues études et je ne suis pas devenu quelqu’un d’important, papa est mort peu de temps après, je ne m’en suis toujours pas remis, j’espère qu’il a pardonné mon échec avant de mourir, depuis maman se morfond sur le canapé du salon, et moi je suis à l’hôpital, où tout le monde préfère que je me taise, parce que je parle trop de papa, et de maman assise seule dans le salon, et ça dérange tout le monde, personne comprend ce que ça veut dire pour moi, en plus tous les repas de la cantine sont dégueulasses, j’ai été le seul à oser le dire, ça s’est retourné contre moi, j’ai été privé de repas pendant trois jours, je ne pensais pas qu’ils avaient le droit de faire ça, personne ne me défend ici, depuis que papa est mort personne ne me défend, papa il me défendait parce qu’il avait confiance en moi, et qu’il avait confiance en lui, alors depuis qu’il est mort, c’est un peu comme si j’avais disparu moi aussi.
Oh non, j’ai pas peur de continuer, qui pourrait m’en empêcher, est-ce qu’il y a seulement quelqu’un qui un jour s’est mis en travers de mon chemin, je ne crois pas, si c’est arrivé je ne m’en souviens plus, mais je ne crois pas, il faut dire aussi que je n’ai jamais fait trop de vagues, en somme que personne n’a sûrement dû voir la nécessité de se mettre en travers de mon chemin, mais parfois certains le font pour peu, pour rien, pour le plaisir de nuire, de trahir puis de disparaître, ça s’est vu, je l’ai vu, je me souviens, à des amis c’est arrivé, ils pourraient témoigner, moi je peux témoigner pour eux, de ce que j’ai vu, je gagnerais rien à mentir, ils resteraient mes amis, je pense, je sais pas, je pense, je vois pas pourquoi ça changerait, j’ai jamais nui à personne, j’ai pas le tempérament pour ça, il faut beaucoup de temps aussi, j’ai pas tant de temps que ça, déjà pour moi bof, alors pour nuire aux autres, non, ce temps-là, vraiment, je l’ai pas, certains l’ont, moi je l’ai pas, et le tempérament, oui, je disais le tempérament, je l’ai pas non plus, pas celui-là, c’est pas mon genre certains pourraient dire, je leur accorde ça, mon genre, je sais pas de quoi ils parlent exactement, mais je leur accorde ça, j’ai jamais trop provoqué faut dire, personne, je me tiens bien à ma place, alors qui aurait intérêt à m’empêcher de continuer, est-ce que ça dérange quelqu’un, si je parle trop fort peut-être, mais je ne crois pas, c’est bien isolé chez moi, aucun bruit ne passe, les appartements d’à côté se tiennent bien tranquilles, ils ne sont peut-être pas habités, peut-être, je ne pense pas, quand même, le facteur livre du courrier dans toutes les boites, je le vois, parfois, le matin, il livre dans plusieurs boites, alors, ça prouve bien, n’est-ce pas, que je ne dérange personne, qu’il y a du monde autour mais que je ne dérange personne, on n’a jamais frappé, ni parce que je dérangeais ni pour aucune autre raison, on n’a jamais frappé, c’est que je dois me tenir bien tranquille, personne m’ôtera ça, des fois j’ai cru, la nuit, alors je me levais en panique, j’allais ouvrir, mais il n’y avait personne, même dans mon sommeil je ne dérange personne, certains sont somnambules, ils tuent ils se rendent pas compte, c’est inconscient, c’est le cerveau qui travaille sans prévenir, moi non, mon cerveau il travaille pas sans prévenir, il fait rien, comme moi je fais rien, aucun bruit, aucun mot plus haut que l’autre, bien sage, comme disait maman, bien sage, dans mon coin, bien seul, sans contrarier personne, bien gentil, bien mort déjà.
Je n’ai aucune histoire, j’entends seulement des voix parler en moi.
Je cultive mes échecs.
Je n’ai rien obtenu à être vivant. Alors, chaque jour, je travaille à vivre.
Bien sûr, j’ai cru avoir compris, bien sûr, oui, évidemment, comment ne pas comprendre, qui n’aurait pas compris, je demande, je sais pas, d’ailleurs on est venu me voir y a pas longtemps pour me prévenir, mais j’avais déjà compris, alors j’ai dit merci, merci, je savais déjà, on m’a dit désolé, je pensais être le seul à l’avoir vu, chacun dans son coin devait penser ça, d’être tout seul à l’avoir vu, mais comment ne pas le voir, comment n’avoir pas compris, à chaque repas, devant chaque ami, comment ne pas s’en rendre compte dès le premier instant, comment ne pas se rendre à l’évidence, il faudrait mentir, tromper, il faudrait ne pas vouloir pour ne pas le voir, il aurait fallu que je ne le veuille pas, mais je m’y attendais trop, alors je l’ai trop vu, et dès cet instant-là ça a été trop tard, oh bien sûr j’ai cherché quoi faire, oui, bien sûr, après avoir compris j’ai voulu agir, mais ça ne tenait plus à moi, est-ce que ça n’y a jamais tenu, aucune idée, je crois pas, je demande, mais je crois pas, ensuite on a voulu m’expliquer, je n’ai jamais voulu qu’on m’explique, je préférais qu’on se taise mais tout le monde tenait à m’expliquer, j’avais même plus la force de dire oui, oui, je sais, j’écoutais dire sans rien dire, les autres parlaient moi j’écoutais, j’avais déjà tout compris, j’avais plus la force de dire que j’avais tout compris, ils savaient plus s’arrêter, ça faisait que doubler la douleur, j’ai préféré rien dire, je voulais pas blesser, il aurait plus manqué que ça, que je blesse, après tout ce qui s’était déjà passé, les autres disaient allez, ça va aller, je disais rien encore une fois, ensuite ils partaient, ils pensaient bien faire, ils pensaient que j’avais pas compris, alors que si, ils partaient le soir, ils me laissaient seul, ils pensaient que ça irait, je disais oui, ça ira, ils revenaient parfois, ils m’appelaient, je répondais plus, je savais ce qu’ils allaient dire, je préférais m’épargner ça, parfois je mentais, j’ai menti, j’étais obligé, je voulais pas mais j’ai menti, j’ai dit oui, oui, ça ira, je le disais déjà avant, je mentais, aujourd’hui quoi, je mens toujours, je dis que ça va, je m’en remets pas, je dis le contraire, ça rassure tout le monde, parfois ça me rassure moi, sinon j’oublie, le plupart du temps j’oublie, ensuite le temps passe, j’oublie par-dessous le temps qui passe, et plus personne ne vient, plus personne m’appelle, plus personne ne se soucie de moi, personne ne se demande plus si j’ai tout bien compris, et c’est pas plus mal comme ça, bien sûr, oui, chacun à ses affaires, et on recommence comme avant, et c’est pas plus mal, c’est pas plus mal, je dis ça, je sais pas, je demande, j’espère, je me dis, c’est pas plus mal, en même temps, je peux pas tellement faire autrement.
« Auprès de cette femme, il souffrait déjà de l’emprisonnement où elle le tenait, sentant qu’il frapperait en vain sur ce coeur, comme un homme enfermé frappe du poing une porte de fer. » — Guy de Maupassant, Notre coeur.
Ça fait plusieurs matins qu’au réveil j’ai du sang plein la bouche.
Rien n’arrivait. Souvent j’attendais mais rien n’arrivait. Ni du bout de la rue, ni du parc, rien nulle part. Parfois quelqu’un arrivait mais pas pour moi, alors c’était comme si rien n’arrivait, pire, c’était comme si rien n’arrivait pour moi, pour d’autres oui, derrière, à côté, mais pour moi, là, non, rien, rien n’arrivait. Pourtant, j’ai longtemps été là, au croisement de la rue et du parc, à attendre qu’on arrive, pourtant chaque jour à la même heure je suis là sur ma chaise, et pourtant non, personne n’arrive, alors que je suis bien là, sans faute. Parfois je ferme les yeux et je vois quelqu’un qui arrive, mais très lentement, de très loin, mais quand je les ouvre à nouveau, il n’y a plus personne, et la tristesse reprend. Dans le parc, j’entends chanter les oiseaux qui n’arrivent pas. Dans la rue, j’entends passer les voitures. On s’agite autour de moi. Ce jour-là spécialement, rien n’arrivait. Plus que d’habitude, rien n’arrivait. C’est pourtant pas faute d’essayer de faire venir, mais non, personne ne m’écoute comme j’écoute les oiseaux dans le parc ou les voitures dans la rue. Alors, j’ai eu une idée. J’ai sorti le radiocassette de mon salon, et je l’ai posé à côté de moi là où j’attendais. J’ai mis de la musique. Un temps, j’ai eu la sensation d’être écouté à nouveau. Mais, très vite, un policier a été alerté et m’a demandé d’éteindre mon radiocassette. Apparemment, il dérangeait les riverains. Ne voulant pas m’attirer de problèmes, je me suis exécuté aussitôt. Et, alors que le policier s’éloignait et que les derniers échos de la musique se dissipaient par-delà le parc et la rue, le silence m’est devenu encore plus insupportable.
Depuis, je n’attends plus ; c’est moi qui vais.
Whiplash est un superbe film pour la simple raison qu’il tente d’exprimer la tentation d’absolu. Le personnage d’Andrew, je m’y suis reconnu sous bien des facettes. J’ai vécu la même contrainte de rupture car la relation ne coïncidait plus avec les ambitions démesurées qui un jour m’ont habité souterrainement, et c’est un tel sentiment, une telle force, qu’il est impossible de s’en débarrasser, qu’elle engloutit tout, sans rien laisser, aucune trace, quedalle. L’implication iraisonnée dans l’art n’est pas quelque chose que n’importe qui puisse comprendre, malheureusement. Cette incompréhension entraine souvent la moquerie, car qui encore aujourd’hui se soucie de n’être pas oublié, sinon en faisant des enfants ou en enterrant trois reliques dans le fond de son jardin. Cette ambition de perdurer outre la mort est la plus belle des motivations de vivre, et quiconque remet en cause cette source essentielle risque la plus grave indifférence envers lui-même. La mort, l’insulte, la rage, la haine, forgent le caractère individuel sous sa plus pure forme, et il faut détester du plus sombre de son coeur pour aimer ensuite à travers ce qui est produit depuis cette vase immonde.
Évidemment, le jeu de batterie est impressionant, démonstratif : les saignements, la sueur, l’effort du muscle, mais je pense qu’on aurait pu faire exactement le même film avec le jeune Flaubert. On l’aurait vu s’énerver contre lui-même à l’instant d’énoncer une phrase dissonante, casser sa plume sous l’effort de réécriture comme Andrew troue son tom basse, être humilié par ses amis après sa première version de Saint-Antoine, s’isoler parfois jusqu’à l’absurde pour se consacrer au travail d’être écrivain, mourir devant la bêtise de ses contemporains. On aurait aussi pu se dire qu’il était passé à côté du plus important. Pourtant, regardez ce qu’il a laissé, ce qu’il est devenu. Est-ce que ça ne vaut pas largement tout le reste.
D’énormes nuages noirs recouvrent progressivement la ville. Peut-être bientôt une tempête ! La dernière tempête ! Enfin ! Qu’elle engloutisse tout ! Et si ça n’était que la nuit ?
Tant de grantécrivains ! et si peu d’homologues journalistes…
Intéressé par son adaptation en film, je me suis enfin décidé à lire Extension du domaine de la lutte. Le film épure judicieusement plusieurs éléments du texte franchement redondants (notamment les extraits de fictions animalières) mais modifie la chute initiale pourtant primordiale. À la fin du film, il y a l’amour d’une femme qui sauve ; à la fin du livre, il n’y a rien d’autre que rien. L’espoir consensuel que donne le film ôte une partie que j’ignorais donc jusqu’alors du livre : son absolu néant.
J’ai beaucoup de réserves quant à Houellebecq, mais il faut bien admettre que ce livre a su saisir à la perfection le malaise grandissant des années quatre-vingt-dix en majeure partie dû à l’impact de l’économie sur chaque réalisation humaine. Tout, dans ce livre, tend à l’insignifiant : le narrateur est un raciste mysogine désespéré qui, comme seule échappatoire, ne trouve plus pour s’exprimer que la haine, la rancoeur, et (comme il le dit lui-même très justement) l’amertume. Les événements sont d’une vacuité abyssale, alternant ennui morbide, masturbation, travail et collègues ridicules. Pour se donner du baume au coeur, il pousse son seul “ami” au meurtre, et ébauche des théories qui le confirment dans sa solitude et sa bile.
Ce type, c’est personne dans le style, et personne dans le fond. Et c’est ce qui donne justement toute son importance au livre. La décadence de l’identité est sans doute le plus gros problème de notre époque qui arrive à son terme dans sa logique économique (et donc sociale) interne. Houellebecq a pointé du doigt très justement le moment de rupture. À d’autres à présent de trouver les ouvertures possibles pour ne plus sombrer.
(Il y aurait encore beaucoup à dire, notamment sur l’humour grotesque du texte inexistant dans le film, ou sur la posture de narrateur quand rien n’a de sens, mais il me faut admettre être bien trop feignant pour continuer à parler.)
Tu aurais dû voir, Jecht, quand le vaisseau s’est posé, quand les derniers missiles ont fini d’exploser dans le ciel et que leur déflagration a formé une millième planète, tu aurais dû voir les sauts de joie de la foule quand on a créé cette millième planète de soufre et de calcaire, cette millième planète hostile au monde, quand les lions ont rugi, tu aurais dû voir ça Jecht, quand les girafes ont baissé le cou sous cette sphère orange, quand les derniers vaisseaux ont détruit l’espace, quand on a découvert la nuit derrière le ciel, quand on a découvert les météores, les comètes, tu aurais dû voir cette dernière pluie de feu sur nos visages émerveillés, et le froid du vide, tu aurais dû voir cette dernière saison des hommes, cette dernière communion sous les astres libres, avant la fin, tu aurais au moins dû la voir une fois, cette réalité-là d’une nouvelle ère qui s’ouvre, Jecht, au moins une fois, avant l’ultime sommeil.
Vous êtes si intimement persuadé que je suis toujours le même à écrire ici depuis le départ. Pourtant, il n’y a plus mon nom nulle part. Alors, à quelle identité imaginaire êtes-vous encore rattaché ? Pas à la mienne, j’espère.
Ce qui tue en partie la compréhension de notre époque c’est l’approximation généralisée. On ne diffuse plus aujourd’hui que des informations floues, obscures, à peine vérifiées, globables, et la précision, la spécialisation font peur. On ne sait plus vraiment de quoi on parle, ni sur quoi s’appuyer pour comprendre ce qui est dit. Et malheureusement, le général, à cause de ses manques, laisse une grande place à la peur. À trop le perdre on tue l’esprit.
Je ne sais pas trop ce que j’espère retrouver à Rennes quand je quitte Matignon. Une quiétude, des habitudes, quoi, une attention ? une maison ? la solitude, sûrement.
D’ailleurs, en revenant de Trégueux dimanche soir, un écart inespéré en voiture nous a sauvé la vie à ma grand-mère et moi. Un conducteur qui n’avait pas su apprécier les distances pour doubler a surgi plein phares face à nous, et sans mon réflexe pour nous déporter sur la droite dans le fossé, à quatre-vingt-dix kilomètres heure, il ne serait sans doute resté qu’une vaste charpie de nos deux corps dans l’habitacle cabossé. Les chances qu’on y réchappe étaient si infimes qu’on n’en est pas revenus durant la fin du trajet, demeurant silencieux et sonnés par le frôlement inattendu de la mort.
« Oui, je crois que les histoires que l’on raconte non seulement finissent par être vraies mais, en fait, ne sont peut-être qu’anticipation de la réalité ; ou alors je suis complètement névrosé, ou alors c’est la pluie sur les volets… » — Pierre Autin-Grenier, Je ne suis pas un héros.
Après l’espérance vient la résignation, puis le silence, puis l’oubli. Je vais, comme à mon habitude, faire le mort, et le temps passera, et il recouvrira ce que je ne veux plus voir, et je serai débarassé, englouti, et on ne pourra plus rien me reprocher, parce que j’aurai tout annihilé en moi, je ne serai plus qu’un vaste champ désert à la terre infestée, et comme moi le céréale crèvera, et à terme plus rien ne repoussera derrière ; seuls les regards des conducteurs attristés remarqueront une dernière fois le ravage de mes sentiments.
J’ai su oublier Laurène, je saurai en oublier d’autres.
Parfois j’envisage l’intégralité de ma vie en solitaire, isolé au sommet d’un phare à l’extrémité d’une presqu’île ; j’aurai disposé là une table, une gazinière, et quelques étagères pour ranger des galets ; on ne viendrait pas me visiter, et même les navires ne passeraient plus à proximité. Parfois, quand même, j’irai promener mon chien, mais il ne reviendrait pas. Et quand l’heure sera venue, j’ouvrirai l’unique fenêtre de mon phare, je marcherai sur la promenade autour et, passant mes deux jambes par-dessus la rambarde, me jetterai une dernière fois dans le vide.
Alors, mon chien reviendrait, et lècherait mon visage immobile, et s’allongerait à mes côtés pour japper jusqu’à ce que lui-même meure de fatigue et d’ennui.
Déjà le quatrième roman de Cécile Coulon ! À seulement 24 ans ! Quel talent ! Si jeune ! Quelle plume ! Et quel oeil !… Eh oui, n’en déplaise aux médias, mais on creuse parfois très tôt le sillon de sa propre médiocrité.
bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, rires.
Regarder les mêmes chaines de télévision qui animent la haine et enflamment les torches prêcher, après le chaos, la bonne parole sociale, c’est trop de bêtise et d’irresponsabilité pour demeurer en l’état.
Je suis tellement fatigué. Je fais des nuits d’au moins dix heures, et trouve encore le temps pour m’assoupir l’après-midi. Forçant le doute, j’espère un soir ne jamais me réveiller. Ainsi ma vie sera passée, et tout le monde sera bien tranquille ; moi le premier.
Au moins j’ai l’intelligence de ne pas imposer aux autres tout ce que j’écris ici ; les tâtonnements, les questionnements, les erreurs. La plupart des gens n’ont aucune soupape entre leur médiocrité et son expression, et rejettent leur bile sur quiconque les croise, sans tact, avec tout l’égoïsme de leur expérience dérisoire. Alors ils parlent, ils parlent, ils se rendent compte de rien, ils répandent toute cette matière ridicule, et j’aimerais me moquer, les traiter de cons, mais on m’a appris à ne pas être impoli. Bien sûr vous êtes idiot, faillible, comme nous tous, mais putain de Dieu, prenez un peu sur vous et ne testez pas cette débilité sur nos pauvres vies déjà bien trop ingrates ; vous ne forcez que nos rires et notre intolérance.
En ce moment il y a des travaux sur le viaduc qui mène de Lanvallay à Dinan. Ils élèvent les barrières pour éviter que les gens ne se suicident. Habituellement, à chaque fois que je passais, de nouveaux bouquets venaient fleurir les trottoirs du viaduc. Mais les jetés qui, au mieux, finissaient dans l’eau de la Rance, heurtaient parfois le sentier de randonnée ou, même pire, les jardins des riverains. Et qui accepterait de voir au matin un désespéré désarticulé entre le fil à linge et les rosiers ? Alors la municipalité a décidé que, désormais, de hautes grilles en fer remplaceraient les murets d’époque. Et si ça n’empêche pas les faibles de mourir, ça aura au moins le mérite de ne plus déranger les honnêtes gens dans leur paisible retraite.
Certains pensent que ne plus dire l’écriture c’est ne plus écrire. L’acte de création est le seul rempart contre l’idée de mort, la seule échappatoire pour ne plus se sentir écrasé par l’horrible cercle de néant qui nous entoure, et rien, absolument jamais rien, même quand je ne pourrai plus que me scarifier les bras, les mains, pour y inscrire quelques mots isolés, ne saurait me détourner de cette ambition absolue de vivre.
L’échec, le silence, sont les deux composantes essentielles de l’écriture. Il faut beaucoup de bavardage, et entre chaque bavardage un silence très beau, et très seul, et plus le bavardage est grand, plus le silence doit être profond, et plus le livre est maîtrisé, plus l’échec qu’il entraine doit être total, pour ne jamais se relever, et pour écouter, au fond du gouffre, dans le plus intact des vides, là où personne ne vous attend, la musique de cette peine qui fait naître la lumière.
Le goût de mes doigts était celui de la braise.
Je n’ai eu aucune réponse pour mon saccage. C’est vraiment que ça ne devait pas valoir grand-chose.
Je suis passé voir Fiona hier après-midi, chez ses grands-parents, à Yvignac. C’est là qu’elle vit avec son père et son frère depuis que sa mère est malade. Le village est atroce, on n’y trouve rien ; tout est fermé, ou à vendre. La plupart des bâtisses doivent appartenir à de riches anglais qui les abandonnent la majeure partie de l’année. C’est vide autour ; les champs, les ruelles, les calvaires. Fiona avait un parfum que je ne lui connaissais pas à l’instant de lui faire la bise. Une fois passé le seuil de la porte, et comme sa tante trois semaines plus tôt, les premiers mots de sa grand-mère ont été : Depuis qu’on entend parler de toi.
On a discuté comme d’habitude de son chagrin, du reste, de la difficulté qu’elle a à s’endormir le soir, des hurlements qu’elle pousse seule quand elle prend sa voiture, aussi de la plus basse routine, des riens qui après la perte d’une mère n’en sont que plus évidemment dérisoires. Sa grand-mère m’a remercié de venir la voir, de lui changer les idées. J’ai dit que c’était normal, la moindre des choses. Plus tard, en sortant de la cuisine, sa grand-mère avait les larmes aux yeux, alors j’ai dit : Prenez soin de vous. Dehors, sur le parking, la nuit arrivait, et avec elle les adieux. J’éprouve un déchirement de plus en plus fort à chaque fois que je dois la quitter. On s’est pris dans les bras. Je l’ai faite rire une dernière fois en lui expliquant les difficultés que j’avais à ouvrir la portière de ma voiture, puis on s’est finalement dit au revoir, et, une fois au volant, j’ai prévenu ma grand-mère que j’arriverais pour l’heure du dîner.
Je me dis : tu es un connard. Je me trouve égoïste. Je m’en veux d’aimer.
Je ne sais pas comment font la plupart des autres pour écrire avec un stylo. Je trouve ça si lent, si laborieux. J’aimais bien écrire au stylo-plume en primaire, mais vite le goût m’a passé, à cause des taches, des changements de trait, de la précaution que cela demande, de l’attention. J’ai ensuite noté mes cours pendant tout le lycée, puis à l’université, avec un stylo bic. Je ne relisais jamais mes cours, mais je faisais attention à ce qu’ils soient correctement organisés. Durant ma première année à l’usine, je me suis fracturé la première phalange de mon annulaire droit. Depuis, avoir un crayon appuyé dessus trop longtemps comme je le fais habituellement quand j’écris m’est douloureux. Ma main se crispe, s’engourdit, et finalement je ne suis plus capable de rien, j’écris comme un paralysé des lignes droites d’où pointent parfois les extrêmités de quelques lettres, comme les p, ou les t.
Écrire sur un clavier me fournit paradoxalement une plus grande liberté. Je tape très vite, même si je ne me sers pas de tous mes doigts (Sylvie s’en était d’ailleurs amusée une fois), et la possibilité de pouvoir effacer, puis retaper par-dessus le blanc, puis saisir un morceau de texte, et le développer à loisir, sans avoir besoin de scotch, ou de papier supplémentaire, est un soulagement réel durant mes phases de création. Écrire sur un carnet (et j’ai essayé nombre de fois) m’épuise autant que de tenir un crayon. Je ne sais pas comment placer ma main, j’ai l’impression de ne pas savoir la poser, mon poignet devient douloureux, alors finalement je me lasse, me fatigue, et je laisse presque toutes les pages blanches avant de ranger le cahier dans un tiroir.
Une fois, Sylvie m’avait demandé de lui écrire une lettre à la main, parce qu’elle y trouvait un symbole important de ma personne. Je l’avais prévenue que je n’écrivais qu’au clavier, et que l’écriture manuscrite ne représentait rien pour moi, mais elle y tenait. Alors j’avais d’abord écrit ce que j’avais à dire sur l’ordinateur (où je peux être parfaitement sincère), puis j’avais recopié méticuleusement le contenu sur une feuille de papier, à l’encre, en prenant mon temps, en traçant des lignes au crayon de bois pour ne pas m’exprimer de travers. Elle avait été émué par cette lettre, jusqu’à ce qu’elle apprenne (de ma bouche) qu’elle n’avait pas été écrite dès le départ à l’encre, et alors c’est comme si le charme s’était rompu, comme si ce que j’avais écrit n’avait plus aucune importance, plus aucune espèce de sincérité. Comme si je mentais. Alors que c’est l’encre qui me fait mentir. La technologie me permet d’être flamboyant, l’encre ne m’est bonne qu’à noter mes listes de courses.
Évidemment, rien n’a tenu. Comment être sincère quand, dès le départ, on ne comprend pas où réside la sensibilité de l’autre. Elle a dû croire qu’il n’y avait que de la lumière sur le papier, avant de découvrir tous les fusibles brûlés qui me composaient, toutes les failles, toutes les ratures qui sont invisibles à l’autre, mais qui ont animé l’intégralité de ma déclaration, de mon amour. Toute cette misère que, dès le départ, elle n’a pas pu voir.
Si je suis honnête ici (et encore) c’est dans l’espoir que ce travail contamine ma façon d’être, et que je puisse ensuite, face à l’autre, dire aussi sincèrement que possible à quel point il me répugne, à quel point il me fascine, à quel point il m’éblouit. Si j’y parviens un jour, c’est ce qui fleurira ma tombe.
J’éprouve une douleur intense en pensant à ma famille, et j’ai longtemps essayé de la comparer aux autres, mais personne ne vit ce même traumatisme invisible, alors c’est à peine si l’on peut me comprendre, c’est à peine si l’on entend ce que je raconte, et je suis seul avec cette douleur, dans les conversations, dans les confidences, dans les longs monologues qui m’entrainent parfois jusque dans le somnambulisme, parce qu’il n’y a personne capable de la contenir pour moi, et ça a même sans doute été trop égoïste de ma part d’espérer qu’on puisse la contenir pour moi rien qu’un jour, une fois. La réponse se trouve forcément dans une parole anodine, perdue sous je ne sais quel amas de déchets, mais je n’ai aucun guide vers la lumière, je n’ai que mes pauvres phrases de passager de rue, je n’ai que la détresse du cri contenu, et j’espère sincèrement qu’on me tendra la main un jour, peut-être dans un sous-sol malfamé, peut-être sous les dalles d’une église, peut-être derrière les tableaux sanglants de galeries désertes, parce que je suis incapable de saisir ma propre main, parce que je suis incapable de me sortir de là.
Peut-être un jour, par je ne sais quel miracle, mes enfants, ou mes petits-enfants, liront cela, et alors, qu’est-ce qu’ils se diront, qu’est-ce qu’ils penseront de moi ? Me trouveront-ils courageux, seront-ils fiers de moi, de tout ce travail accompli dans l’ombre pour découvrir quel salut, quelle conclusion, estimeront-ils que, comme j’aurais pu construire un phare à mains nues ou découvrir une civilisation oubliée au fond des abysses, j’ai, par l’écriture, trouvé ma façon d’apprendre à être homme ?
« C’est pour cela, c’est pour cette raison, que j’écris même si tout ce que j’écris n’est pourtant rien qu’un mensonge qui est transporté par moi comme une vérité. » — Thomas Bernhard, La Cave.
J’aime quand le texte est gratuit, quand il n’est tenu que par une pure causalité verbale, quand il se décline et se déplie à loisir comme bon lui semble, qu’il part dans un sens, puis n’y revient pas, et s’étend vers l’inconcevable, vers l’absurde, vers l’absence, quand il s’oublie dans lui-même, quand il ne s’accroche plus à rien sinon à sa propre nécessité, quand il ne raconte plus que sa propre perte, quand il s’atrophie et se réduit au néant, quand le mot même n’est plus que vide et insignifiance.
Alors que je faisais la vaisselle, une bulle s’est formée depuis mon éponge, a pris un peu d’altitude, puis s’est éloignée de l’évier, et je l’ai regardée partir derière mon dos, je me suis tourné et l’eau accumulée dans l’éponge a trempé le sol, et j’ai suivi la bulle faire son chemin dans les airs, seule, au milieu de cette immense cuisine où chaque surface, chaque coin, chaque heurt, était une mort possible, un moment je l’ai perdue de vue, enfin elle s’est posée sur le sol, a bougé là tranquillement, sans rien d’autre à espérer, puis, dans une dernière impulsion, a éclaté. Je ne me suis jamais senti plus nécessaire que cette bulle.
« La nuit est tombée dans sa chambre ; son coeur est vide et triste ; tout un royaume de rêveries est en train de s’effondrer autour de lui, s’effondrer sans trace, sans bruit et sans fracas, vient de passer comme une image de songe, et lui, il ne se souvient pas lui-même de quoi il a rêvé. » — Fédor Dostoïevski,
J’avais déjà commencé, l’année dernière, un recensement de mes chambres. Mais elles s’inscrivent toutes dans des ensembles plus vastes qui m’ont toujours marqué : les maisons. Je les ai toutes perdues peu à peu, malgré moi, et j’entame ce travail de reconstruction intime pour déceler les sources du chez-soi.
1. 18 rue du Lac, Lamballe.

Quand j’y vivais encore, les bordures des fenêtres étaient rouges, et la barrière blanche n’existait pas. On avait aussi une boîte aux lettres américaine, mais aucun facteur ne pensait à lever le drapeau rouge après son passage. Derrière, en passant par la droite, on croise un bassin qu’avait construit lui-même mon père, puis un rectangle de pelouse qui donne directement sur le plan d’eau de Lamballe. Il y avait au fond à gauche un immense arbre qui couvrait nos réserves de bois, et à droite un autre arbre plus petit dans lequel mon père m’avait amenagé une cabane (j’y montais peu, ayant le vertige).
Le garage, je m’y suis réfugié souvent, au début de mon adolescence, pour manger en cachette des barres chocolatées que ma mère gardait dans un frigo de secours. C’est l’endroit où mon père garait sa moto, et où Julien, mon demi-frère, avait entreposé son matériel de pêche. Un jour, sous un amas de cartons que conservait ma mère pour son travail, on y avait retrouvé Saya, ma chatte, en sang ; elle s’était réfugiée là après s’être fait percuter par une voiture. Plusieurs semaines de plâtre, et tout a repris pour le mieux. Saya, personne ne l’a jamais tuée.
Du garage, on accédait à la cuisine, avec un bar à l’américaine. Elle était au départ en gris et rouge, mais mon père a finalement repeint les bordures en bleu pour répondre au désir de modernité de ma mère. Elle nous y faisait tout l’hiver des soupes que je mettais un temps fou à manger, guettant systématiquement les fonds de mes bols peints de Becassines en couleur qui annonçaient la fin du calvaire (j’en ai d’ailleurs conservé un dégoût profond, et n’en mange presque plus). Je n’ai aucun souvenir de cuisine autre ; ma mère n’en avait pas le goût, et mon père, je crois, n’avait alors jamais réellement eu l’idée de s’y mettre. J’y revois en dernier instant mon père pleurer à cause de ma mère. Je ne sais plus pourquoi. Pour sa tyrannie habituelle, sans doute.
La cuisine ouvrait donc directement sur la salle à manger et le salon. La salle à manger était peu utilisée ; un Noël seulement, je me souviens avoir reçu des mains de ma soeur la version bleue du jeu vidéo Pokémon, qui a enchanté ensuite des dizaines d’années mon enfance. Également, certaines parties de jeux de société, mais comme nous recevions peu, nous jouions peu. J’avais gagné un poisson rouge durant une kermesse, qu’on avait mis dans un vase sur le buffet de la salle à manger. Un midi, Saya avait voulu manger le poisson et l’avait coincé derrière le buffet. Dans le salon, on avait un ensemble de fauteuils et de canapés bleus que ma mère a d’ailleurs conservé dans sa nouvelle maison à Taden. Avant, on avait des canapés gris immondes, mais sur lesquels je me souviens avoir regardé les dessins-animés en compagnie de Saya, elle patounant mon doudou alors que je suçais ma têtine. C’est aussi là que Angélique, ma demi-soeur, a fait une crise d’épilepsie alors que les parents étaient partis au cinéma. Paniqué, j’avais dû alerter les voisins en pleine nuit, mais je la revois encore, convulsant sur le carrelage, renversant tout de ses bras fous, se cognant la tête sur le sol, ses yeux roulant librement.
Puis un minuscule couloir menait à la salle de bain et à la chambre de mes parents. J’utilisais cette salle de bain uniquement pour prendre des douches, c’est-à-dire que je l’utilisais peu, puisque je détestais ça, ne supportant pas d’avoir de l’eau dans les yeux (ce qui est toujours vrai aujourd’hui). Dans la chambre de mes parents, il n’y avait qu’un immense lit, et en face de ce lit une armoire avec un tout aussi grand miroir. Je venais parfois là le dimanche matin pour prendre le petit déjeuner, et systématiquement les matins de Noël, pour ouvrir mes paquets dans leur lit, même les plus imposants. Juste avant de monter l’escalier qui mène à l’étage, il y avait là un endroit anodin, devant un radiateur, dans un coin, qui me permettait de regarder, clandestinement et au chaud, la télévision alors que je devais être couché. Le dimanche soir, étant très sensible au cafard, j’attendais là qu’ils me trouvent, pleurant parfois juste derrière leur dos, incapable de les quitter.
L’escalier, j’y ai passé de longues heures, à faire descendre des figurines en rappel, ou assis sur les marches, à observer l’agitation dans la cuisine, à jouer avec Saya. En haut de l’escalier, on trouvait une mezzanine spacieuse qui déservait cinq pièces : les toilettes, une première chambre, le bureau de ma mère, une seconde salle de bain, ma chambre. Mon père a fait beaucoup de travaux dans cette pièce : installé du parquet, lambrisé le plafond, mais on n’a jamais pu investir les lieux. J’y répandais mes Lego pour reproduire des villes miniatures, et j’y revois ma mère apprendre le synthétiseur ou la calligraphie, sans succès. Il y avait une triste bibliothèque remplie de livres navrants, dont une bande-dessinée pornographique que j’ai très vite consultée en cachette, parfois avec mes copains de primaire. Mon père passait, et passe toujours, un temps fou aux toilettes. Une photo de moi jeune enfant me montre nu, refusant d’aller au bain, courant jusqu’aux toilettes pour me cacher, la bouche ouverte d’un rire heureux.
La première chambre, qui a longtemps été la chambre d’Angélique, était, comme la mienne, conçue en mezzanine. Peu aménagée, je me souviens seulement d’un poster du film Roméo + Juliette et d’un puzzle encadré immonde représentant des chevaux bleus sur fond violet. Après qu’elle ait quitté la maison, mon père a utilisé cette chambre comme bureau. Je n’y allais pas souvent, la chambre était froide. Mais il avait un jeu de flipper sur son ordinateur, et on s’affrontait l’un l’autre par parties interposées. La seconde pièce, le bureau de ma mère, a d’abord été ma chambre de jeune enfant, et je me souviens avoir passé des heures sur le tapis route. Puis ma mère l’a investie, et j’ai passé là des heures à jouer sur l’ordinateur, puis à faire mes premières pages web, puis à imprimer des images de femmes aux seins nus qui mettaient un temps fou à charger et que je cachais tant bien que mal entre les pages de mes bandes dessinées. C’est la pièce qui a englouti ma mère, c’est la pièce de la tristesse, la pièce du heurt, de la douleur. C’est la pièce où elle était, et étant là, elle n’était plus nulle part.
La salle de bain, mon père y a développé ses photos. J’étais venu avec lui une fois dans sa chambre noire, et je trouvais fascinante cette ampoule rouge au-dessus de nos têtes. C’est là que je prenais mes bains, Saya toujours sur le rebord, tentant d’attraper mes orteils quand je les faisais paraître hors de la mousse. J’y faisais d’autres expérimentations, comme de mélanger tous les produits pour voir les couleurs et les textures, puis je les versais dans l’eau, qui moussait alors encore de plus belle. Un jour, mon père, en bricolant je ne sais plus quoi, s’était entaillé profondément la main dans cette pièce, et j’avais couru le plus loin possible de lui, affolé de le voir ainsi réduit, appelant à l’aide, ne comprenant pas comment il pouvait faillir aussi soudainement.
Enfin, ma chambre. Elle était similaire à celle de ma soeur, et j’en ai déjà beaucoup dit à son propos dans mon texte sur les chambres, alors je ne vais pas y revenir plus en détail. C’est là que j’ai construit mon imaginaire, seul. Car aujourd’hui, j’ai perdu tous mes compagnons d’aventure dans cet horrible gouffre : la réalité.
« — Comme ce serait bon pour tout le monde… comme tout le monde y trouverait son compte si on pouvait, nous aussi, l’éprouver, cet amour de soi… » — Nathalie Sarraute, Tu ne t’aimes pas.
Depuis un an, je suis sec.
Elle m’avait confié le temps passé dans le coin de son escalier de bois, à pleurer un amour passé perdu, et j’ai encore en moi la douleur de cette tristesse-là, qui pourtant ne m’a jamais concernée, qui pourtant ne me concernera plus.
On peut me haïr avec la force d’un météore pulvérisant une terre déjà morte, je crois que de toute façon, à la fin, j’aimerai toujours, j’aimerai toujours les personnes que je répugne, et j’aurai tout pardonné, et j’aurai tout oublié, et je ne dirai plus rien, j’accepterai, je tolèrerai, parce que le combat me fatigue, parce qu’il ne me mène à rien, et que je n’y trouve que solitude et déception ; parce que la rancune entraîne le chaos, qu’elle troue mes paysages, et qu’elle anéantit chaque jour un peu plus mes espoirs d’aimer à nouveau.
Les traiter de fous, c’est nier notre responsabilité de parents.
Je n’ai aucune nouvelle de ma soeur. Je lui envoyais encore il y a peu des messages qui demeurent sans réponse. Je crois qu’elle va bien. Peut-être qu’un matin elle mourra des suites de sa maladie, mais je respecte son silence, et je me tais à mon tour. C’est dur de se faire présent face au vide.
De tristes sires espèrent convaincre des illuminés qu’ils agissent mal avec trois pancartes et une chanson navrante. Mais que valent vos dénonciations face à l’éblouissement du ciel, au pardon et aux baisers chaleureux d’un père supérieur, qu’espérez-vous déclencher d’autre que des rires, quand après avoir déchiré la peau qui les recouvre, on les escortera avec honneur vers des jardins magnifiques, et qu’on leur offrira des bals somptueux où des nymphes aux ailes d’aigles valsent et rient nues. Vous ne pouvez rien leur opposer, ni la douleur, ni la haine, ni la bêtise, car au bout de leur combat aveugle, il n’y aura que l’amour.
Il y en a qui veulent toucher l’Absolu sans même supporter le réel : mais, avant d’atteindre les étoiles, vous croyez qu’une fusée s’élance sur quel sol ?
La plupart du temps, on se trouve inutile, sans talent, tout juste bon à grossir les rangs des condamnés à l’abattoir de cette vie sans lumière. La plupart du temps la nuit engouffre et nous laisse démunis. Pourtant, il y a quelques fractions de secondes durant lesquelles la clameur se fait, où la beauté de vivre s’impose, où le choeur des sirènes chante nos louanges, où les roches se font moins lourdes, les néons moins vifs, les chiens moins fous. Pour ces quelques secondes là, l’enfer en son entier est supportable.
« L’homme d’aujourd’hui ne se drape plus dans les chairs que lui léguèrent ses répugnants ancêtres. Il est nu, il est fort, et, s’il apprend à tenir d’une main ferme la glace où bouge son reflet, s’il apprend à s’examiner objectivement au creux des eaux dormantes, il ne retournera ni à la boue, ni aux larmes. »
Sur le quai de la gare de Laval, une jeune femme a été accueillie par son chien, un très beau labrador blanc, avec une telle joie, une telle impatience, que j’avais envie d’être ce chien, ou cette jeune femme, ou cette joie intense de l’un pour l’autre.
Dans ma solitude j’ai découvert celle qui m’aime, et elle passe des rideaux bleus, elle franchit des rivières, elle a dans les mains un fusil et une lampe torche, et elle éclaire le fond des ruisseaux et elle tue les poissons d’une balle dans les branchies, et chaque pas qu’elle fait est de la boue, chaque mot qu’elle prononce une douleur noyée.
« Quand l’homme se sent désolé de solitude, quand il se sent on ne peut plus seul et qu’il a peur, il se prend la tête entre les mains, il secoue la tête tout en pressant contre ses tempes les jointures tremblantes de ses doigts, et il supplie la police qui est en lui ; il l’invoque, il la somme d’apparaître. » — Antoine Volodine, Lisbonne dernière marge.
Le temps va passer, et la haine reprendra.
Je n’aime pas du tout ce qu’écrit Houellebecq depuis quelques années, mais lui demander de justifier sa fiction c’est quand même d’une débilité profonde. Je pensais qu’on avait enfin fait le pas entre les possibilités du monde et ce qu’on fait de lui. Heureusement qu’aucun journaliste n’a demandé à Volodine, lors de la sortie de Terminus radieux, si ce monde d’apocalypse, de fantômes et de trous béants nous attendait, parce qu’une vague de dépression aurait saisi toute la France dont elle ne se serait jamais remise.
Au-delà de ça, je trouve que le style de Houellebecq s’enfonce dans l’insignifiance et la platitude, décrit, narre avec paresse, somnole, et c’est ce qui fait de ce livre-là, comme d’autres auparavant, un mauvais livre. Mais si votre problème, c’est la puanteur du sujet, alors tant mieux, au moins vous êtes un peu secoués, car vous vous attendiez à quoi de la part de la littérature : des caresses ?
Un intense sentiment depuis plusieurs années oublié a saisi à nouveau le peuple français suite à cet attentat : la fraternité.
Je n’ai jamais été lecteur de Charlie Hebdo, pourtant je crois que toutes les critiques proférées à son encontre actuellement concernant son homophobie, sa mysoginie, son racisme, son islamophobie, etc. sont hors de propos. La satire est un exercice particulier qui repose sur la moquerie pour faire surgir une prise de conscience et une dénonciation. Elle est violente, car la société est violente, car les traumatismes sont violents, et la satire aide à mesurer celà. Elle illustre à quel point nous sommes bûtés et idiots. C’est la révolte que les caricaturistes inspirent à dessein. C’est qu’on mette en relief nos expériences et nos idées. Ils n’ont épargné personne, car personne n’est autorisé à paresser au point de demeurer insensible. Ils nous mettent en colère pour qu’on s’interroge sur notre colère, ou s’ils nous font rire, pour qu’on s’interroge sur ce rire. Ce n’est pas l’envie de nuire qui les habite, mais l’ardeur du combat. Ils inspirent de tels sentiments car ils nous savent intelligents ; ils ne nous mâchent rien. Je crois d’ailleurs qu’ils étaient les derniers à ne pas nous prendre pour des cons. Lire au pied de la lettre chaque information dite, écrite, énoncée, est, je crois, un travers puissant de notre époque, et il serait sage de ne pas tout confondre. Sinon, l’esprit de sérieux nous condamnerait à demeurer sôts.
Continuons à moquer l’autre comme ils se sont moqués de nous, avec le respect de nous savoir plus sensibles que ça, et on révèlera alors nos crises, et on se moquera de s’être moqués.
Donc oui, je suis aussi et surtout Charlie, car je ne rendrai jamais les armes face à la bêtise, à l’ignorance, et à la nuit.
Je suis beaucoup plus jeune que vous tous et déjà beaucoup plus vieux pourtant.
J’ai entâmé une descente inachevée de quinze mille mots et trente messages vers une femme perdue et jamais retrouvée. Je ne sais pas au bout de combien de mots elle le sera, ni si jamais ça sera seulement le cas. C’est sans titre pour le moment, je ne sais même pas si ça en a besoin d’aucun.
Aujourd’hui, dix journalistes ont été tués dans leurs bureaux par deux hommes cagoulés, à la kalashnikov. Il n’y a aucun mot pour dire ce qui se passe après.
Il n’y a aucune limite à la violence, car l’homme inventera toujours de nouvelles façons de se haïr.
« Hurlements des enfants que l’on étouffe. Silence des cendres épandues sur une plaine. » — Robert Antelme, L’espèce humaine.
Je sors de Fidélio. J’avais l’impression d’observer Sylvie dans chaque plan d’Alice. Mais ma mémoire est morte, et avec elle le monde entier.
En passant les portes coulissantes vers l’extérieur, une jeune femme disait à un jeune homme : Sinon on peut aller boire un verre chez moi, et j’aurais aimé être celui à qui elle disait cela.
Je suis rentré à pied en traversant la ville ; c’est bizarre les gens qu’on y rencontre, qui parlent seul, qui sortent des restaurants et tentent de ramener chez eux laquelle ils avaient en vue toute la soirée, les étrangers qui parlent quelle langue derrière soi, et puis tous les fantômes qui rentrent dedans et qui laissent à genoux, et le froid, qui brise tout ce qui reste.
Je vous laisserai tous sur le carreau.
Ce que je n’ai toujours pas accepté, c’est qu’on ait pu nier ma maladresse.
J’ai écouté un bout d’une émission sur la “littérature” (compte-tenu des invités, j’en doute) présentée par Ono-Dit-Bio, et sa prétention était telle qu’elle m’a ouvert le ventre en deux avant de me bourrer de somnifères. Et le jeune Désérable, fidèle relève dans cette assemblée de bavards pompeux, n’a pas manqué de m’achever.
L’époque pue tellement qu’on la recouvre de parfum bon marché dans l’espoir de masquer l’horreur, mais un jour la bouteille se vide, et l’odeur se répand partout sur nos vêtements, sur nos visages, sur nos mains, sous nos ongles, dans les cheveux de nos proches, et on est alors contraints de baisser la tête, dégoûtés par notre propre aveuglement. On mesure toutes les douleurs, on hiérarchise les injustices, on rit de ce qui est insupportable, on s’esclaffe face aux victimes, on leur hurle aux visages qu’elles le méritent, on soutient les crachats, on sollicite les chutes, on dynamite nos espoirs sous d’autres déflagrations ; et on pleure de voir tout autour sombrer, quand bien même on le mérite.
Fiona est venue à Rennes aujourd’hui. C’est la première fois que je la revoyais depuis l’enterrement de sa mère. On a mangé ensemble, je lui ai offert Journal de deuil et Le Livre de ma mère au cas où ça puisse l’aider à tolérer, un peu. Je l’ai emmenée au Thabor, où elle n’était jamais allée, on s’est dirigés vers la volière, et il y avait là deux oiseaux, peut-être deux mésanges, ou deux moineaux (je n’ai jamais trop su les différencier) qui faisaient leur nid. Ils manquaient de brindilles, coinçaient tout à trac de minuscules brins de pailles, des souillures du sol, de la sciure. Alors on a fait glisser à travers la grille des feuilles plus larges, des branches plus épaisses, qu’ils venaient récupérer directement dans nos mains, et ils poursuivaient ainsi leur labeur, l’un allant quêter, l’autre s’occupant d’aménager les lieux. Parfois, l’un des deux devait défendre leur construction face aux autres oiseaux qui les dérangeaient.
La facilité qu’ils avaient à bâtir émouvait, surprenait. Leur témérité, leur habileté, la simplicité du mouvement du sol aux branches. L’instinct de vie, que j’ai complètement perdu. On a ensuite tourné un peu dans le parc, on a été jusqu’à la roseraie, puis on est sorti par les colonnades. On a rejoint une tante à elle, on a perdu du temps à regarder des tissus dans une droguerie, et finalement, à l’instant de nous quitter pour prendre le métro, sa tante a dit : Depuis le temps qu’on entend parler de Quentin. Je ne sais pas ce que Fiona dit de moi quand je ne suis pas là. J’espère le meilleur.
La dernière note de Chevillard à propos de sa grand-mère est incroyable de sincérité et d’amour.
Je suis fatigué, tellement fatigué de devoir me justifier à chaque instant, je suis fatigué d’entendre n’importe quoi, et en plus de devoir y répondre, et en plus avec tact, je suis fatigué du discours des autres, je suis fatigué d’être en colère, je suis fatigué d’être incapable, et de ne pas comprendre comment faire, je suis fatigué de n’être pas celui à qui l’on parle, je suis fatigué de faire semblant d’écouter, de tolérer, je suis fatigué de faire peur, je suis tellement fatigué, tellement triste, je suis tellement seul, et tellement loin du calme.
Depuis les dernières profondeurs des champs des cavaliers avançaient, et leurs épées étaient enflammées, et leurs lances noyées de poison, et les sabots de leurs chevaux faisaient pourrir les blés et leurs crinières étaient des aiguilles de scorpions ; une ombre s’est tenue face à eux, perchée dans le brouillard, le corps habillé d’une armure de cobalt, et sous son casque il y avait une gueule de lion, sous ses chevilles du bois coulé de métal ; les cavaliers arrivaient sur elle et l’ombre ne tremblait pas, elle n’était pas armée, elle avait dans ses mains un détail qu’elle seule pouvait connaître ; les cavaliers avaient connu ce détail bien avant de devenir des cavaliers, mais n’y pensaient plus alors, et lorsqu’ils ont fondu sur l’ombre, toute leur armée a volé en éclats.
J’ai volé vos photos, j’ai tranché dedans, et j’ai collé ma tête sur tous vos visages. Le lendemain, dans la rue, un homme m’a reconnu et m’a pris pour son fils, alors j’ai taillé son visage au cutter et j’ai collé le mien dessus, et je suis devenu père, et je suis devenu fils. Et je suis devenu chaque homme de la ville, chaque homme du pays, je me suis croisé dans les couloirs, je me suis salué sur les trottoirs d’en face, je me suis aidé pour construire des maisons, dans les miroirs je me suis aperçu, et quand j’ai brisé la glace, dans les débris, c’était encore moi qui me reflétait, en dizaine d’innocents.
Durant mon sommeil, quelqu’un m’a parlé, s’est penché sur moi, et a laissé au matin sur ma table de nuit un loup brisé et une pierre de Lune.
L’année qui vient se s’achever a été la plus éprouvante ; plus instable qu’aucune autre. Celle qui arrive n’est rien encore, sinon quelques goules qui dansent autour d’une tombe, et inscrivent à la feuille d’or des prénoms inconnus qui tomberont sous les balles ; premières victimes de l’affreuse sélection du temps.