2017
Extrait d’un entretien avec Thomas Guillemet (je souligne).
Figure Figure : Dans Body Fail, tu déjoues souvent les capacités de ces machines ou tu les présentes parfois même comme handicapées. Finalement, est-ce que ces faiblesses que tu cherches à exposer ne les rendraient pas plus humaines ?
Thomas Guillemet : Si. Finalement ce qui fait qu’on est parfait par rapport à la machine, c’est que l’on sache faire ces erreurs. Toute la problématique est là pour l’intelligence artificielle, il faudrait lui apprendre à faire des erreurs.
Figure Figure : Oui enfin, si tu places l’humain comme perfection…
Thomas Guillemet : Ce qui nous rend encore supérieurs à la machine, c’est nos capacités à créer, à concevoir… Et dans la création, c’est finalement lorsque cela nous échappe que c’est intéressant. La machine ne comprend pas cette donnée-là. C’est une autre problématique abordée avec Body Fail : faire reconnaître une erreur inconnue à la machine. Elle identifie une suite de données, sans savoir que c’est une erreur, tout simplement parce qu’elle n’a pas encore appris que c’est une erreur.
Je suis en train d’écrire un court texte à destination d’un potentiel futur employeur, dans lequel je dois expliquer mes motivations pour postuler à l’offre proposée. Ma seule motivation est : gagner de l’argent régulièrement. Pourtant, dans mon court texte, je ne parle jamais de cette motivation principale qui est de gagner de l’argent régulièrement. Je parle même de tout sauf de ça. L’enjeu de ce type de texte est d’ailleurs de parler du reste le mieux possible pour faire oublier ce que les potentiels futurs employeurs savent parfaitement : on ne veut que de l’argent. Les potentiels futurs employeurs, entourés de leurs collaborateurs, jugent tous les courts textes qui leur sont envoyés et notent si on parle d’argent ou surtout pas d’argent. Généralement, ils privilégient quand on ne parle surtout pas d’argent. Moins on parle d’argent et plus on a de chances d’en gagner. Il faut très bien maîtriser la langue française et les figures stylistiques pour ne surtout pas heurter les potentiels futurs employeurs avec ces questions d’argent. Les potentiels futurs employeurs supportent très mal que l’on parle d’argent, car selon eux l’argent est secondaire, c’est surtout l’emploi qui est important. Pourtant, ils proposent toujours des emplois de merde qui n’intéressent personne, tout en étant persuadés d’offrir des emplois en or. En somme, les potentiels futurs employeurs sont persuadés d’offrir des emplois en or à des candidats véritablement motivés par la valeur de ces emplois. Alors qu’on postule à des emplois de merde uniquement pour gagner de l’argent. Le monde du travail, c’est une sacré aventure.
(J’ai déjà un métier, mais dois en trouver un autre.)
the end of the virtual world © Robert Overweg

Le livre de Triclot est un bon livre, qui malheureusement s’arrête avant de véritablement m’intéresser. Davantage une histoire et une sociologie du jeu vidéo qu’une philosophie. Il n’envisage pas la grammaire propre au jeu vidéo, ses possibilités narratives, et donc son développement logique ; il ne s’intéresse pas non plus à ses limites, ses failles, ses bugs (à peine une ligne sur le sujet, si ma mémoire est bonne). En bref, je n’en sais pas plus sur les problèmes métaphysiques et ontologiques soulevés par les jeux vidéo. Je n’ai rien appris sur moi.
(La multiplication des prises de parole m’empêche d’en dire plus ici ; par exemple, le fait de vivre avec Cécile, ou d’avoir des conversations quotidiennes avec Fabien. Je me répète très peu, et souvent les Relevés passent en dernier.)
« L’univers construit peut d’abord être suffisamment vaste pour englober le joueur qui n’en fera jamais le tour entier : une manière de donner le sentiment d’un infini à travers le fini, de faire oublier le monde clos du code. Cette tactique est celle des jeux que l’on appelle « à monde ouvert ». On peut néanmoins se demander si l’ouverture promise peut être autre chose qu’une forme de dissimulation de la clôture. » – Mathieu Triclot, Philosophie des jeux vidéo.
Dans Trio, je lis : Un train passa et j’enviai ceux qui avaient un but.
Puis, plus loin : Ce soir, je suis encore allée me baigner toute seule. Il n’y avait plus de vent, mais j’ai trouvé l’eau plus froide que la veille. Je me suis mise à l’abri dans une grotte pour fumer après mon bain. Souvenir d’autres grottes. Fabriquées par nous-mêmes, changeant au gré de notre changement.
On se quitte là-dessus.
(J’ai l’impression d’écrire comme tous les cons de ma génération.)
« Leurs étroites dimensions me saisissent et me précipitent dans une terrible léthargie, où n’importe quoi serait accueilli comme une délivrance. Ils se balancent mutuellement et heurtent les murs qui les renvoient en eux-mêmes. » – Ann Quin, Trio (trad. L. Tranec).
Comme souvent, j’avais une idée, et puis je l’ai oubliée.
Parfois, simplement le temps de cliquer sur un nouvel onglet, et j’ai déjà oublié ce que j’avais prévu de faire. Comme ma grand-mère qui part chercher quelque chose à la cave, puis revient un peu plus tard les mains vides.
Si on me le demandait, je dirais que j’écris pour retrouver cette liberté d’enfant de raconter et d’imaginer n’importe quoi (on ne me le demande pas).
Je ne voyage pas, je ne m’enfuis pas, idéalement j’aimerais retrouver le lit et les jouets de ma première chambre.
Par exemple, commettre un acte raciste sans savoir que c’est un acte raciste ne vous rend pas raciste. Si vous vous déguisez en Noir ou si vous imitez un accent petit nègre ou si vous riez en lisant certaines cases de la première édition de Tintin au Congo, si vous ne savez pas que c’est raciste, alors, heureusement, vous n’êtes pas raciste. Également, si vous riez devant le sketch de Michel Leeb intitulé L’Africain, vous n’êtes toujours pas raciste, car Michel Leeb lui-même n’est pas raciste. Ne pas savoir que l’on est raciste est très pratique car cela vous évite d’avoir à vous excuser et réfléchir quant à vos actes racistes (dont, encore une fois, vous ignoriez le caractère raciste). Si on vous accuse d’être raciste (ce qui se produira sans doute), vous pourrez vous défendre en utilisant, au choix, l’hommage, le second degré ou l’ami noir. Vous pourrez également affirmer qu’on ne peut plus rien dire, ou, plus précisément : plus rien dire de raciste sans savoir que c’est raciste. C’est-à-dire qu’il faut devenir conscient et responsable de toutes ses paroles, quelle plaie. Qui a le temps pour réfléchir à et peser ce qu’il veut dire, personne, sauf probablement les bobo-gauchiasses et les journalopes, et peut-être aussi les bien-pensants. Si vraiment vous êtes poussé dans vos retranchements, n’hésitez pas à citer Pierre Desproges sans avoir compris le sens de ses paroles (ce n’est pas important) ; cela aura un effet assurément déstabilisant car au fond personne n’a vraiment pris le temps de bien comprendre le sens de ses paroles, et donc encore moins de les expliquer et de les détailler. Votre principal avantage face à vos détracteurs est votre honnêteté, votre amour de la vie (cf. les barbecues) et votre respect de toutes les personnes vivant sur cette Terre, peu importe leur religion ou leur couleur de peau (cf. France - Brésil 98). Un respect d’ailleurs tellement puissant et empathique que vous ne voyez même plus les couleurs de peau, vous ne voyez que des égaux, des semblables, partageant les mêmes atouts et les mêmes blocages que vous face aux épreuves de la vie. Vous ne pouvez être raciste simplement car le racisme est absolument en dehors de votre horizon de pensée. Vous êtes de la pure matière spirituelle, sans aucune attache ni aucune considération pour les données sociologiques et les expériences vécues, bien trop éloignées de vos expériences à vous de pure entité immatérielle, c’est-à-dire sans doute des expériences de nirvana, de sublime et d’infini. Il est donc évident qu’un acte raciste de votre part puisse vous échapper complètement si vous êtes uniquement concentré sur des questions de sublime et d’infini, qui requièrent toute votre énergie et toute votre attention. Oui, c’est ça, c’est sans doute ça, c’est bien cette histoire de sphère spirituelle, oui, ok, partons là-dessus, et puis j’aime bien vos idées, le truc de France 98 oui, c’est fédérateur, et puis le barbecue, bien sûr, tout le monde comprend ce type d’image, ah quand même, putain d’islamogauchistes, on peut plus être tranquilles une seconde, moi raciste, ah c’est quand même la meilleure, on croit rêver, quand on sait tout ce que j’ai fait, ils ne me connaissent pas ces gens-là, quand même, quelle époque, oui, je le dis : quelle époque !…
Hier soir, je me disais, mais c’est encore une idée confuse, comme une intuition, que notre expérience des paysages virtuels rejoignait finalement celle des paysages réels. Que si nous étions amener à évoluer toute notre vie dans les métropoles de GTA ou dans les plaines/déserts/cavernes de Minecraft, nous pourrions mourir en ayant la sensation d’avoir sincèrement vécu. Car ces paysages factices appellent en effet des ressentis, des émotions, semblables aux campagnes ou aux rues dans lesquelles nous évoluons pour maintenir en état notre corps. Ces paysages trichent comme n’importe quel paysage triche, en nous trompant par le biais de souvenirs, d’appréhensions, d’agencements.
La majorité de notre territoire nous est inconnue, inaccessible. C’est pour cela qu’il nous semble évident de ne pouvoir accéder à certaines zones dans de soi-disant open world. Cet empêchement est une expérience courante. Par exemple, je n’ai aucune idée de la façon dont est composé l’immeuble en face de chez moi, je ne sais même pas s’il y a bien quelque chose à l’intérieur, s’il ne s’agit pas simplement de cubes vides, factices. Son entrée est gardée par des codes, mais d’autres bâtiments plus prestigieux le sont par des grilles, voire des gardes. L’environnement est un espace majoritairement privé.
La virtualité de la réalité semble amoindrie par l’expérience, l’appréhension de notre corps physique. J’éprouve pourtant un vertige équivalent lorsque je gravis une montagne ou durant un saut de l’ange dans Assassin’s Creed. J’éprouve la même peur dans une forêt la nuit que dans celle où rôde le Slenderman. Ces forêts me semblent d’ailleurs encore plus terrifiantes depuis que je connais l’existence du Slenderman, pourtant pure projection de mon esprit.
Ce que je veux dire par là, c’est que nous n’avons pas attendu les jeux vidéo pour évoluer dans un monde que l’on pense partagé par tous mais qui est en réalité propre à chacun. Nous sommes les héros solitaires de mondes remplis de PNJ, et seule notre témérité à nous convaincre du contraire nous permet de vivre comme égal des autres. Et nous arpentons vainement des territoires en perpétuelle reconfiguration.
(J’avais prévenu, c’est encore flou.)
« Les lumières s’éteignirent d’un coup. La rampe se désintégra sous ses doigts. Un hurlement strident s’éleva, assourdissant. Il tombait. Sharp essaya frénétiquement de se raccrocher à quelque chose mais ne trouva autour de lui que l’obscurité et le vide. Plus rien de tangible, de réel, juste un gouffre sous ses pieds et le vacarme de ses propres cris terrifiés. » – Philip K. Dick, Phobie or not phobie (trad. M. Thaon).
J’ai toujours cette grosseur étrange dans la gorge. J’ai pris rendez-vous chez le médecin.
Ma grand-mère, en train de recoudre ses rideaux, s’est précipitée pour allumer la télévision et regarder les funérailles de Johnny Hallyday. Je ne l’ai jamais surprise en train de l’écouter ; elle n’a aucun album ; je crois même qu’elle ne l’apprécie pas tellement. Elle doit apprécier les funérailles, les Champs-Elysées, les motos. Elle reste debout dans le salon, devant la télévision. Elle doit aimer quelque chose qui n’a rien à voir avec Johnny Hallyday, mais qu’elle tient à regarder, une chose pour laquelle elle a abandonné son travail de couture. La nostalgie, sans doute. Le temps, peut-être.
Ses deux seules paroles ont été : « Mais il a neigé là-bas ? » et « Qu’est-ce qu’elle est moche depuis qu’elle s’est faite refaire Sylvie Vartan ».
L’arrière du corbillard était transparent. On pouvait aperçevoir le cercueil blanc qui lui était opaque.
Initialement, les pommes de pin n’avaient pas tout à fait été considérées par le service de sécurité du Roi comme la meilleure façon de contrôler les faits et gestes des habitants de la ville.
« Nintendo always felt more real than life. Simple yet somehow beautiful worlds, constantly breaking down, designed, whether intended or not, as pixilated avatars of hope. Old school video games are perfect precisely because of how unreal they are. They don’t try to teach you anything, except if you see a hammer, you better grab it. » – Sampson Starkweather, Self Help Poems.
Là où Rivage avait tort, c’est que l’homme aux jumelles qu’il avait surpris depuis son bureau avec ses propres jumelles, en réalité, ne le regardait pas du tout. Il n’avait d’ailleurs même pas remarqué que Rivage l’avait remarqué. L’homme aux jumelles était bien plus intéressé par la pièce jouxtant le bureau de Rivage, dans laquelle patientait un témoin clé qui n’avait pas encore parlé et qui ne devait surtout pas parler. Depuis le sixième étage de l’immeuble dans lequel il était posté, l’homme aux jumelles faisait de simples repérages pour jauger la meilleure façon d’éliminer ce témoin clé sans trop laisser de traces, sans trop attirer l’attention. Il s’avéra qu’aux yeux de l’homme aux jumelles la meilleure façon était le fusil de précision, mais, considérant la polyvalence de l’homme aux jumelles, la fléchette empoisonnée, la fronde ou encore le bazooka auraient tout aussi bien fait l’affaire. L’homme aux jumelles monta son fusil de précision et installa ensuite son canon de manière à atteindre exactement le crâne du témoin clé. Si, plus tôt, Rivage n’avait pas perdu la joute de regards contre l’homme aux jumelles, il aurait sans doute pu prévenir cette attaque et sauver le témoin clé. Mais, malheureusement, il se trouva qu’il perdît. La fenêtre vola en éclats ; le témoin clé suivit.
« l’entropie qui submerge toutes choses visibles, le divertissement et la technologie et tous les mômes de quatre ans avec leur ordinateur, chacun son propre artiste d’où ça vient tout ça, le système binaire et l’ordinateur d’où ça vient la technologie au départ, vous comprenez ? je n’arrive même pas à m’y mettre, vous comprenez c’est à ça qu’il faut que je me mette avant que tout mon travail soit mal interprété et déformé et, et changé en dessin animé parce que c’est un dessin animé toute cette populace ahurie là-dehors qui attend qu’on la distraie et fait de l’artiste créateur un artiste de cabaret » – William Gaddis, Agonie d’agapè (trad. Claro).
Hier soir, avant de m’endormir, je me disais que dans un appartement comme le mien, il serait tout à fait possible qu’une personne suffisamment furtive puisse vivre en même temps que moi sans que je m’en rende compte. Il lui suffirait de se rendre dans ma chambre quand je vais dans le salon, et vice versa quand je vais dans la chambre. Elle pendrait sa douche quand je suis dans la cuisine, et ferait la cuisine quand je prends ma douche. Elle vivrait en permanence à contre-temps de mon propre rythme. Cela demande une parfaite maîtrise de l’art du déplacement, mais je suis persuadé qu’il existe des ninjas modernes, qui vivent donc simplement dans la pièce d’à côté. Inutile d’aller voir, votre ninja est déjà rendu dans la pièce d’où vous venez. Il faut simplement accepter son sort (la colocation imposée), ou installer des caméras de surveillance dans chaque pièce, ce qui demande un certain budget (que, personnellement, actuellement, je n’ai pas). Je vais aller préparer une jardinière ; mon ninja en profitera sans doute pour faire la sieste, ou écrire quelques phrases dans son journal en ligne.
« Dans le grand théâtre vivant où les animaux de zoo et de laboratoire jouent leur rôle, les gardiens maintiennent un contrôle strict sur l’élevage, la naissance, la mort, l’alimentation, et la socialisation. L’authenticité et l’autorité requièrent une manipulation constante des maisons-cages. Nous voyons les zoos comme des endroits où amener les enfants, mais faire que les animaux semblent naturels demande un travail constant. » – Thalia Field, L’amateur d’oiseaux, côté jardin (trad. V. Broqua, O. Brossard et A. Lang).
Ma grand-mère a appelé Cécile tout à l’heure. C’est rare qu’elle appelle, seulement pour appeler, pour la présence, pour la voix. Elle ne m’appelle pas moi ; elle imagine toujours qu’elle me dérange. La dernière fois, dans la cuisine, elle nous a dit qu’elle aimerait qu’on passe la voir une fois par mois, si possible. Avant, elle ne demandait pas ce genre de choses. Elle vieillit. Elle doit s’en rendre compte (elle dit parfois que la machine déconne).
Si vous êtes dans votre baignoire et que vous fixez le rideau de douche assez longtemps, il est possible que quelqu’un que vous ne connaissez pas le tire et tienne un couteau à la main. Même chose avec une porte : si vous fixez la poignée assez longtemps, il est possible qu’un étranger hostile tente de l’ouvrir avec férocité (et gueule depuis l’autre côté de la porte, vous menace par exemple, de vous tuer par exemple). De cette attention démesurée envers des détails apparemment inoffensifs naît l’angoisse. Attention : si ces deux événements vous arrivent dans la même journée, il est tout à fait possible que vous soyez le second rôle d’un quelconque film d’horreur.
Parfois, un homme passe en marchant dans ma rue, avec des écouteurs sur les oreilles et toujours son téléphone dans une main (auquel sont branchés les écouteurs). Je l’entends chanter depuis mon bureau, quatre étages plus haut, des chansons de variété, ou des classiques de la funk (en yaourt). Les autres passants autour font comme s’ils n’entendaient rien, mais cet homme chante vraiment très fort, en pleine rue, des classiques de la funk en yaourt. Il est sans doute le seul dans toute la ville à faire ça.
Je viens également de remarquer que l’homme aveugle n’avait plus son chien guide avec lui. Désormais il a une canne téléscopique, qui semble beaucoup moins sympathique et affectueuse. Qu’est devenu le chien ?
« Un jour, Al acheta dix litres de la plus sombre des peintures vertes chez Kammenstein’s, à Forest Green, bien qu’elle ait été véritablement la couleur de l’enfer. Au cours des deux ou trois jours suivants, il peignit tout son appartement, y compris les plafonds, avec ce vert sépulcral, un vert tellement lugubre et morne qu’il paraissait être la représentation du pur désespoir, une couleur suicidaire, si on peut parler de couleur, car elle était d’une certaine façon plus noire que noire. »
J’ai traduit quelques paragraphes du King of the Forest de Sampson Starkweather, qui est le premier livre du volume The First 4 Books of Sampson Starkweather :
Il y a en permanence des hordes de loups en ville qui errent autour des monuments et des stations de métro abandonnés, sans aucune crainte ni résistance. Tant que vous vous occupez de vos affaires, ils vous ignoreront. Mais il suffit qu’un touriste prenne conscience de leur existence, ou qu’une jeune fille, percevant leur présence animale, fasse un mouvement brusque, pour qu’ils déferlent aussitôt sur leur victime, et que de leurs griffes aiguisées et de leurs crocs ils déchiquètent la personne en lambeaux avant de la dévorer sous les yeux de tous. Il est difficile de faire comme s’il n’y avait pas de cris, mais la plupart des gens sont désormais formés pour ne pas se laisser submergés par les sons. Je préfère vous rappeler que la plupart du temps les loups errent simplement dans la ville, calmement, sans rien faire de particulier.
Si un homme tombe dans une forêt sans personne à proximité, fait-il toujours du bruit ? Et comment est-ce qu’un putain de couteau suisse est censé vous sauver ? La nature suit les mêmes règles que l’art. Ou que le langage. Le zoo pour lequel nous avons tous perdu notre état sauvage. La frontière entre être fait et être né. L’utilité contre la beauté. Il n’y a aucune différence entre un poème et un arbre. Un arbre tortueux n’a aucun devoir. Mon ami ne sait pas s’il croit en Dieu ou non, ce qui en soi est un art. Shelly dit que la grande énigme de la morale, c’est l’amour. Le livre que je suis en train de lire dit « Sont Dieu, le péché et la sainteté ». Je suis effrayé par le fisc et par l’idée de tomber dans une forêt sans personne à proximité. Mais j’imagine que vous l’avez déjà compris. Comme pour ce couteau suisse, Peu importe que ce qui nous menace par la destruction soit caché au fond de nous, et qu’on se laisse anéantir complètement jusqu’au plus petit atome, car depuis sa résistance émergera — un monde qui est ce que je taille dans l’arbre que je suis.
Voici l’histoire de la matière noire. Un samedi matin, une fillette de 6 ans a marché droit vers ma petite maison. Quand je me suis réveillé, elle se tenait au pied de mon lit, et elle a dit : « C’était ma maison de poupées ». Un pacte, sous-entendu, s’est couvert de plumes. Parfois je l’aperçois sur la balançoire ou je l’entends jouer entre les arbres. Elle sait que tu es partie, mais pour moi elle fait semblant du contraire.
Mes amis pensent que la poésie n’a rien à voir avec les mots. « La poésie, m’a-t-elle dit, est une montagne ». Une véritable montagne. Une chose qu’un idiot gravit simplement « parce qu’elle est là ». La poésie est là, mais pourquoi avons-nous toujours besoin de prouver qu’elle existe ? Pour la montrer du doigt ? Comme une montagne qui apparaît au loin. « Deviens un pur bloc de bois » est ce qu’une Sarah Lawrence enfant, insomniaque depuis deux jours, encore défoncée à l’ecstasy et à l’acide, assise en tailleur sur les rochers, muette, m’aurait crié durant un match de tennis. Ils avaient raison. Ce qui se trouve au fond d’un pur bloc de bois. Des spires et des grains, des histoires et de la fumée contenue. Entourée par. Mon bloc de bois, la montagne d’un autre. Le son d’un doigt pointant ce qui est invisible. Être pris en compte ou, peut-être, estimé par. Une chose sur laquelle dessiner une porte.
J’écris comme je contemple les montagnes. Espérant quelque chose de rouge et de trop vrai pour tomber. J’ai peur. J’ai peur de ce que je sais et de ce que j’ignore. Quelque chose s’échappe de moi comme des chevaux apeurés. Est-ce que vous le sentez ? J’ai cette image de vous et à l’intérieur de vos yeux il y a des oiseaux gelés sur un évantail chinois. Vous avez cet air, on dirait que vous venez de dire quelque chose de sublime ou de criminel. Je berce vos excuses entre mes mains pour en boire une gorgée.
Rivage inspecta de fond en comble l’usine désaffectée. Les hommes de Saint Pepsi avaient quitté les lieux en vitesse, sans doute de peur que Rivage ne les élimine à leur tour. Avant de partir suivre une autre piste, Rivage s’attarda dans une dernière pièce, une pièce quelconque à l’écart, anodine, sur le plan de travail de laquelle il remarqua pourtant des documents confidentiels tamponnés TOP SECRET, ainsi que des détritus de repas et des cartons de pizza tout sauf confidentiels. Rivage mit ce manque de rigueur de la part de tels professionnels du crime sur le compte de la précipitation. Il parcourut rapidement les fichiers dispersés ici et là sur le plan de travail : des graphiques, des paragraphes aux trois quarts rayés, des suites de chiffres, des codes, des repères géographiques, ce genre de données. Il fronçait les sourcils quand les informations semblaient importantes, posait une main sur son menton quand il avait besoin de réfléchir, fit des suppositions éclairantes, jetait parfois les détritus sur le sol, puis se mit à faire toutes ces actions en même temps à un rythme très soutenu après avoir aperçu, dans un coin de la pièce, un petit minuteur digital relié à un plus important amas d’explosifs chargés de réduire l’usine en cendres dans les plus brefs délais (deux minutes quarante d’après le minuteur), mais également les documents confidentiels et, tant qu’on y était, si ça n’était pas trop demandé, Rivage. Quand l’usine explosa et emporta dans son brasier les documents confidentiels, Rivage se trouvait déjà loin. Depuis le bord de la route où était stationnée sa voiture, il put apprécier la colonne de fumée noire qui montait vers le ciel et qui lui fit penser à la scène finale d’un film d’action qu’il avait bien aimé dernièrement, même si le nom du réalisateur lui échappait.
Rivage repensait au système de surveillance que les hommes de Saint Pepsi avaient installé dans l’usine. Si un système similaire était installé dans les rues de la ville, cela faciliterait grandement ses enquêtes, il n’aurait presque plus rien à faire, il n’aurait plus qu’à patienter derrière son poste de contrôle que les meurtriers commettent leurs crimes en flagrant délit, puis il dépêcherait des policiers sur place dans l’instant, et le tour serait joué. Rivage se dit aussi qu’il pourrait zoomer de très près sur les visages des habitants pour les détailler en profondeur et découvrir tous leurs secrets. Pour l’instant, Rivage se contentait de ses jumelles, et il observait par la fenêtre de son bureau l’immeuble à côté du commissariat. Il s’aperçut que quelqu’un l’observait également au travers de jumelles depuis l’immeuble à côté du commissariat, depuis, à vue de nez, le dixième ou onzième étage, et bientôt ce fut à celui qui craquerait le premier et arrêterait d’observer l’autre, et Rivage fut le premier qui craqua, car simplement il n’avait aucune force mentale. Il s’en voulut d’être aussi faible dans ce type de joute et se dit que la prochaine fois ce serait au tour de l’autre de craquer et de se désoler de n’avoir aucune force mentale. Rivage reposa ses jumelles sur son bureau et bascula dans son fauteuil. Il jeta un oeil au petit tableau qui se trouvait à sa droite et qui représentait une porte rouge donnant sur une pièce en hors-champ. Rivage se demandait ce que devenait son assistant.
En ce moment, je ne gagne quand même pas beaucoup d’argent.
« Il sort un roman tous les deux ans et, s’ils ne sont pas meilleurs que ses premiers livres, ils ne sont certainement pas pires. Comme il était célèbre pour un roman d’une charmante médiocrité publié à l’âge de vingt-huit ans, il est toujours célèbre pour ses charmantes médiocrités, lesquelles permettent de rappeler son premier livre, pour le plus grand plaisir des critiques. Et ainsi les honneurs et les récompenses lui arrivent au rythme de un par an. » – Gilbert Sorrentino, L’Abîme de l’illusion humaine (trad B. Hoepffner).
Non, effectivement, l’hélicoptère n’était pas nécessaire. Rivage avait toujours éprouvé de grandes difficultés pour jauger l’utilité de l’engin en fonction de l’enquête sur laquelle il était dépêché. Comme le corps avait été découvert dans la rade du port, il s’était dit que ça serait plus rapide ainsi, décoller depuis le toit du commissariat, survoler la ville, jeter un coup d’oeil au passage sur le superbe paysage faiblement éclairé dans la nuit, puis atterir enfin exactement à l’endroit où il était attendu. Dans les faits, le pilote fut incapable de poser l’hélicoptère au port à cause du manque évident de surface pour l’accueillir et de la force du vent qui manquait de tous les fracasser contre les bâtiments de pêche. Le pilote fut contraint d’effectuer au péril de sa vie un vol stationnaire à très basse altitude qui permit à Rivage et à son assistant d’effectuer un saut tout aussi périlleux (Rivage manqua se briser les chevilles) de plusieurs mètres pour rejoindre les autres corps de métier (pompiers, ambulanciers, témoins, potentiels coupables) déjà présents sur place, et qui s’étaient tous baissés au ras du sol pour éviter au maximum les rafales de vent que provoquaient les pâles de l’hélicoptère lancées à toute allure. En somme, beaucoup plus de contraintes que si Rivage avait pris sa voiture.
Dans une production télévisuelle standard, c’est sans doute à cet instant que serait apparu le titre de l’épisode.
(Pour le moment, je rassemble les éléments. Ensuite, j’en ferai quelque chose.)
« Everything is so extra,
it gets hard
to know what to exactly
give a fuck about. » – Tommy Pico, IRL.
Cinq balles, donc. La première perfora un poumon, le seconde explosa un crâne, Rivage était bien parti, la troisième finit dans une caisse, Rivage n’est pas non plus infaillible, la quatrième se logea en plein ventre, et la cinquième ricocha dans la pièce de façon à terrasser les huit hommes restants. Rivage vérifia l’état de santé des hommes étendus un peu partout sur le sol. L’un d’entre eux semblait encore entre la vie et la mort, dans un état parfaitement disponible donc pour communiquer des informations de la plus haute importance concernant leur chef et ses terribles objectifs. Les phrases de l’homme entre la vie et la mort étaient complètement décousues, ce qui contraignait Rivage à lui administrer de petites claques sur le visage pour qu’il éclaircisse ses propos. Les propos éclaircis par Rivage n’étaient d’aucune utilité pour la suite de son enquête. Tout ce que l’homme mourant lui disait avec difficulté, Rivage le savait déjà. Rivage soudain entendit une voix s’adresser à lui depuis des enceintes installées en hauteur. Rivage n’imaginait pas qu’il s’agisse de la voix de Saint Pepsi. Il n’avait jamais pensé à la voix de Saint Pepsi. La voix prévint Rivage qu’il s’était mis dans de mauvais draps, qu’il ne savait pas à qui il avait à faire (Rivage confirmait : c’était tout le problème), que désormais il était dans leur viseur (Rivage rit : pas ceux de vos hommes en tout cas), qu’il ne pourrait plus dormir de la nuit (Rivage le rassura : c’était déjà le cas), qu’il mettait sa famille en danger (Rivage le rassura : il n’en avait plus), et que putain de merde il arrête de la couper à chaque fois pour faire son malin. Dans le local de sécurité, un des gardiens vit Rivage s’approcher d’une des caméras de surveillance et lever le visage vers l’objectif. Rivage mima un pistolet avec ses doigts, qu’il pointa en direction de la caméra. Le gardien se demandait ce qu’il faisait. Après avoir assuré sa visée, Rivage plia son pouce comme pour propulser la balle qui allait sortir de son index. Il y eut un bref instant de silence, puis la caméra explosa.
Non, effectivement, l’hélicoptère n’était sans doute pas nécessaire.
« En règle générale, les hommes qui viennent attendre le train dans cette gare meurent pendant l’attente. Ce n’est pas une mort terrible, très calme au contraire, et, à sa manière, élégante ; certains d’entre eux se font escorter par leur famille, par leurs fils en particulier, qui portent de longues chaussettes noires et des culottes courtes, afin qu’ils apprennent la manière de mourir dignement. » – Giorgio Manganelli, Centurie (trad. J.-B. Para).
Rivage savait que le moment viendrait où il devrait affronter un chien. Affronter les chiens n’était pas ce que Rivage préférait dans son métier. Il ne savait jamais comment s’y prendre. D’après lui, tout était très prévisible, sauf les chiens, qu’il frappait toujours un peu au hasard. Frapper un chien est très compliqué car ils sont très bas, très agiles, et très peu entraînés à se laisser faire. Il n’est possible de frapper un chien du poing que lorsqu’il vous saute à la gorge, et alors vous frappez sa gueule ouverte qui se referme sur votre poing, et finalement c’est le chien qui gagne. Il est sinon possible de lui asséner des coups de pied dans le ventre, mais pas dans la gueule, au risque de voir son pied finir dans le même état que sa main. Du chien, il faut surtout éviter la gueule. Rivage avait remarqué qu’en dehors de sa gueule, un chien est une sorte de saucisse, et une saucisse véloce n’est rien sans sa gueule. C’est la gueule qui fait la force du chien, c’est elle qui souvent pose problème à Rivage. Rivage tentait parfois de faire abstraction de la partie gueule du chien pour ne se concentrer que sur la partie saucisse, mais ça ne changeait pas grand chose. Rivage devait le reconnaître : la partie saucisse seule le terrassait. Vraiment, le plus gros point faible de Rivage était les chiens. En ville, tous les criminels le savaient, et ils encerclaient donc leurs repaires de dizaines de molosses enragés, que Rivage tentait tant bien que mal de transformer en simples saucisses. Et le repaire devant lequel Rivage était posté ne transigeait pas à la règle. Il avait devoir prendre sur lui.
« Mon père me hait, me dit que je dois être une femme et me faire engager chez un respectable sellier. Tout ce dont il a envie c’est de me violer. Je refuse. Le salopard s’arrange pour me faire enlever par ses amis, me fait jeter dans le donjon d’un navire qui appareille pour la Virginie. Je suis une esclave. » – Kathy Acker, La Vie enfantine de la tarentule noire, par la tarentule noire (trad. G.-G. Lemaire).
Les trois balles manquèrent d’atteindre Rivage, qui esquiva les tirs d’une roulade sur le côté. Quelqu’un au loin l’encourageait à se rendre, c’est-à-dire à mourir, Rivage n’était pas dupe. « Voici comment on va faire », cria Rivage, qui ne rencontra aucune réponse en retour. Ses interlocuteurs semblaient très peu enclins à le laisser partir, ce que Rivage pensait pourtant faire, ce qui était son plan désormais : qu’on le laisse partir. Il n’avait aucun moyen de joindre qui que ce soit. Ses interlocuteurs campaient comme lui, plus loin dans le hangar, derrière d’autres caisses en bois, et parfois il apercevait le haut d’un masque, parfois un pied, et Rivage se disait qu’il pourrait tirer avec précision dans ces cibles minuscules, que si on lui en donnait l’opportunité il ne lui suffirait sans doute que d’une balle pour chaque homme. Il n’avait plus que cinq balles ; il priait pour qu’il n’y ait que cinq hommes. « On va tous baisser nos armes et partir chacun de notre côté tranquillement », cria Rivage. « Non, on ne va pas du tout faire ça », lui répondit-on. Merde, pensa Rivage. Tant pis, pensa-t-il ensuite. Si Rivage s’était trouvé dans le local de sécurité à ce moment-là, il se serait aperçu en regardant les écrans de contrôle qu’il y avait onze hommes dans le hangar, que certains étaient déjà passés dans son dos et s’approchaient dangereusement, qu’en somme la situation était totalement sous le contrôle des hommes masqués, qu’il n’avait aucune chance de s’en sortir. Si Rivage s’était trouvé dans le local de sécurité, il aurait tout de suite compris que non, en effet, on n’allait pas du tout faire comme il avait dit.
« Maintenant tu commences à flipper. Tu vois les gestes et la gueule de Ben et tu comprends. Pourtant tu bouges pas et tu restes planté, les mains dans les poches et pire que ça : tu t’excuses. Sur la deuxième photo je te jure, en admettant que ce soit toi, t’es déjà une victime. » — Guillaume Vissac, Coup de tête.
Il faut s’imaginer un type qui ouvre sa boite mail un soir et qui reçoit un email avec objet : mes vacances en afrique et une pièce jointe en .zip nommée diaporama072016. Ça ne peut pas être un virus parce que le type a installé un antivirus de type avast qui lui dit : aucun problème. Alors le type se dit : aucun problème aucune chance que je me fasse niquer et il télécharge le .zip. Dans le .zip il y a un .exe et le type double clique sur le .exe alors qu’il a un mac. Rien ne se passe. Le type pense qu’il s’agit d’une erreur et il double clique encore sur le .exe. Toujours rien. Le type se dit : merde ça doit être un virus. Le type appelle son pote thierry qui s’y connaît en informatique vu qu’il a installé sa livebox. Et thierry lui dit : à 100% c’est un virus. Quelle merde, pense le type en mettant le .exe et le .zip à la corbeille. Trente minutes plus tard il se branle sur un site de cul quelconque. Il se rend pas compte que sa webcam est allumée et le filme en train de se branler. C’est le lendemain quand sa femme lui demande ce que c’est que ce bordel en lui montrant des photos de lui en train de se branler qu’il pige ce qui s’est passé. À savoir qu’on l’a filmé en train de se branler. Il appelle son pote thierry le pro de l’informatique qui lui dit : à 100% c’est le virus. Thierry lui dit aussi : vérifie ton compte en banque c’est peut-être les russes. Le compte en banque du type est déjà vide. Sa femme le quitte aussitôt et part avec leur fille chez thierry, qui était à l’origine de l’email.
Le type veut se venger de thierry et lui envoie un email du même type avec une pièce jointe du même type. La boite mail de thierry filtre automatiquement l’email en spam.
« You are swimming in the ocean. A bit of breeze, some sunlight on your eyelids, salt on your skin, clouds scroll by like the comments field of the sky, a wave lifts you up like a father, then puts you back down like a mother. You think of nothing or something. You are simply swimming. Everything else melts away.
All the computers and devices in the entire world are abandoned on the bottom of the ocean floor.
This is called pornography. » — Sampson Starkweather, PAIN: The Board Game.
Parfois, j’ai comme l’impression que des gens vivent dans le grenier au-dessus de notre appartement. Ce n’est vraiment pas étrange comme idée, il y a des gens qui vivent dans bien moins d’espace que ça à Paris. Il y a des gens qui vivent littéralement dans des chiottes à Paris, et qui font leur vaisselle assis sur la cuvette, et qui paient une somme folle pour ça, et ce n’est même pas illégal, de vivre dans ses chiottes, c’est incroyable. Au moins, dans le grenier, il y a de l’espace, et puis les compartiments ont chacun un vélux, ce qui n’est pas rien. On peut regarder la pluie tomber en croyant être de la bohème. En réalité, on est juste du grenier, et on vit dans la misère, pas dans la bohème, mais on entend la pluie tomber. Au moins on vit pas dans ses chiottes. Au moins on vit pas à Paris.
Je viens de terminer ma lecture de The Other Hollywood, qui retrace l’histoire de l’industrie pornographique depuis les années 50 jusqu’à 1997. Sans aucun doute un des meilleurs livres lus cette année, quand bien même il montre ses limites sur certaines questions importantes (mériterait donc d’être approfondi / enrichi / augmenté par d’autres livres). 800 pages qui se lisent comme un excellent roman policier, avec toute la panoplie classique liée à la désillusion américaine (ambition, mafia, armes, manipulation, gloire, FBI, infiltration, drogue, suicide, sida, etc). C’est à lire même si on se fout du porno.

Scene_14/ En bas de l’escalier, je me suis retrouvé dans une sorte de cave morbide, avec très peu de lumière, seulement la lumière qui venait du haut de l’escalier. Il y avait des os, et aussi une clé. J’ai récupéré la clé. Au fond de la cave, il y avait un autre escalier qui montait je ne sais pas où.
« LORENA BOBITT : Quand il en a eu fini, j’ai remis ma culotte. Je me suis assise sur le lit et je lui ai demandé pourquoi il me faisait ça encore et encore. Il m’a repoussée d’un geste, il a dit qu’il se fichait de ce que je ressentais. J’ai été dans la cuisine pour prendre un verre d’eau.
J’étais en train de boire le verre pour essayer de me calmer – la seule lumière allumée, c’était celle du frigo, et alors j’ai vu le couteau.
Je me souviens de plein de choses.
LARRY FURST : Elle a tranché son pénis avec un couteau de cuisine, s’est enfuie de l’appartement et a jeté le pénis par la fenêtre de sa voiture. » – Legs McNeil & Jennifer Osborne, The Other Hollywood.
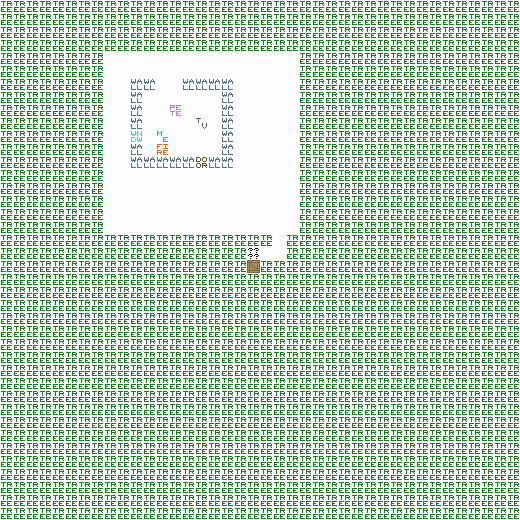
Scene_12/ Pete m’a dit de brûler la cassette vidéo parce qu’elle le mettait vraiment mal à l’aise. J’ai fait semblant de la brûler mais je l’ai gardée dans ma poche.
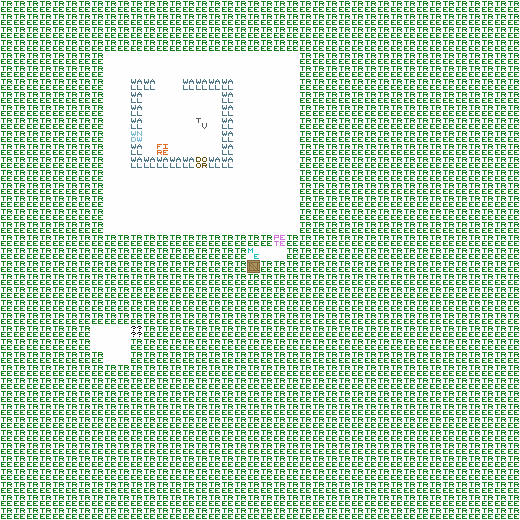
Scene_13/ On est sortis dehors et Pete m’a fait remarquer que des arbres avaient été abattus à l’orée de la forêt. On s’est approchés et on a vu une trappe dans le sol. Pete m’a dit de descendre en premier. Il m’a dit qu’il resterait ici pour faire le guet.
Certains lecteurs s’enthousiasment sur des textes, parfois, quand même, je me dis, il ne leur faut pas grand chose.
Aussi, hier après-midi, on discutait avec Émilien du rapport qu’entretiennent certains jeunes auteurs avec leurs aînés contemporains (les plus notables actuellement : Michon, Modiano, Echenoz, Carrère), qu’ils placent sur une sorte de piédestal intangible, aux livres tous plus géniaux les uns que les autres, sans aucun recul critique, sans aucun relief. Il nous semblait que le manque de remise en question du travail de ceux que nous admirons (et on a tous nos églises) était comme un défaut de fascination, comme de l’excès de zèle, et que cela transformait des oeuvres individuelles et faillibles en une sorte de mixture audacieuse, sublime, impeccable et intemporelle.
Par exemple, j’estime sincèrement le travail d’Echenoz, mais il ne faut pas que je pousse trop loin ma réflexion pour admettre qu’un roman comme Envoyée spéciale est du Echenoz au carré (du Échenoz qui fait du Échenoz = de la recette = du confort), comme le mois dernier Made in China est du Toussaint au carré, ou à peu près tout ce que publie Modiano depuis Un pedigree. Aujourd’hui, quelqu’un comme Michon est un demi-dieu sur notre Terre, et personne ne se prive de le lui dire (le pauvre, il n’y est pour rien). Il est déjà en train d’agrémenter sa tombe sous les yeux admiratifs de ses disciples, il agence avec soin les compositions florales et les plaques mortuaires des admirateurs, on l’applaudit, et puis il se couchera heureux dans son cercueil, on le descendra parmi les vers, et il se dira sans doute (avec cette économie de moyens qui le caractérise) : j’ai fait du bon boulot, en avant pour la postérité.
En somme : il ne faut surtout pas s’empêcher de ne pas aimer, et de le dire. Par le discours critique, on développe aussi sa propre marge de progression. Chacun construit sa légende ; aux autres la charge (le devoir) de ne pas y croire.
« Puis j’entends un autre coup de feu. Ils sont étrangement espacés. Alors je suppose que finalement il se soucie de savoir qui meurt. Peut-être même que c’est des gens qu’il connaît. Les coups de feu finissent par s’arrêter. Peut-être que quand il a commencé à se soucier de qui mourait il s’est rendu compte qu’il pouvait mourir. Ou il a fini par comprendre ce qu’il voulait faire, et soit il l’a fait, soit il a compris qu’il ne pouvait pas. Peut-être que pour le dernier coup de feu il avait retourné l’arme contre lui. Ça a fait le même bruit que tous les autres. » – Dennis Cooper, Défaits.
C’est étrange : depuis quelques jours, je sens comme une grosseur au niveau de ma gorge, à droite. Quand je ne la touche pas, elle ne grossit pas, mais si je la palpe, si. C’est au niveau des ganglions, je sais qu’on a des ganglions dans la gorge, que c’est normal, mais celui-là, d’une certaine façon, n’est pas normal. Parfois je me dis que j’ai un cancer, et en même temps je me dis : un cancer, ce n’est pas possible. Au fond, on ne sait jamais ce qui est possible ou non. Je ne sais pas quelle douleur provoque un cancer dans la gorge, sans doute pas cette douleur-là, mais peut-être que si. La plupart du temps, on est déjà morts sans le savoir, mais on se persuade du contraire. On vit ainsi.
about:newlife
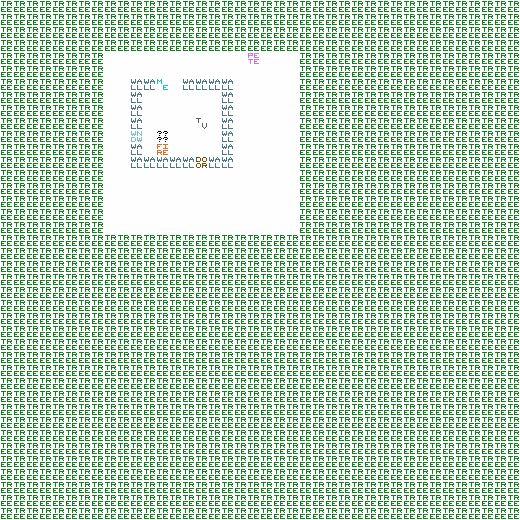
Scene_10/ J’ai jeté un œil par la fenêtre, et j’ai vu Pete qui arrivait de la forêt. Pete vient parfois me voir. Il ne m’a jamais dit où il vivait. On ne parle pas beaucoup.

Scene_11/ J’ai montré la cassette vidéo à Pete. Il n’a pas semblé très réceptif.
L’homme mort se retourne vers moi et me demande : À quoi ça sert d’être mort ?
Il y a deux ou trois mois, histoire de voir, j’ai traduit quelques paragraphes du premier roman, Fra Keeler, d’une autrice américaine, Azareen Van der Vliet Oloomi. Comme je suis incapable de savoir ce que je vais précisément en faire, je les mets ici, peut-être que ça me motivera à poursuivre le travail, à corriger, ou à rien du tout, etc. C’est imparfait, je n’y connais rien, et j’ai seulement commencé parce que ça me semblait être la chose à faire.
1. « Elle se trouve sur la crête d’un canyon », m’a dit l’agent immobilier, qui avait tiqué quand j’avais offert d’acheter la maison sans l’avoir visitée auparavant.
« D’accord », ai-je dit, même si je n’étais pas tout à fait sûr de ce que l’agent immobilier avait voulu me faire comprendre. Puis je n’ai rien dit pendant un long moment parce que je pensais au décès de Fra Keeler. Puis j’eus l’impression que l’agent immobilier voulait répéter ce qu’il venait de dire, car ses sourcils s’étaient crispés. « Certaines choses ne méritent pas qu’on les examine », ai-je dit, et les sourcils de l’agent immobilier se relâchèrent. « Où sont les documents ? » ai-je demandé ensuite. « Les voilà », a-t-il dit. « J’aimerais les signer », ai-je dit, et il me les fit glisser sur le bureau avec son majeur. Quel doigt atroce, me souviens-je avoir pensé tout en signant les documents, puis je me suis levé et je suis parti.
Officiellement, il est dit qu’on meurt d’une certaine manière, mais en réalité on meurt à cause de tout autre chose, ai-je pensé tout en quittant l’agence immobilière. Et il est dangereux de considérer comme acquise la nuance entre les deux : ce à cause de quoi on meurt vraiment et la façon dont il est dit qu’on meurt ; c’est à peine s’il y a un rapport. Et à présent je pense que les décès de certaines personnes méritent qu’on les questionne en profondeur. Je suis certain que je pensais à ça aussi quand j’ai quitté l’agence immobilière, mais l’idée n’était sans doute pas aussi claire dans mon esprit. Maintenant je pense : ce n’est pas tous les jours qu’on tombe à point nommé sur une mort aussi remarquable que celle de Fra Keeler. Puis : on doit vraiment s’y mettre, et vraiment réfléchir, pour reconstituer les traces psychiques de la personne décédée (par exemple Fra Keeler), puisque la probabilité pour qu’une mort qui tombe à point nommé demeure officiellement inexpliquée la rend encore plus notable.
Et il est juste que certains événements parmi les plus dé_plaisants sont en train d’apparaître. Je ne peux pas précisément dire lesquels ; je ne peux pas tout à fait mettre le doigt sur l’étendue de leurs répercutions. La vérité, c’est que je ne suis plus le même depuis la mort de Fra Keeler. Certains décès sont plus que des décès, me dis-je, et celui de Fra Keeler était en ce sens exemplaire. Et je pense à la même chose depuis que j’ai quitté l’agence immobilière : certaines morts méritent qu’on les questionne en profondeur, oui, pensai-je, oui : j’ai acheté cette maison justement pour questionner en profondeur la mort de Fra Keeler. Et maintenant que j’en suis le propriétaire, de cette maison que Fra Keeler possédait, je commence à être le témoin de certains événements. Je ne peux pas m’empêcher de penser : il est mort juste à temps, Fra Keeler, il devait être au courant de certaines choses pour mourir ainsi juste au bon moment. Certaines morts ne peuvent être comprises qu’en les mettant en rapport avec les événements dont elles sont issues. Les gens prétendent que ce sont les événements qui mènent à la mort d’une personne qui sont les plus importants. Que la vie accumule les choses vers un but, ce but qu’on atteint au moment de mourir, et que rien d’autre après cela n’est pertinent aux yeux de la vie qu’on a menée. Mais non, me dis-je. Et le mot _non se met à bouger dans mon esprit comme le doigt de l’agent immobilier avait bougé sur son bureau. Les choses se révèlent rétrospectivement, me dis-je encore. Et ce sont ces événements déplaisants qui m’en diront le plus sur la mort de Fra Keeler. Seulement, ils sont constamment en train de se former, ils sont encore en train de se matérialiser. Je commence seulement à mettre le doigt sur eux, aussi directement que l’agent immobilier avait mis son doigt sur les documents quand il les avait faits glisser sur son bureau.
J’apprends que Leïla Slimani, après avoir remporté le Goncourt (accomplissement artistique), « va représenter la France au Conseil permanent de la francophonie » (fierté personnelle). Elle a rendez-vous avec Emmanuel Macron aujourd’hui même, à 15 h. Les écrivains en accord avec le pouvoir en place me questionnent toujours, les écrivains qui travaillent pour le pouvoir n’en parlons pas (Orsenna, bientôt Slimani), idem pour les éditeurs (Nyssen). Je ne pourrais jamais publier chez une maison qui se sent des affinités avec l’ultra-libéralisme économique et le capitalisme. Si je publiais chez Actes Sud, j’aurais honte que mon éditrice côtoie des types comme Gérard Colomb ou Édouard Philippe ou Bruno Le Maire (etc.). J’aurais vraiment sincèrement honte, sans doute même que ça me mettrait en colère, je n’en tirerais aucune fierté. Ah, mon éditrice bras droit d’Emmanuel Macron à la culture, quel progrès, quelle joie. Et, sincèrement, je pense qu’il faut avoir honte d’être édité et de travailler avec des gens pareils. Je pense qu’il faut même l’éviter à tout prix. Quelle joie cette jeune autrice progressiste qui travaille pour Emmanuel Macron, lui-même progressiste à quel point, on le sait à quel point, quelle joie, vraiment, tous ces artistes progressistes qui travaillent main dans la main avec le pouvoir pour ruiner les pauvres, frapper les mendiants sous les ponts et talquer les culs des millionaires, quelle résistance, quel courage. Heureusement que la littérature est là pour dénoncer ce à quoi on s’empresse d’adhérer.
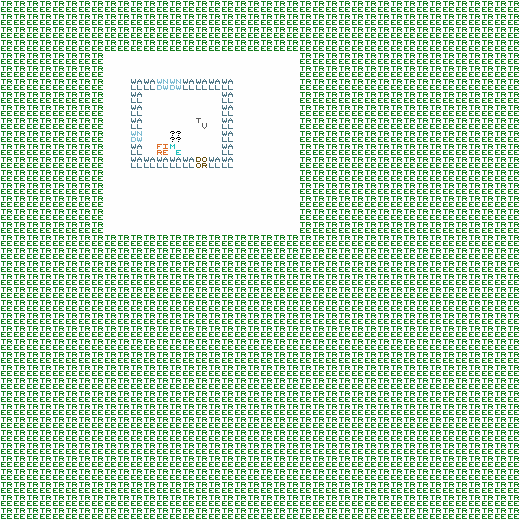
Scene_8/ Depuis que j’ai regardé la cassette, je me sens mal à l’aise. J’ai rallumé le feu, mais j’ai l’impression que quelqu’un ou quelque chose me suit.
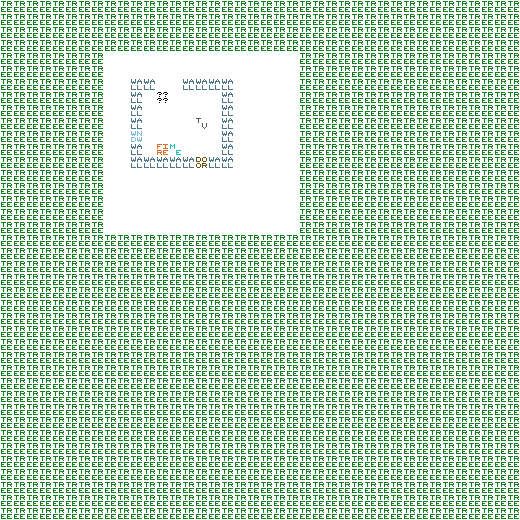
Scene_9/ Une des fenêtres a explosé alors que je regardais le feu. Je ne sais pas ce qui l’a faite exploser. Depuis, il y a comme une béance dans ma maison qui crée de forts courants d’air.
En recherchant des manuscrits pour Benoit et Aurélien dans la littérature américaine contemporaine, je me rends compte (ou plutôt je me rends à l’évidence) que la littérature française que j’aimerais lire aujourd’hui est en réalité la littérature américaine que les américains de mon âge écrivent en ce moment-même.
Par exemple, le travail de quelqu’un comme M Kitchell me frappe par sa proximité. Ce sont des types qui se revendiquent de Beckett, de Robbe-Grillet, de Pinget, qui construisent des architectures impossibles pleines d’interractions morbides et d’interférences électriques. C’est entre l’expérimentation poétique (qui souvent me lasse), et le roman. Des travaux comme CINEMA / TELEVISION / PASSION, c’est exactement ce que j’aime lire, et dans l’idée, par extension, ce que j’aimerais écrire aussi. Comme ce paragraphe :
« I found a machine in one of the rooms of the inner sanctum. There was nothing else in the room so I’m not sure if it existed. I found a box. When I put my palm on en edge the metal screams and I think of sand. The sound of the sand is what comes out of the dying men’s mouths. The image is beautiful and makes me feel. »
Il y a des choses comme ça qui existent dans d’autres langues et que personne ne traduit, que personne même, sans doute, ne connaît. En face, ils sont en train de tout démolir dans l’indifférence générale.
Scene_5/ [Le cauchemar qui est visible sur l’écran de la télévision]
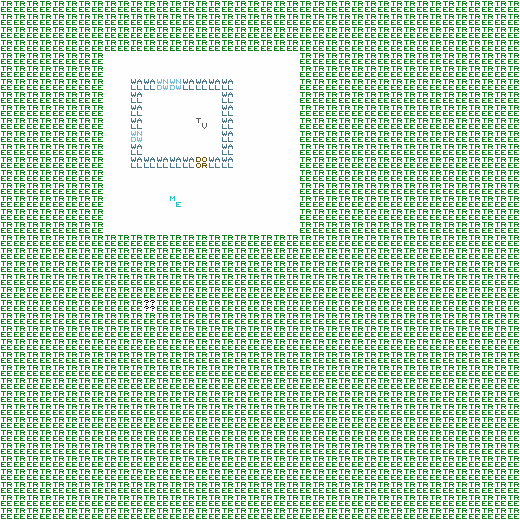
Scene_6/ J’étais vraiment perturbé par ce que je venais de voir à la télévision. Je ne m’attendais pas du tout à ce que cette cassette contienne une telle chose. J’ai cru entendre du bruit dehors alors je suis sorti.
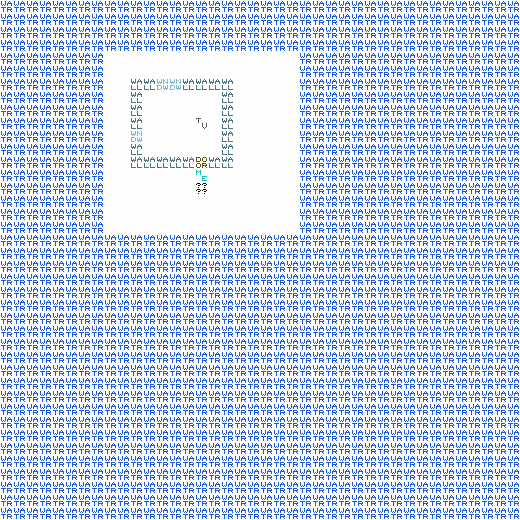
Scene_7/ Sur le pas de ma porte, j’ai cru ressentir une présence dans mon dos, mais quand je me suis retourné, il n’y avait personne. J’ai regardé la forêt. Je me suis dit que parfois, la forêt, on dirait l’océan.
Poetic Computation: Reader « is an online-book by Taeyoon Choi that discusses code as form of poetry and aesthetic while raising ethical questions associated with it ».
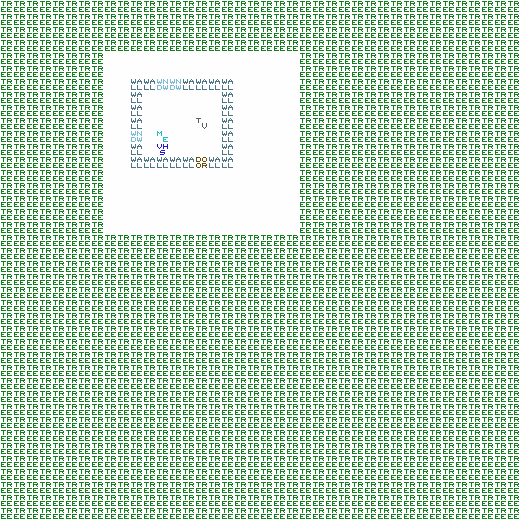
Scene_3/ Quand j’ai quitté la fenêtre, j’ai remarqué que le feu dans la cheminée s’était éteint. Je me suis approché. J’ai remué les braises et j’ai aperçu une cassette vidéo intacte dans l’âtre.

Scene_4/ J’ai allumé la télévision et j’ai inséré la cassette vidéo dans le magnétoscope. Il s’est passé un certain temps avant que quelque chose apparaisse sur l’écran. Puis quelque chose est apparu.
Qu’est-ce que l’image ajoute au texte, ou plutôt : qu’est-ce que l’image (ici faite de mots) ouvre en dehors d’elle-même. La description d’un environnement ou d’un décor comporte à mes yeux deux contraintes principales : soit l’accumulation des détails perd le lecteur, qui ne peut mémoriser et agencer les éléments parfaitement comme on aimerait qu’il les imagine, soit le manque de détails empêche de créer une surface suffisamment solide pour ouvrir des brèches à l’intérieur. L’image a cette efficacité immédiate qui permet de saisir d’un seul mouvement l’ensemble des éléments concernés. Mais cette évidence est le leurre : rien n’est évident. Tout va se fendre.
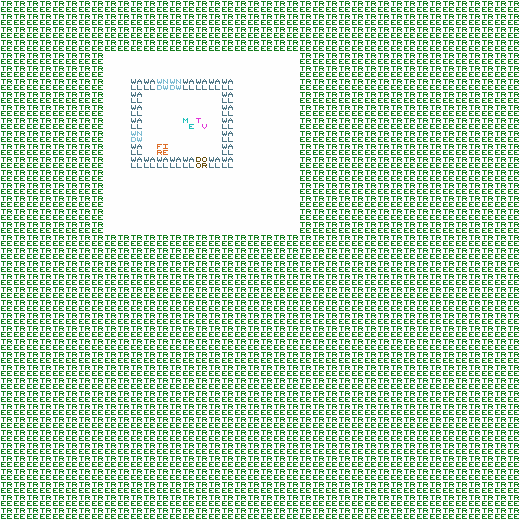
Scene_1/ Je vis dans ma maison au milieu de la forêt. Je regarde la télévision. C’est une petite maison au coeur d’une immense forêt. Il n’y a pas grand-chose dans ma maison. Simplement, je vis seul à l’intérieur.
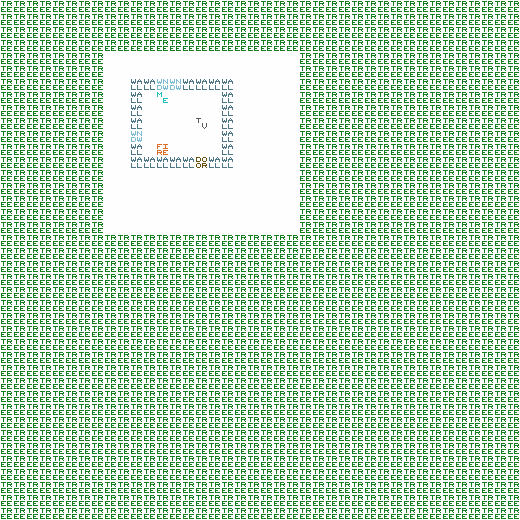
Scene_2/ J’ai éteint la télévision et j’ai regardé les arbres qui bougeaient dehors. J’ai pensé que j’étais seul. Je me suis demandé si quelqu’un d’autre vivait quelque part à côté de la forêt et regardait la télévision. Je me suis demandé si quelqu’un d’autre vivait quelque part ailleurs.
Ces derniers temps, je me suis beaucoup interrogé sur les objets que j’avais à produire, ou plutôt que j’avais l’ambition de produire dans le futur. Est-ce que la voie qui s’annonce pour moi est faite de nouveaux romans qui ressemblent aux anciens, ou tout simplement de romans, juste des romans, est-ce que mon but c’est uniquement de continuer à écrire de nouveaux romans, et tous identiques, tous construits sur le même calque, je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne m’y retrouve pas.
Sinon, j’ai regardé la journal télévisé hier, et j’y ai vu un journaliste être juge plutôt que journaliste.
Après quatre ans sous les mêmes couleurs, j’ai pris la décision de modifier la feuille de style des Relevés. Les choses changent sans changer, mais je sentais qu’il me fallait continuer sur une nouvelle ligne. Je me souviens, en 2012, les Relevés n’avaient aucune feuille de style, et j’aimais bien ça je crois, ce côté désordonné, enfin, bac à sable, mais pas non plus un espace encombré et incompréhensible ; simplement un espace disponible pour tout. En ligne, je me suis toujours très mal entendu avec les contraintes. Plus le lieu demande d’informations, plus il me paralyse. Bref, voilà.
Antoine m’a aidé et m’a montré comment me servir d’un logiciel (PyxelEdit) qui me permet de gérer beaucoup plus facilement mes calques. Voici un nouvel essai, donc. Je me suis dit que comme le début de l’aventure se passe la nuit, il fallait tout de même la représenter à l’image. Le texte sous l’image est accessoire puisque si un livre est publié, le texte sera écrit directement sur le papier (mais dans la même police Courier New). Ensuite je me dis : qui accepterait de publier un livre avec un tel niveau de détail dans les couleurs ? Ça coûterait sans doute infiniment cher à imprimer.
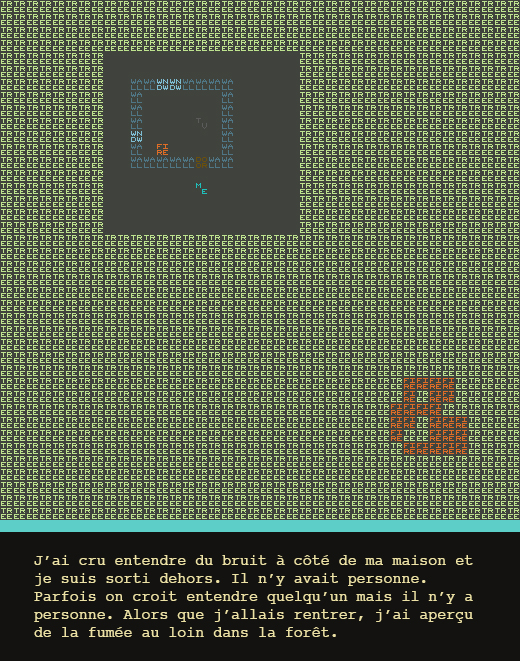
J’ai imaginé un projet (que j’ai nommé HOME pour le moment), qui serait une sorte de roman graphique sans en être un, un truc amusant je pense, facile à lire, et en même temps visuellement évident. J’ai fait un test avec mes propres moyens, donc au moins il y a l’idée en image.
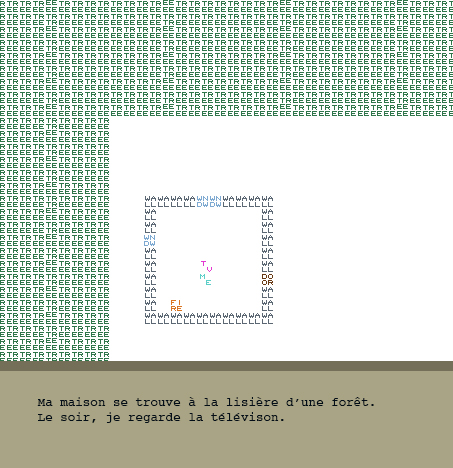
HOME serait l’histoire d’un ME qui habite dans une maison à la lisière d’une forêt (c’est écrit sur l’image), et à qui il arriverait des aventures. Parfois la forêt (composée de TREE) serait incendiée, et alors les TREE seraient remplacés par des FIRE. Je pense que c’est simple. Un étrange individu pourrait aussi faire irruption et on suivrait sa trajectoire grâce à des STRG diposés soit au milieu des TREE soit dans l’espace blanc autour de la maison. S’il est à l’intérieur des WALL, c’est sans doute mauvais signe pour ME. Enfin bref, je pense qu’on saisit vite le principe. C’est un peu laborieux à mettre en place, notamment les forêts, mais sûrement parce que je n’ai pas les bons outils ni les bons automatismes. C’est en tout cas amusant à imaginer. Ça serait une sorte de jeu vidéo sur papier, avec des graphismes étranges et minimalistes. Ça serait aussi pratique visuellement car je pourrais m’amuser à perturber l’image d’une multitude de façons (par exemple, en substituant le fond blanc par un fond transparent, ou soudain rempli de WATR, les possibilités sont infinies). À mon avis, il vaudrait mieux développer ce projet avec un graphiste ou un level designer, sinon j’y passerais mes nuits (pour un résultat laid). Au fond, ce sont seulement des pixels à positionner correctement.
Je suis persuadé qu’il me manque quelque chose pour Rivage au rapport, une mécanique, qui fait que chaque paragraphe indépendamment peut s’écrire facilement, mais que l’ensemble bute sur une poétique qui n’est pas uniforme. Simplement, je n’ai sans doute pas encore trouvé le ton. J’ai écrit Rivage comme un prolongement de La Ville fond, ce qu’il n’est pas du tout (je m’en rends compte à mesure que j’avance). J’ai donc la double contrainte d’oublier le rythme de mon pas tout en en inventant un nouveau, neuf littéralement.
La publication pousse à la précipitation. Il est nécessaire que je retrouve le temps d’ici, d’avant toute ambition, ou plutôt de l’ambition déçue, quand je n’avais que ma pratique régulière comme soutien et remède (en même temps tout et pas grand chose). Se couler dans l’habitude est la meilleure façon de ne jamais progresser, de maintenir sur un niveau neutre ce qu’on sait faire de mieux (car on l’a déjà fait). Revenir aux routines : lire, tester, échouer. Accumuler sur place les diverses façons de voir. À terme : une nouvelle façon de voir. Le livre est une industrie qu’on veut nous faire oublier ; l’industrie à ses codes (prix, réceptions, influences, entregent) ; aller contre ses codes c’est aller contre l’industrie. Vendre 50 livres peut signifier : 1) être un mauvais livre 2) aller contre l’industrie. Il faut trouver la limite entre le mauvais livre et la destruction de l’industrie. Trouver son rythme pour détruire au mieux l’industrie tout en écrivant de bons livres. Un livre de merde est tout disposé à obtenir un prix car il consolide l’industrie. Il ne faut jamais oublier de dynamiter la base, c’est-à-dire : s’en foutre, et cracher sur les jurés (les jurés n’ont aucun goût, ils représentent l’industrie). Pour résumer : émoji bombe émoji immeuble émoji femme qui hausse les épaules.
Être célébré par l’industrie : est-ce une ambition ? Écrire ici : Édouard Louis est un con, c’est une ambition autrement plus satisfaisante (ne pas céder à l’aigreur).
Gravé sur une pierre tombale (la veuve en larmes) : GRAND PRIX DU ROMAN DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE.
« Il est sûr que tout reviendra poussière disait Grani et elle avait raison. Toutes ces paroles consignées tout ça deviendra poussière – ces discussions tous ces pseudo-dialogues toutes ces pensées matinales et nocturnes – tout ça deviendra poussière disparu fini évanoui la vie n’est qu’un torrent d’épines etc. » – Olivier Cadiot, Futur, ancien, fugitif.
Après s’être levé, le fils de la serveuse s’est installé en tailleur sur le carrelage de la cuisine pour regarder la télévision. Le dessin-animé qu’il regardait à la télévision racontait les aventures d’un jeune garçon dans un univers fantastique en images de synthèse. L’aventure était conçue de telle façon que le jeune garçon se trouvait au bas de l’échelle sociale de l’univers en question, et qu’il devait affronter de nombreux ennemis pour échapper à sa condition sociale de jeune garçon pauvre et opprimé. L’environnement dans lequel il vivait était fait d’égoûts sordides et de marécages pollués, mais sa personnalité excentrique lui permettait d’entrer en communion amicale avec d’autres êtres du même univers sordide et pollué, comme un androïde psychopathe ou un chien savant. Chaque ami du jeune garçon avait une vision bien arrêtée sur l’univers en images de synthèse, et un passé terrible qui mettait en relief leur personnalité excentrique. Par exemple, le chien savant avait perdu toute sa famille de chiens savants dans une boucherie exterminatrice à l’encontre de sa race de chiens savants. Cette boucherie exterminatrice avait été le fait de l’androïde psychopathe, mais ni l’androïde ni le chien ne connaissaient les liens horribles qui les unissaient. Cela donnait lieu à quelques situations amusantes lors desquelles les liens amicaux s’exprimaient par-delà les liens barbares enfouis. Le chien savant faisait des remarques savantes à l’androïde qui lui répondait en poussant jusqu’au grotesque des situations de dangers (comme mettre une lâme sous sa gorge de chien). Et le chien savant fixait la caméra façon de dire : tout de même, cet androïde, quel phénomène. Ces trois personnages franchissaient une série d’épreuves et d’aventures qui renforçaient leurs liens et augmentaient leurs compétences de combat. Le chien savant avait de très mauvaises compétences de combat et l’androïde psychopathe en avait de très bonnes. Le jeune garçon apprenait au contact de ses amis à grandir, et chaque épisode était l’occasion d’une morale sur le monde, l’identité et la quête de vivre. Les enfants de la ville aimaient beaucoup ce dessin-animé pour ses environnements hostiles et ses combats récurrents. Parfois, les enfants de la ville se retrouvaient chez l’un ou chez l’autre et faisaient se battre ces trois personnages grâce aux figurines que la société de production du dessin-animé commercialisait. Parfois également, les enfants décapitaient les figurines ou faisaient s’entrechoquer leurs anatomies en plastique avec des figurines provenant d’autres dessins-animés. Parfois les enfants brûlaient les figurines. L’épisode que regardait le fils de la serveuse en mangeant ses céréales sur le carrelage de la cuisine était dramatique car le chien savant mourait. Le jeune garçon et l’androïde psychopathe se mettaient alors en quête de le ressusciter, ce qu’ils parvinrent à faire grâce à une méthode astrale osbcure qui conjuguait magie noire et transmutation humaine. Le chien savant était revenu d’entre les morts, mais possédé par un esprit satanique millénaire, et ainsi s’achevait l’épisode. Le fils de la serveuse n’avait pas remarqué que sa mère était étendue derrière lui.
Par exemple, chaque jour, nous utilisons des outils technologiques construits à partir de matériaux récoltés dans le sang et la mort. Notre avancée technologique actuelle se base sur le sang et la mort d’ouvriers exploités partout dans le monde, notamment dans des pays d’Afrique comme le Congo ou le Soudan et dans des pays d’Asie comme l’Inde. Les experts en nouvelle technologique sont très fiers des nouvelles fonctionnalités de leurs outils technologiques, comme par exemple la durée de la batterie, et l’appareil photo intégré, et le processeur, et toutes ces autres choses comme les circuits électriques que les experts en nouvelle technologie ne prennent même pas le temps de détailler mais qui pourtant sont faits aussi de sang et de mort. La puissance des outils réalisés à partir de sang et de mort fait absolument oublier le sang et la mort qui les composent. Le sang et la mort sont comme les bases alchimiques des choses sublimes, mais cela Baudelaire l’a déjà dit, même s’il ne parlait sans doute ni des téléphones portables ni des ordinateurs. Les experts en technologie refusent tout produit moins performant mais qui aurait l’avantage d’être construit sans sang ni mort, car alors qu’en serait-il des prouesses techniques et technologiques ? Le sang et la mort sont des concepts bien flous face aux vingt-quatre millions de pixels de l’appareil photo ou des seize heures d’autonomie de la batterie. Le sang et la mort sont des concepts bien flous une fois qu’ils ont permis de se faire oublier. Dans les mines le sang et la mort sont omniprésents et les prouesses technologiques ne sont pas du tout présentes. Dans les mines les trous creusés dans la terre sont minuscules, consolidés avec des planches en bois pourries et les minerais sont récoltés à l’aide de pioches elles aussi en bois et souvent rouillées. Dans les mines parfois les ouvriers meurent, par exemple d’asphyxie, ou si la mine s’écroule sur elle-même, ou parfois de maladies en dehors de la mine. N’importe quel outil technologique qui ne contient pas cette horreur et ce désastre lors de sa conception ne vaut pas la peine d’exister car il n’est simplement pas assez performant. Dès que l’humanité a découvert une nouvelle technologie, quand bien même elle ne serait le fruit que de sang, de mort, de désastre et d’horreur, elle refuse de revenir en arrière, de la remettre en question, de se contenter de moins, de moins de performance. L’humanité refuse de revenir sur ses acquis car elle a l’impression de se trancher un bras, car elle a impression de perdre ses libertés, sa liberté surtout fondamentale d’exploiter le sang et la mort et le désastre et l’horreur d’ouvriers qui n’ont pas leur mot à dire là-dessus. L’humanité, bien sûr, ne concerne jamais toute l’humanité, juste une partie de l’humanité, celle qui s’inquiète de savoir combien de millions de pixels aura l’appareil photo intégré à son nouveau téléphone portable. Si on construisait un téléphone portable dont l’appareil photo intégré avait moins de millions de pixels que ce qu’ils ont habituellement, mais avec la garantie que cet appareil photo intégré ait été créé sans sang ni mort, sans doute que l’humanité n’en voudrait pas, sans doute que l’humanité jetterait aussitôt ce téléphone portable à la poubelle, comme elle jette déjà quantité de téléphones portables à la poubelle, alors qu’ils ont été conçus dans le sang et la mort. L’humanité jette à la poubelle une quantité astronomique d’objets conçus dans l’horreur la plus complète, sans aucune considération pour l’horreur et le désastre de ceux qui les ont conçus. L’humanité, dès l’achat de l’outil technologique, oublie. Si bien qu’au moment de le jeter à la poubelle, l’horreur et le sang et la mort et le désastre sont déjà très loin derrière elle. À ce point loin derrière elle que l’humanité est prête dès le lendemain à racheter un nouvel outil technologique, toujours plus performant, toujours plus moderne, innovant, intuitif, repoussant toujours plus loin l’imagination humaine, toujours plus fait de sang, de détresse, d’horreur, de cris, de maladies, de haine et de mort.
« Son histoire avait été réduite à un flou primaire, comme les traces laissées dans l’air par les personnes qui brûlent. » – Dennis Cooper, Frisk.
Je pense avoir développé une addiction à l’ordinateur. Je ne parviens absolument plus à le gérer, y passe un temps fou sans ordre de priorité, ne construis rien, ne fais rien, seulement regarde, passe d’une chose à l’autre, indéfiniment, parfois j’en oublie même de manger, et mes yeux et mon cerveau se pétrifient, je persiste dans la douleur, je m’obstine, je m’obstine à ne rien faire, à avoir mal, à passer d’une chose à l’autre encore, bientôt la journée a passé, je n’ai rien fait, je suis passé d’une chose à l’autre et me suis fait mal, je n’ai avancé sur aucun projet, je n’ai rien écrit, je n’ai rien lu, je n’ai pas gagné d’argent, je n’ai toujours pas de métier, chaque mois je paie mon loyer et mes factures et je m’obstine sur cet écran à passer d’une chose à l’autre, je perds mon temps et tout mon temps y passe, toutes mes forces y passent, ma santé et mes yeux aussi, je suis juste là sans rien à mon bureau, parfois ailleurs, je dis à Cécile : je n’ai rien fait de ce que j’avais prévu, je n’ai rien fait de ma journée, ce qui est la vérité, la vaisselle s’est accumulée, les courses n’ont pas été faites, la poubelle pas descendue, je n’ai rien fait de ma journée, j’ai seulement attendu qu’elle passe, et demain sans doute il en sera de même, pendant des jours ainsi, avant c’était parfois trois ou quatre jours d’affilée, je me disais : c’est mon passe-temps, maintenant je me dis : c’est peut-être une maladie.
Tout à l’heure, je me suis rendu compte que quelque chose n’allait pas. Au début, j’ai pensé que c’était une erreur de ma part. J’avais commencé à écrire sur une découverte faite la semaine dernière. C’était une découverte qui, à mes yeux, avait son importance. J’avais noté quelques éléments importants quant à ma découverte, et je n’avais qu’à les retranscrire ici. Il me fallait du temps pour les mettre en ordre et rendre un sens clair à ce que j’avais trouvé, d’où la semaine nécessaire à ce travail. Mais quand je me suis mis à taper, je me suis rendu compte que ce que je retranscrivais et ce que je tapais n’avaient rien à voir. J’étais persuadé de retranscrire ce que j’avais noté sur des feuilles volantes, mais les choses, les mots, n’avaient aucun rapport entre eux. J’ai cru qu’il s’agissait d’une erreur du logiciel, qui avait changé de langue ou qui ne reconnaissait plus mon clavier. Ça m’était déjà arrivé par le passé, en d’autres circonstances. J’ai vérifié les paramètres, et tout était en ordre. Je me suis dit qu’il s’agissait du logiciel, et en ai donc changé. Mais l’erreur persistait. Tout me poussait à croire que ça n’était rien. Seulement, un événement est venu me contredire.
Terminé Le Roi pâle. Décidement, Wallace est à part.
« De rue en rue, je me promenai avec elle au milieu des débris d’une fête que signalaient des torches en plein midi. Un bruit immense de cris, obéissant à un commandement souterrain, portait d’un seul coup toute la foule tantôt à l’est tantôt à l’ouest. À certains carrefours, la terre tremblait et il semblait que la populace marchât sur le vide, qu’elle franchissait sur une passerelle de vociférations. » – Maurice Blanchot, Le Ressassement éternel.
Par exemple, s’il y a dix ans on m’avait demandé comment j’imaginais ma carrière littéraire, j’aurais sans doute été très loin de ce qui s’est réellement produit. J’ai publié quatre livres en tout, dont deux à visée humoristique dans de grandes maisons et qui resteront comme une tache j’en suis sûr d’ici même pas 10 ans. Le premier a été vendu à 15 000 exemplaires et le second à 1500. J’ai également publié deux romans dans une petite maison dont l’un s’est vendu à environ 250 exemplaires et l’autre est toujours en vente. Les choses auraient sans doute pu en être autrement, ce qu’elles n’ont pas été.
Autres carrières littéraires possibles : 1) aucune carrière littéraire et suicide à 35 ans. 2) aucune carrière littéraire mais grande production dans l’ombre et redécouvert en 2156 par un universitaire. 3) splendide carrière littéraire posthume. 4) carrière littéraire posthume éphémère. 5) aucune carrière littéraire posthume. 6) publication dans une grande maison et aucun succès (200 ventes). 7) publication dans une grande maison et succès mitigé (1500 ventes). 8) publication dans une grande maison et Goncourt dès le premier roman (300 000 ventes). 9) publication dans une grande maison et Goncourt dès le premier roman puis plus rien ensuite. 10) publication dans une grande maison et Nobel de littérature dès le premier roman (1 000 000 d’euros). 11) publication d’un unique roman total considéré comme un chef d’oeuvre mondial et génie à 20 ans. 12) publication d’un unique roman merdique et suicide à 20 ans. 13) publication de trente romans érotiques sous pseudonyme. 14) carrière moyenne d’auteur moyen (ventes correctes, parfois des éclairs de génie, rarement). 15) carrière moyenne d’auteur moyen avec grand attrait pour les festivals littéraires de merde. 16) carrière dans l’ombre jusqu’à 70 ans puis prix Nobel et décès cardiaque suite à l’annonce des résultats. 17) carrière dans l’ombre jusqu’à 70 ans puis prix quelconque d’un festival littéraire de merde quelconque. 18) carrière progressive jusqu’à 35 ans puis succès commercial et jeune millionnaire. 19) rentier. 20) succès commercial immédiat et millionnaire à 20 ans puis mort d’overdose. 21) succès commercial immédiat et idylles avec diverses jeunes femmes médiatiques. 22) carrière modeste mais appréciée par dix fidèles lecteurs. 23) carrière interrompue après amputation des deux mains. 24) carrière interrompue après redirection vers une autre branche professionnelle plus stable (caissier). 25) autoproclamé génie et autopublication. 26) autopublication et suicide dans la foulée. 27) autopublication d’une fanfiction érotique puis milliardaire. 28) enchaînement de prix de merde quelconques décernés dans des festivals littéraires de merde quelconques. 29) romans de merde mais bon réseau donc ventes correctes (3000). 30) romans de merde et aucun réseau donc ventes de merde (250) et rage car autoproclamé génie. 31) aucune reconnaissance littéraire au bout du dizième roman puis attentat à la bombe au CNL. 32) belle reconnaissance littéraire immédiate puis attentat à la bombe par conviction communiste. 33) trente romans qui usent jusqu’à la moëlle les convictions communistes merdiques personnelles qui sont en réalité du libéral-capitalisme. 34) trente romans sur les attentats à la bombe dans le monde. 35) aucun succès dans le pays d’origine mais énorme succès à l’étranger. 36) adopte la nationalité étrangère du pays où les romans se vendent le plus et où les contraintes fiscales sont les plus souples (inexistantes). 37) énorme succès à l’étranger sur une incompréhension des livres à cause de traductions de merde. 38) romans de merde puis personnalité politique locale quelconque. 39) romans moyens mais grosse popularité sur Facebook. 40) figure publique sur Facebook. 41) figure publique sur Facebook puis suicide puis vague d’hommages sur Facebook. 42) figure publique puis suicide puis vague d’hommages à la télévision. 43) carrière dans l’ombre puis retrouvé pourrissant un mois après sa mort. 44) etc.
« C’est quoi cette fumée ? » demanda l’assistant de Rivage à Rivage. Rivage se retourna et vit de la fumée s’élever au loin. Depuis le cap lui et son assistant voyaient les nappes de fumée s’élever dans les airs. L’assistant de Rivage resta au cap pour ranger le matériel tandis que Rivage s’approchait en voiture de l’origine de cette fumée. C’est en arrivant sur place et en voyant la bibliothèque en flammes que Rivage comprit l’origine de la fumée. Instinctivement Rivage se précipita à l’intérieur de la bibliothèque en flammes. Rivage eut un mal fou à avancer à l’intérieur de la bibliothèque tant la fumée et les flammes emplissaient les couloirs et empêchaient d’y voir. Finalement très vite Rivage ressortit car sans doute personne d’encore vivant ne se trouvait à l’intérieur de la bibliothèque, et sans doute lui-même ne serait bientôt plus vivant s’il s’obstinait à avancer à l’intérieur parmi la fumée et les flammes. « Il y a quelqu’un ? » cria Rivage. Personne ne lui répondit. Quelle chaleur, pensa Rivage. Un instant il crut voir un homme ramper sur le sol. Finalement, pensa Rivage, ça ne vaut sans doute pas la peine que je m’aventure dans cet enfer, ça vaut sans doute mieux que je sorte. Dans le jardin de la bibliothèque, les habitants s’étaient regroupés pour observer la bibliothèque en flammes. « On fait un autodafé », dit un des habitants à Rivage alors qu’il arrivait à leur hauteur. « Je vois ça », répondit Rivage. Ce que voyait surtout Rivage, c’était que la bibliothèque était intégralement en proie aux flammes et qu’à côté un groupe d’habitants l’observait. Rivage leur demanda pourquoi. « C’est pour le symbole », répondirent-ils. L’un d’entre eux s’effondra en toussant sur la pelouse. De l’avis de Rivage, cet habitant sur le sol avait vraiment l’air mal en point, enfin il crachait du sang, ce qui aux yeux de Rivage n’était quand même pas signe de bonne santé. De l’avis de Rivage, cet habitant allait y rester. « Il va y rester », dit Rivage aux autres habitants toujours en train d’observer le brasier. « C’est pour le sacrifice », répondirent-ils. Ah, pensa Rivage. Parfois le brasier de la bibliothèque projetait dans les airs des débris de bois et d’autres choses indiscernables comme des résidus de sièges sans doute ou d’ordinateurs que les habitants récupéraient une fois retombés au sol et qu’ils arrangeaient avec précision sur la pelouse de la bibliothèque. D’après Rivage, chaque débris semblait avoir sa place, et les habitants semblaient vouloir écrire quelque chose de précis avec les débris de la bibliothèque réunis sur le sol, de la même façon que les naufragés d’une île déserte tracent sur la plage un message d’alerte du type SOS ou HELP pour être aperçus depuis le ciel ; et ici d’après Rivage les habitants semblaient vouloir écrire quelque chose de semblable dans le jardin avec les débris de la bibliothèque, et sans doute d’ailleurs, pensa Rivage, prévoyaient-ils le passage d’un avion dans le ciel. Rivage leva les yeux vers le ciel et vit un avion bimoteur passer en effet à ce moment précis au-dessus de la bibliothèque. Rivage sortit ses jumelles et s’aperçut que le capitaine de l’avion bimoteur photographiait ce qu’avaient écrit les habitants sur la pelouse avec les débris de la bibliothèque. Rivage s’aperçut que le capitaine de l’avion bimoteur le photographiait lui aussi. Les habitants saluaient l’avion qui passait dans le ciel. Puis l’avion disparut. L’assistant de Rivage le rejoignait à pied depuis le cap et se trouvait sur les hauteurs de la ville quand Rivage l’appela. « Tu peux me dire ce qu’ils ont écrit ? » demanda-t-il. Un immense SAINT PEPSI de débris et de bois calciné était dessiné sur le sol à côté de la bibliothèque en flammes et des habitants satisfaits. Bon, se dit Rivage, il faut vraiment faire quelque chose.
Écrire, c’est toujours être le dupe de notre propre toute-puissance.
Rivage roulait à nouveau en direction du port. « Comment ça trois corps ? Il n’y en avait qu’un tout à l’heure. » On lui expliqua simplement : en plus du premier, ils en avaient repêché deux autres. Quand Rivage arriva sur les lieux, plusieurs habitants étaient regroupés autour des trois cadavres étendus sur la jetée. Une femme enroulée dans un tapis, le mercier (des habitants l’avaient reconnu), et quelqu’un d’autre (personne ne l’avait reconnu). « Ça fait déjà quatre en tout », entendit Rivage en traversant le petit groupe d’habitants. « Quatre ici. Ailleurs, on ne sait pas. » « Que Dieu nous garde. » Déjà quatre morts juste dans cette baie, pensa Rivage. Quatre morts aussi vite, ça n’est pas normal, pensa encore Rivage. Les suppositions de Rivage se confirmaient : le mercier était mort, avait été tué, avait été jeté dans la baie comme ces deux autres corps. Sans doute avait-il été jeté dans la baie. Aux yeux de Rivage, c’était le plus vraisemblable. Le mercier avait su quelque chose. « Décidément, cette baie, c’est un cimetière », entendit encore Rivage derrière lui. « Qui les a repêchés ? » demanda Rivage. Tout le monde se regardait, personne ne savait dire. « C’est la marée qui les a repêchés », entendit Rivage. « C’est la mer qui ramène ses morts sur le rivage. » Un camion de pompier arriva en urgence et transporta les trois corps jusqu’à la morgue. Rivage resta un temps à regarder la mer tandis que les habitants se dispersaient derrière lui. Il n’eut aucune illumination. Il fallait tout recommencer.
Les trois morts étaient étendus sur des tables roulantes. « Alors ? » demanda Rivage au médecin légiste. Le médecin légiste avait dans les mains des fiches médicales qui correspondaient à chaque mort. Là, une autre femme méconnaissable emballée dans un tapis. Là, le mercier (on l’avait reconnu). Et là, on ne sait pas (personne ne l’avait reconnu). « Tiens », remarqua Rivage. Il demanda à son assistant de noter dans son carnet que la nouvelle morte porte une alliance à la main gauche. La morte porte une alliance à la main gauche, nota son assistant. « Comme la femme du mercier », remarqua Rivage. Comme la femme du mercier, nota son assistant. L’employé de la morgue regardait Rivage faire sans rien dire. Rivage récupéra l’alliance sur le doigt de la morte et s’aperçut que la marque laissée par la bague n’était pas profonde, que sans doute la bague n’était pas une bague de mariage, que sans doute il s’agissait d’un cadeau récent, exactement comme pour la femme du mercier, que sans doute ces deux bagues étaient liées, et que sans doute la première morte portait elle aussi une bague à son doigt à l’instant de sa mort, une bague que Rivage n’avait pas remarquée lors de l’autopsie, à laquelle il n’avait pas fait attention. Rivage demanda au médecin légiste s’il pouvait revoir l’autre femme retrouvée dans un tapis. Le médecin légiste s’exécuta. D’abord, Rivage ne vit rien sur les doigts de la première morte, et surtout pas de bague. C’était une évidence : cette morte ne portait pas de bague. Il n’y avait pas de bague, et il n’y avait pas de marque non plus. En somme, sur les doigts de la morte, il n’y avait rien. Il y avait une bague ici, pensa Rivage. Quelqu’un a enlevé la bague du doigt de cette morte après qu’on l’ait repêchée. Rivage regarda l’employé de la morgue sans rien dire. L’employé de la morgue était occupé à annoter les fiches médicales. « La femme du mercier est en danger », conclut Rivage en s’adressant à son assistant. La femme du mercier est en danger, nota-t-il.
Dans la maison du Roi, la professionnelle découvrit à l’étage une porte qui donnait sur une sorte de réduit. Le réduit était plongé dans l’obscurité et il était impossible pour la professionnelle de distinguer ce qui y était rangé. La professionnelle savait que dans le réduit il y avait plus que seulement l’obscurité, elle savait que le Roi s’y cachait, non pas le Roi physiquement, mais quelque chose du Roi, sans doute quelque chose de plus que le seul corps du Roi. Dans l’obscurité du réduit la professionnelle pouvait voir le Roi, et elle le voyait avec une telle précision qu’elle pouvait dire qu’il était là. Par la fenêtre du couloir, la professionnelle vit deux hommes masqués qui patientaient dans la rue. Les deux hommes masqués savaient que la professionnelle avait découvert le réduit à l’étage de la maison, et sans doute attendraient-ils qu’elle redescende pour l’arrêter. Les deux hommes masqués la regardaient et la professionnelle les regardait en retour, et elle regardait aussi du coin de l’oeil le réduit plongé dans l’obscurité. Elle était prise au piège dans la maison du Roi. Dans le réduit qui était une impasse le Roi l’attendait, et dehors dans la rue les deux hommes masqués au service du Roi l’attendaient. Le téléphone de la professionnelle sonna alors et elle vit sur l’écran que Rivage l’appelait. « Il faut faire vite, il n’y a plus personne en ville », lui dit Rivage. « Je veux dire : ils sont tous morts en ville. Il ne reste plus que vous et moi. » La professionnelle regardait les deux hommes masqués dehors. « Il y a deux types qui m’attendent », dit-elle à Rivage. « Oui, je sais, je les vois », répondit-il. Rivage se tenait à l’étage de la maison d’en face et observait la professionnelle et les deux hommes masqués avec des jumelles. Les deux hommes masqués n’étaient pas si loin que ça de Rivage, si bien qu’il les voyait avec une netteté et des détails qui n’étaient sans doute pas nécessaires pour mener à bien sa mission de surveillance. En fait, se dit Rivage, j’y vois moins bien que sans mes jumelles. En fait, remarqua Rivage, je n’y vois rien du tout. « En fait, je ne vois rien du tout », dit-il à la professionnelle. La professionnelle raccrocha puis entra à l’intérieur du réduit. À peine avait-elle mis un pied dans la pièce qu’elle entendit la porte d’entrée de la maison s’ouvrir. La professionnelle referma la porte du réduit derrière elle, et quand les deux hommes masqués montèrent à l’étage et l’ouvrirent, la professionnelle ne s’y trouvait plus.
Appréciez le bon goût lacté subtilement aromatisé d’un yaourt au lait entier, sous sa fine pellicule de crème, m’ordonne ce pot de yaourt.
Sans le mouvement, je n’ai pas de livre. J’ai une histoire, mais pas de livre.
J’éprouve un intérêt croissant pour les environnements dissimulés. Déjà, l’année dernière, j’avais écrit une série de courts textes à propos de certains jeux vidéo qui avaient éveillé très jeune cette obsession en moi. Je crois que ce que j’espère y trouver dépasse complètement les frontières réelles et fictionnelles. Ou plutôt, que l’une permet de me appréhender l’autre. J’ai sincèrement le sentiment que derrière ce qui est construit, produit ou vécu se cache une vérité, qui est sans doute la vérité, et qui ne demande qu’une légère inclination de la pensée ou de l’expérience physique pour être découverte. Peut-être, sans doute, ne demande-t-elle pas qu’une inclination, mais une réelle volonté de découvrir (savoir). Quelque chose de l’au-delà, un détail, un objet, un lieu, peut-être un temple (= parking, chambre), un espace réduit mais qui contiendrait toute la compréhension. Un espace qui obligerait à considérer les univers supérieurs autrement pour être découvert. Un espace uniquement perceptible par une avancée volontaire au travers de codes et de dédales imprévisibles. C’est-à-dire, une complète ré-appropriation de l’espace sans norme et sans contrainte. C’est-à-dire, par exemple, emprunter un nombre de portes, d’escaliers, de couloirs et de rues incroyable, et ce sans ordre pré-établi, sinon avec comme boussole la seule intuition d’avancer. Au terme de ce chemin qui serait propre à chacun (personne ne pourrait accéder au terme du chemin par le même itinéraire) s’ouvrirait une nouvelle connaissance des choses. Reproduire ce mouvement dans des mondes plus réduits (romans, films, jeux vidéo) aide à mon sens grandement à dompter le gigantesque labyrinthe qu’est notre réalité (et là, vous m’aurez compris, il ne faut pas atteindre le centre du labyrinthe, mais marcher sur le haut de ses murs).
Je me souviens, je crois que c’était dans la version Perle de Pokémon, ou Argent (en réalité : Heart Gold ou Soul Silver, donc il n’y a pas si longtemps). Dans le Bois au Chêne, il y a un autel, dont on ne nous dit rien dans l’intrigue du jeu, qui est perdu en pleine forêt, et avec lequel il est impossible d’interragir. D’après mes souvenirs, on ne peut même pas tourner autour. Cet autel est là, sans aucun PNJ à proximité, complètement perdu, complètement inutile. Pendant longtemps, je me disais : j’espère que cet autel mène quelque part. Je me disais : il faut que je trouve la porte qui débloque la fonction de cet autel. Mais cet autel ne menait nulle part, ou plutôt à rien de convaincant (seulement un événement spécial inutile débloquable grâce à un pass Nintendo). Cet autel trônait là, dans le vide d’une région virtuelle inutile, et il ne donnait accès à aucun autre espace. Il me rappelait le camion de Carmin-sur-Mer. Dans ces détails réside l’opportunité de découvrir autre chose ; il faudrait faire de cette opportunité un guide pour traverser le rempart du visible.
Ce que je veux provoquer, c’est un effet d’accumulation. Alors c’est simple : dès le départ, il faut accumuler.
« Supposons que la pièce où vous êtes en train de lire ceci ressemble aux vestibules qui entrelacent mon récit. En d’autres termes, elle est flanquée d’une pièce secrète ou d’un passage. Supposons également, par commodité, que cette pièce secrète est reliée au mur face auquel vous vous trouvez en ce moment. » – Dennis Cooper, Le Fol Marbre.
Un mois plus tard, je vous le donne en mille : ma fille vient me voir en prison. J’étais déjà tatoué sur le torse et les bras alors elle m’a pris pour un bandit. Je lui ai dit : mais je suis toujours ton père, et elle a détourné les yeux et a fondu en larmes. Ensuite elle m’a demandé de lui prêter de l’argent parce qu’elle avait fait faillite. Elle avait investi ses trois milliards et quelques dans une entreprise bidon qui vendait des godes rotatifs. Évidemment c’était une arnaque elle a jamais rien touché sur son investissement et les types se sont barrés aux Canaris avec les trois millards et quelques. Depuis on me l’a dit les types glandent sur des yachts et se tapent des putes. Je sais pas pourquoi ma fille avait fait ça et elle non plus savait pas elle faisait que pleurer dans le parloir de la prison j’avais la honte. Je lui ai dit : et pourquoi tu lancerais pas ta propre entreprise de godes rotatifs ? C’est ce qu’elle a fait et depuis elle est encore plus riche qu’avant tellement son entreprise de godes rotatifs marche bien. Je suis bien content pour elle, je vous le dis franchement. À onze ans c’est quand même une sacrée trajectoire de vie. Ses copines elles entrent en sixième donc ça vous place d’emblée l’écart intellectuel. Quand je fais mes tractions dans ma cellule je pense à ma fille et je chiale parce que ça me donne la force de m’en sortir. Un autre gars de la cellule est venu me voir une fois pendant que je faisais mes tractions et il m’a dit : pourquoi tu chiales ? Et je lui ai dit que c’était parce que je pensais à ma fille et il m’a dit : putain c’est beau d’être père et je lui ai dit ouais et on s’est regardé avec émotion et le gars de la cellule a fondu en larmes et on s’est fait une accolade fraternelle pour se consoler. La prison c’est dur, heureusement que y a les autres gars de la cellule pour se soutenir. Des fois à la télévision on regarde des feuilletons comme Docteur Queen femme médecin. Cette fois-ci, après notre feuilleton, on entend que les gars se battent au rez-de-chaussée. On passe la tête par les barreaux de la cellule et là on voit tous les gars courir dans tous les sens comme si y avait plus de cellules ni de gardes. On gueule aux gars du rez-de-chaussée : eh les gars qu’est-ce qui se passe ? Et les gars nous répondent : y a plus de gardes on peut se barrer ! Et là on remarque que notre cellule était ouverte. Pendant que d’autres gars foutent le bordel dans la prison nous on court jusque dans le jardin derrière la prison. On grimpe par dessus le grillage et on se retrouve dans la rivière. Deux types avec moi savent pas nager et se noient alors qu’ils ont pied. Avec les autres gars on se marre même si c’est triste puis on continue à nager dans la rivière jusqu’à retourner en ville. Là y a un type qui tient une boutique de jeux vidéo qui nous dit : eh venez dans ma boutique ! On le rejoint à l’intérieur et on joue un peu à la console avant que les policiers se pointent. Heureusement c’est aussi des amateurs de jeux vidéo alors on joue tous à la console entre policiers et prisonniers et au bout du compte on les défonce complètement, vraiment on les éclate, à la console je veux dire. Les policiers nous disent : vous êtes de sacrés compétiteurs les gars, ça vous dirait de participer à la compétition nationale de ce weekend ? Nous évidemment on dit oui et on s’entraîne jusqu’au weekend à la console. On sort même plus de la boutique, c’est le type qui tient le commerce qui va nous chercher à manger et à boire. Une fois à la compétition on se met en place avec les gars et une par une on défonce toutes les autres équipes jusqu’à la grande finale. Pendant la grande finale c’est les fleuristes nos adversaires. Ni une ni deux on les éclate et on prend la coupe et les quatre millions d’euros qu’on se partage équitablement. Avec les gars on se fait une accolade fraternelle tellement on est émus d’avoir défoncé tout le monde à la console et de repartir avec un million chacun. De quoi se refaire une vie, dit l’un d’entre nous. Et moi je lui dis : oui, on l’a bien mérité. C’est une belle expérience de vie. Quand je repense à moi champion de jeu vidéo et à ma fille entrepreneuse dans le business du gode rotatif, je me dis que parfois on a juste à se donner les moyens pour réussir, que ça ne tient qu’à nous. Alors que je me dis ça, des bandits déguisés en Jacques Chirac entrent dans la salle des fêtes où se tient la compétition et commencent à réclamer les quatre millions qu’on vient de gagner avec les gars. Avec les gars on se regarde et on se dit : hors de question de rendre les quatre millions, donc on se met à tabasser les bandits déguisés en Jacques Chirac et comme on est des prisonniers et qu’on s’est bien musclés en faisant nos tractions chaque jour on les éclate en moins de temps qu’il en faut pour le dire, et là on les éclate physiquement je veux dire, pas à la console, vraiment on leur met la branlée du siècle d’un point de vue physique et viril et pas du tout virtuel. Là les policiers qui étaient toujours dans la salle des fêtes mais qui s’étaient fait éclater au premier tour de la compétition de jeux vidéo remarquent qu’on est pas des joueurs normaux mais plutôt des prisonniers, et ils nous passent les menottes et ils récupèrent les quatre millions d’euros tout en se marrant. Moi je me dis : c’est pas possible, ça peut pas finir comme ça, mais faut croire que si.
« Ils essaient de me filer un matelas humide pour que je dorme dans un coin sombre alors que la seule chose dont j’ai envie, c’est de l’odeur grossière d’un type, ses aisselles velues et son entrejambe sur lequel plonger. J’émettrai des sons gutturaux et je cesserai de manger et de boire et d’ici la fin de l’année je serai mort. Mes yeux ont toujours fait la publicité d’une mort précoce. » – David Wojnarowicz, Chroniques des quais.
Je vais vous raconter : l’autre jour, je marchais dans la rue, quand soudain, un type qui arrive en face de moi s’arrête à ma hauteur et me reconnaît. Je peux vous dire que j’étais fier : un admirateur ! Le premier ! Il me dit à quel point il aime mon travail etc., puis il me demande de lui signer un autographe sur le dos d’un ticket de caisse qu’il avait dans la poche ; je le fais. Le type me dit merci puis se barre sans récupérer le stylo qu’il m’avait prêté. Trois semaines plus tard, je découvre sur internet que le type de l’autre jour vendait le ticket de caisse en faisant passer ma dédicace pour celle d’un chanteur célèbre, le plus célèbre chanteur du pays. J’étais fou de rage. J’achète le ticket de caisse avec ma signature pour une somme incroyable. Depuis, à la télévision, je vois des sujets qui parlent de mon achat, comme quoi j’aurais acheté la dernière relique du plus célèbre des chanteurs de mon pays. Je me dis : c’est fou quand même, vu que c’est ma signature, et que je ne suis pas le chanteur le plus célèbre de mon pays, je ne suis même pas chanteur du tout. Des journalistes sont venus chez moi pour m’interroger, ils veulent savoir depuis quand j’entretiens une passion pour le chanteur le plus célèbre du pays et pourquoi j’ai tenu à débourser une telle somme pour son autographe. Je leur explique qu’il s’agit d’un quiproquo mais véritablement ils s’en foutent parce qu’ils sont journalistes et pas inspecteurs. Les journalistes c’est pas des lumières mais j’ai bien conscience que c’est pas une révélation que je vous fais. Après, je me dis que si le ticket de caisse est aussi rare que ça, j’ai qu’à le revendre une somme encore plus folle que celle que j’ai déboursée pour l’acheter. Donc je remets le ticket de caisse sur internet le triple du prix d’origine, pas loin d’un million d’euros. Et personne n’en veut ! Dans les commentaires, on me traite même de charlatan ! Comme quoi ça serait une copie, que personne d’à peu près sain d’esprit ne revendrait le dernier ticket de caisse possédé par le chanteur le plus célèbre du pays. Je baisse le prix, mais ça ne change rien. Bientôt je suis prêt à le vendre pour une somme symbolique mais toujours personne n’en veut. Dans les commentaires, on me traite de connard. Je réfléchis et je me dis : oui, sans doute, pour vendre sa propre signature un million d’euros, bon, mais ils ne sont pas censés le savoir. Dans les commentaires, je réponds : c’est vous les connards ! Évidemment, ça n’arrange pas les ventes, et en plus je me fais bannir du site internet. Quelle histoire. Je suis tellement en colère contre ce ticket de caisse que je m’apprête à le déchirer en morceaux et à le jeter au feu. À peine ai-je commencé à le déchirer que je vois ma fille de onze ans avec son téléphone dans les mains en train de me filmer moi en train de déchirer le ticket de caisse. Ma fille poste aussitôt sa vidéo sur internet et la titre : mon père déchire la dernière relique du plus célèbre chanteur du pays ! Je n’en reviens pas, la vidéo fait douze millions de vues. Ma fille génère tellement de revenus grâce à sa vidéo que bientôt elle est plus riche que moi et qu’elle quitte la maison (sa mère est d’accord). Je deviens une espèce de bête de foire et des inconnus viennent me filmer dans ma maison avec leurs téléphones. Chacune de leur vidéo fait pas loin de cinq millions de vues. Moi, pendant ce temps, évidemment, je touche pas un rond. Peu après, je remarque que ma femme aussi laisse des commentaires sous les vidéos pour me traiter de connard. Son pseudonyme est composé de son nom et de son prénom, c’est pour ça que je la reconnais rapidement. Je lui demande des comptes mais elle nie qu’il s’agit d’elle. Elle me dit : il y a d’autres femmes qui portent le même nom que moi. Je lui dis : prends moi pour un con, puis elle fait ses valises et part vivre chez ma fille désormais milliardaire et troisième plus grande fortune du pays. L’entreprise de ma fille capitalise un maximum sur la haine que les gens ont contre moi, c’est très intelligent, je la reconnais bien là, elle a toujours été en avance pour son âge. Après cela, comme je ne veux pas me laisser abattre, je me dis que peut-être je pourrais revendre le ticket de caisse au marché noir. Je donne rendez-vous sous un pont autoroutier à un marchand d’armes peu commode. Ça se voit qu’il est peu commode étant donné qu’il a toujours une arme braquée sur moi pendant que je lui parle. Je lui montre le ticket de caisse et comme il est très tard et qu’on y voit rien du tout sous le pont autoroutier, le marchand d’armes semble tomber dans mon piège, et je me réjouis par avance de lui revendre ce ticket de caisse trois fois le prix de l’achat. Le marchand d’armes ouvre une valise pleine de liasses de billets et me la tend tout en rangeant le ticket de caisse dans une ses poches. C’est à ce moment-là que les policiers débarquent de partout avec leurs lampes et me placent en état d’arrestation ; évidemment le marchand d’armes était aussi un policier, et il se marre bien en me mettant les menottes. Moi aussi je me marre, et je me dis : quelle vie je mène, quelle vie.
Tout à l’heure, avec Fabien, on parlait de tous ces livres publiés ces temps-ci par des auteurs de notre âge et qui s’apparentent à du pseudo-Jean-Philippe Toussaint, d’où l’appelation générique que nous avons inventé pour les qualifier : “sous-Toussaint”. Le sous-Toussaint est un genre à part entière dans la littérature contemporaine. Le roman sous-Toussaint est un roman qui doit être malin en toute circonstance, un peu primesautier également, léger mais pourvu d’un regard pertinent sur le monde. Le roman sous-Toussaint favorisera évidemment l’utilisation de parenthèses ironiques et décalées, pour souligner aussi bien l’intelligence subtile de son propos que la distance éprouvée par le narrateur dans son environnement. Le sous-Toussaint est souvent drôle mais pas burlesque (le sous Toussaint n’est pas là pour déconner). Le sous-Toussaint est parisien mais cosmopolite, et a pensé voter à gauche en votant Emmanuel Macron. Ce qui fait du sous-Toussaint un globetrotter alerte et sensible. Le sous-Toussaint apprécie particulièrement les autres romans écrits eux aussi en sous-Toussaint. Le sous-Toussaint apprécie également particulièrement être adoubé par le Jean-Philippe Toussaint originel. C’est comme si Jean-Philippe Toussaint prenait plaisir à contempler le travail de tous ses doubles moins bons, et qu’il s’amusait à vivre au milieu des sous-Toussaint, comme une sorte de pape ou d’apôtre, ou les deux, car Jean-Philippe Toussaint est capable de tout.
C’était quand même beaucoup plus facile pour La Ville fond. Je me demande pourquoi ça ne peut pas toujours être aussi facile. Il faudrait que je puisse faire en sorte que ce soit facile. C’est très complexe que de rendre le difficile facile, c’est presque le plus dur, je trouve. Je ne travaille bien qu’en éprouvant de la facilité ; la difficulté me rebute, même elle m’ennuie. Je n’éprouve aucun plaisir à ne pas y arriver. Alors je me demande toujours : comment m’arranger pour rendre tout cela plus facile. Plus facile, c’est mieux, sans aucun doute. Faire plus facile, c’est dans tous les cas moins se prendre la tête. Je ne fais pas de bons livres en me prenant la tête. C’est compliqué de créer. Parfois on préfèrerait faire autre chose. Tout un tas de choses beaucoup plus faciles à faire que créer. Éplucher des légumes est beaucoup plus facile que créer (c’est un exemple). Si on épluche ses légumes n’importe comment ça peut devenir extrêmement difficile, sans doute plus difficile même que créer. Éplucher ses légumes avec une chaise par exemple c’est beaucoup plus difficile que créer, mais ça doit être évident pour tout le monde, je pense, c’est d’ailleurs pour cela que personne n’épluche ses légumes avec une chaise ; et aussi pour cela que personne ne crée à part deux trois cons éparpillés par-ci par-là sur la planète et persuadés de leur génie. Bien sûr, il ne faudra jamais dire publiquement qu’il a été facile d’écrire mes livres, sinon, qu’est-ce qu’on penserait de moi. Vous imaginez, publiquement, on me prendrait pour un nul. En ce moment, je suis en train d’élaborer un discours parfaitement rodé dans lequel je détaille à quel point j’en ai chié comme jamais pour écrire La Ville fond. Quand on en chie, ça impressionne toujours, et les gens après se disent entre eux : quand même, qu’est-ce qu’il en a chié ! et tout de suite ça donne beaucoup plus de poids à votre livre, c’est incroyable. C’est incroyable comme les gens sont cons. Quand on en chie, les gens ça les impressionne terriblement. À croire qu’ils aiment nous voir en chier. Clairement, je ne me reconnais pas du tout dans cette philosophie de la galère. Mais je vais faire un effort publiquement, car c’est publiquement que tout se joue, et c’est publiquement qu’il faut montrer à quel point on en a chié. Je pense me couper une jambe pour montrer à quel point j’en ai chié. Je dirai que c’est à cause du livre, je ne détaillerai pas vraiment pourquoi, ça créera un mystère qui est propice à la vente et à la construction d’une identité complexe d’auteur (la mienne). Dire publiquement qu’on en chie, c’est avant tout savoir se vendre. Quand on ne sait pas se vendre, c’est bien simple, on ne vend pas de livres non plus. Personne ne nous aime, et on est pauvre. Avec une jambe en moins, pour sûr, j’en chierai vraiment, mais les gens m’aimeront, et je serai riche. Je pourrai me faire greffer une prothèse en aluminium et profiter des retombées financières de mon stratagème. C’est tout un projet, ça demande beaucoup de travail, vous pouvez me croire, c’est sincèrement difficile.
(Sinon, toute la presse littéraire semble se foutre de mon livre comme de l’an 3000. C’est un secret que je vous confie : la plupart du temps, on écrit des livres pour personne.)
« Je ne faisais que regarder. Pendant que sa mère lui apprenait à couvrir de maquillage les plaies et les bleus dont son père avait constellé son minuscule minois. Ça va être rigolo, lui disait-elle pour lui changer les idées et lui faire oublier le désastre. On va se déguiser. » – Peter Sotos, Au fait.
Ces derniers temps, aux alentours de minuit (véridique), depuis notre chambre à Cécile et à moi, nous entendons un téléphone sonner. Nous ne savons pas s’il provient de l’immeuble d’à côté (les immeubles sont mitoyens), de l’appartement du dessous où vit la vieille dame, où de l’autre appartement du palier (à l’exact opposé de notre chambre). Le téléphone sonne une fois intégralement, jusqu’au bout de la sonnerie. La sonnerie est une sonnerie classique que Cécile et moi avons déjà entendue ailleurs. Le téléphone sonne peut-être une dizaine de fois avant de s’arrêter. Jamais personne ne répond, ni ne semble vouloir répondre (aucun bruit).
Lecture du dernier Toussaint. Quand même parfois l’impression d’une grande paresse dans le propos et dans la forme ; enfin, j’attendais plus de Toussaint et en même temps incapable de mettre le doigt sur quoi précisément. Il y a beaucoup moins d’intelligence dans son utilisation des parenthèses, si bien que Toussaint fait comme qui dirait du sous-Toussaint, il fait du Toussaint moins bien que lui-même, presque du pastiche, c’est assez notable comme infléchissement, de finir par faire du sous-soi-même. Mais ce n’est finalement pas si rare.
J’ai également été voir mother!, dont j’ai aimé à peu près tout sauf l’introduction et la résolution. À peu près tout excepté également certains choix esthétiques et thématiques que je trouve mauvais : fondus au blanc lumineux, effets spéciaux à la limite du kitsch, symbolique christique pompeuse, etc. Le premier plan est complètement contre-productif quant à la tension que le film cherche à développer sur la longueur. Pour revenir sur les effets spéciaux : souvent, ils servent moins à repousser les limites de l’imaginaire qu’à illustrer à quel point ils ne sont rien d’autre que de pauvres effets spéciaux inintéressants. Le film aurait été très bon si ses fondations n’avaient été pourries dès le départ. La sensation finale ressemble sensiblement à celle qu’on ressentirait si un acrobate faisait la plus belle figure jamais vue pour finalement s’écraser sur le sol (avant qu’un vandale arrive pour le tabasser de coups de pieds). Pour conclure, je dirais que son film aurait été meilleur s’il n’avait pas voulu à ce point traiter son sujet.
Je pars toujours du principe que la scène vaut plus que sa signification.
De manière générale, un conseil que je pourrais vous donner, c’est de boire de l’eau. Ça me paraît absolument essentiel.
« Il suffit de se mettre à écrire pour se rendre compte que le monde entier est en travaux. » – Jean-Philippe Toussaint, Made in China.
En 2015, je disais que cette phrase de Guillaume me semblait importante : La vue sur la ville est superbe (mais la ville est fictive). Je crois qu’inconsciemment elle a si bien fait son chemin qu’au bout du compte il y a eu La Ville fond.
La vieille dame du dessous écoute vraiment la télévision trop fort.
Il se trouve de plus en plus souvent que dans les romans les néons soient blafards. Ensuite, je ne peux plus m’empêcher de trouver que dans la réalité ils le sont aussi.
Par exemple, maintenant, quelqu’un est tué, probablement une femme, d’après les statistiques c’est sans doute une femme. Cette femme on l’aura tabassée puis tuée, ce sont les statistiques qui le disent. C’est très difficile de se rendre compte quand on est là tranquillement dans son salon ou dans ses toilettes et qu’une femme meurt exactement au même instant, c’est une expérience étrange et horrible en même temps, et pourtant on n’y voit rien, on n’y peut rien, on est juste assis là sur ses toilettes, au fond, on ne fait rien de spécial. En même temps que vous sur vos toilettes et la femme tabassée puis tuée, il y a sans doute également un enfant qui est violé, et un piéton qui est écrasé, statistiquement c’est jouable, je pense même que c’est fort probable, voire réaliste, alors que vous êtes juste là vous dans vos toilettes, sans doute en train de lire ou de compléter une grille de sudoku. Et en même temps, que pouvez-vous faire, tandis qu’à toute cette horreur s’ajoute encore dans le même instant l’extinction de trois espèces animales, au fond qu’y puis-je, moi sur mes toilettes, et la grille de sudoku tombe sans doute alors au fond de la cuvette tant le désespoir vous habite soudain, qu’y puis-je, et vous vous levez, le pantalon sur les chevilles, le stylo encore dans la main, comment puis-je sauver cette femme et cet enfant et ce piéton et ces animaux, et vous n’en savez rien, et sans doute que vous n’y pouvez rien, à moins que vous ne possédiez un quelconque pouvoir d’ubiquité, et dans ce cas-là il faut immédiatement vous manifester, le monde n’attend que vous. Vous remontez votre pantalon et vous vous précipitez au dehors sans même tirer la chasse d’eau (certaines choses peuvent attendre), vous courez dans les rues de votre ville, vous criez à l’aide, vous cherchez la femme tuée, et l’enfant violé, et le piéton écrasé, et les animaux exterminés, mais vous ne trouvez rien ni personne, vous ne savez pas où chercher ; les passants vous regardent comme si vous étiez fou. Vous savez pourtant qu’ils sont morts et qu’ils sont là quelque part, et que les crimes sans doute sont impunis, mais vous êtes incapable de rien sinon de vous agenouiller sur le sol et de pleurer en silence. Après avoir erré dans la ville, vous rentrez chez vous et vous vous décidez enfin à tirer la chasse ; au moins trente personnes encore sont mortes durant ce laps de temps ; vous retenez une envie de vomir. Le soir, sans envie, vous mangez quelque chose devant la télévision. Il y a une émission de divertissement dans laquelle les gens chantent et parfois vous vous surprenez à connaître des refrains. Les candidats gagnent un peu d’argent, de quoi partir en voyage, disent-ils. Une femme fond en larmes après avoir remporté la finale. Le lendemain, toute l’horreur est déjà oubliée.
« Je vais devenir un souvenir dans ma mémoire, comme le paysan coincé au fond de son puits, qui voit au loin un rond du ciel et devine les bustes penchés des voisins qui, eux, ne voient déjà plus que du noir. » – Mika Biermann, Palais à volonté.
Je vais vous dire : une fois, j’ai travaillé dans un abattoir, deux jours à peu près. Quand je suis sorti de l’abattoir après le deuxième jour, je me suis dit : je vais écrire un livre sur l’abattoir. En deux jours, j’avais tout compris de l’abattoir et de ses ouvriers. Je pouvais écrire un livre total sur l’abattoir et ses ouvriers car en deux jours j’avais tout compris. C’est comme ça, souvent, pour les choses, il faut à peine plus de deux jours et on finit par tout comprendre, c’est génial. On peut écrire tout et n’importe quoi sur n’importe quel sujet dès qu’on a passé deux jours quelque part, c’est la beauté de la chose. La plupart des livres qui sont publiés actuellement procèdent d’une expérience de deux jours dans un lieu, les abattoirs par exemple. Autres lieux possibles : Pôle Emploi, les hôpitaux, les prisons, les entreprises en faillite. Il y a d’autres exemples mais je ne veux pas dévoiler tous mes filons ; je ne voudrais pas qu’on marche sur mes plates-bandes. Les abattoirs c’est pratique parce qu’il suffit de s’inscrire dans une agence d’intérim quelconque et deux jours plus tard on a toute la matière pour notre livre. Les prisons c’est plus chiant, en plus les détenus sont violents. Et puis les abattoirs c’est à la mode à cause des animaux maltraités. Avec les ouvriers maltraités, ça fait beaucoup de social, donc c’est vraiment à la mode et bien vu. Après bien sûr c’est éprouvant, deux jours quand même ce n’est pas rien, tout le monde ne pourrait pas. Deux jours, entre nous, il faut tenir. Entre les animaux maltraités et les ouvriers maltraités, il faut tenir. Et puis il faut se lever au beau milieu de la nuit, et on est complètement crevés après la journée de travail, on est obligé de faire une sieste. Tout le monde pourrait pas faire une sieste après sa journée de travail, souvent on a perdu l’habitude. Je devrais écrire un livre sur la sieste, à mon avis j’ai la compétence pour le faire. En deux jours de sieste j’ai fait le tour de la question de la sieste. Mais ça manque de social. Je ne vais pas non plus écrire sur n’importe quoi. À quoi est-ce que je pensais. Ça manque d’ouvriers et d’animaux maltraités. La sieste c’est un sujet à peine bon pour les amateurs, pour ceux qui n’ont pas le courage de passer deux jours dans un abattoir, les bons à rien, ceux qui n’osent pas prendre leur sujet à bras-le-corps, enfin bref, ceux qui ne font pas de littérature.
Je voulais vous dire aussi : ça y est, La Ville fond est disponible en librairie. Si votre libraire n’en a pas fait un coup de coeur, songez à l’assassiner (après l’avoir forcé à en faire un coup de coeur).
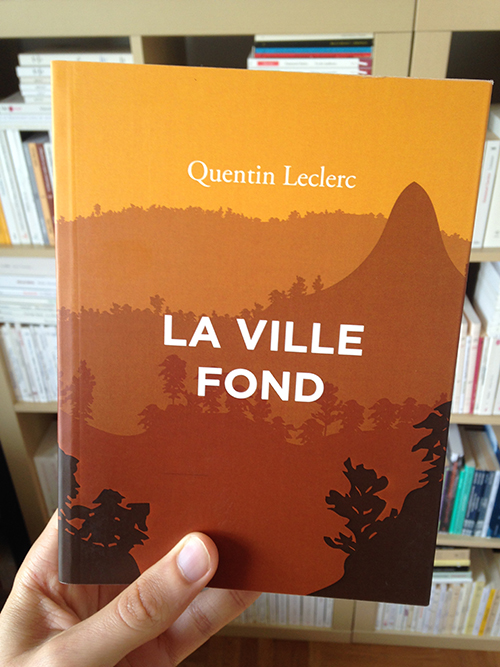
« Mon esprit incrédule erre dans un pays inconnu où les habitants portent des chapeaux bizarres. On n’ose pas leur demander le chemin de la gare. » – Mika Biermann, Sangs.

Par exemple, depuis l’élection d’Emmanuel Macron, je ne me suis pas du tout intéressé à la politique du pays. Sans doute que les vacances empêchent en grande partie de s’intéresser à la politique du pays, et c’est quelque chose qu’Emmanuel Macron a très bien compris. Non pas qu’Emmanuel Macron s’en soit pris particulièrement à mes vacances parce que je ne m’intéressais pas à la politique de notre pays (ça aurait été injuste), mais il s’est dit que ça serait sans doute une bonne idée que de profiter du désintéressement des citoyens lié aux vacances pour mettre en oeuvre tout un tas de réformes sociales toutes plus dégueulasses les unes que les autres. C’est fou de profiter d’un aussi beau moment pour les citoyens que les vacances d’été pour mettre en oeuvre des réformes sociales dégueulasses. C’est vraiment chercher à enfoncer notre glace à peine entâmé dans le sable. C’est vraiment sensiblement la même chose que d’enfoncer une glace tout juste achetée dans le sable et de mettre en oeuvre des réformes sociales dégueulasses. Il n’y a qu’un pas de la glace aux réformes sociales. Il faut vraiment ne pas aimer les vacances pour niquer à ce point l’ambiance. Il faut vraiment n’en avoir rien à foutre de rien pour profiter que les gens soient à barboter dans l’eau pour leur supprimer tous leurs droits sociaux et les mettre dans la misère. Je suis dégoûté autant que si on venait d’enfoncer ma glace tout juste achetée dans le sable, ce qui heureusement ne s’est pas produit (ça aurait été trop à supporter). Vraiment, c’est le genre de choses que seuls les tyrans font : enfoncer les glaces dans le sable, réduire à néant les acquis sociaux. Je suis vraiment très remonté car je déteste qu’on gâche les glaces et qu’on réduise à néant les acquis sociaux. Et je n’avais rien vu venir car j’étais trop occupé à profiter de mes vacances, comme tout le monde. On rentre des vacances après des heures de route et on remarque que quelqu’un a chié dans notre lit, et ce quelqu’un c’est Emmanuel Macron en personne. C’est incroyable ce président qui chie dans notre lit, se dit-on. Mais dans quel pays vit-on sérieusement, se dit-on ensuite en contemplant la merde dans notre lit. On ne peut plus partir en vacances sans risquer que le président de la République vienne chier dans notre lit. C’est une triste époque, et pourtant sans doute la meilleure époque que la civilisation humaine ait jamais connue. Sans doute qu’au Moyen-Âge on chiait dans votre lit mais en plus vous n’aviez ni vacances ni glaces, on chiait dans votre lit devant vous alors que vous labouriez votre champ, et en plus on maltraitait votre femme et on tabassait vos enfants. Mais je vais vous dire : ce n’est pas une raison pour laisser Emmanuel Macron nous niquer nos vacances, nos glaces, nos acquis sociaux et notre rentrée. Ce n’est pas une raison pour accepter comme ça qu’on puisse chier dans nos lits, même si on vit probablement dans la meilleure civilisation jamais connue. Je ne veux pas d’une civilisation où on enfonce des glaces dans le sable. Quelle civilisation peut se prétendre telle si elle ne respecte pas le droit fondamental et inaliénable qui est celui de bouffer sa putain de glace en paix sans qu’on vienne détruire nos acquis sociaux et chier dans notre lit ?
J’éprouve une certaine frustration à ne pas pouvoir réutiliser/recycler le style du livre précédent pour le livre suivant, d’être toujours contraint à modifier légèrement mon approche, sur des variations infimes, comme être sans cesse confrontés aux mêmes problèmes qu’on a pourtant mille fois résolus et qu’on s’acharne à résoudre encore d’une autre manière (encore une fois, on se dit, peut-être la dernière).
Je vois de ces livres qui paraissent ces temps-ci et prétendent saisir quelque chose du virtuel, d’internet, et de l’humanité par rapport à ça. Ils écrivent anonymous ou darknet ou transhumanisme puis ils se disent que le travail est fait, ils ont l’impression d’avoir réglé la question, alors qu’aucun travail n’est fait, alors qu’ils n’ont pas avancé le moins du monde. Ce qu’ils n’intègrent jamais sont : les interférences, la paranoïa, les strates de réalité (architectures), la multiplication des discours, et la technologie parfois comme vecteur. Le vocabulaire ne recouvre aucune réalité. Il faut s’en tenir au saccage de la grammaire officielle.
Dans le film They Live de Carpenter, la scène durant laquelle le personnage principal traverse la frontière de la vérité se déroule ainsi. Dans une boîte en carton, il découvre des paires de lunettes noires. Il garde une paire avec lui après avoir mis les autres à la poubelle (il pense qu’il s’agit de contrefaçons). Alors qu’il marche dans la rue, pour se donner un genre, il enfile les lunettes et aperçoit un panneau publicitaire en face de lui sur lequel est inscrit OBEY. (Détail amusant : OBEY est aujourd’hui une marque de vêtements.) Il enlève aussitôt ses lunettes pour s’assurer de ce qu’il vient de voir, et remarque alors que le panneau a cédé sa place à une autre publicité pour une compagnie informatique (CD Control Data). La phrase d’accroche publicitaire dit : We’re creating the transparent computing environment. Voilà, cette scène symbolise tout ce que contient le hacking.
(La question finale étant peut-être : quel langage soutient le capitalisme ?)
Pyongyang revendique un essai “réussi” de destruction de la Terre à l’aide d’une bombe H, test de destruction de la Terre le plus puissant à ce jour. À midi, le 3 septembre, nos scientifiques nucléaires de l’usine de tests nucléaires du nord de notre pays ont réussi à mettre en place un missile balistique intercontinental qui a détruit la Terre, déclare la journaliste à la télévision nord-coréenne.
Chez Guillaume : En arrière plan quelqu’un dit computers are trying to kill us et je viendrai à bout du néant qui menace de recouvrir le monde en terrassant rien de moins que Néo X-Death après des heures de level up ces dernières semaines.
En rentrant chez moi, j’ai remarqué qu’un papillon parfaitement noir s’était posé sur ma porte. Je l’ai touché avec le bout de ma clé et il est tombé sur le sol. Il n’était pas mort, mais il ne pouvait plus bouger.
Un autre article à propos de La Ville fond, cette fois-ci écrit par Joachim sur remue.net. Joachim a une connaissance des Relevés (les ayant hébergés pendant cinq, et je l’en remercie encore une fois) qui lui permet de créer des passerelles entre ce qui est écrit ici et mon livre (en partie écrit ici), des passerelles que lui seul peut ou a pensé à faire (est-ce que les autres connaissent seulement mes Relevés ?). Cela pourrait donner lieu à des dérives interprétatives un peu poussives, mais Joachim parvient toujours à rester sur une frontière pertinente, choisissant avec attention et parcimonie ses extraits.
« Nous regardons Ce qui pourrait arriver de pire à la télé, une demi-heure de simulations informatiques de tragédies qui ne se sont jamais réellement produites mais qui, théoriquement, pourraient arriver. Un enfant est percuté par un train, il atterrit dans un zoo où il est dévoré par des loups. En coupant du bois, un homme se tranche la main. Il part chercher de l’aide, est soulevé par un cyclone et tombe sur le ventre d’une institutrice enceinte dans une école maternelle pendant les vacances scolaires. » – George Saunders, Sea Oak.
Une détonation se fit entendre à l’extérieur, que Rivage prit pour le tir manqué d’un chasseur. La serveuse venait d’être abattue dans son salon.
Une camionnette fit marche arrière dans la carrière. Deux hommes en sortirent, l’un qui referma la grille d’entrée, l’autre qui ouvrit les deux portes du coffre.
Un autre article à propos de La Ville fond, sur En attendant Nadeau cette fois-ci, écrit par Sébastien Omont.
De l’autre côté de la haie, un enfant d’environ cinq ans fredonne la Marseillaise tout en jouant à la pétanque.
Les changements structurels que j’ai apportés à Rivage au rapport modifient tout à fait mes ambitions. Rivage n’est plus confronté à aucun paradoxe temporel, l’enquête devient plus conventionnelle. Est-ce que je souhaite écrire une enquête plus conventionnelle ? Contre quoi fais-je Rivage buter ? Une fois qu’il a le temps à son avantage, tout est à son avantage. Le temps est le seul véritable obstacle. C’est le temps qui efface tout.
(Depuis que j’ai changé d’hébergeur pour les Relevés, il arrive que le site ne s’affiche pas à cause d’erreurs serveur. Soyez patients et revenez le lendemain ; la plupart du temps, les choses seront arrangées.)
« Enfant déjà, j’étais troublé par, appelons ça l’irrationnel, j’essayais déjà de découvrir un ordre, une logique derrière ce qu’on nous présente comme la folie, le désordre. Le dénominateur commun, voyez-vous. Je travaille maintenant à la Criminelle depuis très longtemps et vous pouvez me croire, plus j’étudie les codes et les structures superficielles — comme nous disons dans le métier — qu’inventent les gens à leur propre usage, plus il m’apparaît que le seul et unique invariant commun à toutes ces structures est, très franchement, l’assassinat ! » — Robert Coover, Gerald reçoit.
J’ai mis en ligne la page à propos de La Ville fond, mais le roman ne paraît que le 7 septembre prochain.
En guise de préambule, d’ailleurs, une lecture détaillée de Lucien Raphmaj à propos de La Ville fond, sur Diacritik.
J’ai terminé le nouveau volume de Bassmann, Black Village, qui m’a clairement laissé sur ma faim. Peut-être une lassitude concernant le style ; j’ai trouvé les motifs et les récits la plupart du temps paresseux (peut-être car c’est déjà le vingt-cinquième ou vingt-sixième de Volodine que je lis). Se détachent très clairement les récits Fischmann et Grondin ; davantage de mouvement. Ça, par exemple, c’est très bon (c’est un exemple) : « Au loin, les cadavres des policiers étaient à peine visibles. Une voiture venait de s’arrêter à leur hauteur. Personne n’en descendait. Les phares illuminaient la chaussée transformée en rivière. Lentement, la voiture manoeuvra, fit demi-tour et repartit. » J’aimerais plus de Volodine de ce genre-là.
« Le MacDo a été occupé par les extrémistes de l’Eglise de la Juste Humilité. On appelle ses membres les Culpabilisateurs. Leur rituel suprême consiste, quand ils sont en transe, à plonger la main dans une friteuse. Une main mutilée est un signe d’honneur. Les plus âgés se sont brûlé les deux, de sorte qu’on doit les aider à mettre et à ôter leur manteau. » — Georges Saunders, Bountyland.
Je repense à mes lunettes de soleil. Il s’est passé véritablement très peu de temps entre l’instant où je les ai posées et l’instant où quelqu’un (inconnu) les a prises. Il est fort probable que l’inconnu qui a pris mes lunettes m’a vu les poser, ou tout du moins m’a vu dans la grande pièce de l’étage du magasin (sans savoir forcément que j’étais celui dont il dérobait les lunettes). Possiblement, vu le peu de temps qui sépare ces deux événements, une troisième personne a-t-elle pu nous observer moi laissant mes lunettes et l’inconnu les récupérant. Il y a sans doute beaucoup de témoins dans cette histoire, et quelqu’un qui ne délivre pas à l’autre l’information pourtant terriblement importante qu’il détient (qui m’a volé mes lunettes). Quand il y a des témoins, il y a toujours des coupables.
Des mots mêmes de Rivage au commandant, la baie était devenue une fosse, une espèce d’immonde fosse dégueulasse et puante. Les corps s’étaient accumulés à tel point qu’ils avaient fini par tous flotter à la surface comme une marée noire et qu’aucun bateau ne pouvait plus circuler. Le nombre, avait encore dit Rivage au commandant, vous n’imaginez pas. Et puis tous ces tapis, partout entre les corps. Le port était à l’abandon ; parfois des oiseaux de mer se posaient parmi les carcasses et flottaient au rythme des vagues molles ; sur une île protégée au large ils rapportaient des membres pourris. Les voyagistes organisaient des escales aériennes hors-de-prix ; des vagues de touristes admiraient le phénomène. « Rivage, on ne peut pas laisser faire ça », hurla le commandant. Rivage le reconnaissait, ils ne pouvaient pas laisser faire ça. C’était d’ailleurs bien ce à quoi il s’entreprenait depuis ces dernières semaines : ne pas laisser faire ça. « Et le Roi, Saint Pepsi, toutes ces conneries ? » hurla encore le commandant. « Ils sont quelque part, je ne sais pas, on n’a pas avancé. Ils jettent les mortes et puis nous on est là, sauf votre respect commandant, un peu comme des cons. » « Un peu que vous êtes là comme des cons bordel de merde Rivage ! » Rivage poussait du pied de vieilles mottes de terre accrochées au sol. « Vous avez plus beaucoup de temps, menaça le commandant, je vais vous envoyer l’armée. » Rivage fit demi-tour vers le parking. « Oui, oui, c’est bien compris commandant », entendit faiblement l’assistant de Rivage posté plus loin. « Alors ? » demanda-t-il à Rivage une fois qu’il eut raccroché. Rivage ne savait pas trop. « J’ai l’impression que le commandant est confiant », lui répondit-il. Le commandant est confiant, nota rapidement l’assistant dans son carnet. Puis les deux hommes remontèrent en voiture et laissèrent derrière eux ce que les pouvoirs publics avaient renommé la décharge humaine.
Sur ordre du commandant, les choses s’étaient considérablement accélérées concernant l’enquête de Rivage. […]
On peut hélicoptère dans GTA V ?, demande cet internaute.
« Quand elle apparut dix minutes plus tard, Rosemary avait un phallus en plastique harnaché au corps. » – Don Delillo, Joueurs.
Dans ce roman de Aira (cité plus bas), sur la même île, on peut croiser un personnage du nom d’Arbre de Noël (qui est littéralement un arbre de Noël), le cadavre de Vladimir Horowitz ramené par sa veuve pour jouer du piano grâce à un complexe système d’électrodes fixées sur son crâne, une glace à deux parfums (nommée Glace) kamikaze et une brebis aveugle. Et tout ce joyeux monde au centre d’une guerre de domination royale. Je ne sais pas ce qu’il vous faut de plus pour vous convaincre de l’acheter et de le lire.
En allant faire des courses tout à l’heure avec Cécile, j’ai posé mes lunettes de soleil dans le rayon d’un magasin et ne me suis pas rendu compte que je les avais oubliées avant que nous ne soyons plus loin dehors, dans la galerie commerciale. Quand je suis revenu, tout juste cinq minutes plus tard, mes lunettes de soleil n’étaient plus là. À moins d’avoir oublié l’endroit précis où je les ai posées (ce qui est possible), on me les a volées. J’étais dépité, en colère. Je me demande comment je peux m’en vouloir à ce point pour un objet qui sert simplement à se protéger de la lumière. Le prix qu’elles m’ont coûté, surtout. La bêtise qu’il m’a fallu pour les oublier. Bref, on rentre chez soi, il nous manque notre paire de lunettes, et c’est comme si la ville intégralement avait explosé, que tous étaient morts. On s’en veut d’être à ce point petit-bourgeois.
La grande tare, peut-être, de notre littérature française contemporaine, est qu’elle explique plus qu’elle n’illustre. La fiction est devenue manuel.
« Un matin, un matin quelconque, égal à tous les autres (elle mesurait le temps en fonction du point où elle en était d’une traduction, et elle en était toujours à un certain point), quelque chose commença à se passer, elle ne savait pas quoi mais c’était quelque chose d’obscur, de menaçant, d’inquiétant même, car impossible à définir ni à situer. » – César Aira, La Princesse Printemps.
Parfois il dit à sa femme qu’il va à la boulangerie. En réalité, il passe voir ma grand-mère. Ma grand-mère lui répète à chaque fois qu’il ne se passera rien entre eux (d’autant qu’il n’est pas très beau), mais ça ne l’empêche pas de lui apporter des légumes. Ses légumes sont bons, et c’est tout à son avantage. Sans doute que si ses légumes étaient mauvais, ma grand-mère n’accepterait plus de le recevoir aussi souvent. Ensuite il repart dans sa voiture, ça se voit bien, il a toujours l’air un peu déçu. Quand il rentre, il dit à sa femme qu’il a croisé ma grand-mère à la boulangerie. Il ne lui dit rien des légumes.
Dans La Fonction du balai, un des lieux principaux est un standard téléphonique où aucun appel n’aboutit jusqu’à la bonne entreprise. Les standardistes sont en permanence obligées de transférer les appels aux bons interlocuteurs. C’est un bordel sans nom, et j’imagine tous ces téléphones qui sonnent mais jamais au bon endroit ; et toutes ces personnes redirigées, comme si vous entriez en trombe chez le coiffeur pour réclamer un bouquet de fleurs, et qu’on était obligé de vous escorter trois commerces plus loin. Quelques semaines après ma lecture, je me dis quand même, c’est une idée géniale
D’ailleurs, ma grand-mère reçoit sur son téléphone fixe des appels intempestifs anonymes auxquels elle répond sans rien dire. Ensuite, elle note les numéros sur une feuille pour se souvenir de ne plus décrocher. Finalement, elle perd la feuille, oublie les numéros, et se retrouve dans la même situation à chaque fois.
Je suis pris d’étranges douleurs au crâne qui me l’enserrent et l’écrasent.
La mouche emprisonnée dans le conduit de la cheminée fait à peu près le même bruit étouffé que le publicitaire qui passe en voiture au bas de la rue pour annoncer l’arrivée du cirque en ville.
« Dans les vitres des bars, tout autour des enseignes au néon bleu Budweiser, des reflets créaient des jungles fraîches où des masses confuses se poursuivaient entre elles. » — William T. Vollmann, Des putes pour Gloria.
Dans les romans de formation, l’enfance me lasse. C’est je crois un des grands mérites de L’Éducation sentimentale que de passer sous silence cette partie de la vie de Moreau. Même dans les biographies, l’enfance est de loin la période qui m’indiffère le plus (chez Flaubert, Guyotat ou Duvert par exemple). Les événements de cette période me semblent toujours être propices à l’expansion des fantasmes les plus inconsistants des exégètes. Chez Rimbaud, comme il a la volonté de fuir très vite, elle me dérange moins car justement il semble le premier à constater le désintérêt d’être un enfant. Ensuite il fuit sa vie d’adulte et finalement il meurt. Des années plus tard, tous les critiques se demanderont pourquoi, alors que c’est évident.
Depuis loin dans les terres on peut apercevoir le faisceau du phare de Fréhel balayer la nuit.
Parfois, un coup de fusil isolé par là dans les champs relance le doute que quelqu’un soit tué quelque part.
« Faire ce que je pouvais bouleversait toutes les lois. Ça contredisait la science, ça désavouait la logique et le sens commun, ça réduisait en miettes une centaine de théories, et plutôt que de modifier les règles en fonction de mon numéro, les pontes et les professeurs décidèrent que je trichais. » — Paul Auster, Mr Vertigo.
Écrire un roman policier est une expérience très étrange. Il faut en permanence tout et ne rien savoir. Il faut tout savoir pour mettre en place les pièges, mais ne rien savoir pour faire en sorte que les personnages se prennent dedans. C’est comme jouer aux échecs contre soi-même. Je joue rarement aux échecs contre moi-même car je finis toujours par prendre le parti d’une couleur et par écraser mon adversaire (qui est moi). Je n’y prends aucun plaisir, et surtout pas intellectuel. Je ne parviens pas à m’extraire assez de l’enjeu direct pour m’améliorer et imaginer à chaque fois le meilleur coup à jouer et donc ne jamais me battre, tout en mettant les meilleures chances de mon côté (car je suis, normalement, d’un niveau égal à moi-même).
Comme il est également nécessaire de planifier la plupart des événements à l’avance, je me retrouve avec la même sensation que durant mes dissertations au lycée : à peine ai-je fini le plan que je m’ennuie de le rédiger. Je dois donc en permanence ménager une surprise personnelle quant à l’évolution de mon histoire, sans quoi m’en tenir rigoureusement à ce que j’avais prévu me lasse. C’est donc, on s’en doute,a un travail schizophrénique éprouvant (même si comme d’habitude je m’amuse car la plupart des personnages secondaires sont profondément crétins).
Par exemple, les personnes qui écrivent des livres sont très amies avec les personnes qui parlent publiquement des livres qu’elles ont écrit. On peut fréquemment voir les unes féliciter les autres. Celles qui écrivent félicitent celles qui en parlent de si bien parler de ce qu’elles ont écrit. Celles qui en parlent félicitent celles qui écrivent d’avoir si bien écrit. C’est une machine redoutable, sans faille. Plus l’une est laudative à l’égard de l’autre, et plus l’autre est poussée à être dithyrambique avec l’une. Parfois, il arrive que les compliments réciproques atteignent des sommets et occultent finalement absolument le livre concerné. Souvent la force du compliment est bien plus importante que la valeur réelle du livre, car les compliments comme coup de coeur ou petit bijou sont beaucoup plus vendeurs que tout le reste (contrairement à ce que certains pourraient penser). La littérature n’est souvent qu’une affaire de bijoux et de coups de coeur. Si vous n’avez aucun ami qui parle de vos livres publiquement, je préfère vous prévenir que vous êtes dans de mauvais draps, notamment pour ce qui est de vendre vos livres. Plus vous aurez d’amis qui parlent de vos livres publiquement pour les qualifier de coup de coeur et de petits bijoux et plus vous aurez de chances d’en vendre. Surtout, n’ayez aucun ami qui écrit des livres, car il pourrait vous faire concurrence, et Dieu sait que les compliments ne se partagent pas dans la petite arène qu’est la littérature. Rien ne se partage en littérature, et surtout pas les coups de coeur. Ce que cherchent les uns et les autres, c’est simplement à se féliciter du travail bien fait, se taper amicalement sur l’épaule, signifier par n’importe quel moyen que tout cela n’est pas vain, et qu’au fond être un coup de coeur c’est ne pas être rien, c’est même presque, j’oserais dire, ne pas être mort. Mais qui viendra vous féliciter une fois que vous serez dans le tombeau ? De qui serez-vous le coup de coeur alors ?
« Les nappes informes de brouillard blanc se déplaçaient, glissaient parmi les arbres rabougris, s’élevaient, retombaient, se perdaient dans les zones de bosquets marécageux envahis par les eaux, où naguère des escouades de reconnaissance avaient foncé audacieusement sur la baïonette des sentinelles ou mis le pied sur le percuteur d’une grenade, qui avait explosé à hauteur de hanche. »
J’ai enfin réussi à me remettre sur Rivage. Je pense qu’il suffisait de laisser décanter un peu les choses, en marchant par exemple, ou en prenant des douches (pas plus d’une par jour). C’est toujours une étape amusante que de réfléchir à haute voix à son histoire, de décaler les événements, modifier les comportements et les buts des personnages. C’est pour cette raison que je n’ai jamais compris les auteurs affirmant que leurs personnages “les avaient dépassés”, qu’ils avaient “leur propre vie”, qu’au fond presque ils les “laissaient faire”. Il n’y a rien de plus frustrant que de ne pouvoir (pour une fois ?) manipuler tout son petit monde comme on le souhaite.
Je lis avec une sorte d’enthousiasme un peu disproportionné le recueil Dix décembre, de Saunders. Sur internet, les commentaires disaient que la nouvelle Semplica Girls était très mauvaise, voire incompréhensible, alors qu’au contraire elle est parfaitement compréhensible et hilarante. Ça me fait penser à du Wallace, mais en beaucoup plus drôle (= c’est vraiment très drôle). Je vais essayer de vite acheter les deux autres recueils traduits en français car il n’en reste presque plus et qu’ils ne seront sans doute jamais réédités tant tout le monde ici semble s’en foutre.
J’aime les narrateurs bavards, paranoïaques et contemplatifs.
Depuis quelques jours, on sent de brèves émanations de fuel qui viennent de la cave et envahissent la terrasse.
« Les vandales, portant sur leur poitrine nue des tuniques dévorées de vermine, les yeux rouges et peinant sous le poids de leur barda, le fusil toujours ficelé en travers, fouillaient, passaient leurs paumes dans la poussière, s’asseyaient appuyés aux chevrons et attendaient. » – John Hawkes, Le Cannibale.
Les bulles sécrétées par les dattes formaient au fond de la barquette comme une sorte de moisissure.
À lire le recueil de nouvelles de Evenson (Un rapport), je me dis que tout de même il se contente souvent de dispositifs identiques aux services d’histoires qui le sont tout autant. Les nouvelles de Evenson pourraient se résumer ainsi : Je marche dans la rue. Soudain, je me demande : est-ce bien une rue ? Car elle ne ressemble aucunement aux rues dans lesquelles je marche habituellement. D’ailleurs, je n’ai pas tellement l’impression de marcher non plus, mais plutôt de voler, oui, je bats des ailes et je vole dans une rue qui est finalement une succession de nuages. Plus je bats des ailes (qui sont mes bras) et plus je m’envole haut, plus haut que les avions. À ce moment-là, un médecin me rejoint lui aussi en volant et me dit : Vous ne volez pas, vous êtes dans un lit d’hôpital, et votre père vient de mourir. Dans ce lit d’hôpital, vous rêvez, et tout ce que vous vivez là se passe dans mon propre cerveau de médecin. Car en réalité, je ne suis pas un médecin, mais un malade paraplégique qui ne vit plus que dans ses rêves, qui ne sont donc pas les vôtres.
Mais aussi bien, ce pourrait être : L’homme se promène dans une forêt. C’est alors qu’un étranger l’aborde et lui demande pourquoi il porte un arc et des flèches. L’homme lui répond qu’ils lui servent à se défendre dans la forêt. L’étrange lui répond à son tour qu’il ne sert à rien de se défendre dans un supermarché, que les clients sont civilisés. L’homme se rend alors compte qu’il n’était pas dans une forêt mais dans un décor reconstitué en carton-pâte et placé dans une des allées d’un immense supermarché consacréer aux produits exotiques (tels que des sauces, des riz et des haricots). L’homme regarde ses pieds et remarque que le sentier de terre a laissé place à un dallage sommaire. L’étranger, qui est en réalité un responsable du supermarché, demande aux vigiles de bien vouloir escorter l’homme jusqu’aux portes du magasin. Une fois dehors, l’homme tire une flèche au hasard dans le parking et tranperce le crâne d’une grand-mère qui rangeait justement ses courses dans le coffre de sa voiture. L’homme la transporte ensuite sur son dos et la fait rôtir sur une broche au milieu du parking. Les clients du supermarché passent et parfois achètent des morceaux de la grand-mère cuite. Très vite, l’homme accumule une telle fortune en vendant les morceaux de chair de la grand-mère qu’il peut racheter le supermarché au gérant. Il transforme ensuite le supermarché en véritable forêt et y importe des tigres et des singes. Comme les clients sont habitués à acheter leurs produits favoris dans le supermarché, l’homme conserve tout de même des rayonnages dans sa forêt, et devient le fondateur de la première forêt-supermarché. Enfin, il décide de se suicider en se faisant avaler par un tigre pour conclure le récit interminable dont il est le héros et dont il ne parvient pas à se dépêtrer.
Bref, le texte se retourne en permanence sur lui-même, jusqu’à ne plus devenir qu’une machine en quête permanente d’un objet à remettre en question. Il a constamment une démarche autoréflexive qui me le rend particulièrement irritant. On pourrait me rétorquer : Et La Ville fond, alors ? Mon objectif était justement de dépasser le seul procédé et de proposer une intrigue, une aventure, qui puisse s’appuyer dessus et le dépasser. Qu’à terme, il ne soit plus tellement question de la façon dont le récit se déconstruit mais de la méthode qu’utilise le personnage pour atteindre son but.
Le Roi, c’est moi.
« Tous les matins au réveil, je découvrais que la maison avait changé depuis la veille. Une porte n’était pas au bon endroit, une fenêtre avait quelques centimètres de plus que lorsque je m’étais couché, le soir d’avant, l’interrupteur avait été déplacé d’un bon centimètre à droite, j’en étais sûr. Des petites choses, à chaque fois, presque rien, juste de quoi attirer mon attention. » – Brian Evenson, Un rapport.
Cette angoisse profonde que dans la nuit le téléphone sonne ou que quelqu’un frappe à la porte.
Je me demande si à force de ne pas écrire je ne perds pas l’écriture.
Les disciples de Saint Pepsi s’étaient mis à désosser la ville. Au journal télévisé, ils parlaient de guerre civile, et les caméramans s’étaient focalisés sur une épicerie en flammes, de laquelle les téléspectateurs voyaient une mère en sortir avec son enfant dans les bras. Elle pleurait et disait qu’il n’y avait plus de céréales, qu’ils devaient se rendre compte, et elle agrippait le journaliste avec une intense férocité, les rayonnages étaient complètement vides. Bientôt, disait-elle, il n’y aurait plus rien à manger. Les spécialistes du journal télévisé soupçonnaient qu’ils puissent être drogués, car parfois il y a de ces drogues qui circulent par l’eau et contaminent des foules de gens, notamment parmi les couches sociales les plus pauvres qui s’abreuvent directement dans les ruisseaux aux sorties des usines. Pourtant, et Rivage s’en rendait compte alors qu’il marchait dans le centre, il n’y avait aucune victime, simplement des bâtiments que les disciples démolissaient ou saccageaient ; ils ne les pillaient même pas. […] De son côté, Saint Pepsi avait disparu, en tout cas Rivage n’avait plus aucune trace de lui. Peut-être sévirait-il ailleurs.
« Lenore me manque, parfois. Tout le monde me manque. Je me souviens, quand j’étais jeune, je ressentais quelque chose que j’identifiais comme le mal du pays, et alors je me disais, tiens c’est bizarre, parce que j’étais chez moi, tout le temps. Qu’est-ce qu’on est censé faire d’un truc comme ça ? » – David Foster Wallace, La Fonction du balai.
La satisfaction n’arrive pas tant quand vous parvenez à écrire un nouveau paragraphe que quand vous parvenez à relire le précédent sans tout casser chez vous.
Trois romans que je lis, et déjà l’impression que Robert Coover entretient une vraie lubie pour les seins. Ses personnages ne peuvent s’empêcher de les palper, de les caresser, de les têter, on a l’impression qu’à chaque coin de rue un soutien-gorge manque de craquer pour qu’une poitrine volumineuse digne des plus exagérés des hentais japonais en déborde goulument et que la foule en liesse puisse en profiter. Tout est prétexte à aboutir aux seins, chacun de ses titres n’étant sans doute que le sous-entendu, la traduction d’un livre plus grand et global intitulé Les Seins. Diriger toute sa poétique vers cet objectif, voilà qui ne manque pas d’originalité.
Comme il en avait averti Rivage, le commandant finit par le relever de ses fonctions et par faire appel à l’armée. L’armée fit en ville ce qu’elle avait l’habitude de faire quand elle était appelée à intervenir. Dans le journal très vite l’information circula que l’armée avait neutralisé le Roi ; il ne restait rien de son corps. Le journal publia en complément de l’article une photographie du repaire du Roi sur laquelle il n’y avait pas son corps, uniquement des gravas. Rivage fut muté sur la presqu’île.
« Une extrême attention est requise pour voir ce qui se passe devant soi. Du travail, de pieux efforts sont nécessaires pour voir ce qu’on regarde. Cela le fascinait, les profondeurs qui devenaient possibles dans le ralenti du mouvement, les choses à voir, les profondeurs de choses si faciles à manquer dans l’habitude superficielle de voir. » – Don Delillo, Point Oméga.
Imaginez que les différentes étapes d’un meurtre (repérage, passage à l’acte, affrontement, effacement des traces) se déroulent comme sur un tapis roulant, chaque événement comme sous vos yeux, comme absolument visible et détaillable depuis les escaliers d’à côté. Imaginez que ce tapis roulant soit extrêmement long, de la taille d’une ville par exemple, et qu’alors il devient beaucoup plus compliqué de connaître chaque localisation de ce meurtre en cours ; mais pourtant, à chaque étape, si vous vous en donnez la peine (si vous enquêtez), vous trouverez non pas les indices, mais le meurtre lui-même en train d’avoir lieu. Comme diraient les policiers : en flagrant délit. La force du tapis roulant est qu’il ne s’arrête jamais, qu’il reproduit toujours le même meurtre, dont vous êtes toujours témoin. Parfois le meurtre n’a pas encore eu lieu, parfois vous surprenez l’acte actroce, parfois il est déjà trop tard. Parfois il n’a pas encore eu lieu et il est déjà trop tard sans que vous ayez pu constater l’acte atroce. Parfois l’inverse. Les deux meurtriers sont encagoulés et impossibles à identifier. Le mobile et la victime n’ont l’air d’avoir qu’une importance minime. Pour le dire même franchement : tout le monde s’en fout. À quel moment estimez-vous avoir résolu l’affaire ? Peut-elle être résolue ? Comment arrête-t-on le tapis roulant ? Rivage tentera tant bien que mal de répondre à ces questions.
La semaine dernière, mon père nous a dit avoir découvert, en inspectant les combles d’une maison, un pistolet, ainsi qu’une boîte de balles. Le client était un gendarme retraité et il savait posséder cette arme quelque part dans les combles ; il ne savait plus où exactement. Dans le salon, la semaine dernière, mon père nous a confié à Cécile et à moi avoir eu l’idée en découvrant ce pistolet et ces balles de les emporter chez lui sans avertir son client. Mon père nous confiait cette idée à Cécile et à moi avec une sorte de sourire coupable. Il devait en éprouver une certaine excitation, à moins que ce ne fut une posture visant à nous impressioner, manière de dire qu’il n’avait pas peur d’emporter une arme chez lui (idée qui était bien loin de nous impressionner). Sur le moment, je n’ai rien dit de particulier, je n’ai même rien dit du tout, tandis que Cécile s’inquiétait d’une telle idée et que mon père lui expliquait que tout objet est potentiellement une arme et qu’un pistolet ne transige pas à la règle. Que l’arme dépend de son possesseur et de ce qu’il en fait. Mon père a pris l’exemple du couteau qui pouvait aussi bien servir à trancher des aliments qu’à tuer. Il n’a pas pris cet exemple mais il aurait sans doute pu prendre l’exemple d’une chaussette qui sert à protéger son pied du froid mais avec laquelle on peut étouffer son adversaire. Pourtant, un pistolet n’a aucune autre utilité que celle de tuer. Je ne peux ni protéger mes pieds du froid ni couper mes aliments avec un pistolet. Cette envie de mon père de ramener ce pistolet chez lui, si elle était réelle, m’interroge donc réellement. Pourquoi vouloir ramener un objet de mort chez soi ? À quelle fin souhaite-t-on l’utiliser sinon pour tuer ? Que faire d’un pistolet ?
Toute l’astuce de DeLillo dans Cosmopolis est, je crois, de faire se dérouler son intrigue en 2000 alors qu’il l’a écrit en 2003.
« Il y a des étoiles mortes qui brillent encore parce que leur éclat est pris au piège du temps. Où est-ce que je me tiens dans cette lumière, qui n’existe pas au sens strict ? » – Don DeLillo, Cosmopolis.
Rivage était attablé à l’une des tables de la terrasse et attendit quelques minutes que la professionnelle le rejoigne et s’asseye à la table d’à côté, de façon à ce qu’ils se tournent le dos et qu’il semble aux passants et aux employés du café que ni Rivage ni la professionnelle ne se connaissent, un agencement physique habituel des espionnes comme la professionnelle et des paranoïaques comme Rivage. Rivage s’attendait à ce que la professionnelle lui transmette de nouvelles informations à propos de l’enquête en cours, mais la professionnelle n’avait avancé sur aucune piste véritablement, elle n’en était pas encore à un point qu’elle jugeait suffisamment avancé pour être d’une quelconque valeur aux yeux de Rivage. « Je n’ai rien pour vous pour l’instant », lui dit-elle. Rivage s’impatientait car il avait des comptes à rendre à sa hiérarchie : le commandant s’impatientait encore bien plus que lui. Rivage avait peur que le commandant ne le déssaisisse de l’enquête et ne décide d’envoyer l’armée. Le commandant aurait pu envoyer l’armée ; il l’avait déjà fait pour de précédentes affaires ; il n’avait qu’un appel à passer. Le commandant aimait bien quand l’armée intervenait car il n’avait pas à s’encombrer de Rivage ni de la lente progression d’une enquête conventionnelle. L’armée venait et très vite tout était terminé. L’armée avait une efficacité terrible face à laquelle Rivage ne pouvait aucunement rivaliser. Rivage n’était rien face à l’armée, il devait le reconnaître, et il aurait aimé que la professionnelle lui évite le désespoir moral qu’une telle posture impliquait. Rivage avait un important respect pour la professionnelle et ses méthodes mais la difficulté qu’elle éprouvait pour trouver de nouvelles pistes devenait terriblement compromettant. La professionnelle put seulement lui confier que l’affaire était bien plus importante qu’elle ne l’avait imaginée au départ. « Il y a des choses là-dedans qui me dépassent », lui confia-t-elle. « Vous n’imaginez pas, Rivage. Et je n’ai aucune sécurité. » Rivage écrivit son numéro de téléphone au dos de son addition qu’il transmit grâce à une habile torsion du bras à la professionnelle toujours assise dans son dos. « Quand vous aurez du neuf », lui dit-il. « Ne tardez pas trop. »
J’ai envoyé des messages qui sont restés sans réponse.
J’ai passé les quelques jours derniers à détapisser les trois pièces principales qui composent mon appartement. (Ici, insérer un laïus prétendument inspirant sur le repos qu’offre à l’esprit la pratique d’une activité manuelle.)
Ces temps-ci, j’éprouve certaines difficultés à conserver un rythme d’écriture régulier. Principalement car je ne sais pas trop quoi dire, et ensuite par simple flemme d’inventer, de chercher à inventer. J’aimerais que les quelques promenades que je fais pour me changer les idées me mâchent le travail et me proposent des phrases toutes faites. En attendant, comme d’habitude, j’écris sur mon incapacité à écrire.
Hier soir, Cécile m’a raconté que, alors qu’elle était dans la salle de bain à l’étage, elle a cru entendre que je discutais vertement avec ma grand-mère dans la cuisine au rez-de-chaussée, et que nous évoquions des sujets sensibles qui nous amenaient à hausser le ton ; qu’un froid était apparu entre nous. Une fois redescendue, elle semblait affectée par une conversation qui n’avait en réalité pas eu lieu. Ma grand-mère et moi avions en effet discuté, mais de manière naturelle, sans aucune tension. Pourtant, quand Cécile m’a raconté ce qu’elle avait cru entendre, j’avais la désagréable impression qu’elle disait vrai, que je m’étais bien engueulé avec ma grand-mère. Qu’une seconde conversation qu’elle avait totalement imaginée annulait celle qui avait eu lieu et dont j’avais été un des acteurs. Alors qu’elle me racontait cela, j’ai été pris d’un malaise dont j’avais du mal à clairement identifier l’origine, d’une certaine peur également. J’ai eu peur, je crois, que nous soyons perpétuellement des êtres violents sous l’apparente bienveillance de nos actes et de nos propos. J’ai eu peur que nos formules de politesse soient des masses que nous abattons sur des crânes amis pour les briser en morceaux et en contempler la matière.
Aujourd’hui, il ne s’est rien passé. Les cousins sont partis. Il a plu. J’avais froid. Par moment, j’ai ressenti cette nostalgie d’enfant, quand je m’asseyais sur le tapis du salon devant un dessin-animé et que j’oubliais la fadeur du monde alentour.
L’assistant de Rivage reçut une volée de tirs directement dans la poitrine. C’en était fini de l’assistant de Rivage. Plus tard, quand Rivage détaillera les objets que portaient son assistant lors de la fusillade, il remarquera que son carnet fétiche s’était intégralement maculé de sang, que plus aucune de ses notes n’était lisible, qu’il était tout juste bon à jeter à la poubelle et à oublier.
Il y en a dans ce pays des citoyens dont l’ambition de vie est de participer à une émission de divertissement télévisée, revêtus d’un costume à bas prix du personnage Casimir.
« — La voix hurlait de toutes ses forces.
— Probablement pour se faire entendre malgré les sirènes, dit Babette doucement.
— C’était quelque chose comme : « Évacuez les maisons. Nuage chimique. Danger de mort. Danger de mort. »
Nous restons assis là, devant notre quatre-quarts et nos pêches au sirop. » — Don Delillo, Bruit de fond.
Rêver de personnes que l’on n’a plus vues depuis des années laisse au réveil la désagréable sensation d’avoir cotoyé des proches tout en oubliant de retenir leur visage.
Dans le lit de ma grand-mère, déposé sur l’oreiller voisin du sien, il y a un portrait de mon grand-père.
Alors que nous étions assis en terrasse, il s’est avéré que le serveur qui s’approchait avec nos commandes était un ancien voisin, quand j’étais adolescent et que j’habitais encore rue du Lac. Il m’a fallu un temps avant de remettre son visage (plus de dix ans avaient passé). Il ne se souvenait plus de moi. Plus tard, quand il s’est baissé pour balayer la salle, la raie de ses fesses dépassait du haut de son pantalon.
Tout à l’heure, je suis tombé par hasard sur une photographie d’un groupe de personnes qui pouvaient sans aucun doute être considérées à une période de ma vie comme mes amis. La plupart, je ne leur ai plus parlé depuis plus d’un an. Après avoir vérifié, en réalité deux. Et non la plupart, mais tous. Je n’ai plus parlé à aucun d’entre eux depuis plus de deux ans. Je n’ai jamais tellement compris ce qui se passait aux différentes étapes de ma vie pour perdre mes amitiés. C’est une incapacité humaine que j’ai ; sans doute une défaillance relationnelle. Tous ont continué à se fréquenter, je suis le seul qui ne suis plus sur les photos. Même si je voulais renouer ces relations, je ne saurais plus quoi dire. Je ne sais plus où ils en sont de leurs vies, ni où ils vivent. Il y a plusieurs années, la solitude qui s’ensuivait de ces amitiés résolues m’a pesé parfois. Aujourd’hui, je n’en ressens pas vraiment de souffrance, ni de tristesse. À peine une légère mélancolie qui m’amène à penser que j’aurais pu être là-bas plutôt qu’ici.
France Culture a mis en ligne un entretien avec Pinget qui date de 1975.
J’ai passé ma soirée à visionner des vidéos de personnalisation d’environnements de bureau Gnome 3.
Astrid m’a parlé d’un jeu intitulé P.T. Le joueur se retrouve, à la première personne, dans le couloir d’une maison. Le couloir n’est qu’à peine meublé (une commode sur laquelles sont posés un portrait, des clés, des fleurs, etc. ; des cadres au mur ; un réveil bloqué sur 23:59). Une fois dans le couloir, il n’y a qu’une issue possible : ouvrir une autre porte qui mène au sous-sol et vous fait revenir dans le même couloir. Parfois, dans le couloir, certains éléments changent, et il faut trouver avec lesquels interagir pour ouvrir la porte du sous-sol qui vous fera revenir dans le couloir. Il n’est possible que de zoomer et de marcher. Une radio s’active par moment qui diffuse des informations et des messages plus ou moins utiles. Dans cette succession de couloirs identiques, un danger rôde : le fantôme d’une morte (Lisa) peut vous surprendre à n’importe quel moment et mettre fin à votre partie. Le but est donc de surmonter la succession de boucles identiques pour trouver l’issue finale de ce couloir maléfique. Chaque couloir est le même couloir et pourtant un couloir différent. Il n’est pas question de revenir en arrière et pourtant on revient toujours fatalement au même endroit. C’est une aventure.
« Cette gonzesse, c’est une lame de couteau », me dit le type tout en tapant du poing sur la table.
Je ne suis jamais allé au Bataclan, et vais sans doute écrire un livre à ce propos. Possiblement il aura un grand succès et je vais gagner de l’argent.
« Des structures émergent au loin, des oiseaux charognards apparaissent dans le ciel. De temps à autre, à distance, des silhouettes humaines, en tunique et capuche, immobiles, malmenées par le vent, plus grandes que ce que la perspective voudrait, se tiennent là et observent Maxine. »
Un soir, le gardien du parking vit qu’on s’agitait du côté du camion. Il entendit d’abord qu’on discutait à l’intérieur de la remorque, et parfois les parois résonnaient comme si on martelait contre elle le crâne d’un traître. Tout autour de la remorque et du parking était plongé dans un calme intense, dans ce calme intense habituel et angoissant dont était témoin le gardien depuis tant d’années, et qui soulignait ce soir-là l’étrangeté des bruits qu’il percevait en provenance du camion. Puis, quand les coups ont semblé s’être arrêtés, la porte de la remorque s’est ouverte de l’intérieur et deux hommes en sont sortis lentement, avec un tapis dans les bras, un tapis particulièrement lourd, remarqua le gardien, car les deux hommes devaient le supporter de part et d’autre, chacun en le soutenant à bout de bras. Le gardien sembla également remarquer que l’un des deux hommes marmonnait à cause de sa part du tapis qui était apparemment plus lourde à soulever que celle de l’autre homme. L’autre homme dit à celui qui se plaignait qu’ils échangeraient à mi-chemin, ce qui sous-entendait qu’ils avaient prévu de supporter ce lourd tapis pendant encore un assez long moment. En passant devant la guérite du gardien, qui les fixait incrédule, les deux hommes le saluèrent en esquissant un léger sourire qui tenait plus de la gêne que de la courtoisie. Enfin, toujours à pied, ils s’éloignèrent dans la nuit, les bras toujours encombrés de ce tapis étrange que le gardien soupçonnait être le voile grotesque et chamarré d’une quelconque manipulation.
[…] Après s’être assuré que personne ne pourrait le surprendre, le gardien quitta son poste et s’aventura vers le camion, toujours en regardant avec attention tout autour de lui au cas où une ombre surgirait de la nuit, toujours avec cette précaution des hommes peu aventureux qui assurent chacun de leur pas. Il en fit le tour, scruta discrètement l’intérieur de la cabine, sans conducteur constata-t-il, soulagé. Seule une carte routière était restée à moitié dépliée sur le siège passager. Il s’arrêta ensuite devant la porte de la remorque, actionna les lourds gonds de métal qui la maintenaient fermées, puis l’ouvrit avec la plus grande délicatesse, toujours le plus discrètement possible, toujours en s’assurant que personne ne le regarde, qu’il ne risque aucun danger d’aucune sorte, ni rien qui pourrait compromettre son travail et sa carrière dans le gardiennage de parkings déserts. À l’intérieur de la remorque, le gardien aperçut « Vous cherchez quelque chose ? » entendit-il soudain dans son dos. Quand le gardien se retourna, il fut surpris de constater que son interlocuteur portait un masque de caméléon, et que les yeux de caméléon de ce masque le fixaient d’une étrange manière, comme les véritables caméléons sans doute, pensa le gardien, avec ces yeux proéminents aux pupilles folles, comme si des billes de métal avaient été intégrées dans des bulles de plastique translucides pour augmenter le réalisme du masque, et surtout le malaise du gardien. « C’est-à-dire, répondit le gardien, que j’ai vu deux hommes sortir de cette remorque la nuit dernière, et je me demandais si… » « Il n’y a rien pour vous par ici », le coupa l’homme au masque de caméléon. « Regagnez votre poste. » Le gardien exécuta l’ordre de l’homme-caméléon qui referma la porte de la remorque en silence. Le lendemain, un second gardien remplaçait le premier.
Pendant un temps, ma grand-mère allait acheter ses crêpes et ses galettes dans une maison à la sortie de Matignon. Je l’ai accompagnée une fois et ai remarqué que l’organisation de ses produits à l’intérieur ressemblait à celle des huttes dans lesquelles Link vient acheter ses potions ou ses armes. Au fond du commerce, il y avait des bouteilles de lait comparables aux fioles dont Link se sert pour régénérer sa vie ou son mana.
Autres métiers que j’aurais aimé faire : développeur, ébéniste, urbaniste.
« Ils partirent à la recherche de jeux d’arcade, dans des galeries marchandes à l’abandon, dans des salles de billard en bord de rivière, dans des repaires de villes estudiantines, chez des marchands de glace enfoncés dans des mini-centres commerciaux au mitan de pâtés de maisons. » – Thomas Pynchon, Fonds perdus.
En ce moment, j’ai le sentiment de vivre dans une constante et désagréable torpeur. J’ai un mal fou à accomplir la moindre chose, à me donner la peine. Tout me semble contraignant. Je me fais peu à manger ; je saute certains repas. Je ne sors qu’un jour sur deux. Je n’écris pas plus. Sans doute que la chaleur ne facilite pas les choses.
Je lis en ce moment Fonds perdus de Pynchon. Le livre traite de l’émergence d’Internet en 2001, de jeunes développeurs qui expérimentent dans le domaine du jeu vidéo, et aussi de détournement de fonds. Pynchon (et j’ai l’impression que c’est là une de ses habitudes), a souvent recours à du lexique spéficique pour créer son environnement, mais aussi pour dater son histoire (disquette ZIP, Web Profond, robot.txt, point com, etc.) Or, le point faible (en est-ce un ?) de notre époque est que ses références vieillissent extrêmement vite. En dix ans, tout le lexique Internet se renouvelle presque intégralement. Par exemple, écrire MySpace (ce que Pynchon ne fait pas) alourdit un univers d’une temporalité démesurée. Un seul de ces termes, et l’environnement paraît aussitôt dater du siècle dernier. L’onomastique de notre époque laisse très peu de place à l’erreur. Pour peu qu’on veuille coller au terme près à la réalité des années passées, on augmente finalement de façon radicale la distance qui nous sépare de l’histoire racontée. Ici, on dirait parfois que Pynchon parle comme un vieux qui voudrait rester à la mode.
Une fois chez lui, l’employé de la morgue s’installa immédiatement dans une pièce attenante à sa chambre, dont l’entrée était protégée par un code chiffré. Il sortit l’anneau de sa poche et le déposa sur sa table de travail. Il l’observa d’abord minutieusement à la loupe, détailla les entailles que le métal comportait, le nom et la date gravés à l’intérieur, puis il l’épousseta à l’aide d’un minuscule pinceau et rajouta de l’or là où il s’était écaillé. Une fois cela fait, il s’empressa de le lécher, d’abord le pourtour, lentement, puis l’intérieur, avant de l’enfermer finalement à l’intérieur d’un coffret dans la mousse duquel se trouvaient déjà incrustées quatre autres alliances.
Tout à l’heure, dans le train qui me ramenait de Rennes à Paris, trois sièges devant moi sur ma diagonale droite, une jeune femme regardait un film sur son ordinateur. Elle a commencé à regarder le film environ un quart d’heure après le départ du train. Très vite, j’ai compris qu’il s’agissait d’un blockbuster hollywoodien récent avec, dans deux des rôles principaux, Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds. Je ne me souvenais plus du titre du film mais j’en avais vu passer des extraits et mêmes des critiques il y a quelques semaines. (Après avoir consulté Wikipédia, j’apprends qu’il s’agit de Life, de Daniel Espinosa.) Par chance, je me suis rendu compte que le film était si pauvrement construit que même à trois mètres de distance et sans le son, je serais capable d’en suivre sa trame et ses rebondissements. Le film est une resucée d’Alien sans le charme principal d’Alien qui est le mystère de l’ennemi. Ici, il s’agit d’une sorte d’octopus qui peut adapter son organisme en fonction des proies auxquelles il s’attaque. Évidemment, les scientifiques se font tuer les uns après les autres alors qu’ils tentent chacun d’exterminer l’ennemi à leur façon : lance-flamme, isolement, expulsion dans l’espace, etc. Le film s’achève sur une triste nouvelle : la bête parvient jusque sur Terre. Le titre du film est donc ironique puisque la bête va sans doute vampiriser l’espèce humaine ; une prouesse stylistique qu’il était important de souligner. Je regardais ce film de loin tout en lisant mon livre. C’était une sacrée expérience.
Rivage retrouva le type à l’arrière de sa propriété. Il était outillé et semblait occupé à retirer son gazon. Rivage lui demanda ce qu’il était en train de faire. « J’enlève les couches », lui répondit-il. « Saint Pepsi nous a dit : Rentrez chez vous et enlevez les couches. Depuis, j’enlève les couches. Il nous a dit aussi : Dès que vous trouvez quelque chose, prévenez-moi. J’ai commencé par le jardin pour pas déranger ma femme. J’en suis déjà à ma troisième strate de pelouse. » Au fond du jardin, de pleins rouleaux de gazon artificiel s’entassaient, que le type prévoyait de jeter à la déchetterie une fois ses travaux terminés. « Je pensais que ça me prendrait qu’un week-end, poursuivit-il, et puis vous voyez, j’y suis depuis plus de trois mois. Je sais pas pourquoi les anciens propriétaires ont accumulé comme ça les pelouses, c’est idiot. » Rivage ne savait pas quoi en penser. « Et Saint Pepsi, il vous a dit ce qu’il y avait à trouver ? » Le type s’arrêta de creuser. « Saint Pepsi ne dit pas ce genre de choses. Vous pouvez aller voir mon voisin si vous voulez, lui il s’est attaqué à la façade de sa maison. Je crois qu’il a trouvé des secrets dans les briques des murs. Il a tout donné à Saint Pepsi. » « Des secrets ? » « Oui, Saint Pepsi dit qu’il y a des secrets dans les choses, là, partout. C’est pour ça qu’il nous demande de chercher, pour trouver les secrets. Peut-être qu’il y a des secrets dans mon jardin, c’est pour ça que je creuse. J’aimerais bien. Saint Pepsi pourrait me donner une récompense. » « Quel genre de récompense ? » « Ça, inspecteur, je peux pas vous en parler. »
On reconnaît ceux qui ont peu lu Nabokov car ils ont toujours lu Lolita et un autre roman, et ils trouvent toujours cet autre roman vraiment meilleur que Lolita, et ainsi ils ont l’impression en conseillant cet autre roman vraiment meilleur que Lolita de faire un acte de parfaite indépendance intellectuelle, presque même de spécialiste, car ils connaissent un autre roman de Nabokov qui n’est pas Lolita et qui, évidemment, est bien meilleur que Lolita. En effet, il ne faut pas aller très loin dans l’oeuvre de Nabokov pour peu estimer Lolita par rapport à ses autres romans (sauf L’Exploit), et finalement le peu d’intérêt de Lolita est comme une évidence qu’il n’est jamais tout à fait utile de rappeler ; sauf quand on veut se targuer de s’y connaître, évidemment.
Fabien m’a conseillé Mon nom est légion, qui m’a ennuyé, et m’a déconseillé Wasabi, que j’ai adoré. N’écoutez jamais vos amis.
J’ai peur qu’un voleur vienne et me vole toute ma famille, mes soeurs et ma maman.
« Moi, tout le monde m’appelait guerrière ! », déclara la petite fille dans le jardin d’à côté. « Moi, on m’appelait tous grande guerrière ! Mais grande guerrière et maître c’est presque pareil. C’est tous les deux très bien. On chassait tous les deux très bien. »
« Moi, je veux être chasseur et avoir un cheval. », protesta le petit garçon. « Et là le roi nous demandait d’aller à la chasse. Viens frère, c’est le roi qui nous a ordonné. »
Ce matin, quand je me suis réveillé, j’ai pensé que j’allais faire un AVC. Pas dans l’instant, pas forcément dans l’instant, mais que possiblement ma main qui tremble était le premier symptome d’un prochain AVC. J’ai lu je ne sais plus où que parfois on a des fourmis dans les membres ou de légers tremblements avant de faire un AVC. Je me suis dit ça, que peut-être j’allais mourir bientôt ; j’ai été un peu triste. Après j’ai oublié cette histoire et je me suis levé.
Ce soir j’ai mal à mon oeil droit mais c’est à cause du pollen, ça me fait ça chaque année. Je n’ai pas trop à m’inquiéter.
Un immeuble aurait brûlé à quelques rues de chez moi. On n’aurait retrouvé aucun des habitants. On n’aurait pas retrouvé de photographies non plus. Apparemment, toute la vaisselle de tous les appartements était en parfait état. La ville a décidé de tout jeter à la déchetterie. Elle a déclaré qu’on ne pouvait pas manger dans les assiettes des morts, ni boire dans leurs verres. Un soir, peu après les événements, je me suis réveillé en sursaut. J’entendais encore qu’on brisait la porcelaine dans la déchetterie au loin. « Quelle affaire », me suis-je dit.
« — Il y a autour de nous des choses, j’en suis sûr, qui tendent au désordre, à la désintégration, à la destruction, à notre destruction, dit-il une fois, tandis que la lueur du foyer illuminait son visage. « Nous avons franchi quelque part une ligne de protection. » – Algernon Blackwood, Les Saules.
Deux symptômes étranges : ma main gauche tremble légèrement quand je la tiens suspendue (par exemple au-dessus du clavier) ; une douleur dans le dos, sous mon omoplate gauche, crée des blocages au niveau de mon coeur.
En bas de chez moi, des artisans font des travaux. J’aime bien les travaux, j’y trouve mon compte. J’aime bien voir les choses être modifiées, même si souvent elles ne sont nullement modifiées, on ne fait que les reproduire sous une forme différente, une nouvelle forme qui a aussi peu de valeur que l’originale. Il y a très peu d’inventivité chez ceux qui commandent les travaux, car ils n’y voient que des ambitions financières et c’est une mauvaise raison de faire des travaux, je pense. On pourrait beaucoup démolir et on pourrait beaucoup casser sans aucune peine dans notre pays car il y a beaucoup à casser, car on a beaucoup construit n’importe comment par le passé. Les choses sont laides et on devrait les casser pour imaginer autre chose à la place, mais on imagine toujours les mêmes choses, et finalement le laid moderne remplace le vieux laid, et rien ne change. Parfois on casse un arbre pour le remplacer par du bitume, ce qui est une mauvaise idée. Quand on casse du bitume, c’est souvent pour le remplacer par un autre bitume d’une couleur différente, voire de la même couleur, si vraiment les pouvoirs publics ne veulent pas se fouler. Parfois il y a des travaux, et on ne dirait même pas qu’il y a eu des travaux ; c’est triste. La ville change bien qu’elle ne change jamais. On vit toujours dans des simili-villes, alors qu’on pourrait vivre dans des forêts. Moi si je pouvais, si j’étais maire, je casserais toute ma ville pour créer des maisons dans les arbres qui communiqueraient à l’aide de ponts suspendus. Ça serait quand même autre chose. Au moins, ça serait pas des travaux pour rien.
Rivage au rapport est un texte qui se construit plus lentement que le précédent. Il y a quelques semaines, je pensais même l’abandonner ; mais simplement, je n’étais pas dans le bon état d’esprit, dans la bonne appréhension de ce projet. Il se compose par morceaux que je rajoute progressivement à divers endroits, sans visualiser pour autant ce qui les lie. Je sais ce que je veux faire avec Rivage, mais ne sais pas encore comment y arriver.
K. Dick est une espèce de bébé génial.
« La réalité a ici une qualité plastique, non dans le sens habituel de ce mot, mais plutôt changeante et à moitié transparente, comme si parfois on pouvait voir des ruines. […] L’univers est en carton, et si on s’appuie trop longtemps ou trop lourdement dessus, on passe au travers. » – Philip K. Dick, La fille aux cheveux noirs.
En lisant La fille aux cheveux noirs, une sorte de recueil de lettres écrites par K. Dick à certaines femmes de sa femme (sur le tard, apparemment), j’ai un peu honte pour lui. Il y a quelques années, j’avais déjà lu dans la biographie de Carrère qu’il avait eu beaucoup de femmes, la plupart du temps aussi défoncées et paranoïaques que lui (c’est le souvenir que j’en ai). Je crois que sa dernière femme l’a beaucoup soutenu. Je ne me souviens plus de son nom. K. Dick souhaite à tout prix une stabilité (affective, quotidienne), mais je pense que la stabilité se contrefout de K. Dick. Il aime bien quand ses chemises sont repassées et quand on lui a fait la cuisine. Il était malade, je ne suis pas indulgent. Il parle comme un vieux pervers qui tombe amoureux de la moindre fille un peu originale ayant vingt ans de moins que lui. Il est triste et il est terriblement seul, et la solitude le rend dégueulasse, je veux dire pourri, un peu vicieux. Évidemment, les filles s’en foutent et se barrent, parce qu’il est fou et qu’il est vieux ; c’est normal. C’est aussi un manque d’intelligence de la part de l’éditeur que de ne pas avoir daté les lettres ; on a l’impression qu’il accumule les déclarations d’amour. Il s’est peut-être passé des années entre chacune. Je suis triste pour lui, j’ai l’impression qu’il va crever loin de tout (ce qui arrivera). Après être mort il sera célèbre et des femmes l’aimeront.
« Imagine un peu : tu es conscient, mais pas vivant. Tu vois, et même tu comprends, mais tu ne vis pas. Tu as le nez collé au carreau. Tu reconnais les choses, mais ça ne fait pas de toi un vivant. On peut mourir et durer encore. Parfois, ce qui t’observe derrière les yeux de quelqu’un est mort dans l’enfance. C’est mort et c’est là, et ça regarde toujours. Ce n’est pas simplement le corps, sans rien dedans, qui te regarde ; non, il y a encore quelque chose à l’intérieur qui est mort depuis longtemps mais continue à regarder au-dehors, et regarde et regarde encore sans pouvoir s’arrêter. »
Une galerie d’art qui exposerait dans les mêmes salles les tableaux d’Adolf Hitler et les oeuvres amateures des déportés exterminés.
Dans mon verre il y a de l’eau mais je ne la bois pas, car elle est polluée et je ne voudrais pas mourir.
« — Pas mal, mais celle-là, on me l’a déjà faite. Tout le monde me baise. » Elle se reprit. « Essaie de me baiser, en tout cas. C’est comme ça, quand on est une fille. En ce moment, je poursuis un mec en justice. Pour outrage et voies de fait. On réclame quarante mille dollars de dommages.
— Jusqu’où il a été ?
— Il m’a palpé un sein.
— Ça vaut pas quarante mille. » — Philip K. Dick, Substance Mort.
« Peut-être n’y a-t-il aucun meurtrier, soupira Rivage, peut-être n’y a-t-il même aucun meurtre. Peut-être n’y a-t-il qu’une suite de morts sans cause qui ponctuent mon chemin et terrifient les habitants. À moins que les habitants n’en savent rien, à moins qu’ils ne se doutent même pas de l’enquête que je mène. Au fond, peut-être que personne n’est au courant de l’enquête que je mène, que personne ne s’en soucie. Le commissaire ne m’appelle plus. Ils doivent imaginer que je suis mort moi aussi. » Aucun meurtrier, aucun meurtre, écrivit l’assistant avant de le souligner d’un trait. « Ne perdez pas espoir, inspecteur », lui dit-il ensuite. « Mon intuition, c’est qu’il y a toujours des morts à trouver quelque part. »
J’ai fini ma lecture de Mantra, qui m’a laissé la même désagréable impression qu’Abattoir 5. Les cent-cinquante premières pages sont excellentes et jusqu’à la moitié du roman j’étais intrigué et intéressé. Mais passé ce cap, je n’ai plus bien compris pourquoi je lisais ce livre, ni ce qu’on espérait me raconter comme histoire. Je me trouvais face à une débauche de références et de termes obscurs dont je ne parvenais pas à percer le sens. Peut-être est-ce Mexico qui veut ça.
Il fait 27,7 degrés dans l’appartement.
Vers les trois heures du matin, je suis persuadé d’avoir entendu une camionnette stationer au bas de l’immeuble, et un ou deux de ses occupants rentrer par effraction dans un des appartements du dessous.
« Quant à moi, je reste ici à jamais, vivant une autre histoire mexicaine qui fait partie de celle de Mexico. Je deviens une nouvelle locataire de l’enfer bourré de téléviseurs des suicidés subliminaux. J’ai un trou dans le front et j’entends le bruit de houle que fait la balle lorsqu’elle entre dans ma tête. »
Par exemple, on s’extasie souvent devant la quantité de livres qu’une librairie contient. Pourtant, de mon expérience, les librairies contiennent assez peu de livres. Je dirais même qu’il y a plus de livres hors des librairies que dans les librairies ; que les librairies font le minimum du travail requis. Quand je vois la quantité de livres que j’ai besoin de commander aux librairies pour qu’elles les aient, je me demande quels livres les librairies possèdent pour en même temps contenir une telle quantité de livres qu’elles donnent l’illusion de l’illimité, et en même temps ne jamais avoir ceux que je souhaite. Quel temps je perds à attendre tous ces livres que les librairies ne possèdent pas. Je suis sûr que les gens n’entendent jamais parler de certains livres tout simplement car les librairies ne les ont pas, car les librairies enflent leurs rayons avec des doublons de livres qu’elles ont déjà et qui en plus sont terriblement mauvais. Voilà le terrible constat : les libraires sont toutes pleines de répliques du même livre épouvantable que personne n’achète, et surtout pas moi. Les libraires sont toutes pleines à craquer d’excellents livres qu’elles n’ont pas, et que personne n’achète sinon moi qui ai la patience de les commander. Plus je commande des livres aux librairies et plus je me rends compte qu’elles n’ont rien, que je suis obligé de faire le travail à leur place. Il ne leur coûterait pourtant rien de suivre mes commandes et de les prendre comme des conseils, mais cela, elles ne le font jamais, elles se contentent juste de regarder passer les chiffres de vente et elles se satisfont de cela. La possession des livres est une question qui a beaucoup intéressé les romanciers de science-fiction. Dans leurs romans, jamais les librairies ne sont mentionnées comme sauveuses des livres. Ce sont les lecteurs qui sauvent les livres, ce sont ces lecteurs comme moi qui commandent les livres et les conservent chez eux qui sauvent l’humanité. Les librairies vendent des livres, et vendent les livres qui se vendent le mieux, c’est une simple question de marché. Les librairies sont des commerces et elles n’ont aucune autre ambition que marchander de mauvais livres à des prix démesurés pour le peu de choses qu’ils contiennent. J’en mets ma main à couper : n’importe quelle bibliothèque de votre entourage est une meilleure librairie que la meilleure des librairies que vous fréquentez.
Je suis né en 1991. Je viens de découvrir le style musical varporwave. C’est un style qui réutilise les ambiances sonores des années 1980 et 1990, notamment des publicités et des animés japonais, pour composer des morceaux la plupart du temps redoutablement mélancoliques. Ces morceaux sont souvent accompagnés de clips réalisés dans la même esthétique. Il y a par exemple un artiste dont le nom est Saint Pepsi ; j’adore ce nom, je le trouve génial. C’est un nom que j’aurais aimé inventé et qui me parle immédiatement. Il y a tout dans Saint Pepsi. D’autres s’appellent Vector Graphics, ESPRIT 空想, Macintosh Plus, etc. Ce sont de parfaits noms de personnages. Il faudrait des romans dont les personnages s’appellent Saint Pepsi et Vector Graphics. Ça manque cruellement. Je pense que des personnes nées en dehors des années 80 et 90 ne peuvent pas imaginer de tels personnages. Macintosh Plus serait pourtant un parfait inspecteur de police.
J’ai jeté aux égoûts une quantité astronomique de lait de soja jamais bu.
(Cette dernière phrase me plaît. C’est pourtant une phrase qui ne va nulle part, ne dit rien, et dont je ne me servirai sûrement jamais dans le futur, mais son rythme et son agencement me plaisent. Il suffit parfois d’agencer correctement des mots pour être satisfait de son travail. Une phrase ne se mesure pas forcément à l’aune du sens (profond) qu’elle dégage, ou de la pensée qu’elle inspire ; il suffit qu’elle soit construite correctement. Le façonnage lui confère une valeur. Et cette valeur lui confère un sens. Peut-être est-il seulement dissimulé sous les termes égoûts, astronomique et soja. Quand le rythme est présent, ce qui reste n’est plus qu’une question de synonymes.)
« Question : de quelle catégorie relève la photo d’un vivant qui, en dehors du cliché, est mort ? »
Ce n’est pas parce qu’on vous dit que c’est bien que c’est bien.
Je suis fasciné par tous ces auteurs qui tiennent des journaux sans aucun déchet.
Le camion manoeuvra lentement sur le parking désert. Le gardien n’avait pas été averti qu’aucun camion devait stationner sur le parking ni arriver au milieu de la nuit, mais c’est pourtant ce qu’il fit : arriver au milieu de la nuit pour stationner sur le parking désert que surveillait le gardien. Le gardien avait levé la barrière pour laisser le camion passer car le conducteur agissait selon les ordres du Roi, et le gardien ne discutait pas les ordres du Roi, même les ordres indirects, même les ordres qui lui parvenaient au terme de dix intermédiaires ; le gardien ne discutait rien qui pouvait provenir de la bouche du Roi. La plupart des plans du Roi dépassaient absolument le gardien, qui n’était au fond personne dans la hiérarchie des hommes de main du Roi, et qui n’était tenu informé d’aucun de ses plans ni d’aucune de ses actions. Le gardien devait se contenter de surveiller le parking. Ce qui avait toujours étonné le gardien, c’est que jamais personne n’avait utilisé ce parking, jamais personne n’avait même cherché à s’en approcher, jamais il n’avait au fond compris pourquoi il devait surveiller ce parking, pourquoi le Roi le payait pour veiller sur un terrain isolé et abandonné. Depuis neuf ans qu’il travaillait comme gardien pour le Roi, jamais il n’avait vu la moindre voiture s’aventurer dans les parages, c’est-à-dire sous cette bretelle d’autoroute perdue dans une zone périphérique de la ville. Le gardien n’était pas payé cher pour surveiller le parking mais les horaires et la fonction le satisfaisaient. Le gardien avait l’obligation de surveiller sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre le parking, faute de quoi les hommes du Roi se chargeraient de lui ; c’est en tout cas la manière dont ils avaient présenté les choses avant qu’il ne signe son contrat. Dès son premier jour, ils avaient installé une caméra dans sa cabine qui depuis le surveillait sans interruption, bien qu’il ne sut jamais qui était chargé de le surveiller pendant que lui surveillait le parking. Maintenant qu’il y pensait, jamais même il n’avait remarqué de cables partant de sa cabine pour relier un quelconque centre de contrôle. Il s’y était fait et n’y avait plus pensé. Parfois on l’avait appelé pour lui demander de nettoyer le parking ou de remplacer les ampoules des lampadaires. Parfois il avait cru apercevoir des animaux sauvages courir sur le bitume inoccupé. Trois nuits après la venue du camion, deux inconnus firent un bref signe de tête au chauffeur avant de monter dans la remorque du camion. Au terme de neuf ans d’ennui et de silence, enfin il semblait se passer quelque chose. Le gardien, curieux, avait discrètement regardé les deux hommes refermer la porte de la remorque derrière eux. Il commençait déjà à regretter son ancienne vie.
(D’abord, mettre en place la scène. Ensuite, la travailler.)
« María-Marie : hier j’ai vu un type nu qui courait dans les bois de Chapultepec en criant que c’était la fin du monde. Il est descendu par les créneaux du château, enveloppé dans un drapeau pirate, le visage caché sous un masque de tête de mort. » – Rodrigo Fresán, Mantra.
Arrivé en retard, l’inspecteur s’installa tout à fait au fond de la salle qui accueillait ce jour-là les amateurs de tapis. Les amateurs de tapis se trouvaient tous assis sur des chaises pliables, chacun enroulé dans son tapis personnel, « comme d’immenses saucisses cabossées » pensa l’inspecteur, éparpillés en divers endroits de la pièce, face à l’estrade qui accueillait le gourou des amateurs de tapis, un homme d’une cinquantaine d’années qui invitait les amateurs de tapis les uns après les autres pour venir exprimer leur amour des tapis au micro, pour témoigner de leur parcours social d’amateur de tapis aux autres amateurs présents dans la salle. De ce que l’inspecteur comprit, ces amateurs n’aimaient pas tant les tapis pour leur fonction de tapis (à savoir : décorative) que pour la sensation de chaleur qu’ils éprouvaient en les maintenant enroulés autour d’eux. « Mon tapis est comme un cocon », confia l’un d’entre eux au micro, ému, ce qui ne manqua pas de faire rire l’inspecteur, suite à quoi le gourou d’une cinquantaine d’années, qui s’était étonné plus tôt de la présence de cet homme sans tapis, lui demanda de bien vouloir quitter la salle pour ne pas gêner et heurter la sensibilité des présents. Dehors, l’inspecteur se demandait comment pouvait venir l’idée d’un jour s’enrouler dans un tapis, comment cela avait pu traverser l’esprit d’autant de personnes différentes, comment on pouvait favoriser le tapis à l’aide médicale, qu’est-ce qui amenait une civilisation à ne plus avoir confiance qu’en ses tapis et plus du tout en son expertise scientifique. Une fois la séance terminée, l’un des présents s’arrêta à hauteur de l’inspecteur. « Moi aussi au départ je riais parce que j’avais honte, commença-t-il, parce que je n’osais pas m’avouer mon besoin viscéral de tapis. Mais vous verrez, vous y viendrez un jour vous aussi. Vous comprendrez les bienfaits du tapis. » Puis il lui tendit une carte de visite comprenant les coordonnées d’un centre d’aide spécialisé dans les bienfaits du tapis. L’inspecteur rangea la carte dans sa veste et demanda à l’amateur de tapis s’il pouvait parler à leur chef. L’amateur de tapis signala à l’inspecteur qu’il ne s’agissait pas de leur chef, qu’il préférait le terme de catalyseur, qu’il se faisait d’ailleurs appeler Le Catalyseur, et qu’il devait être en train de ranger la salle avant de partir, à moins qu’il ne prodigue encore quelques conseils à ceux. L’inspecteur le remercia sans écouter la fin de sa phrase et se dirigea en vitesse vers la salle. Les chaises et le matériel audio avaient été rangés ; plus personne ne se trouvait sur l’estrade. Le gourou s’était enfui par une porte dérobée.
« Il se fait appeler Le Catalyseur, lui dit-il, ça te rappelle quelque chose ? » Le Catalyseur, nota l’assistant dans son carnet avant de répondre non, rien à l’inspecteur. « Enquête là-dessus, et appelle-moi si tu trouves une piste. » « Faites attention à vous inspecteur, vous savez comment ces choses-là finissent. » Il y eut un bref silence puis l’inspecteur raccrocha.
Tout à l’heure, je rangeais ma bibliothèque, notamment le rayon Bolaño, je faisais de la place pour intercaler trois nouveaux ouvrages, et dans la manipulation j’ai déplacé 2666, et tout en le déplaçant je l’ai rouvert. Je ne l’avais pas rouvert depuis cet été, après l’avoir lu d’une traite, je l’avais fermé et je l’avais rangé dans ma bibliothèque, à un autre endroit que là où il est actuellement (avec le reste des romans traduits de Bolaño). Je l’ai rouvert un instant, je l’ai feuilleté un peu, le livre pèse vraiment très lourd en grand format, et je me suis repris à me dire, comment peut-on écrire un truc pareil, et même, comment peut-on le conserver, comment peut-on le laisser là mine de rien dans sa bibliothèque, et inviter des gens qui sans doute passeront à côté sans se douter un seul instant de ce qu’il renferme, qui feront comme si de rien n’était, comme si ce roman n’existait pas, parce qu’il vaut sans doute mieux pour eux qu’il n’existe pas en effet, car il contient l’enfer-même, et cela je crois qu’il faut un certain temps pour le comprendre, je crois qu’il faut l’avoir lu puis l’avoir oublié puis l’avoir rouvert par hasard en rangeant sa bibliothèque pour s’en apercevoir, et je crois que Bolaño le savait pertinemment tout en l’écrivant, que sa taille repousserait la plupart des lecteurs et des non-lecteurs, la plupart des citoyens de notre monde, et sans doute même parmi les lettrés qui prétendent l’avoir lu sans doute ne sont-ils qu’à peine une poignée à vraiment l’avoir fait, car ce livre est la mort et le chemin pour y parvenir et toute la jungle de souffrance qu’il faut traverser pour atteindre le mal absolu. Il trône là comme un livre noir ; il émane parfois. On ne peut pas faire semblant de ne pas le voir.
Mon astuce, c’est de toujours aborder mes sujets métaphysiques par la marge. Par exemple, si on veut parler d’amour, une bonne porte d’entrée est sans doute de traiter en premier lieu des endives au jambon. Les endives au jambon paraissent bien éloignées de l’amour et pourtant, à force d’exploiter le sujet des endives au jambon, on finit par parler d’amour, et bien mieux d’ailleurs qu’en parlant d’amour d’emblée. En parlant d’amour d’emblée, une chose est sûre, c’est qu’on ne finit jamais par parler des endives au jambon, et c’est bien malheureux. Bien sûr, la plupart du temps, en lisant le livre qui parle d’amour, on ne voit plus aucune trace des endives au jambon, et c’est là tout le talent du romancier que de dissimuler ses endives au jambon dans son roman sur l’amour. Personne n’a envie de voir des endives au jambon alors qu’on parle d’amour ; les endives au jambon sont la dernière chose à laquelle on aime penser quand on fait l’amour, ou quand on parle d’amour. Les endives au jambon sont pourtant la base de tout amour, de tout éloge de l’amour même. Tous les romans de Marguerite Duras sont des variations sur un plat d’endives au jambon, différents plats de différentes endives enroulées autour du même jambon. Évidemment, dire de Duras qu’elle est la romancière des endives au jambon n’est ni très vendeur, sauf dans les rayons consacrés à la cuisine, ni particulièrement poétique, car les endives au jambon n’ont rien de la poésie, elles ne permettent aucunement d’atteindre ni à la poésie ni au sublime ; les endives au jambon ne sont un tremplin que vers l’amour, et c’est déjà beaucoup qu’elles nous donnent, quand on y pense. Ces endives au jambon pourraient aussi bien ne rien receler. Les endives au jambon pourraient n’être que des confits de canard, c’est-à-dire un vulgaire plat sans saveur. Les confits de canard ne mènent à rien en littérature. Méfiez-vous des confits de canard, voilà ma meilleure astuce, la plus primordiale : éloignez-vous des confits de canard, car ils ne vous apporteront que du malheur, et surtout pas de la littérature. Les confits de canard, notez bien mes mots, sont l’antithèse de la littérature, ils sont la négation absolue de tout écrit, ils sont l’absence même de poésie dans ce monde. J’espère que vous saurez faire bon usage de ces quelques conseils.
Pour ce qui est de l’écriture, je me suis toujours considéré comme un pillard. J’ai l’impression que mes livres sont la fusion imparfaite de deux autres auteurs lus auparavant. Saccage serait Duvert et Volodine (même si je n’ai pas voulu me l’avouer au départ) ; La Ville fond serait Bernhard et Katchadjian. Rivage au rapport est forcément Bolaño, mais il me faut encore trouver l’autre influence manquante.
Ma mère a publié sur Facebook la dédicace que je lui avais faite dans mon premier livre (pas Saccage, l’autre premier). Je ne me souvenais même plus ce que je lui avais écrit ; ça date de plus de trois ans. J’ai ressenti une honte intense en voyant ce mot que je n’avais écrit que pour elle ainsi exposé aux yeux de tous. Et j’ai trouvé ça honteux de sa part de l’avoir fait. Je ne sais pas ce qu’elle espère trouver en faisant cela. Montrer à quel point je l’aime toujours alors que je ne la vois plus, peut-être. Parader auprès de ses connaissances pour je ne sais quelle raison qui m’échappe encore une fois, peut-être. Ma mère est une des personnes les plus maladroites et plus indélicates que je connaisse. J’en regretterais presque de lui avoir écrit la moindre chose. C’est à quel point ma mère m’irrite.
Après l’obtention par Volodine du Prix Albertine pour Bardo or not Bardo, le journal La Presse a décrit ce livre comme une collection de vignettes surréalistes. Surprenant.
Le fantasme de tout écrivain : faire de son expérience de mort un produit commercial. (Être presque mort, c’est toujours s’assurer quelques ventes ; je devrais y penser à l’avenir.)
Je vais continuer à rassembler les éléments pour cette histoire, et peut-être que son sens général finira par se dégager. Pour l’instant, je n’ai aucune idée d’où je vais, absolument comme mes personnages. D’abord, je crois que je voulais faire quelque chose de drôle, maintenant je n’en suis plus trop sûr, j’aimerais bien faire autre chose. J’aime bien l’inspecteur et son assistant mais j’ai l’impression qu’ils sont constamment en train de mourir. La ville n’a aucune forme ; ils progressent comme des spectres.
« Alors, qu’est-ce que c’est qu’une écriture de qualité ? Eh bien, ce que ça a toujours été : savoir mettre la tête dans l’obscur, savoir sauter dans le vide, savoir que la littérature, fondamentalement, est un métier dangereux. Courir au bord du précipice : d’un côté l’abîme sans fond et, de l’autre, les visages que l’on aime, les visages souriants que l’on aime, et les livres et les amis et les repas. Et accepter cette évidence, même si parfois elle pèse sur nous plus lourd que la dalle qui recouvre les restes de tous les écrivains morts. » – Roberto Bolaño, Entre parenthèses.
J’ai rouvert un carnet de mon adolescence qui était resté chez mon père. C’est vraiment épouvantable. Tout ce que j’y ai écrit, je veux dire ; épouvantable. Déjà, quand parfois il m’arrive de relire les pages des années passées, ma pensée me déprime. Mais là, durant l’adolescence, quelle horreur, quel enfer. Il faut vraiment du travail, constamment travailler, pour se sortir de l’insignifiance dans laquelle on barbotte. Il faut vraiment perpétuellement ne pas abandonner, se faire violence à soi-même, se haïr souvent, car sur le moment on ne se rend absolument pas compte de notre médiocrité, on est souvent même plutôt satisfaits, mais il suffit d’un peu de temps, et tout est annulé, et alors la vérité saute aux yeux, et cette vérité déprime au plus haut point, cette vérité c’est notre nullité profonde et absolue, notre nullité perpétuelle.
Rivage s’engagea dans l’allée. Les deux meurtriers discutaient tout au fond, à l’ombre d’un mur de briques qui semblait faire impasse. L’un s’en prenait à l’autre en le poussant au niveau de la poitrine. Rivage s’approcha lentement. Alors qu’il s’estimait assez proche pour décliner son identité et leur crier qu’ils étaient en état d’arrestation, les deux meurtriers s’aperçurent qu’ils étaient observés et s’enfuirent en courant par une porte débordée donnant dans l’arrière-cuisine du Cabanon. Rivage courut à leurs trousses tout en jurant contre les meurtriers qui avaient décidément une fâcheuse tendance à fuir, puis contre les employés du Cabanon qui semblaient s’ingénier à compliquer son passage, l’un des cuisiniers manquant même de lui clouer un pied au sol après avoir lâché son couteau de chef. Arrivé dans la salle principale, Rivage ne vit plus rien sinon une danseuse entièrement nue suspendue à une barre verticale. Les néons du bar dessinaient sur son corps des tatouages abstraits ; à ses pieds l’estrade semblait faite d’eau. Une dizaine d’hommes immobiles observaient le spectacle depuis leurs tables. L’un d’entre eux tourna lentement son visage et croisa le regard de Rivage, puis revint sur la danseuse à présent assise sur le sol, les jambes écartées de part et d’autre de la barre métallique. Rivage tenta de distinguer ses suspects dans la pénombre mais aucun visage ne lui revenait. Plus il observait ces étrangers et plus sa mémoire s’embrouillait ; un bris de verre le fit se retourner ; on avait pulvérisé des bouteilles derrière le comptoir. Il fut pris de nausées, la danseuse s’articulait toujours dans les airs, les hommes immobiles la fixaient, leurs yeux noirs comme des billes de plomb, et l’obscurité dans la pièce bientôt atteignit Rivage. Il s’effondra sur le sol. Quand il se réveilla, il faisait grand jour et tous les inconnus de la veille avaient quitté la salle. Son assistant était allongé à ses côtés et lui demandait où étaient passés les meurtriers. Rivage se redressa. « Tu le vois comme moi, lui dit-il, il n’y a plus rien par ici… » L’assistant s’empressa de sortir son carnet de sa poche. Il n’y a plus rien par ici, inscrit-il.
Ne cherche-t-on pas parfois dans l’amour cette absence d’amour qui pousse au vide et à la solitude de notre vie.
Quand il vit quel numéro s’affichait sur l’écran, Rivage préféra ne pas décrocher. Il reposa le téléphone sur la commode, où il vibra un temps, puis s’immobilisa. Rivage fixait l’objet en silence. Sur son répondeur, une femme était en train d’avouer qu’elle l’aimait.
« Rivage, c’est moi », commençait la voix. L’assistant se tenait prêt à transcrire le message, mais la voix continuait de parler et l’assistant ne notait rien. « Inspecteur, dit-il à Rivage tout en maintenant le téléphone à son oreille, il y a une femme au téléphone qui dit qu’elle vous aime ; est-ce que je dois le noter ? » Rivage saisit son manteau et quitta la pièce sans lui répondre. L’assistant continua d’écouter la voix qui se confiait à Rivage. Quand il se décida enfin à utiliser son stylo, le message touchait à sa fin. Rivage, je sais que tu es là… fais attention…, écrivit-il dans son carnet avant de raccrocher.
« Je suis allé à la cuisine et j’ai rempli un verre d’eau. Je l’ai bu jusqu’à la moitié et j’ai posé le verre sur la table. Du bout des doigts, j’ai caressé le rebord humide, là où j’avais bu, comme si je palpais mes lèvres. Je suis retourné au lit et j’ai cherché la main d’Ana. Je suis resté comme ça, allongé sur le dos, tenant sa main. Le plafond était invisible. Peut-être que la Troisième Guerre mondiale va éclater bientôt, ai-je pensé. » — Roberto Bolaño & A.G. Porta, Conseils d’un disciple de Morrison à un fanatique de Joyce.
Par exemple, on cherche souvent une bonne idée. On ne sait pas trop si on cherche plutôt la bonne idée ou la bonne façon de la raconter. Souvent, on ne sait pas tellement par quel bout commencer. On a l’idée parfois et puis pas la bonne façon de la raconter, et finalement la bonne idée ne devient plus qu’une idée, puis plus une idée du tout, juste un regret. Parfois on trouve une bonne façon de parler d’une idée pourtant banale, pourtant anodine et dérisoire, mais finalement, après l’avoir racontée, cette idée n’en demeure pas moins banale et dérisoire, peu importe la façon d’en parler. Il est très dur de conjuguer la bonne idée et la bonne façon d’en parler ; c’est même le plus dur je crois. La plupart du temps on reste là à ne rien faire parce qu’on est paralysé par notre absence de bonnes idées et notre totale incapacité à raconter correctement. Nous sommes de piètres conteurs, il faut le reconnaître. Nous sommes de piètres penseurs et de piètres conteurs, et les deux cumulés forment notre humanité. Parfois il y a de bons conteurs et de bons penseurs qui se détestent car ils se jalousent et finalement ils se haïssent jusqu’à la mort dans l’aigreur et le désespoir. Le penseur jalouse toujours le conteur et inversement. Seul l’idiot ne jalouse personne car il est parfaitement satisfait de sa situation. Les idiots sont de parfaits penseurs et de parfaits conteurs car ils se contentent de leurs idées bancales et de leurs discours fallacieux, ils estiment même avoir là des idées géniales et des discours géniaux et ils s’en vantent auprès de leurs confrères idiots, et parfois même auprès des véritables conteurs et des véritables penseurs qui pensent alors que ces idiots sont de grands penseurs et de grands conteurs, lors qu’ils ne sont que des idiots. Souvent pour accorder une bonne idée à une bonne façon de raconter, il suffit de faire l’idiot ; pour la plupart des choses, être idiot suffit.
On s’attend toujours au meilleur, et on récolte toujours le pire.
Par exemple, extrapoler au maximum sur les résultats du second tour est le meilleur moyen de se donner bonne conscience. Apparemment, un large résultat en faveur d’Emmanuel Macron aurait montré que personne ne croyait en lui et qu’il n’avait plus qu’à se méfier des citoyens. Apparemment, à l’inverse, un résultat serré aurait montré qu’un vote d’adhésion de ses partisans suffisait à l’emporter, et il s’en serait gargarisé. Le résultat moyen qu’Emmanuel Macron a obtenu ne montre pas grand chose car il n’est ni serré ni large, si bien qu’il ne doit finalement en tirer aucune conclusion, il doit juste se satisfaire de la situation. Les votes blancs et l’abstention montrent cependant que la victoire n’était pas aussi large qu’il aurait pu l’espérer. Plus ou moins de votes blancs et d’abstention auraient sans doute voulu dire tout autre chose. Obtenir le pouvoir avec 50,01% ou avec 100% ne change rien au fait qu’on a le pouvoir. Le pouvoir est le pouvoir peu importe les chiffres. Je me demande si Emmanuel Macron se questionne sur les résultats du second tour maintenant qu’il a le pouvoir. Je pense qu’Emmanuel Macron doit surtout se dire : désormais, j’ai le pouvoir, et qu’il doit bien se moquer des résultats. Emmanuel Macron doit surement trembler d’imaginer autant d’abstention, de votes blancs et de votes utiles maintenant qu’il a le pouvoir et qu’il peut nasser les manifestants à l’aide de ses compagnies de CRS. On essaie toujours de se convaincre qu’on fait la bonne chose. Se convaincre qu’on fait la bonne chose montre déjà qu’il y a de grandes chances qu’on ne fasse pas la bonne chose. Il n’y avait pas grand chose de bon à élire Emmanuel Macron, peu importe le pourcentage avec lequel il était élu. La seule bonne chose qu’il y avait à élire Emmanuel Macron était que cela empêchait à Marine Le Pen d’être élue. Il ne faut pas oublier cela je crois : il n’y a rien de bon derrière l’élection d’Emmanuel Macron. On pourra extrapoler très longtemps sur les pourcentages de vote, mais il ne faudra jamais oublier qu’avoir Emmanuel Macron au pouvoir n’est bon sur aucun plan.
Peut-être a-t-il éteint la télévison, fermé son ordinateur. Ensuite, il s’est sans doute dirigé vers sa chambre où sa femme l’attendait déjà, couchée dans leur lit en train de feuilleter un livre quelconque ou une revue de la veille. Il est passé par la salle de bain dans laquelle il s’est brossé les dents en détaillant son visage. Peut-être a-t-il appliqué une crème hydratante de nuit sur son visage car il l’avait particulièrement sec. Il devait discuter de choses et d’autres avec sa femme toujours allongée dans la pièce voisine. Il s’est déshabillé et a enfilé un pyjama chaud mais pas trop, car nous sommes en mai et les températures s’adoucissent. Il a sans doute pensé lire un peu, mais finalement il s’est contenté de regarder les dernières nouvelles sur son téléphone, et puis le sommeil est arrivé assez vite. Sa femme avait déjà éteint sa lampe de chevet. Il a fait de même et puis lui a dit : Allez, bonne nuit ! Demain, je serai président !
Maria, gardienne d’un gosse au nom d’archange.
Je viens d’apprendre que le journal Sud Ouest et la librairie Mollat s’associaient pour créer un prix littéraire : le Prix du livre du réel. Selon le site de la librairie Mollat qui détaille les conditions de ce prix, les livres du réel seraient « un genre peu reconnu en France ». Il me semble pourtant que c’est exactement l’inverse à quoi l’on assiste, qu’on n’a jamais autant vu de romans se réclamer du réel, si bien qu’il n’est plus possible que quoi que ce soit existe sans qu’on nous demande de quels faits sont inspirées nos histoires, si les personnages ont véritablement existé, et si au fond, le narrateur, ce n’est pas nous. La littérature est boursouflée de réel, et les journalistes se jettent tous dessus comme des idiots. On n’en peut plus du réel ; vivement sa fin.
J’habitais des chambres tristes dans des hôtels sordides à force d’être pauvre, et qui se ressemblaient tous. Des chambres que je partageais quelques fois avec des garçons dans la même situation que moi.
« Rosmarino redoute l’arrivée des ténèbres, par jour de beau ou de mauvais temps, car la nuit fait de son espace une tache noire, mal éclairée ici et là par les lumières d’une maison, puis tout s’éteint et l’obscurité envahit son coeur d’écrivain. Jamais auparavant il n’a si bien senti que le paysage comble l’absence des êtres dont la compagnie lui manque. » – Harry Laus, Sentinelle du néant.
Je suis en train de lire Le Troisième Reich ; en le lisant je me dis : tout a l’air si simple. Tout est mélancolique au plus juste. Bolaño parfois je me dis est l’auteur parfaitement mélancolique, tous ses ouvrages sont purement mélancoliques, ils ne produisent que de la mélancolie (et d’autres choses aussi parfois, mais ayant pour but la mélancolie). C’est très compliqué de toucher autant du doigt un sentiment aussi complexe. C’est son génie je crois. C’est ce qui fait de Bolaño un écrivain indispensable.
Par exemple, il m’arrive pendant un ou deux jours d’oublier de boire. Je trouve ça incroyable d’oublier aussi facilement de faire cette action pourtant vitale : boire. Il se passe deux jours et je me dis : tiens, je n’ai toujours pas bu. Bien sûr, certains signes indiquent ce manque évident d’eau dans mon organisme, comme des maux de tête, ou une plus grande fatigue. Si je ne suivais pas ces signes, peut-être oublierai-je de boire totalement. Au fond, c’est vraiment un privilège de pouvoir oublier de boire, car la plupart des gens n’oublient pas et meurent simplement de n’avoir pas bu. Il faut vraiment être distrait pour ne pas boire davantage. Je ne pourrais jamais oublier de dormir par exemple. Un peu manger, mais surtout pas dormir. Boire oui, je peux oublier. Je ne sais pas si les autres oublient également de boire. Si tout le monde n’est pas constamment assoiffé à cause de notre permanente distraction des besoins vitaux. On se rappelle parfois que l’on vit car l’on est assoiffé, c’est un étrange rappel. Je me dis : c’est vrai, si je ne bois pas, au fond, je meurs. C’est me tuer que de ne pas boire, c’est incroyable. Nous nous tuons tous constamment faute de boire suffisamment. Nous sommes tous perpétuellement assassinés par notre paresse profonde. Il m’a fallu un sacré recul pour envisager cela. Peut-être la plupart des personnes que je croise dans la rue ne se rendent-elles pas compte être dans la même situation que moi, être perpétuellement assassinées ; peut-être est-ce pour cela que nous sommes tous aussi tristes et aussi affectés par la moindre contrariété, car au fond nous ne buvons simplement pas assez, car au fond nous ne faisons que nous tuer.
Drôle de résolution : un email transféré par mes éditeurs m’apprend que j’ai remporté le Prix Littéraire des Grandes Écoles. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Les bookmakers anglais sont sûrement en larmes à l’heure où je vous parle. C’est un beau message pour la jeunesse : partez perdants. En n’ayant aucune chance, on se donne les meilleures chances. C’est ce que me disait mon vieux père, je me souviens, alors qu’il se balançait dans son fauteuil à bascule, sur la terrasse de notre maison du Mississippi : pars perdant mon fils, ainsi tu auras tes meilleures chances. Et il disait vrai, ce bon vieux père qui tout en se basculant sur son fauteuil fumait la pipe et méditait, le regard tourné vers les étoiles. Il disait vrai et je ne l’avais jamais écouté car il me semblait ivre et idiot. Pourtant il disait vrai. Comme disait mon vieux père souvent : heureux sont les fêlés car ils laissent passer la lumière. Voilà qui était particulièrement juste, vraiment habilement noté et poétique. Sans doute pourrais-je faire un roman de mon vieux père dans son fauteuil à bascule. Un roman à la fois poétique et cruel sur la vie, qui déboucherait sur cette belle morale : mieux vaut partir perdant. Dans les grandes étendues désertiques du Mississippi, sans doute que ça rendrait de manière vraiment poétique et réelle. Peut-être de vieux pompistes pourraient-ils cracher dans des bidons d’acier. Peut-être un héros handicapé et sportif pourrait-il découvrir cette morale au terme d’un périple émouvant : il suffisait de partir perdant. Lui qui s’ingéniait à surmonter ses différences pour l’emporter, il oublait le plus important : ne pas tenter de l’emporter. Ce jeune héros sportif et handicapé pourrait être moi ; et mon vieux père un entraîneur sadique mais juste car profondément sensible. Montaigne lui-même n’aurait jamais pu le deviner, qu’il suffisait de partir perdant. D’après ma lecture, c’est ce que les Essais tentent de dire, qu’il faut partir perdant, mais ils ne parviennent qu’à peine à le dire. Montaigne semble passer complètement à côté de son propos, à savoir partir perdant, et tourne autour pendant 3000 pages pour finalement dire tout autre chose, mais pas le plus important. C’est ce qui fait des Essais une oeuvre râtée, à mon avis ; qu’elle ne dise pas ce qu’elle devait dire. Là voilà je le répète enfin, je fais comme qui dirait le travail de Montaigne : partez perdants. Ça vaut bien trois volumes de philosophie, c’est l’évidence même : doutez, perdez, abandonnez, vous gagnerez.
Une fois dans un rêve je suis mort et quand je me suis réveillé je vivais toujours.
Tous ces photographes amateurs qui prennent à leur insu des lecteurs dans le métro, mais toujours aucun photographe amateur pour prendre ces photographes amateurs à leur insu dans le métro…
Il vit le chien emporté par la mer et son maitre accourir sur la plage. Ils étaient seuls ; la femme se tenait allongée sur le sable. Le maitre faisait de grands gestes sur le rivage et les vagues s’écrasaient au bas de son pantalon. Le chien semblait définitivement emporté par le courant, il ne parvenait pas à faire demi-tour. Les vagues étaient de plus en plus imposantes, le maitre bientôt ne vit plus son chien ; il se jeta dans les vagues. Il rejoignit son chien dans les vagues qui l’avalèrent. La femme s’approcha de la mer, elle s’assit, l’eau s’étalait sous son corps. Les vagues finirent de tremper le sable et s’en allèrent. La femme bascula en arrière avant de s’endormir. Ce fut la nuit.
De plus en plus, et ce qui ne m’arrivait pas avant, on me parle de choses que j’ai consignées dans les Relevés. Poli, je prends toujours le temps de répondre, même si ce sont des conversations qui me fatiguent par avance, car si je prends le temps de les consigner là c’est souvent que j’ai peu envie d’en parler. Il ne faut pas que je transige là-dessus : les Relevés doivent demeurer un espace clos où moi seul peux parler. C’est le jeu, et ce sont les seules règles que je tolère.
« À l’horizon, le cargo est maintenant posé à droite et au-dessous de la montagne de nuages aux ombres mauvres, mais toujours immobile. Toutefois peut-être a-t-il un peu diminué de grandeur. Rien ne bouge toujours dans le paisible et menaçant paysage que composent la corne du bois, le coteau, le chemin, le petit pont et les prés encadrés par le chambranle de la fenêtre. » – Claude Simon, Leçon de choses.
Par exemple, voter pour Emmanuel Macron au second tour des élections présidentielles permet de faire barrage à Marine Le Pen. Ne pas voter pour Emmanuel Macron ne permet pas de faire barrage. Voter pour Marine Le Pen n’est pas considéré comme un barrage à l’encontre d’Emmanuel Macron. Ne voter pour personne ne fait barrage à personne, mais surtout pas à Marine Le Pen, et c’est d’ailleurs étrange. En ne votant pas c’est souvent comme si on votait non et pourtant cela ne fait aucunement barrage au candidat ciblé, cela ne fait rien. Voter pour l’ultralibéralisme permet apparemment de faire barrage au fascisme. C’est ce que les spécialistes des barrages nous disent. Faire barrage est une occupation intéressante. Les barrages ont toujours été des constructions intéressantes, utiles même souvent, pour empêcher des désastres. Parfois les barrages n’empêchent pas les désastres car soit ils sont mal construits soit les désastres sont trop importants. Quand les désastres sont trop importants les barrages ne servent à rien, ils sont dévastés aussitôt. Le barrage construit contre Jean-Marie Le Pen depuis 2002 est un barrage qui ne tient pas très bien le coup, qui d’ailleurs est même profondément défaillant, car qu’un barrage cède déjà à ce point en à peine quinze ans démontre bien à quel point nous sommes de mauvais bâtisseurs, à quel point nous n’y connaissons rien en barrages. Plus les années passent et moins nous possédons de matériaux utiles à la construction de barrages ; les réserves s’épuisent. Déjà nos barrages ne sont plus que quelques palettes de bois maintenues avec de la corde. On se convaincra que ce sont de bons barrages et que nous avons fait du bon travail mais au fond nous saurons parfaitement que nous avons fait un travail de cochon, que nous sommes des cochons et des incapables. Actuellement nous faisons un barrage contre Marine Le Pen comme des cochons, avec des planches et des cordes usées et nous sommes très satisfaits de notre barrage et nous disons à Marine Le Pen qu’elle ne passera pas car notre barrage est trop fort pour elle, mais Marine Le Pen sait parfaitement qu’en bâtissant nos barrages toujours sur les mêmes modèles elle finira par profiter de la faille et s’infiltrer partout. Il y a une chance peut-être, c’est de se passer du barrage et d’affronter le désastre, et de détruire le désastre, car il faut se rendre à l’évidence : nous ne sommes pas le barrage, nous sommes le désastre.
Tout à l’heure, je recherchais une information que je croyais avoir consignée dans mes Relevés. Je faisais défiler les pages des deux dernières années puis je me suis dit : quand même, qu’est-ce que j’ai pu écrire…
« Le monde prit à mes yeux l’aspect d’une maison déserte et triste et j’étais aussi bouleversé que s’il m’avait fallu parcourir, nu-pieds, toutes les pièces d’une telle demeure. »
Après avoir quitté cet énième rendez-vous professionnel inutile, j’ai pris le métro et me suis rendu à la librairie. Je ne savais pas quoi acheter ; j’y ai passé des heures. Un homme ivre est entré, a commencé à touché des livres dans un coin de la librairie, et un des libraires lui a calmement demandé de sortir, ce qu’il a fait. Plus tard, un autre homme est entré qui insultait à voix haute la nouvelle génération, de salauds et de salopes si je me souviens bien, cette nouvelle génération (dont je fais partie sans doute) apparemment immergée dans une ignorance crasse (ce sont ses mots) ; cette fois-ci le libraire ne l’a pas fait sortir et l’homme est resté un certain temps à insulter la nouvelle génération dans la librairie. Quand je suis ressorti de la librairie, rien n’avait changé. J’ai pris à nouveau le métro jusque chez Cécile. À côté de moi un type d’une trentaine d’années lisait un livre sur la manipulation : pourquoi et comment la pratiquer. Le type n’avait pas l’air tellement captivé par sa lecture, si bien qu’il s’est endormi sur son livre. Sans doute n’avait-il pas tellement le coeur à manipuler qui que ce soit. Enfin j’ai pris le bus tout en lisant un des livres que j’avais achetés à la librairie ; je suis arrivé chez Cécile.
J’ai fini une cinquième ou sixième (?) relecture de La Ville fond. Benoît a presque fini la couverture. Le livre est bientôt prêt.
« Dans ses yeux, ses yeux noirs, je trouvai l’éternelle et profonde nuit que je recherchais ; je me plongeai dans leurs ténèbres terribles et enchanteresses. Il me semblait qu’ils faisaient jaillir une immense vigueur des tréfonds de mon être. Le sol frémissait sous mes pieds, et j’aurais éprouvé à tomber un plaisir inexprimable. » – Sadegh Hedayat, La chouette aveugle.
Je suis en train de regarder les offres d’emploi. Je suis complètement perdu. Je n’ai aucun diplôme précis (seulement une licence en Lettres Modernes), et je ne trouve aucun poste en accord avec mon expérience passée. Je vois une offre de couvreur-zingueur, je me dis que je n’ai aucune des compétences pour être couvreur-zingueur, et je me demande : qui a besoin de mes compétences ?
Il est l’enfant-sorcier, il guérit les plaies !
Par exemple, voter utile est utile pour voter pour quelqu’un en qui vous ne croyez pas mais qui pourrait l’emporter face à la menace fascite. Voter Emmanuel Macron est utile dans la mesure où cela permet de battre Marine Le Pen. Voter Marine Le Pen est inutile car c’est justement contre elle que l’on doit voter utile. On ne peut voter utile qu’en faveur des perdants. Mais pas n’importe quels perdants. Voter Philippe Poutou est inutile car il est par avance trop perdant. Voter utile ne peut s’appliquer qu’à des presque-perdants, et surtout pas à des gagnants, comme Marine Le Pen. Le vote utile est véritablement subtil à comprendre ; c’est un travail de longue haleine que de parvenir à comprendre les tenants et les aboutissants du vote utile. Après les élections, si jamais Marine Le Pen l’emporte, ne dites surtout pas à vos amis que vous vous êtes abstenus de voter utile, ils pourraient vous en vouloir ! Si Emmanuel Macron gagne, ne leur dites pas non plus que vous avez voté Emmanuel Macron pour éviter d’avoir Marine Le Pen au pouvoir : ils vous en voudraient presque deux fois plus. Après avoir voté utile, le mieux est de se taire et de faire comme s’il ne s’était rien passé. Voter utile Marine Le Pen c’est voter tout court, en plus d’être un fascho. On peut voter utile fascho mais ça n’est pas comptabilisé comme du vote utile, uniquement comme du vote fascho. Voter Emmanuel Macron est utile pour battre Marine Le Pen, mais absolument pas pour se libérer du libéralisme économique, il faut faire attention. On a tendance à voir dans le vote utile de l’utilité à tous les niveaux, mais malheureusement ce n’est pas le cas, sinon ça s’appelerait un vote d’adhésion. Le vote d’adhésion est l’idéal mais malheureusement il ne peut exister tant que Marine Le Pen existe. Il ne pouvait déjà qu’à peine exister du temps de son père Jean-Marie Le Pen, mais désormais il ne peut plus du tout exister, il n’y a plus que le vote utile qui peut exister, ou le vote fascho. On ne sait plus très bien si c’est Jean-Marie Le Pen qui a créé le vote utile ou si c’est le vote utile qui a créé Jean-Marie Le Pen. C’est en tout cas pour sûr Jean-Marie Le Pen qui a créé le vote fascho. Il y a comme une sorte d’affrontement entre le vote utile et le vote fascho actuellement en France. En somme, soit on est utile soit on est fascho. C’est un bon résumé de notre société je crois.
(Dans Cargo marécage, nommer une ville Cité-Soleil.)
Après cinq ans d’hébergement sur le site de Joachim (et je l’en remercie sincèrement, quand on sait quelle place a pris ce site dans mon travail et dans ma vie), je déplace mes Relevés sur mon propre serveur. L’adresse est plus longue, j’espère que ça sera pas trop chiant. Vous pourrez donc à l’avenir les lire ici :
On verra avec Joachim ce qu’on fait de cette adresse : soit une redirection vers la nouvelle, soit la laisser en l’état, soit la supprimer ; peu importe. Les plus vifs me rejoindront, sinon oublieront l’existence de cette page, sinon la redécouvriront par hasard dans quelques mois ou années.
Rien ne change pourtant ; le temps simplement passe.
Je suis rentré d’Édimbourg. Vous voyez, je n’ai rien écrit.
Je me suis trouvé à relire Une saison en enfer. Ce qui m’a frappé, et je ne sais pas pourquoi ça ne m’avait pas déjà frappé auparavant : on croirait lire Récidive. J’ensevelis les morts dans mon ventre.
J’éprouve de profondes difficultés à avancer sur mes autres projets. Le document de Rivage au rapport n’a pas bougé depuis des mois, si bien que je songe de plus en plus à l’abandonner. Et je ne parviens pas à structurer correctement mes idées autour de Cargo marécage, je n’ai d’ailleurs aucune idée de ce que je veux faire, de ce que je veux dire. J’ai parfois l’impression qu’un texte en implique d’autres, éphémères ceux-ci. La Ville fond a tiré derrière lui ces deux autres projets qui n’existeront peut-être jamais. Ils sont des prolongations de La Ville fond et des étapes peut-être nécessaires pour le construire et l’aboutir. Il faudrait alors repartir à zéro. Je n’ai pas de projets pour l’instant.
J’ai essayé d’inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues.
Pour ne rien arranger, tous les livres que je lis me semblent insipides.
« Je m’en vais écorniflant par-ci par-là des livres les sentences qui me plaisent, non pour les garder, car je n’ai point de gardoires, mais pour les transporter en cettui-ci, où à vrai dire, elles ne sont non plus miennes qu’en leur première place. »
La première relecture de son propre manuscrit est stimulante. On sait avoir écrit un chef d’oeuvre et on est impatient de pouvoir le lire à nouveau, voire l’améliorer, le rendre encore plus chef d’oeuvre qu’il ne l’est déjà. La deuxième relecture nous fait sensiblement douter, on se dit peut-être qu’il n’est pas tant chef d’oeuvre que cela. La troisième relecture est formelle : ce n’est aucunement un chef d’oeuvre, à peine un livre mineur, à peine un prospectus. À la quatrième relecture, on se demande pourquoi on s’obstine sur cette merde. À la cinquième, on tente d’oublier ce qu’on a écrit pour passer au-delà de la médiocrité de notre cerveau. La sixième relecture est l’absence totale de relecture. À la septième relecture, on demande à notre éditeur de nous débarasser au plus vite de cette honte. La huitième relecture est celle que l’on ne fera jamais, c’est la publication. C’est à peu près à ce stade-là qu’on peut enfin discuter avec d’autres lecteurs.
« Tout ce que vous vivez, vous le dérobez à la vie, c’est à ses dépens. Le continuel ouvrage de votre [vie], c’est bâtir la mort. » – Michel de Montaigne, Essais.
Par exemple, si les places les plus chères se trouvaient au fond des salles de spectacle, et les places les moins chères devant la scène, sans doute qu’on se désintéresserait totalement du théâtre. Les plus fortunés se précipiteraient pour se confiner derrière, admirant là les crânes chauves de leurs voisins de devant, ou les brushings des dames, ou pour les plus chanceux de larges colonnes en granit. Il serait alors à la mode de ne plus rien voir des spectacles à l’affiche, de scruter au loin d’étranges ombres qui seraient les acteurs et les actrices, d’à peine entendre leurs répliques, de pester contre ceux de devant qui eux voient et entendent tout parfaitement, ces privilégiés. Des places chères impliquent une expérience culturelle de qualité. Les fortunés ayant les moyens de payer ces places chères trouveraient forcément des raisons à ce prix démesuré, et retourneraient tous les inconvénients en avantages. Bientôt les inconvénients seraient même à la mode, on en parlerait dans les journaux et les magazines, êtes-vous allé à cet énième spectacle où nous ne voyions rien ? oh oui, c’était délicieux !, et ce seront les pauvres du devant qui se demanderont pourquoi on s’amuse tant à l’arrière, où pourtant on ne voit ni n’entend rien, où pourtant eux, quand ils avaient le plaisir d’y être, n’y trouvaient justement ni aucun avantage ni aucun plaisir. Il faudrait tenter l’expérience, elle serait forcément concluante. Les acteurs des pièces eux-mêmes se demanderaient ce qui intéresse tant les spectateurs du fond pour qu’ils fassent du bruit à ce point, presque même la fête dirait-on. Les acteurs inventeraient d’autres performances artistiques qui intégreraient les spectateurs du fond pour leur faire profiter d’une expérience artistique encore plus complète. Les spectateurs du fond deviendraient les nouveaux privilégiés. Les pauvres spectateurs du fond seraient en réalité gagnant sur tous les points. Les pauvres du devant seraient encore les défavorisés. Les conventions artistiques ne tiennent pas à grand chose. Le placement ne signifie rien. Les lieux à la mode non plus. Tout n’est qu’une question de prix.
Souvenez-vous : il y a de cela quelques semaines, je vous informais de la sélection de mon livre Saccage pour le Prix Littéraire des Grandes Écoles, et d’une critique plus que négative à son propos. J’en tirais les pires conclusions quant à mes possibilités de gagner ledit prix, et comparais ma situation à celle d’un cycliste à la dernière place de la course (à peine devant les voitures-balai), dont le vélo aurait les deux pneux crevés. Optimiste en diable (ayant sans doute en tête le but que mit Sylvain Wiltord contre l’Italie à la 90ème minute de jeu lors de l’Euro 2000), je précisais cependant que rien n’était impossible. Et je le répète aujourd’hui : rien n’est impossible. J’en veux pour preuve que Saccage est finaliste du Prix Littéraire des Grandes Écoles, au côté de deux autres ouvrages dont j’ignore absolument tout. Rendez-vous compte : de la dernière place, je me retrouve aussitôt dans le sprint final. J’imagine le fameux Nelson Monfort, déployant ses talents de commentateur polyglotte pour célébrer cette remontée fantastique, ne ménageant ni les hyperboles ni les compliments pour qualifier un tel exploit. Ce pauvre Nelson Monfort, emporté à ce point par l’euphorie qu’il en frôlerait l’asphyxie, et ses pauvres collègues dans les studios de France Télévision obligés de le raisonner, gênés par un tel débordement, indigne d’un professionnel. L’amour du sport n’excuse pas tout. De ma remontée, on ne saura rien. Les théories les plus obscures seront élaborées : produit dopant ? raccourci ? aide motorisée ? frère jumeau ? Aucune hypothèse ne convaincra les spécialistes. Aucune hypothèse ne m’empêchera d’être désormais dans les derniers mètres, au coude-à-coude, mon vélo déformé par la vitesse à laquelle je pédale, on croirait presque à la première place, au podium, au champagne, à la peluche de lion, on y est déjà. Mais ne nous enflammons pas, personne n’est à l’abri d’une chute ou d’une cannette hostile. Restons concentrés. Le sport n’est pas chose à prendre à la légère.
Au terme de ce texte, on me rétorquera sans doute que Nelson Monfort n’a jamais commenté la moindre compétition cycliste, mais c’est bien un des plus importants privilèges de l’auteur, que d’imaginer Nelson Monfort là où il n’a jamais été.
Je ne vois finalement pas d’intérêt à tenir un journal de bord de mon voyage. Les villes dans lesquelles on se rend ont toutes des particularités (absence d’immeubles en banlieue, routes et trottoirs défoncés, grande concentration de voitures, multiplication des commerces et des marques), mais je ne parviens pas à en tirer de conclusions, ni encore de sens. Simplement, peut-être, comme je confiais à Cécile dans le bus alors que nous arrivions à Sheffield : La première fois que l’on se rend dans une ville, elle nous semble complètement disproportionnée et incohérente, beaucoup trop grande et beaucoup trop confuse, et pour chaque ville il faut donc à nouveau créer ses propres repères et comprendre la logique interne qui structure les lieux. Chaque ville appelle son lot de questions, car aucune ville ne va de soi. Aussi, à Sheffield particulièrement, une nouvelle manière d’aborder la cohésion locale, de proximité, et à laquelle je n’avais jamais été sensibilisé Rennes (peut-être n’y avais-je simplement jamais fait attention ?). Le commerce d’un menuisier dont les meubles se trouvent directement sur la rue, et lui dans l’arrière-boutique, qui aide ceux voulant réparer ou construire leurs propres meubles, et à l’étage un café (pour le moment en travaux).
À Sheffield, on logeait chez une amie de Cécile qui connaît personnellement Éric Chevillard.
Peut-être Edimbourg me donnera-t-elle davantage de grain à moudre.
Emporté Sartoris. La traduction (de 1949) est épouvantable. Je me demande comment Gallimard n’a pas honte de publier de nouvelles éditions poche sans traduction nouvelle. La manne financière de ceux qui se foutent de la littérature. Les personnages Noirs parlent petit nègre, leurs dialogues sont presque incompréhensibles. J’ai l’impression que l’intrigue se perd, etc. C’est boursouflé à crever. On est loin de Tandis que j’agonise et Le Bruit et la Fureur.
Ces quelques lignes sont déjà un journal de bord.
Demain, je pars en voyage pour quinze jours avec Cécile, en Écosse. D’abord, on passe par Londres puis par Lichfield, et ensuite on reste à Édimbourg. Je ne suis jamais vraiment parti en voyage. L’Écosse, ce n’est pas tellement loin, et pourtant j’ai déjà l’impression d’un très long voyage, très loin. Je me demande comment ça va être.
J’ai rêvé, je ne sais plus dans quel contexte (un cours de stylistique je crois, donc sans doute à la fac), qu’une professeure m’interrogeait à propos d’une traduction de Virginia Woolf. Je ne me souviens plus ni du livre en question ni de la traduction, mais je me souviens parfaitement que je trouvais cette traduction nullissime. Il était évident que cette traduction était d’une nullité absolue. Je disais à cette professeure tout le mal que je pensais de la traduction, et j’arrivais même à argumenter en ce sens. La professeure ne semblait pas du tout réceptive aux arguments que j’avançais. Elle me mit d’ailleurs une note épouvantable, et me signala devant toute la classe que je n’avais rien compris ni au texte ni à la traduction, que les deux étaient sans aucun doute irréprochables, magnifiques. J’ai dit d’accord puis je me suis réveillé.
L’autre jour, en ouvrant mon bocal de haricots azuki, j’ai remarqué qu’il était rempli d’insectes. Je ne savais pas quels étaient ces insectes, je n’en avais jamais vu de tels. Je me demandais même comment ces insectes s’étaient retrouvés dans mon bocal, car je ne l’avais jamais ouvert. Autour du bocal, il n’y avait aucun insecte. Dans mon placard, il n’y avait aucun insecte non plus. En me renseignant sur internent, j’ai appris qu’il s’agissait de charençons. Apparemment, ils peuvent surgir des haricots, et pondre leurs oeufs dans les haricots, et se reproduire ainsi, et complètement vider les haricots de leur substance de haricot. Les charençons peuvent apparemment naître dans un environnement parfaitement clos, et c’est une capacité tout à fait étonnante, tout à fait impressionante. J’ai jeté tous les haricots dans la poubelle et les charençons avec, ces charençons pourtant impressionants je les ai jetés comme s’ils n’avaient même pas existé. Les charençons ne bougeaient pas et se sont laissés benner dans la poubelle. Ensuite j’ai lavé mon bocal et après être retourné faire des courses je l’ai rempli à nouveau de haricots azuki. Dès le lendemain, je les ai cuisinés.
Par exemple, Paris est une ville de 105,40 km2 de superficie, et la France un pays de 672 369 km2 de superficie. La distance entre la place Denfert-Rochereau et l’Assemblée Nationale est d’environ 4km. Quand le peuple français est en colère, il défile sur les 4km de la place Denfert-Rochereau à l’Assemblée Nationale. Arrivé devant l’Assemblée Nationale, le peuple français est nassé par les CRS et il se fait matraquer. Le peuple français sait pertinemment qu’au bout du trajet vers l’Assemblée Nationale il y aura les CRS pour les nasser et les matraquer et pourtant le peuple français y va. Parfois même, le plus souvent d’ailleurs, au sein du cortège, il y a des CRS qui nassent et qui matraquent et qui disent au peuple français mécontent, Bientôt l’Assemblée Nationale, on va pouvoir vous matraquer !, alors qu’ils matraquent déjà. Parfois (quand elles ne sont pas barricadées par des CRS qui matraquent) d’autres rues sont empruntables, à la perpendiculaire de celles qui vont jusqu’à l’Assemblée nationale, mais le peuple français préfère ne pas les emprunter. Parfois ces rues pourraient même déboucher hors du centre-ville et même hors de Paris et même peut-être jusqu’au bord de mer et jusque sur les montagnes, mais le peuple français a une très grande envie d’atteindre l’Assemblée Nationale pour se faire copieusement matraquer. Le peuple français s’étonne qu’une fois arrivé à l’Assemblée Nationale il se fasse nasser et matraquer. Il se demande sans doute comment les CRS ont pu deviner leur point d’arrivée. Le peuple français a un mal fou à ne pas se précipiter dans les matraques des CRS. Il y a tant de rues et de lieux sans CRS qui matraquent qu’il semble étonnant que le peuple français soit à ce point victime des matraques des CRS. On se dit parfois que sur les 105,40 km2 de superficie de Paris et les 672 369 km2 de superficie de la France il devrait bien y avoir un ou deux endroits sans CRS au bout pour matraquer, même peut-être des issues de secours au cas où ils seraient quand même là, enfin bref des possibilités de fuite et de dispersion et de maîtrise du territoire pour faire des matraques de pauvres batons s’agitant dans le vent. Mais tant que le peuple français n’en sortira pas de sa place Denfert-Rochereau et de l’Assemblée Nationale, sans doute qu’il ne pourra jamais s’épargner quelques bleus et quelques désillusions.
Par exemple, nos parents se sont tués au travail pour faire en sorte que nous puissions vivre dans des conditions confortables, avoir une belle maison et de beaux meubles et une belle cuisine à l’intérieur, ils ont tout mis en oeuvre pour que nous possédions le maximum de choses de qualité, un jardin même pourquoi pas, un terrain assez grand, dans une région agréable, au bord de la mer avec un peu de chance. Mais nos parents n’ont pas fait en sorte qu’en 2050, lorsque j’aurai 58 ans, lorsque j’aurai leur âge et qu’eux seront sans doute déjà morts, nous puissions tout simplement conserver une planète vivable, que les trois-quarts des animaux n’aient pas disparu, que la montée des eaux n’ait pas englouti les populations de bord de mer, que le réchauffement de la planète n’ait pas fait fondre la banquise dans son intégralité, que les plantes ne soient pas mortes faute d’être pollinisées, que nos champs ne soient pas devenus d’horribles landes rases calcinées. Nos parents ont tout mis en oeuvre pour que nous vivions dans des maisons confortables sur une planète à moitié morte, pour que nous possédions une cuisine toute équipée sans même d’eau potable à faire bouillir, pour que nous puissions consommer des fruits et des légumes toute l’année sans se soucier de rien, des fruits et des légumes produits dans des laboratoires, car il n’y aura plus ni légumes ni fruits dans les cultures, car simplement il n’y aura plus de culture, car nous serons au terme de la vie sur Terre, car nos maisons pourront à peine retenir le chaos qui s’abattra sur nos têtes, car nos parents n’ont pas pensé qu’au-delà du confort il y avait quelque chose à conserver, car nos parents ont consommé sans aucune mesure, car ils se sont précipités sur les produits dans les rayons et sur leur indépendance et sur leur propre plaisir et leur propre satisfaction, car en soixante ans ils ont tout simplement tout ravagé, car ils se sont comportés comme des enfants, car nous devons nous désormais rattraper leurs erreurs et faire marche arrière et leur apprendre comment se nourrir et comment vivre correctement, car nous devons leur apprendre en tant qu’enfants responsables qu’ils sont des parents inconscients qui ont tout pulvérisé pour une petite maison personnelle avec cuisine équipée et parfois un bout de terrain, nous devons leur apprendre en tant qu’enfants responsables qu’ils sont eux-mêmes des enfants, et qu’ils n’ont écouté que leurs caprices, et qu’aujourd’hui ils nous en font payer le prix, et que nous ne prenons aucun plaisir à jouer les adultes et à les rappeler à l’ordre.
Avant que le cargo Marécage ne quitte l’île, le capitaine demanda au garçon ce qu’il ferait, ce qu’il voulait devenir, maintenant que l’archipel était libéré. La question du capitaine plongea le garçon dans un profond silence. Il fixait ses pieds sans trouver de réponse. Le capitaine lui ébouriffa les cheveux et s’en alla vers l’échelle d’embarquement. Le cargo Marécage se mit lentement en mouvement tandis que le capitaine grimpait à l’échelle. Alors qu’il posait un pied sur le pont, le capitaine entendit le garçon lui crier : « Capitaine, capitaine ! Je sais, j’ai trouvé ! ». Le capitaine se retourna et vit en contre-bas le garçon s’approcher en courant, disposer ses mains autour de sa bouche comme un porte-voix, et lui affirmer d’une voix claire : « Capitaine, je veux devenir une femme ! »
« Pendant les derniers jours, Kafka se tint strictement à la consigne de ne pas parler, fût-ce en chuchotant. Il s’entretint jusqu’à la fin avec ses amis en écrivant de courtes phrases où s’expriment encore la sensibilité et l’originalité de son langage toujours vivant. »
Par exemple, les meurtres commis par des hommes ne sont jamais vraiment des meurtres. Les meurtres peuvent avoir d’autres noms, surtout les meurtres commis par des hommes. Couramment, les meurtres sont qualifiés de drames familiaux. Par drames familiaux, on entend évidemment des carnages commis par des hommes, qui ont pu tuer leurs familles au couteau ou les enterrer sous une terrasse ou éparpiller leurs membres aux quatre coins du département. Un drame familial est ce type de meurtre car en effet c’est un drame et car en effet toute la famille est impliquée. C’est-à-dire plutôt que l’homme a impliqué toute la famille dans sa sauvagerie mais sans doute un spécialiste sur un plateau de télévision se lèvera pour dire que la femme elle aussi est un peu responsable, qu’au fond elle a dû aimer ce mari violent et horrible sinon elle serait déjà partie depuis bien longtemps. Les drames familiaux sont la plupart du temps des drames sociaux car ils sont aveugles sur la réalité des hommes meurtriers et des femmes tuées. Un meurtre est encore moins un meurtre si jamais l’homme assassin s’est ensuite jeté et noyé dans la rivière de la commune où il a sévi ; dans ce cas-là, il s’agit tout simplement d’un suicide. Beaucoup de suicides sont des meurtres injustes mais ils sont avant tout des suicides, car selon une règle officielle, c’est toujours du dernier tué qu’on se souvient. D’après une autre règle officielle, c’est toujours du meurtrier dont on se souvient. Les meurtres font oublier les victimes car ils ont cette faculté. Les hommes font oublier leurs victimes qui sont des femmes et des enfants. Les drames familiaux font oublier qu’un homme a pu saisir un couteau et trancher les gorges et taillader les yeux de sa femme et de ses enfants. Les drames familiaux font oublier les taillades et les couteaux et le sang répandu dans toutes les pièces de la maison. Les drames familiaux au fond, si on s’y aventure un peu, ont la même fonction que les pièces de viande vendues sous célophane qui font oublier les bêtes électrocutées et les gorges tranchées dans des abattoirs sordides et les convulsions et parfois la merde sur le sol et toutes ces choses encore. De manière générale, tout est fait pour oublier. Tout est fait pour oublier que les hommes tuent et rôdent partout dans la ville. Si jamais un homme tente de vous tuer dans la rue, ne hurlez pas au meurtre, hurlez au drame familial, ou au suicide, vous aurez beaucoup plus de chance d’être entendue. Proposition scientifique : tout meurtre contient en lui-même son absence de meurtre.
Par exemple, et c’est vrai que nous n’y avions jamais pensé au fond, mais il n’est pas étonnant de trouver sous la monumentale montagne d’argent originelle d’autres petits monticules d’argent, ou d’autres costumes trois pièces ou d’autres assurances vie ou d’autres appartements dans un coin reculé de la Sarthe ; et il n’est pas étonnant non plus d’y trouver de faux papiers qui attestent de la bonne composition de cette monumentale montagne d’argent, ou d’autres amis perdus qui voulaient leur part du butin, ou son propre enfant déjà empoisonné par tout cet argent à sa disposition. Il n’est pas rare de tout perdre sous de monumentales montagnes d’argent. Il se trouve que sous la plupart de nos propres monticules d’argent il n’y a que de la poussière et des épluchures de légumes, et que nous n’avons besoin d’aucun papier pour justifier de nos pauvres monticules car les papiers nous prennent déjà presque aussitôt nos monticules d’argent dérisoires. Le plus difficile est toujours de constituer la colossale montagne d’argent première sous laquelle dissimuler tous les autres méfaits, c’est cette colossale montagne d’argent qui est la protection absolue car personne ne prend le temps de débusquer sous l’argent encore plus d’argent, tout le monde se contente de ce qu’il a sous les yeux, et une colossale montagne d’argent est très appréciable pour la vue, c’est très rassurant, il n’y a pas besoin de savoir ce qui se trouve dessous, c’est toujours signe de bonne santé et de bonne intégration dans notre pays. Une colossale montagne d’argent est la plus sûre preuve de notre patriotisme et de notre amour pour la patrie. C’est sous la colossale montagne d’argent que l’on peut cacher la tricherie et la haine car personne ne peut les voir et personne ne veut les voir. Que nous soyons gouvernés par des haineux aux colossales montagnes d’argent n’est aucunement étonnant car nous ne prenons jamais la peine de fouiller sous les colossales montagnes d’argent car nous avons déjà tellement de temps à consacrer à nos pauvres monticules pour en faire de colossales montagnes d’argent sous lesquelles dissimuler nos propres secrets. Car il devrait y avoir des professionnels chargés d’investiguer les colossales montagnes d’argent, mais ils se contentent souvent d’apprécier la vue. Comment les blâmer ? Sous les colossales montagnes d’argent il fait si noir et si frais. On pourrait très bien y trouver un coin à l’écart où s’allonger et se complaire toute sa vie.
« D’où vient ce délire ? Pourquoi la lecture ne se satisfait-elle jamais de ce qu’elle lit, ne cessant d’y substituer un autre texte qui à son tour en provoque un autre ? »
Comment un texte que nous avons écrit peut-il nous apparaître à la fois aussi sensible et aussi médiocre ?
Je suis en train de trier mes emails. On garde de ces choses parfois, on se demande pourquoi. On ne les relit jamais. On laisse tout en foutoir et puis on se dit que c’est mieux là qu’ailleurs. On ne visualise pas la pile immense de documents qui trône là à côté de nous. Je jette à la corbeille. Je lis, je me dis ah oui, c’est vrai, je me souviens, et ensuite à la corbeille. Je mets ci-après des bouts de trucs que je vais supprimer mais dont je souhaite juste garder une trace, comme ça. Les expéditeurs sont divers, ils se reconnaîtront.

Janvier 2016 : Je viens d’achevé la lecture d’une grande partie de “relevés” et je tenais à te dire que c’est excellent comme blog. A la fois pour la partie critique et pour la partie fiction, j’ai vraiment pris mon pied et c’est rare que ce genre de format me plaise. Mais la je ne sais pas le stratification fonctionne très bien.
Juillet 2016 : En refermant Saccage, j’aurais voulu dire à Quentin Leclerc combien son livre m’avait plu. Je l’ai lu et presque immédiatement relu, par passage, pour graver encore plus profondément ces puissantes hallucinations.
Mon coup de coeur reste “Saccage”!! J’ai trouvé ce petit livre énorme. J’ai ressenti des influences certes, mais il a sa propre voix (ou voie). Transmettez à l’auteur mon plaisir de lecteur et mes modestes encouragements. Peut être est-il important de se savoir lu et apprécié? Je n’en sais rien, il a sûrement d’autres raisons, pour écrire avec une telle force, que celle d’être célèbre un jour. Mais je lui souhaite d’être reconnu bien-sûr et j’espère qu’il continuera d’écrire encore et encore.
Novembre 2016 : Je raccroche à l’instant d’avec Jean : il vous embrasse ! Il avait une très bonne voix, et il était de bonne humeur.
Novembre 2016 : J’espère que tout va bien pour toi. Je préfère ne trop rien promettre mais j’essaierai de venir vous voir cette semaine chez Charybde.

Novembre 2016 : Un tit mail pour te dire que je t’aime !
Décembre 2016 : bisous de manou qui s’amuse sur son ordi bonne soiréé et bonne nuit
Ma grand-mère m’a laissé un message vocal sur mon téléphone ce midi. Elle souhaitait savoir si je serais à la journée d’anniversaire pour mon père, ma tante, ma petite cousine, et elle-même. J’avais répondu à ma tante que peut-être, et puis finalement j’ai eu trop de travail cette semaine, je ne sais pas, je me suis mal organisé, hier je pensais à autre chose qu’à prendre mes billets de train, je ne comptais pas faire l’aller-retour en voiture dans la journée, et puis finalement voilà, je n’ai rien fait, je suis resté chez moi, je n’étais pas là. Mon absence injustifiée était ma réponse définitive.
Parfois, dernièrement, j’ai la sensation que la littérature ne sera pas toute ma vie. Qu’il viendra un jour prochain où je continuerai à lire des livres, mais que je ne tenterai plus d’en écrire. C’est des choses que je me dis. Simplement car j’aurai concentré mon esprit sur d’autres choses, et que je n’aurai plus la motivation pour ça, simplement plus l’envie. On nous dit toujours : il y aura toujours l’envie, tu écriras toujours. Peut-être en effet. Quentin Leclerc a écrit deux livres, et il n’en écrira plus, ce n’est pas une pensée tellement absurde, présentée de cette manière. Il accomplira peut-être d’autres choses, mais pas des livres. Parfois je me dis : je deviendrai caissier et tout le monde m’oubliera. Je dis ça, je n’en sais rien, c’est peut-être seulement une méthode pour garder la foi de l’écrit. La plupart du temps on ne sait rien et on s’attend à tout.
Voilà, je me dis ça. Mes Relevés sont aussi une occasion de me dire ça.
Je suis entré dans la cuisine car je croyais t’y avoir entendue ; mais une fois à l’intérieur, je n’ai vu personne. Quand je suis ressorti de la cuisine je n’ai plus rien entendu et j’ai éteint la lumière. J’ai remarqué après être sorti qu’une autre lumière venait de l’extérieur et éclairait la cuisine. J’ai regardé un temps la pénombre de la cuisine légèrement éclairée par la lumière extérieure, et je n’ai rien vu. J’ai appelé dans la cuisine au cas où mais personne ne m’a répondu, alors je me suis dit que tu n’étais pas là. Je suis retourné dans ma chambre et j’ai laissé la porte entrouverte au cas où j’aperçevrais quelque chose dans la cuisine. Entre ma chambre et la cuisine il y avait toute l’obscurité du salon. Après un temps, j’ai compris que tu ne serais plus dans la cuisine et j’ai fermé la porte de ma chambre. J’ai pleuré et je me suis endormi.
« La littérature apprend qu’elle ne peut pas se dépasser vers sa propre fin : elle s’esquive, elle ne se trahit pas. Elle sait qu’elle est ce mouvement par lequel sans cesse ce qui disparaît apparaît. » – Maurice Blanchot, De Kafka à Kafka.
Ce qui est difficile, quand on commence à se pencher sur les alternatives libres, c’est finalement de faire le tri dans la multitude d’options disponibles. Par exemple, pour remplacer GMail, ce ne sont pas les offres qui manquent. Mais laquelle est la plus pertinente sur le long terme ? J’utilise mon adresse actuelle depuis dix ans (c’est-à-dire mes quinze ans…), et espère pouvoir utiliser la prochaine au moins autant ; si même je n’avais plus jamais à la changer, ça serait l’idéal. Donc : choisir une solution sur le très long terme. Voici les trois solutions principales. Il y a d’abord la possibilité d’héberger le tout chez soi, en montant son propre serveur, ou en achetant une brique internet. Il y a ensuite la possibilité de s’inscrire sur un service d’emails en ligne dit libre et respectueux de la vie privée (mieux : qui crypte les messages). Il y a enfin la possibilité d’adhérer à une association locale qui promeut le libre et qui hébergera ces services pour vous (comme infini.fr, à Brest).
Une fois ce premier éclaircissement fait, il faut savoir cibler son choix par rapport à ses propres usages. Pour ma part, une utilisation certes quotidienne des emails, mais pas soutenue ; je ne travaille pas dans une entreprise, et je gère toujours mes emails au fur et à mesure de leur réception. Un webmail sommaire serait pratique pour consulter mes emails quand je n’ai aucun matériel avec moi, et c’est de toute façon, je crois, un service compris dans la plupart des offres sérieuses. Cependant, j’ai pris l’habitude de conserver et d’archiver énormément d’emails (mon webmail indique environ 4Go de données), et ça sera sans doute une habitude à perdre à moyen terme, au profit de suppressions plus régulières. M’inscire à un webmail en ligne est l’option qui me semble d’emblée la moins convaincante : pas forcément d’interlocuteur disponible, un certain flou concernant les serveurs de stockage, et peut-être même des failles dans la sécurité.
Donc, il me reste deux choix, motivés ensuite par leur coût, et leur technicité. La brique internet coûte environ 70€, plus environ 7€ de VPN par mois. En plus de mon abonnement internet (18 €), cela me fait donc un total de 25€ par mois pour un service de cryptage + un hébergement à domicile. Mais l’investissement en temps, en matériel, et en technique est plus conséquent. Adhérer à l’association Infini coûte 30€ par an, soit environ 2,5 € par mois (à peu près ce que je paye comme frais pour ma carte de crédit). En plus de mon abonnement internet, cela porte donc la facture à 20,5 € par mois pour un hébergement à distance, sans protection particulière sur ma box internet. Il y a donc des avantages et des inconvénients (financiers, techniques, etc.) qui modulent ma décision. En sachant que je suis actuellement peu souvent chez moi (c’est-à-dire une semaine à Rennes, une autre à Paris en alternance, et l’été entier à Matignon), et que je n’ai pas de grandes connaissances techniques en serveurs, quelle est la pertinence d’avoir une brique à domicile si je ne suis pas là pour la réparer si jamais elle a un problème (on ne sait jamais).
Je pense donc me diriger vers le service proposé par l’association Infini. Je leur ai déjà envoyé un email pour répondre à certaines de mes questions, et je franchirai sans doute le cap ensuite.
(Sinon, Benoit et Aurélien viennent de m’envoyer leurs corrections pour La Ville fond. Au travail.)
Je tente actuellement de supprimer les logiciels propriétaires que j’utilise au profit d’alternatives libres. À terme, quand mon Macbook Air ne fonctionnera plus (d’ici 4 ou 5 ans au mieux), j’aimerais également le changer pour une machine avec Linux (Ubuntu ?) comme système d’exploitation. Je remarque que, depuis plus de dix ans que j’utilise des ordinateurs (sous Windows comme sous Mac), je les ai toujours utilisés de manière inconséquente : sans me soucier de qui peut lire quoi ou de comment sont utilisées les données que j’y mets. Et ce sont des habitudes par rapport auxquelles je n’ai jamais pris de réel recul, alors qu’il comprend probablement 80% de mon temps.
Une autre réflexion qui m’est venue tient à mon utilisation du téléphone, et de la façon dont certains de mes usages sur l’ordinateur découlent de mes usages mobiles. Par exemple : consulter mes emails ou mes flux RSS partout. Mais il me vient à l’esprit que la plupart du temps, quand je dois utiliser mes emails en déplacement, c’est que je ne travaille pas dans de bonnes conditions, et donc que je pourrais le faire de chez moi, une fois correctement installé ; en somme : savoir segmenter la vie professionnelle de la vie personnelle. La consultation de mes flux RSS à l’extérieur est quant à elle une simple distraction quand j’ai la flemme de faire autre chose ou trop peu de temps pour ouvrir un livre. En restreignant mon usage du téléphone à des fonctions basiques (appels, messages, mobilité), je m’enlève quelques complications dans le choix des logiciels à adopter sur mon ordinateur.
J’avais déjà quelques habitudes “saines” (mon éditeur de texte html Atom, mon client FTP Cyberduck, mon client torrent Transmission, et le lecteur multimédia VLC), et j’ai pu en modifier d’autres facilement (Chrome par Firefox, Pages par LibreOffice, Feedly par l’extension Firefox Bamboo).
L’informatique public est un domaine jeune, et il me semble important (considéré que ce sont des machines qui ont sans doute un avenir très long) de mieux maîtriser la façon dont j’utilise cet outil, de développer ce savoir-faire (dans le hardware comme le software). Donc, la liste des logiciels encore à modifier, en fonction de mes usages :
- GMail (le plus compliqué car il implique de transférer plus de dix ans d’emails, et de sensibiliser mes destinaires aux emails cryptés ; pistes : Infini, mon propre serveur, Tutanota, Protonmail)
- Google Drive et Google Docs (facile car il y a des alternatives efficaces, mais implique encore une fois que la personne avec qui je travaille utilise également ces logiciels alternatifs ; pistes : Framapad)
- Facebook (arrêter complètement son usage - dans mon cas principalement chronophage et inutile - puis rediriger mes échanges vers emails, téléphone, et Jabber)
Après quelques jours de recherche, je vais sans doute adhérer à l’association brestoise Infini. Cela me permettra d’avoir mon propre serveur ftp pour stocker les Relevés et pourquoi pas mes flux RSS ; mais également d’avoir enfin une autre adresse email, ce qui règlera la question Gmail pour de bon.
Ce qui m’a frappé aussitôt en faisant mes premiers changements est qu’il est très facile de modifier ses usages pour soi, mais que c’est beaucoup plus compliqué dès que cela implique une autre personne. Par exemple, pour compenser la perte de Messenger, j’ai demandé à Cécile de passer sur Jabber ; mais tout le monde n’est pas prêt à faire de même, et parfois cela restreint donc les usages, et modifie grandement les habitudes de communication. Pour Google Drive (et Docs) le même problème se pose : j’ai quantité de documents partagés dessus avec Michel, et il faudrait donc que nous changions tous les deux nos habitudes. Mais sera-t-il prêt à le faire ?
Par exemple, et c’est amusant quand on y pense, mais François Lenglet, le spécialiste du service économie de France Télévisions, n’a aucune formation en économie. Peut-être au mieux a-t-il obtenu la mention assez bien à son baccalauréat ES. Cela est d’autant plus amusant d’ailleurs que François Lenglet a été rédacteur en chef de Minitel magazine pendant un an, ce qui peut témoigner d’une expertise réelle en Minitel (plus tellement utile de nos jours). Certes, être le rédacteur en chef de Minitel magazine pendant un an n’est pas rien, mais ce n’est pas assez, je crois, pour avoir une quelconque expertise en économie. François Lenglet a écrit des articles dans des magazines et a lu des chiffres provenant de documents sérieux provenant d’organismes encore plus sérieux (comme l’OCDE, qui est un organisme économique sérieux), et ainsi il est devenu spécialiste économique. Lire des chiffres sérieux (comme ceux de l’OCDE) est apparemment suffisant pour présenter des expertises économiques à des heures de grande écoute sur le service public télévisuel et être considéré comme expert et même devenir une des personnalités du monde économique préférées des français. Personnellement, il m’est aussi arrivé de lire des chiffres dans des documents très sérieux (mais pas ceux de l’OCDE), et cela ne m’a apporté aucune expertise en économie, ni aucune notoriété auprès de mes concitoyens. Voilà pourquoi je trouve étrange que tous ces chiffres tirés de documents sérieux aient permis à François Lenglet d’obtenir une expertise en économie et de devenir même l’expert du service économie de France Télévisions. Je ferais beaucoup plus confiance à François Lenglet en ce qui concerne le Minitel que l’économie. François Lenglet gagnerait beaucoup à devenir le spécialiste du service Minitel pour France Télévisions. Sincèrement, c’est une opportunité incroyable qu’a manquée France Télévisions en ne faisant pas de François Lenglet le spécialiste de leur service Minitel, car François Lenglet était l’homme rêvé pour devenir le spécialiste du service Minitel, ce service sans aucun avenir, sans aucun temps d’antenne, ce service où François Lenglet aurait pu parler sans aucun public, sans personne pour écouter ses expertises à propos du Minitel qui, au fond, comme ses interminables et fumeuses expertises économiques, n’auraient intéressé personne.
J’adore jouer. Jouer est une plus grande passion pour moi qu’écrire. Je joue depuis plus longtemps que je n’écris. Je ne me souviens pas de la première fois que j’ai joué (ce qui prouve à quel point j’ai joué depuis ma plus tendre enfance), mais je me souviens parfaitement de la première fois que j’ai écrit (c’était sur la plage, sous un formidable clair de lune, et une adolescente de mon âge reposait sa tête sur mon épaule, et je trempais ma plume dans ses larmes qui coulaient pour je ne sais plus quelle raison). Jeudi dernier, Cécile m’a offert une formidable reproduction en Lego du sous-marin jaune imaginé par les Beatles. J’ai pris un plaisir incroyable à la construire durant la soirée du jeudi. J’ai pris un plaisir bien plus incroyable à la construire qu’à raconter ici que je l’ai construite (d’ailleurs, ce plaisir passé est modéré par le récit que j’en fais actuellement et qui me paraît tout à coup moins plaisant). À mes yeux, les Lego sont la meilleure illustration du divertissement pascalien, ou en tout cas de ce que je me souviens du divertissement pascalien depuis mes cours de français du lycée. Si Pascal avait écrit ses Pensées du temps des Lego je pense que les Lego auraient trouvé une grande place dans son chapitre consacré au divertissement. Je sais bien qu’on ne peut pas considérer les feuillets des Pensées comme des chapitres à proprement parler, même pas du tout comme des chapitres d’ailleurs, mais il me semble que ma pensée est plus claire exprimée de cette manière, en utilisant des chapitres. Je me demande ce que serait devenue l’entreprise Lego si elle avait davantage exploité le divertissement pascalien dans ses éléments de communication. Blaise Pascal et l’entreprise Lego auraient tous les deux grandement gagné à collaborer. En effet, la philosophie de l’un et le commerce de l’autre s’en seraient retrouvés renforcés. Souvent on n’ose pas lier des choses apparemment aussi anodines que les Lego à des concepts aussi profonds que ceux développés par Pascal ; et pourtant, je viens de prouver en toute simplicité que des passerelles sont possibles. Je vous invite à relire les Pensées de Pascal à la lumière de cette nouvelle clé de lecture. Ce n’est pas anodin. Comme les Lego ont inspiré Pascal ils m’inspirent aujourd’hui. Les Lego sont une des sources principales de la création littéraire. Les Lego ont quelque chose de l’origine de la vie et véhiculent toutes les questions métaphysiques essentielles. Les Lego sont comme qui dirait notre père à tous, comme Dieu lui-même, comme l’origine de toute chose et de toute vie sur la Terre notre mère.
Il y a toujours des coquilles qui traînent dans mes Relevés. Je m’en rends compte a posteriori quand parfois je relis certains paragraphes. C’est d’ailleurs pour cela que je ne relis pas ce que j’écris, pour ne pas voir toutes les coquilles que je laisse traîner derrière moi à cause de mon manque de rigueur. Il y a deux risques à manquer de rigueur en écrivant : écrire n’importe quoi, et faire des coquilles. Par exemple, je connais des personnes qui écrivent n’importe quoi mais sans faire aucune coquille, et c’est appréciable, mais ce n’est finalement pas beaucoup mieux que d’écrire quelque chose de sensé avec d’innombrables coquilles. Il faut toujours trouver un juste milieu entre le n’importe quoi et les coquilles. Le travail d’écrire est justement de trouver ce juste milieu. Souvent on entend les écrivains dire tout et n’importe quoi sur l’acte d’écrire, quand l’acte d’écrire est uniquement ce juste milieu entre les coquilles et le n’importe quoi. Duras par exemple a écrit des choses formidables sur l’acte d’écrire mais sans jamais tenir compte ni des coquilles ni du n’importe quoi. C’est en cela que l’oeuvre de Duras est incomplète (quoiqu’en disent les exégètes). Dans mes livres aussi il y a de nombreuses coquilles, mais des professionnels sont justement embauchés pour les débusquer et les supprimer (mes éditeurs, puis la correctrice). Dans Saccage il y a peu de coquilles car ils ont fait un travail remarquable pour qu’il n’y ait plus aucune coquille (bien sûr, il en reste toujours, car sinon il ne s’agirait plus de coquilles). Personne ne corrige mes Relevés. Mes Relevés sont comme qui dirait une entreprise indépendante et elle a ses limites. Parfois je me dis qu’il faudrait que je corrige chaque coquille de mes Relevés, et puis finalement j’abandonne car je me dis que tout le monde s’en fout, que de toute façon personne ne s’en rend compte, car tout simplement personne ne les lit (c’est faux, et de nombreux emails bientôt me le détromperont).
(Ce soir, j’ai remercié par email une artisane de Brest à qui j’ai acheté des sacs en voile de coton pour faire mes courses. Simplement pour lui dire : bravo pour vos sacs, ils sont superbement réalisés. Je me demandais : quelle personne a conçu les sacs dont je me servais pour emballer mes courses au supermarché ? Probablement une machine. Peut-on remercier les machines ?)
J’écris moins. Aux yeux de certaines personnes, je dois encore écrire beaucoup, voire trop, mais, au fond, je le sais : j’écris moins. J’écris moins d’abord parce que je ne sais plus tellement quoi dire, et aussi parce que je me force moins à trouver quoi dire. J’ai des pistes mais je ne les écris pas car je ne les force pas et car au fond je prends tout mon temps pour les dire, un temps bientôt si long que je finirai par ne rien dire. Je lis beaucoup de choses nouvelles qui pourraient me permettre de trouver des choses nouvelles à dire. J’achète des savons saponifiés à froid et des portes-savon en bambou et en grès et des sacs en tissu mais ils ne me font rien écrire en particulier, ils me servent juste à vivre, ce qui est en fait, je m’en rends compte à mesure que les années passent, essentiel. C’est une pensée terriblement banale et pourtant essentielle que d’acheter des savons saponifiés à froid et des sacs en tissu pour se rapprocher de quelque chose qui est vivre. Ce que je confesse est terrible car finalement j’écris moins pour acheter des savons saponifiés à froid, c’est terrible, mais essentiel dans un certain sens. C’est terrible de moins écrire pour se concentrer sur quelques savons conçus artisanalement. Est-ce qu’il y a une quelconque hiérarchie établie entre l’écriture et les savons ? Confesser moins écrire pour acheter des savons est un acte de bravoure, d’une certaine manière, c’est un acte qui s’impose, car qui oserait dire : les savons avant l’écriture, eh bien pas grand monde, cela je pourrais l’assurer. Pas grand monde n’oserait affirmer son amour des savons à ce point, au détriment de l’écriture, qui est pourtant considérée comme un des arts les plus nobles de la civilisation occidentale. Le savon n’est considéré comme pas grand chose, voire rien, le savon n’intéresse personne, sinon les personnes qui se lavent, c’est-à-dire tout le monde. Je pourrais écrire davantage sur le savon, ou même confectionner des savons. Il y a quelque chose à regarder du côté des savons, j’en suis persuadé. Mon instinct m’indique que quelque part autour du savon se trouve mon avenir. L’écriture, c’est du passé. Je vais m’investir au maximum dans le savon. Le savon sera mon salut. Il n’y aura plus que lui, le savon.
Par exemple, dans le métro, des annonces sonores nous avertissent que pour notre sécurité des agents peuvent fouiller nos sacs à tout moment. Fouiller les sacs des gens est une importante mesure de sécurité pour prévenir du terrorisme notamment. On peut cacher tant de choses dans un sac, comme par exemple des explosifs, ou des armes, ou des barres chocolatées. Les barres chocolatées ne sont pas considérées comme des armes par les agents de sécurité, et pourtant il est possible de faire des choses monstrueuses avec des barres chocolatées. Les agents de sécurité n’arrêtent personne pour port illégal de barres chocolatées. Toutes ces personnes qui circulent en liberté alors qu’elles transportent quantité de barres chocolatées dans leurs sacs, cela ne me rassure pas. Les agents de sécurité ne font décidément pas leur travail. Sous prétexte qu’ils peuvent fouiller les sacs de tous les voyageurs, ils en oublient de confisquer les barres chocolatées. Les agents de sécurité fouillent et fouillent quantité de sacs et laissent passer toutes ces barres chocolatées. Ils ne font rien pour notre sécurité. Toutes les annonces du métro sont mensongères. Désormais, je refuse que les agents de sécurité fouillent mon sac car ils ne les fouillent pas vraiment, ils jouent aux aveugles, ils jouent à ne pas voir, à ne surtout pas voir les barres chocolatées qui sont le problème principal, le coeur du problème, le danger qui nous menace tous, et qui est passé sous silence par les politiques et les médias. Je prends peur souvent d’imaginer tous ces passagers qui voyagent avec des barres chocolatées plein leurs poches et leurs sacs, c’est angoissant, terriblement angoissant, cela demande une vigilance de chaque instant pour ne pas céder à la panique, pour faire le travail que les agents de sécurité ne font pas. On ne peut plus compter sur les agents de sécurité pour nous protéger des barres chocolatés, si bien que j’en ai toujours une sur moi, au cas où, pour me défendre.
« Sans doute, ce n’est pas moi qui déterminerai de quelle manière les plaintes des Nègres se feront entendre, je dois cependant dire que leurs gémissements ont du frapper vos oreilles, comme les flots de la mer irritée battent les rochers des côtes de l’Afrique. S’ils n’ont pas été écoutés, ils ne sont pas absolument étouffés ; ils acquerront de nouvelles forces. Peut-être alors vous épouvanteront-ils. Rien ne pourra les arrêter ; les mers, les montagnes, les rochers, les déserts, les forêts ne les empêcheront pas de venir jusqu’à vous ; la bonhommie des Noirs deviendra une fureur indomptable qui renversera tout ; les coeurs les plus intrépides frémiront ; et une aveugle confiance en votre bravoure sera le dernier piège que vous tendra votre entêtement. » – Ottobah Cugoano, Réflexions sur la traite et l’esclavage des nègres.
Saccage était en lice pour le Prix Littéraire des Grandes Écoles. J’imaginais déjà recevoir un stylo Mont-Blanc et les honneurs de François-Henri Désérable (parrain du prix), honneurs suivis d’une accolade chaleureuse et fraternelle du même François-Henri, dans une salle comble, émue. Mon avenir s’en trouverait changé. Peut-être le début d’une gloire (au moins d’une reconnaissance) que, au fond, je pensais mériter. Un site internet, Zone Critique, est chargé de chroniquer les livres en lice pour rendre-compte des réunions de lecture dudit prix. L’article à propos de mon livre a été publié aujourd’hui, et je suis dans le regret de vous annoncer être, objectivement, fort mal parti pour gagner le prix (disons que si je participais à une compétition cycliste, je me trouverais actuellement à la dernière place et les deux pneus crevés ; mais rien n’est impossible !). L’article s’intitule Saccage de la littérature, ce qui, de toute évidence, ne laissait rien présager de bon. Il a été rédigé par Pierre Chardot, apparemment normalien, et féru, selon sa biographie, de la prose française des XIXème et XXème siècles mêlant littérature, politique et journalisme. Il le reconnaît cependant volontiers : Peut-être un poil passéiste, j’endosse sans complexe le costume étriqué du chroniqueur d’arrière-garde. Pour faire bref : Pierre n’a pas tellement aimé mon livre, si ce n’est qu’il a pu s’adonner à divers exercices d’écriture suite à sa lecture, ce qui n’est pas tout à fait rien. Songeant à en finir définitivement avec la littérature et ma vie suite à cette terrible chronique, j’ai tout de même, dans un geste de désespoir, tapé le nom de mon bourreau sur Google. Je tombe alors sur un article de Ouest-France titrant Figure de l’athlétisme, Pierre Chardot est décédé. Comment ?! On lui enlevait l’opportunité de compulser avec un plaisir coupable les pages de mon second roman à paraître en septembre prochain ?! Comment ?! Il était une figure de l’athlétisme ?! C’en était trop de malheur dans une seule journée… Fort heureusement, en précisant ma lecture de cette brève sportive, je me suis rendu compte qu’il s’agissait (ouf !) d’un homonyme. Pierre était vivant. Pierre n’avait aucunement pratiqué l’athlétisme. Pierre allait à nouveau bénéficier du loisir de remettre quelques balles dans son fusil pour partir à l’attaque. Un plaisir que je m’en serais voulu de lui enlever.
Dans le parc du Luxembourg, en ouvrant la poche avant de mon sac à dos, j’ai constaté qu’on m’avait volé mon stylo. Plutôt, j’en ai déduit qu’on m’avait volé mon stylo car il ne se trouvait plus dans la poche avant de mon sac à dos, ou en tout cas, plus honnêtement, je ne le voyais plus. Quand on ne voit plus son stylo dans la poche avant de son sac à dos, c’est souvent qu’on l’a perdu, ou qu’on se l’est fait voler, ou qu’on l’a prêté (plus rarement). Je ne me souvenais pas avoir perdu mon stylo, car je ne m’étais pas rendu compte de sa perte plus tôt, et pourtant cette poche je l’ouvre souvent, et pourtant j’en inspecte souvent le contenu. C’est donc une piste que j’ai vite (aussitôt) abandonnée. Je me demandais également pourquoi on m’aurait volé ce stylo. Ce n’était pas un stylo tellement précieux, c’était un cadeau qu’on avait offert à Cécile et que elle-même m’avait offert, et dont je me servais principalement pour écrire des recettes de cuisine dans un cahier prévu à cet effet. Parfois je m’en servais également pour noter des informations dans un carnet, mais rarement, car je me sers très peu de mon carnet, voire pas du tout, si bien que je me demande souvent pourquoi j’ai avec moi un carnet qui ne me sert à rien, au fond. Ensuite, je me suis dit que peut-être pour moi ce stylo n’était rien, mais que quelqu’un aurait pu le croire précieux (ce qu’il n’était pas, même pas symboliquement). En sortant du parc du Luxembourg, je me suis dit que ça n’était pas très grave, que c’était l’occasion pour moi d’acheter un crayon à papier, crayon que je voulais acheter depuis un certain temps mais que, pour certaines raisons écologiques, je différais, attendant que l’encre de ce stylo arrive à terme. Une fois sur le quai du RER B, j’ai vérifié à nouveau dans la poche avant de mon sac à dos, et il s’est trouvé que mon stylo était en fait coincé dans un recoin de cette poche pourtant petite, et qu’il n’avait été ni perdu ni volé ni prêté, et qu’il ne s’était au fond rien passé, que tout ce qui précède devait être oublié.
Éric-Emmanuel Schmitt, invité (encore !) sur le plateau de La Grande Librairie pour présenter son énième merde dont le titre m’échappe, a pu déclarer en toute décontraction : « Que quelqu’un soit impressionné encore par le Nouveau Roman, par le diktat du Nouveau Roman, ça m’a touché. Moi je pensais que c’était… Je suis pas en train de mépriser les auteurs en question, mais, je veux dire, je trouve que comme école littéraire, ça s’arrête dans les années 70 quand même. » Il va sans dire que Simon, Sarraute, Robbe-Grillet, Pinget, Ollier, Butor, Beckett, Ricardou, et Duras, du lointain tréfond de leurs années 70 où ils sont restés pour toujours englués, saluent bien bas ce con définitif.
Ne pas oublier de nommer un personnage Chevalier.
Le constat était : Je ne peux plus écrire de poésie. Donc : que faire après la poésie ? Donc : Écrire après la poésie, sous quelle forme ? Donc : Tentatives multiples pour dépasser cette poésie que je ne peux plus écrire. Donc : La Ville fond est une de ces tentatives.
Tombant sur le profil Facebook d’un auteur français (rappelez-moi de ne plus jamais faire ce genre de choses ; auteur que je n’ai par ailleurs jamais lu), je lis ces quelques phrases, écrites de sa main : « N’oublions pas que partout, l’athéisme progresse. N’oublions pas que, sur le long terme, l’humanité se débarrassera des religions. J’ai dit : sur le long terme. » Le message, en tant que tel, pourrait presque être lu comme une profession de foi. Je ne sais pas en quoi la disparition des religions est forcément une bonne chose. Ou plutôt : en quoi l’athéisme résout les questions que posent les religions. Je ne sais pas pourquoi il faudrait se débarrasser absolument des religions pour y mettre à la place l’athéisme. L’athéisme contemporain ne me paraît pas résoudre grand-chose, et je suis pourtant moi-même athée. Mon athéisme quotidien n’apporte aucune réponse satisfaisante aux questions que posent les religions. J’apprécie le fait que d’autres personnes croient, car elles sont sur d’autres pistes pour résoudre les questions que posent les religions que moi, athée ; et je ne pense pas vouloir d’un monde uniquement fait d’athées. Il me semble que la haine des athées pour les religions touche de manière plus globale encore la haine de la spiritualité, ce qui est épouvantable. Que certaines personnes puissent au moins croire est une chose salutaire tant parfois elles n’ont pas grand chose d’autre pour affronter l’idée de vivre. Je n’envisage pas l’athéisme comme une fin en soi. L’athéisme ne rend pas forcément plus libre s’il délivre des religions pour plonger dans le consumérisme, par exemple. L’athéisme est encore une croyance car elle est la croyance qu’aucun dieu n’existe. L’athéisme n’est pas une étape vers la non-croyance ; elle est toujours un positionnement de croyance par rapport aux religions. L’athéisme pourrait être une religion. La religion de ceux qui ne croient pas (croient donc ne pas croire).
Il est possible que Récit d’un avocat, d’Antoine, lu en 2018, n’ait plus du tout le même sens.
« Voici qu’il te semble pénible et nul de te souvenir que, — sous quelques tours, à peine révolus dans l’attract circulaire de ce soleil déjà piqué, lui-même, des taches de la mort, — tu es appelé à quitter pour jamais cette bulle sinistre, aussi mystérieusement que tu y es apparu ! Et voici qu’elle te représente maintenant le plus clair de tes destinées. » – Auguste Villiers de l’Isle-Adam, L’Ève future.
Dans une revue littéraire en ligne qui a pourtant bonne réputation, je lis cette phrase, à propos du dernier roman de Christian Oster, La vie automatique : « Il alterne les phrases courtes et les phrases plus longues, soulignant les mouvements et les changements qui animent le narrateur. » Hm. Alterner les phrases courtes et les phrases plus longues, voilà une astuce à laquelle je n’avais jamais pensé.
Par exemple, quand on y pense, le plastique, on ne s’en servait presque pas avant la Seconde Guerre Mondiale, voire pas du tout, et ce n’est qu’après qu’on s’est mis à concevoir tout un tas d’objets en plastique, de plus en plus d’objets différents toujours en plastique, bientôt même jusqu’à délaisser nombre d’autres matériaux bien plus solides et sains pour le plastique qui est un matériau pratique mais cher en ressources et polluant et pas du tout dégradable et mauvais pour la santé. Disons que le plastique a tout au plus soixante ou soixante-dix ans d’existence et pourtant il a fait en si peu de temps des dommages incroyables sur l’environnement. Disons qu’il a suffit de seulement soixante ans pour détruire absolument l’éco-système entre autres à cause du plastique. Toutes les brosses à dents en plastique utilisées jusqu’à ce jour existent encore quelque part car elles n’ont pas eu le temps de se dégrader naturellement, car le plastique est un matériau infernal car il met des centaines d’année à disparaître et qu’on peut à peine le recycler. Le plastique transmet toutes ses bactéries à la nourriture et pollue la nourriture quand on la stocke dans tel récipient en plastique, et encore davantage si on fait chauffer cette nourriture dans ce même récipient en plastique, même l’eau, le plastique pollue absolument tout, le plastique est véritablement un matériau dégueulasse quand on y pense, quand on s’éloigne un peu du plastique on se demande quand même pourquoi il y a tant de plastique partout. Tout est en plastique. On est à ce point obsédés par le plastique qu’on a oublié que des matériaux comme le bois le verre ou l’inox existaient, on a tout oublié pour le plastique et de fait on a tout construit en plastique pour s’auto-détruire. Si on n’avait pas inventé le plastique je ne sais pas s’il nous aurait beaucoup manqué mais en tout cas il n’y aurait pas tant de brosses à dents inutiles et usagées n’importe où dans le monde qui attendent de se dégrader et ne se dégraderont jamais. Tourner le dos au plastique est un combat de chaque instant et on se rend pas compte à quel point tout le monde désormais veut que vous achetiez du plastique et utilisiez du plastique et on est obligés de se battre pour dire non au plastique, ce qui peut sembler idiot ou ridicule mais est véridique, le plastique est un combattant redoutable, il est comme le pire des combattants, il est partout, il est aimé de tous, il détruit chaque parcelle de terre et accumule les brosses à dents au sommet de décharges infinies, décharges qui seront bientôt dans peut-être soixante ans à peine nos lits. Il faut s’y faire.
L’Ève future est un de ses livres tellement obsédé à détailler comment son principe marche qu’il en oublie de le faire marcher (Verne le fait aussi).
Parfois, quand je me sèche dans ma baignoire, j’imagine que mon pied glisse sur le rebord alors que j’en sors, que mon corps bascule vers l’avant et que je heurte ma tête contre le lavabo ou le mur ou le sol (ou les trois) ; en somme, je me projette mort, et je ne sais pas tellement bien pourquoi.
Par exemple, obtenir le prix Goncourt pour son premier ou deuxième roman est une plaie. Alexis Jenni, lauréat en 2011 pour son premier roman L’Art français de la guerre (roman moyen au demeurant, méritant donc de facto ce prix distinguant chaque année un roman moyen au demeurant), en est la preuve. Le prix Goncourt lui a sans doute permis de s’offrir une maison ou de finir de rembourser le prêt de celle dans laquelle il vivait déjà. Depuis, il a déjà publié six livres (romans et essais) dont évidemment tout le monde se fout puisqu’il a déjà obtenu le prix Goncourt, qu’il ne peut plus l’obtenir une nouvelle fois, qu’il ne sera jamais plus dans la course, et que donc, de fait, son oeuvre n’a plus vraiment d’importance, plus vraiment d’objectif, d’intérêt. Les journalistes ont bien d’autres chats à fouetter que tous ces livres qui ne servent pas à la grande conversation médiatique du contemporain. Une fois le Goncourt obtenu, on peut aisément changer de carrière, ou trouver quelques astuces, comme Romain Gary, qui a compris qu’une fois le prix Goncourt obtenu le mieux à faire était de l’obtenir à nouveau ; ou comme Julien Gracq qui, en le refusant en 1951, demeurait toujours aux yeux des journalistes comme le potentiel lauréat pour une oeuvre future, toujours potentiellement en course, intact. Et si encore le cas d’Alexis Jenni restait isolé, mais ce n’est malheureusement pas le cas. Jonathan Littell avait 39 ans lorsqu’il a obtenu le prix Goncourt en 2006 pour son deuxième roman Les Bienveillantes (pour connaître mon avis sur la qualité du roman, voir la première parenthèse plus haut). Il a depuis écrit huit fictions et essais dont tout le monde se fout également pour les mêmes motifs que ceux ayant touché l’oeuvre en cours d’Alexis Jenni. Leïla Slimani, lauréate en novembre dernier et à 35 ans du prix Goncourt pour son deuxième roman Chanson douce suit avec une courte avance le chemin de ses prédécesseurs. Il ne fait aucun doute que son oeuvre empruntera leur droite lignée, à savoir l’indifférence et le désintérêt pour ne finalement plus devenir qu’un nom parmi d’autres dans la conséquente liste de lauréats disponible sur la page Wikipédia du prestigieux prix. Obtenir le prix Goncourt assure l’argent pour s’offrir la maison dans laquelle se cloître, attendre et mourir ; on se demande pourquoi ne pas s’offrir directement le caveau. Le prix Goncourt permet d’abandonner sitôt obtenu l’ambition de toute une vie. Le point commun des trois lauréats cités ici est d’être publiés aux éditions Gallimard, dans la collection Blanche, ce qui n’est malheureusement pas un très bon signe pour la postérité des auteurs de cette maison.
Quand j’ai mal au dos, pour me soigner, j’attends, jusqu’à ce que finalement la douleur passe (je ne sais pas comment ; passe-t-elle vraiment ?)
Je lis d’un roman qu’il est une seringue d’amour. Étonnant.
(Bram lisait son journal quand il s’aperçut qu’il était en retard. Bram s’aperçut de son retard après avoir consulté sa montre et non en lisant son journal. Bram avait été à ce point distrait par la lecture de son journal qu’il en avait oublié de consulter sa montre et de vérifier l’heure si bien qu’il s’était mis bêtement en retard, bêtement et absolument en retard. Bram replia à la hâte son journal, débarrassa sa vaisselle dans l’évier et s’empressa d’enfiler sa veste. Puis il mit un temps infini à retrouver ses clés, qu’il retrouva finalement, par chance se dit-il, dans une des poches inutilisées de sa veste. Il se précipita à l’extérieur et referma la porte d’entrée derrière lui avant de se diriger d’un pas rapide vers son arrêt de bus.)
Par exemple, sur un plateau de télévision, un syndicaliste policier a pu déclarer (et c’est là tout le privilège des syndicalistes policiers) que, pour interpeller un Noir, Bamboula était à peu près convenable, ce à quoi la journaliste lui répondit que non, ce n’était pas convenable, et le syndicaliste policier de s’insurger alors que, quand on les traite eux d’enculés de flic ça n’était pas tellement convenable non plus. Car en effet, à l’insulte répond l’insulte, et le policier formé le sait bien car il ne peut s’empêcher de répondre à l’insulte par l’insulte, car il est après tout un professionnel, et quel professionnel n’insulte pas dans le cadre de son travail, car quel professionnel peut contenir son sang-froid en toute circonstance, et ne s’autorise pas parfois un petit Bamboula (qui est, rappelons-le, tout de même convenable), quand lui-même se fait traiter d’enculé de flic par des citoyens (à juste titre) en colère. Car sans doute durant la formation pour devenir policier n’apprend-on pas qu’il n’est pas bon d’attiser la haine en propageant plus de haine encore, car sans doute est-ce là peut-être du trop bon sens, ou peut-être pas une réalité de terrain, ou peut-être pas une réponse adaptée aux menaces constantes dont les policiers sont les cibles, et qu’il faut forcément insulter car insulter apaise les tensions et permet d’y voir plus clair et de démontrer qu’on est un professionnel non grâce à son cerveau et grâce à la parole mais plutôt grâce à son gilet pare-balles et son fusil de précision. Car à quoi bon les gilets pare-balles et les fusils de précision si on a la parole et le cerveau, à quoi bon tout ce qui fait le sel du métier de policier, son attrait, sa passion, c’est-à-dire les armes et la domination. Car à quoi bon dévenir policier si on ne peut s’autoriser un petit Bamboula de temps en temps, comme on s’accorde dix minutes de sieste discrètes au bureau. À ce rythme-là, autant devenir plombier (rires), autant devenir éboueur (rires redoublés), si on ne peut même plus exercer son métier de policier comme on l’entend. Jusqu’à quel point l’insulte par des professionnels de la sécurité peut-elle être tolérée, voilà à vrai dire la véritable question, jusqu’à quel point peut-on ne pas se contenir et perdre tout sang-froid sans être jugé et puni, voilà à vrai dire l’autre véritable question, à quel point en ces temps d’injustice et de racisme et de honte peut-on ou doit-on faire justice soi-même, voilà à vrai dire le coeur du problème.
Si on ne nous donne pas le temps de correctement parler, à quoi bon parler.
Par exemple, on ne fait plus tellement attention que le jus d’orange qu’on achète au supermarché (celui produit par de célèbres marques alimentaires dont on peut voir à l’occasion les publicités à la télévision), n’est pas vraiment du jus d’orange, pas tout à fait du jus d’orange, à peine du jus d’orange si on veut être honnête, surtout de l’eau, beaucoup d’eau et très peu d’orange. On s’habitue pourtant à boire ce jus d’orange qui n’en est pas et à le qualifier de jus d’orange. C’est une erreur de langage que de nommer ce mélange d’eau et de conservateurs jus d’orange, car le jus d’orange, et on s’en rend bien compte quand on en presse une (d’orange) pour la boire, ça n’a rien à voir avec ce que ces marques célèbres nous vendent, ça n’en a ni le goût ni la consistance ni les bienfaits, c’est comme qui dirait une autre boisson, comme qui dirait complètement autre chose. Alors qu’est-ce au juste que ce jus d’orange disponible en supermarché, qu’est-ce au fond que ce mélange étrange et chimique, sinon un non-jus produit à partir de non-oranges, sinon finalement un incroyable mensonge uniquement destiné à nous faire croire à la chose que l’on achète, adhérer à ce produit qui n’est pourtant rien de ce qu’il indique sur son emballage, sinon rien qu’un ensemble étrange que nous consommons par aveuglement et par paresse et par pauvreté. Ne sommes-nous pas chaque jour nourris de produits étranges que notre pauvreté et notre paresse nous contraignent à consommer, ne sommes-nous pas chaque jour un peu plus trompés par la publicité et la volonté de profit des grandes marques alimentaires, ne sommes-nous pas chaque jour un peu plus conditionnés par les célèbres marques alimentaires pour oublier le goût et de la saveur du jus produit par quelques quartiers d’oranges pressées ?
Le capitaine apprit à la magicienne qu’auparavant toutes les îles de l’archipel ne formaient qu’une seule et même île, une seule île qui réunissait tous les climats et reliefs de l’archipel en un même territoire, une seule île désormais fendue en de multiples endroits, de multiples frontières, par la montée des eaux, par la submersion progressive des glaciers, et dont les morceaux depuis s’éloignent à chaque instant davantage, si bien que le capitaine n’est plus sûr, confia-t-il à la magicienne, de pouvoir toujours naviguer entre les îles sur le cargo Marécage, de pouvoir toujours transporter les habitants et les marchandises, car peut-être un jour y aura-t-il trop de distance entre chaque île, peut-etre seront-elles chacune isolée absolument, et peut-être sera-t-il obligé alors d’abandonner le cargo au milieu de la mer et de prendre sa retraite ; peut-être faudra-t-il pour les insulaires inventer un autre moyen de transport et oublier le cargo Marécage.
Le capitaine demanda à la magicienne si à tout hasard elle ne connaissait pas un sort capable de, comment pourrait-il le dire exactement, recoller les îles de l’archipel entre elles, les faire se rejoindre, enfin, il ne savait pas s’il était bien clair, refaire de toutes ces îles éparses l’unique et grande île qui avait été comme leur mère à toutes. La magicienne lui répondit simplement qu’elle ne pouvait rien transformer de ce qui avait résulté de l’ordre naturel des choses, quand bien même cet ordre serait la destruction et l’isolement ; qu’elle était incapable, interdite même, de modifier l’empreinte prévue par les mouvements terrestres, comme elle était interdite d’inverser l’expansion des étoiles dans l’espace pour revenir aux origines de l’univers, vers cet éclat disparu de la formation des mondes.
Par exemple, l’immunité est un concept extrêmement pratique pour devenir en toute sécurité un hors-la-loi. Beaucoup de hors-la-loi ne le seraient pas s’ils ne pouvaient bénéficier de l’immunité. Hors-la-loi est en effet un choix de carrière hasardeux pour quiconque ne peut bénéficier d’une immunité de longue durée, à moins d’être lourdement armé et barricadé dans un manoir gigantesque gardé par de gigantesques gardes eux-mêmes lourdement armés. Souvent les hors-la-loi du quotidien n’ont ni la carrure ni l’état d’esprit pour être lourdement armés, ce qui requiert un état d’esprit violent allant de pair avec toutes ces armes lourdes. Beaucoup de hors-la-loi bénéficiant d’une immunité sont présidents de la République ou ambassadeurs ou députés, des postes pratiques et idéalement situés dans la ville pour commettre tout un tas de crimes ignorés. Souvent les citoyens ignorent que tel hors-la-loi est leur président de la République, et ils ne s’en rendent compte que bien après, et ils se disent : ah, tout de même, qui aurait pu imaginer que ce hors-la-loi deviendrait notre président, et ils s’indignent qu’un tel hors-la-loi ait pu être président (par leur faute, ce dont ils s’indignent moins). L’immunité des hors-la-loi présidents est un phénomène mondial, ce qui prouve tout l’intérêt qu’ont les hors-la-loi à devenir président de la République, profession pourtant très difficule d’accès. Souvent les hors-la-loi préfèrent devenir dictateur, ce qui prend beaucoup moins de temps. Il n’y a malheureusement pas assez de postes de président de la République ou de dictateur pour tous les hors-la-loi dans le monde, il y a même, on pourrait dire, une vraie pénurie de métiers immunisés, ce qui empêche nombre de hors-la-loi d’exercer leur profession comme ils le souhaiteraient, ce qui empêche la création d’emplois de hors-la-loi, et entraîne donc le chômage, un chômage immense compte-tenu de la quantité d’apprentis hors-la-loi dans le monde. Être président de la République pour un hors-la-loi est vraiment une situation idéale car même une fois passé le mandat de président, le hors-la-loi, grâce à des indemnités multiples, gagne toujours de l’argent (ce qu’un hors-la-loi adore) ; mais il n’est plus aussi bien immunisé, et risque d’être condamné par la justice à des peines qu’il ne purgera pas (quel soulagement !). Cependant, même une fois son immunité perdue, le hors-la-loi ancien président de la République bénéficie d’une autre aide : l’impunité. Mais attention à ne pas confondre l’immunité et l’impunité, qui elle profite à bien plus de catégories sociales comme, entre autres, les policiers, les juges, les députés, et est donc beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste.
Pour Cargo Marécage, j’avais envisagé un temps que la magicienne vive seule sur une île, et que toute l’action se déroule sur le continent à proximité. Finalement, je pense opter pour l’archipel, qui permet à la fois de mieux mettre en mouvement le cargo, et de m’éviter de construire l’imaginaire d’un territoire entier. Cet archipel aurait la forme d’un archipel polaire sans son climat extrême.
Par exemple, quand vous vous faites tabasser par un policier, il y a de grandes chances en fait pour que vous ne vous fassiez pas tabasser par un policier, que le policier n’y soit pour rien, que ni lui ni ses collègues n’aient rien vu ni rien entendu. Il y a même de grandes chances que vous ayez halluciné, comme les policiers pourront plus tard le déclarer au juge, et c’est en effet une possibilité car les policiers vous ont tabassé à un tel point que vous en avez perdu la notion du temps et de l’espace. Quand les policiers vous tabassent il y a de grandes chances pour que finalement ils ne vous tabassent pas, qu’ils vous tabassent tout en ne vous tabassant pas. Les policiers ont tout un arsenal pour tabasser sans en avoir l’air, comme par exemple des matraques téléscopiques qui font comme si elles ne frappaient pas, ou des fusils flashballs qui font comme s’ils ne laissaient aucun hématome ni aucune éraflure ni ne crevaient aucun oeil. C’est un arsenal extrêmement sophistiqué que seuls les policiers ont le droit de posséder, car si chaque citoyen pouvait tabasser sans tabasser tous seraient immédiatement condamnés par la justice pour violences et tentative d’homicide. Les policiers doivent être très prudents et aguerris pour ne jamais avoir l’air de tabasser, c’est une vigilance de chaque instant. Attention : quand bien même les policiers ne vous tabasseraient pas, ils vous tabassent ! Il arrive que les policiers tabassent sans tabasser en public, et alors les citoyens qui circulent autour d’eux filment ces tabassages qui n’en sont pas, mais sont aussitôt empêchés par les policiers qui ne veulent pas que leur technique ancestrale de tabassage sans tabasser soit divulgée ainsi au tout venant et entraine d’importantes brèches dans la sécurité du pays. Chaque pays du monde maîtrise une arcane de la violence apparente. Par exemple, les états-uniens sont extrêmement compétents pour tuer les Noirs sans en avoir l’air. Ce savoir comme toute marchandise s’exporte mondialement et notamment en France. J’en veux pour preuve le décès en juillet dernier du jeune Adama Traoré qui, après avoir été tabassé par des policiers sans qu’ils aient eu l’air de le tabasser, puis secouru à l’heure prévue par des secours en retard, puis menotté sans que les menottes ne l’entravent tout à fait, est finalement bien mort au bout du compte, tout à fait mort et tué par le tabassage méthodique des policiers qui n’en était pourtant pas un, ou du moins (et c’est là qu’on comprend toute la subtilité de cet art) pas tout à fait un.
« Si vous voulez donc être homme en effet, apprenez à redescendre. » – Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse.
Le garçon la nuit imitait les gestes de la magicienne et, bien qu’il n’y eut en lui aucune magie, bien qu’il soit incapable de lancer le moindre sort, bien qu’il soit le plus anodin des garçons aux côtés de la plus importante des magiciennes, bien qu’il n’y eut aucun espoir qu’un jour il puisse produire une quelconque étincelle, il s’acharnait chaque nuit et s’entrainait chaque nuit dans l’espoir de produire lui aussi cette magie unique que la magicienne maîtrisait. Chaque soir, le garçon s’éloignait discrètement du campement et partait s’entraîner dans la nuit et personne ne le voyait. Parfois la nuit il s’entrainait et quelqu’un qui par hasard passait par là le voyait s’entraîner et s’amusait de ce garçon gesticulant dans la nuit. Alors l’inconnu passant par là saluait le garçon qui tout honteux s’en retournait en courant vers le campement et s’endormait dans son duvet. Plusieurs fois le garçon crut qu’il avait produit un sort, mais il s’agissait soit de la fatigue soit de l’obscurité qui l’avaient trompé. Un soir, alors qu’il s’entrainait, le garçon s’aperçut que des hommes discutaient non loin de là. Il s’approcha des voix des hommes et vit un groupe de cinq ou six hommes discuter ensemble, mais de manière à ce que personne ne les entende, en restreignant la portée de leur voix le plus qu’il leur était possible. Le garçon, imaginant que ces hommes en avaient après la magicienne, courut jusqu’au campement pour avertir cette dernière. Encore à moitié endormie, la magicienne répondit au garçon qu’ils viennent, qu’elle les attendait, puis elle tourna le dos au garçon qui, encore peu au fait de l’étendue des pouvoirs de la magicienne, s’assit en tailleur à ses côtés et attendit que le jour se lève.
Par exemple, dans le train, il arrive que les voyageurs se lèvent alors que le véhicule est dans un virage, ce qui les déséquilibre tout à fait, car souvent les voyageurs ne font pas attention à la force d’attraction des trains et oublient qu’ils sont dans un véhicule lancé à plusieurs centaines de kilomètres à l’heure sur des rails et agissent finalement comme s’ils n’étaient pas dans un train, c’est-à-dire inconsidérément. Souvent les voyageurs dans les couloirs des trains manquent de tomber sur les autres voyageurs confortablement (ou non) assis, et parfois ne manquent pas mais tombent absolument, de tout leur long et de tout leur poids sur les voyageurs assis qui eux n’ont rien demandé et ne comprennent pas pourquoi ces voyageurs debouts n’anticipent pas mieux leurs mouvements et leurs tombent ainsi dessus, mais finalement les voyageurs assis excusent les voyageurs debouts en redoublant de formules de politesse, ce n’est rien, ça arrive, formules de politesse que les voyageurs debouts renvoient aux voyageurs assis avec honte et détresse. Parfois il arrive que les voyageurs tombent alors qu’ils reviennent du wagon-bar et ont dans les mains un café ou un repas conservé dans un pochon en carton ou en plastique et renversent le café et/ou le repas sur les voyageurs assis qui cette fois sont à la limite de l’infractus car souvent ces cafés et/ou repas tombent non seulement sur eux mais également sur leur matériel informatique qui leur a coûté une fortune et qui se retrouve ruiné et détruit instantanément (effaçant du même coût leurs tableurs comptables ou leurs diaporamas de présentation ou leurs oeuvres littéraires en devenir, voire les trois en même temps si jamais le voyageur ou la voyageuse assis(e) est un ou une jeune comptable aux aspirations artistiques, comme on peut en rencontrer dans les romans de Michel Houellebecq ou dans les films de Cédric Klapisch). Souvent l’astuce consiste à avancer dans les couloirs des trains en se reposant (cognant) sur les dossiers des voyageurs assis, qui eux peuvent encaisser le poids du voyageur debout sans protester, car ils sont conçus entre autres pour cela. Il y a chez les voyageurs debouts qui tombent une réelle faculté pour éviter les dossiers des sièges qui est proprement fascinante, proprement inouïe, proprement déprimante, scandaleuse. S’ils ne sont pas assurés, ils peuvent ramper, au moins.
Par exemple, quand on n’a pas grand-chose à dire, on peut se taire.
Suite au transport de la machine à laver (cf plus bas), le blocage de mon dos, qui ne concernait jusqu’alors que la région des lombaires, s’est aggravé et étendu jusqu’au milieu de mon dos qui me fait désormais affreusement mal la journée et même la nuit quand je suis allongé (songer à prendre rendez-vous chez l’osthéopathe).
J’ai fini Fort comme la mort. Le personnage principal, un vieil artiste, tombe amoureux de la mère puis, dix ans plus tard, de la fille, car il croit voir dans la fille la mère, mais la mère est persuadée qu’il ne voie dans la fille que la fille, ce que lui nie (la fille, elle, s’en fout). Ça badine à fond, et finalement l’artiste meurt écrasé par un fiacre. En regardant la biographie de Maupassant, j’ai remarqué qu’il avait écrit toute son oeuvre en dix ans, de 1880 à 1890. Six romans et des dizaines de nouvelles, en dix ans.
Par exemple, j’ai reçu un courrier de la banque HSBC qui m’informe que mon épargne, plus précisément mon épargne salariale, m’a rapporté 7,86€. Le siège français de la banque HSBC se trouve à La Défense, Paris. Je n’ai pas moi-même ouvert un compte dans la banque HSBC, c’est la maison d’édition Flammarion qui l’a fait pour moi, quand bien même je n’avais rien demandé. J’ai pendant un temps lu des manuscrits épouvantables pour Flammarion et à cette occasion ils m’ont ouvert un compte dans la banque HSBC. Certains de ces manuscrits épouvantables que j’ai d’ailleurs refusés ont été publiés dans d’autres maisons d’édition par la suite mais ça ne les a pas rendus moins épouvantables (j’ai été vérifier). Certains auteurs ne se doutent même pas que j’ai pu lire leurs manuscrits en travaillant chez Flammarion et les refuser. J’aurais préféré que Flammarion me paie davantage pour chaque manuscrit lu plutôt qu’ils ne m’ouvrent un compte inutile dans la banque HSBC. Savoir que je détiens 7,86€ dans la banque HSBC ne m’est pas d’une grande aide car je ne sais aucunement comme retirer cette somme à la banque HSBC ni n’ai l’occasion de me rendre dans les prochaines années à la Défense, quartier désagréable où on ne se sent bien qu’une fois parti. La Défense est aussi le quartier où se trouve la SACEM, organisme qui m’a versé ces trois dernières années environ 10 000€ et au siège duquel je ne me suis pourtant rendu qu’une seule fois. Alors pour 7,86€. Payer le trajet jusqu’à la Défense pour retirer 7,86€ me coûterait bien plus que 7,86€, qui est une somme à la fois ridicule et considérable de nos jours. Je n’ai trop su quoi faire de ce relevé patrimonial d’épargne salariale si bien que je l’ai rangé dans un trieur avec d’autres papiers concernant ma banque. Ces 7,86€ sans doute n’appartiendront jamais à personne, sinon à la banque HSBC, et sont comme 7,86€ inutiles, comme 7,86€ gâchés, et gâchés davantage un peu plus chaque année qui passe, car cette somme épargnée ne cesse de croître, et bientôt je pense, dans quelques dizaines d’années, deviendra même considérable, à moins que la banque HSBC ne disparaisse dans quelques dizaines d’années, ce qui risque à vrai dire sans doute probablement d’arriver compte-tenu de l’état compliqué du monde actuel.
Toutes mes plantes dépérissent. Mon ficus n’a plus une feuille sur ses branches. Je ne sais pas m’en occuper, les soigner. Je veux les arroser je les noie.
Hier soir, j’ai rêvé que mon grand-père, avant de mourir, avait un sursaut d’énergie qui nous donnait l’impression qu’il n’allait justement pas mourir. Pendant un moment, j’ai cru que réellement, avant de mourir, il y a de cela une dizaine d’années, il avait eu un sursaut d’énergie avant de mourir. Seulement, je crois qu’il s’agissait d’un autre rêve passé, que mon grand-père n’a jamais connu aucun sursaut d’énergie avant de mourir, que la maladie l’a progressivement rongé et abattu et immobilisé dans un lit d’hôpital puis dans un autre lit d’un plus petit centre hospitalier, qui est comme un hôpital mais en moins inquiétant pour les visiteurs et plus définitif pour les patients. J’ai donc tour à tour rêvé que mon grand-père avait eu un sursaut d’énergie, et de la possibilité même qu’il ait pu avoir un sursaut d’énergie, que cela soit vrai.
Par exemple, quand j’entends un bruit étrange dans la nuit je me lève pour voir ce qui se passe. Depuis mon salon, j’ai une bonne vue sur la rue qui me permet de voir ce qui se passe et quel est ce bruit étrange. Parfois il se trouve que le bruit étrange provient de l’intérieur de mon appartement mais par réflexe je regarde par la fenêtre du salon. Quand je me réveille au milieu de la nuit je suis encore ensommeillé et déboussolé et parfois il est possible que j’hallucine les bruits étranges et c’est pourquoi je ne vois rien dans la rue par la fenêtre du salon. Il arrive également que le bruit étrange se produise mais que je ne l’entende pas et que donc je ne me lève pas et que donc on en viendrait à se demander si le bruit étrange a bien existé si je ne l’ai pas entendu et ne me suis pas levé. Le bruit étrange peut venir de l’alarme incendie défectueuse et alors je désactive l’alarme incendie défectueuse pour qu’elle ne me dérange pas le reste de la nuit. Je vérifie bien avant de la désactiver si l’alarme incendie est défectueuse sinon je pourrais mourir dans un incendie et ne jamais être indemnisé par les assurances pour cette mort par incendie car mon alarme aurait été désactivée (comble : par moi-même). Désactiver l’alarme incendie est très risqué par rapport aux assurances mais non par rapport aux incendies, qui ne sont à l’ordre du jour toujours pas empêchés par les alarmes incendie. Les alarmes incendie en somme nous avertissent qu’on va mourir dans un incendie mais ne nous protègent pas des incendies. Il faut savoir se réjouir de cette information au moment de mourir car après tout on aurait aussi bien pu ne rien vous dire.
« On n’y songe jamais, pourtant ; on ne regarde pas autour de soi la mort prendre quelqu’un à tout instant, comme elle nous prendra bientôt. Si on la regardait, si on y songeait, si on n’était pas distrait, réjoui et aveuglé par tout ce qui se passe devant nous, on ne pourrait plus vivre, car la vue de ce massacre sans fin nous rendrait fous. » – Guy de Maupassant, Fort comme la mort.
Par exemple, il y a beaucoup de livres qui sont publiés aujourd’hui que je trouve épouvantables, vraiment absolument horribles, inutiles et médiocres, et qui mériteraient sincèrement de n’être pas publiés. Ce sont des livres que je ne lis jamais en entier car sinon la colère me dévorerait et le désespoir également, alors je me contente seulement de feuilleter les premières pages et déjà la colère et le désespoir m’accablent et je me demande qui a eu l’idée de publier de telles atrocités, quels comités de lecture ont pu approuver de telles décisions, quels professionnels formés et aguerris ; atrocités qui, de plus, tristement, seront médiatisées et saluées par des critiques littéraires aussi atroces que les livres atroces qu’ils saluent. Je n’avais jamais imaginé qu’il y ait tant de livres médiocres sur les tables des librairies mais il m’a pourtant fallu me rendre à l’évidence : le moindre livre que j’ouvrais pour feuilleter ses premières pages se révélait épouvantable et terrible et je me demandais si je lisais bien ce que j’étais en train de lire, s’il n’y avait pas une erreur, ou tout du moins une astuce pour appréhender ces, disons-le tout net, merdes. Un jour que j’étais énervé et déprimé dans une librairie à feuilleter tous ces livres médiocres je me suis rendu compte en levant la tête un instant qu’un autre homme se tenait dans un autre coin de la librairie et semblait épouvanté par sa lecture en cours qui devait être tout à fait terrible et médiocre pour qu’il paraisse à ce point épouvanté uniquement en lisant les premières pages. Heureux de trouver enfin un homme avec qui partager ma douleur et mon incompréhension, je me suis précipité à sa rencontre, et je m’apprêtais donc à partager avec lui ma douleur et mon incompréhension, quand, alors qu’il se retournait, je me suis rendu compte qu’il tenait mon livre entre les mains.
Ce matin, en me promenant le long de la Vilaine où sont habituellement stationnées plusieurs péniches, j’ai remarqué qu’une boîte aux lettres se trouvait sur la rive sans aucune péniche correspondante. Il y avait là une boîte aux lettres pour personne.
« C’est qu’on a affaire à l’opoponax. C’est lui encore quand on sent quelque chose qui passe sur sa figure et qu’on est couché dans le noir. Ou bien quand par hasard on se retourne tout d’une pièce dans la chambre où on est seul et qu’on surprend une forme noire qui est en train de glisser, qui est en train de finir de disparaître. Ou bien on se regarde dans la glace et il recouvre la figure comme un brouillard. Il ne faut pas se décourager et regarder fixement la glace comme si on ne s’apercevait de rien alors il s’en va. » – Monique Wittig, L’opoponax.
Par exemple, quand on est chez soi et qu’on entend le bruit d’un avion, on pourrait avoir tendance à croire qu’il est en train de s’écraser, alors qu’il ne fait que voler. Il est rare d’entendre un avion s’écraser ou alors on n’en est témoin que très peu de temps avant d’être soi-même écrasé par l’avion, et donc soi-même incapable de témoigner du bruit que faisait l’avion alors qu’il s’écrasait (sur vous). De même, il est rare qu’à l’inverse on pense l’avion en train de voler alors qu’il est en train de s’écraser. Souvent, c’est très visible que l’avion s’écrase, car il y a du feu et de la fumée et des cris si jamais on est soi-même à l’intérieur de l’avion. Sinon, si on est à l’extérieur, il peut aussi y avoir des cris, mais seulement de spectateurs, horrifiés mais heureusement aucunement victimes (peut-être proches de victimes). Cependant, quand l’avion s’écrase, il vole toujours d’une certaine façon. Maladroitement certes et sans l’intervention d’aucun pilote et sans aucune perspective d’arriver à bon port (bien qu’il arrive que parfois l’avion s’écrase à bon port, ce qui redouble le tragique de l’affaire, car finalement on y était presque, il manquait trois fois rien), mais il vole. En temps de guerre, on entendait sans doute plus les avions s’écraser que voler car ils étaient constamment attaqués et pulvérisés par les chars anti-aériens positionnés au sol. Quoiqu’en y repensant on entendait sans doute pas grand chose d’autre que les détonations des bombes et les rafales des mitrailleuses. Finalement il est possible que le bruit de l’avion qui s’écrase ne soit qu’une fiction et que personne ne connaisse réellement le bruit que fait un avion lorsqu’il s’écrase, ce qui implique que même lorsqu’il vole on peut avoir l’impression qu’il s’écrase, car finalement on n’en sait rien, on n’en connaît pas le bruit exact, à l’inverse par exemple d’une goutte qui tombe dans l’évier, que je ne pourrai jamais confondre avec un pot de fleur qui se brise. Il vaut mieux rester sur ses gardes : il serait dommage d’avoir trop fait confiance au bruit des avions et de s’être convaincu qu’ils volent si un jour finalement ils s’écrasent. Statuons donc comme principe que les avions toujours s’écrasent.
Ce matin avec Maëlle on a acheté un lave-linge. À peine l’avions-nous sorti du coffre de la voiture que j’ai failli me bloquer le dos. Deux amis à elle sont venus nous aider et je les ai regardés monter le lave-linge jusque dans notre appartement, au quatrième étage.
Par exemple, si on marche dans un train dans le sens contraire de son avancée, on produit un mouvement physique très complexe. Et cela peu importe si on marche pour se rendre aux toilettes ou au wagon-bar ; il s’agit dans tous les cas toujours du même mouvement physique très complexe. Si on marche et qu’on saute aussi de temps en temps cela rend le mouvement physique encore plus complexe. Et si on marche en plus sur un tapis roulant disposé dans l’allée centrale du train alors le mouvement physique devient encore infiniment plus complexe que celui exposé en premier lieu. À l’inverse, marcher dans le sens du train provoque un mouvement complexe mais moins complexe que marcher en sens inverse. Heureusement, toute cette complexité n’est aucunement ressentie au moment de l’acte, sinon plus personne n’oserait se déplacer en sens inverse dans les trains et les places assises dans le bon sens verraient leur prix s’envoler et les sièges dans le bon sens ne seraient plus réservés qu’à une caste privilégiée (bourgeoise) de la société française. Le prix des places dans le bon sens en première classe par exemple deviendrait tout simplement exhorbitant. On distinguerait les hommes entre ceux capables de se payer les sièges dans le bon sens, et les autres. En sachant que les mêmes sièges ne serraient pas toujours les plus chers car les trains changent parfois de direction. En fonction du voyage il y aurait des sièges dans le bon sens et des sièges dans le mauvais sens. Il deviendrait impossible de se déplacer si jamais on se retrouvait dans le mauvais sens, et il faudrait se retenir longtemps d’aller aux toilettes ou de manger si jamais l’envie nous prenait subitement, et sans doute qu’on verrait des hommes déjà pauvres s’uriner dessus ou manger leur voisin si jamais le trajet durait trop longtemps, ce qui entraînerait une crise très grave, une crise même sans précédent, jamais vue, à la fois pour les dirigeants de la SNCF et pour la dignité humaine.
Souvent je me demande : est-ce que ça a le moindre intérêt ? Mais non, bien sûr, ça n’en a pas le moindre, il faut simplement savoir faire semblant ; convaincre les autres de ce moindre intérêt.
Les textes ici sont souvent un peu maladroits, distordus, inaboutis, mais c’est ce qui fait leur charme, j’ose espérer.
« […] aujourd’hui, un livre de littérature peut se concevoir binguiennement, tout replié sur lui pour produire l’élan typique qui le projette en tête de gondole, et sidère les gondoles, et dispatche les petits coeurs post-it scrupuleusement remplis par les libraires d’adjectifs binguiens tels que jubilatoire, savoureux, etc., et tous ces mots culinaires avec lesquels en France on décrit la littérature […] » – Nathalie Quintane, Tomates.
Par exemple, rouler sur quelqu’un est un meurtre, tandis que rouler sur une voiture est une performance artistique ou du vandalisme. Rouler sur quelqu’un peut être une performance artistique si la personne qui se fait rouler dessus est consentante et prévue dans le dispositif scénique ; mais il peut aussi s’agir d’un suicide assisté. Parfois la frontière est mince entre la performance artistique et le suicide assisté. Pour réaliser une performance artistique qui implique des véhicules souvent il vaut mieux être cascadeur, au cas où la voiture brûle ou explose ou qu’il faille improviser un salto en moto-cross ou une chute de douze mètres. Le risque de ne pas engager un cascadeur pour ce type de performance artistique est de mourir ou de ne pas réussir la performance artistique devant tout un parterre de badauds et de journalistes et donc d’avoir la honte et de devoir enterrer sa carrière artistique à cause de la honte et de l’échec. Le soir, si dans la rue vous croisez un homme faire de la moto-cross sur une rangée de voitures, il y a autant de chances qu’il s’agisse de vandalisme que d’une performance artistique. Il ne faut donc pas accuser trop tôt le conducteur de la moto-cross de vandalisme mais plutôt écouter s’il n’a pas un message artistique à transmettre. Il peut arriver que le vandale vous trompe en inventant un message artistique factice que votre ignorance en art vous empêche d’identifier comme tel. Il vaut mieux s’y connaître en art pour différencier les vandales des artistes. Par exemple, dans le cas où rouler en moto-cross sur une rangée de voiture serait une performance artistique, il ne faudrait pas que vous preniez l’artiste pour un vandale et l’envoyiez en prison. Car malheureusement la police n’a souvent aucune connaissance en art et ne s’embêtera pas de distinguer l’artiste du vandale avant de le matraquer et de le jeter en prison.
Hier, pour la première fois depuis très longtemps, j’ai acheté un savon. En m’en servant ce matin, je me suis étonné de sa practicité, et me suis demandé pourquoi on utilisait tellement de gel douche sinon pour le plaisir de jeter du plastique une fois le flacon vide.
« C’est lorsque la grande douleur est passée, quand l’extrême sensibilité est amortie, lorsqu’on est loin de la catastrophe, que l’âme est calme, qu’on se rappelle son bonheur éclipsé, qu’on est capable d’apprécier la perte qu’on a faite, que la mémoire se réunit à l’imagination, l’une pour retracer, l’autre pour exagérer la douceur d’un temps passé ; qu’on se possède et qu’on parle bien. » – Denis Diderot, Paradoxe sur le comédien.
Par exemple, avec un marteau, on peut planter un clou, mais aussi écraser un doigt, ou enfoncer une boîte cranienne. Avec un train, on peut transporter des voyageurs, ou des marchandises, ou des animaux, qui sont souvent considérés comme des marchandises, ou des hommes, qui sont en temps de guerre considérés comme moins que des animaux, et moins que des marchandises, et qu’on tue finalement ; le train peut servir à tuer. Avec une bombe atomatique, par exemple, on ne peut que faire exploser une surface, souvent une très large surface, mais on ne peut pas cuisiner le chou-fleur avec une bombe atomique, ou arroser les fleurs du jardin. Avec un arrosoir, cependant, on peut étouffer quelqu’un, si on enfonce le manche assez loin dans la gorge. Dans la marmite où on a fait cuire le chou-fleur on peut aussi brûler une main, ou un visage. Avec un fusil d’assault on ne peut que tuer, même si certains artistes contemporains s’en servent comme porte-manteaux, un bien mauvais porte-manteaux par ailleurs car il ne peut porter qu’un seul manteau. Avec un porte-manteaux on peut assomer ou embrocher. Souvent avec les armes on ne peut que tuer, tandis qu’avec tous les autres objets on peut tuer et faire autre chose, ce qui m’amène à me demander finalement pourquoi on a inventé les armes.
En recherchant le mot marmite sur internet pour vérifier son orthographe, je me suis rendu compte qu’en plus de désigner un ustensile, ce mot désignait aussi une marque de pâte à tartiner. Cependant, attention : on peut très bien faire cuire de la Marmite dans une marmite, mais non l’inverse. (Je me mets aux jeux de mots ; c’est très clairement le début de la fin.)
Durant mes successives périodes de travail, j’ai tendance à trouver que les relectures de mes propres textes épuisent leur contenu. Je finis par me lasser de l’histoire que je lis, et parfois il est difficile de comprendre pourquoi elle plairait à d’autres. D’où la nécessité de laisser passer un temps très long entre deux versions : pour oublier.
Le crime qui ouvre Rivage au rapport ne me convient plus qu’à moitié : trop potache, trop dissolu. J’aimerais davantage qu’il s’accorde à l’ambiance qui recouvre l’ensemble. Mais ce crime initial décide de la plupart des événements déjà écrits ; c’est donc presque tout remettre en question. Souvent il faut tout remettre en question.
J’ai eu la Palme d’or à Cannes pour un film qui a véritablement séduit la critique.
Dans les séries télévisées, j’ai remarqué que les personnages conduisaient beaucoup. Ils utilisent leur voiture pour tout et n’importe quoi. Ils utilisent très peu les transports en commun. En voiture, ils n’ont presque jamais de pannes. Personnellement, je trouve ça incroyable. Parfois j’oublie et puis ensuite je me dis : quand même, ils n’ont jamais de pannes, c’est incroyable. Et c’est incroyable, en effet. Personnellement, j’ai toujours des pannes en voiture, et des pannes que je n’aurais jamais pu soupçonner, provenant du dysfonctionnement de pièces et de rouages qui me sont totalement inconnus. Dans les séries télévisées, les personnages ont beaucoup d’accidents, avec d’autres voitures, ou parfois juste ils rentrent dans des arbres, ils sortent de la route, etc. Ce qui est plutôt rare dans la vie quotidienne, plus rare que les pannes en tout cas, même si un accident de voiture est moins rare qu’un accident d’avion, que les accidents de voiture sont même assez fréquents, et tuent beaucoup, il suffit de voir le nombre de campagnes de prévention dans les rues et à la télévision, c’est un sujet qui inquiète beaucoup, beaucoup plus que les pannes, car les pannes tuent peu. N’empêche qu’il m’énerve de voir tous ces personnages n’avoir jamais de pannes quand moi j’en ai presque chaque jour et qu’elles me coûtent une fortune. Je suis pour la réhabilitation de la panne dans la fiction.
Dans le train, quatre gendarmes escortaient un détenu vers je ne sais quelle prison.
Le voyage de la magicienne vers l’Ermite sera jalonné de rencontres avec d’autres personnages, comme le bûcheron, le garçon, mais peut-être aussi un animal, j’aimerais bien, on verra. Un peu à la manière des RPG, où l’on rencontre de nouveaux membres qui ensuite font partie de l’équipe principale ; chacun a ses particularités, ses facultés, ses armes de prédilection. L’effet de bande me tient très à coeur. On n’est plus très loin du conte non plus.
J’ai lu Sa Majesté des Mouches et j’ai trouvé ça bof.
J’ai activé les césures dans mon document de La ville fond pour que les lignes soient plus régulières, mais parfois le logiciel coupe les mots n’importe comment, c’est idiot.
« […] les matons ressemblent à ce qu’ils sont, et la prison commence quand on comprend qu’elle n’existe que parce qu’elle enferme des hommes avec d’autres hommes, que l’homme ne peut exclure l’homme de son territoire qu’à condition d’occuper aussi le territoire de l’exclusion ; s’ils ne se laissaient pas enfermer avec ceux qu’ils détiennent, ils ne sauraient même pas comment rouvrir. » – François Bon, Le crime de Buzon.
Vous m’avez sauvé la vie, lui dit le bûcheron, et ma conscience m’oblige à vous rendre un service de même importance. La magicienne lui répondit qu’elle n’avait besoin de rien pour le moment. Alors je vous accompagne, déclara le bûcheron. J’emporte ma hache, on ne sait jamais. La magicienne n’y trouva rien à redire, et les deux quittèrent le bois ensemble sans parler davantage.
Et vous reviendrez ?, demanda le garçon à la magicienne. Je ne sais pas encore, je ne sais pas encore…, répondit-elle. Tout dépendra du cargo Marécage. Le cargo se mit lentement en mouvement, le garçon entendait encore les marins crier sur le pont, puis il s’éloigna du rivage, allant sur la mer ainsi chargé de ses conteneurs multicolores. Quand le cargo fut suffisamment loin, presque à l’horizon, presque disparu, le garçon tendit la main pour dire au revoir à la magicienne ; elle ne le vit pas, mais une légère flamme sortit alors de sa paume.
(Le garçon aimerait lui aussi devenir un mage, mais est désespéré de n’avoir aucun pouvoir.)
« Le temps, le lieu, la substance perdaient ces attributs qui sont pour nous leurs frontières ; la forme n’était pas son contraire ; le temps et l’éternité n’étaient qu’une même chose, comme une eau noire qui coule dans une immuable nappe d’eau noire. » – Marguerite Yourcenar, L’Œuvre au Noir.
Jeudi soir, en discutant rapidement avec Benoît durant un trajet de métro, je me suis rendu compte de l’intérêt que j’avais pour la construction des textes selon des mouvements englobants qui les structurent. De manière claire, La ville fond est structuré selon une confrontation, une opposition ; Rivage au rapport joue sur le croisement, le décalage, le retard ; et j’imaginais pour Cargo Marécage une structure circulaire, liée au voyage du cargo autour du continent pour revenir au port, et qui prendrait un mois à chaque fois (le capitaine serait tenu au courant des nouvelles du village grâce aux témoignages de la magicienne ou des habitants). Le mouvement me permet de créer une tension ; les personnages et les lieux seuls ne me suffisent pas.
La magicienne remettait de plus en plus en question les paroles de la maire, et l’existence même des bandits.
La magicienne avait demandé à la maire un logement à l’écart du village car, disait-elle, quand on est trop dans le village, avec ses habitants, nos voisins, on ne voit plus ce qui s’y passe, on ne voit plus rien, on dit juste bonjour, et on ne voit plus rien, et un jour on finit par être tuée, et on ne comprend rien, on est juste morte. La maire avait accepté les conditions de la magicienne et l’avait installée dans une maison de pêcheur le long de la côte, non loin du phare vandalisé.
La magicienne avait demandé à la maire si elle connaissait l’identité du chef des bandits. La maire lui dit que oui, mais qu’il s’agissait moins d’un chef que d’une cheffe, et qu’elle se faisait appeler L’Ermite, bien qu’elle n’en soit pas véritablement une, et qu’elle vivait personne ne savait où, et qu’elle avait été l’une des habitantes du village il y a de cela des dizaines d’années, une des meilleures amies de la maire par ailleurs, mais qu’elle avait choisi de partir pour se venger, et faisait régner sur le village une terreur inouïe avec ses bandits.
(Recycler extraits du passage abandonné pour bref conte de la guerrière.)
Mon amie est partie au milieu du mois de décembre. Elle savait que son expédition durerait plusieurs jours, et dans des conditions intenables, dans les glaces, et le blizzard, et le danger des températures absolues. L’équipage était nombreux, notamment des scientifiques, qu’elle avait mis des années à rassembler, et qui devaient l’aider à trouver l’emplacement du sanctuaire. Le bateau appartenait à un ancien navigateur, qui accepta sa proposition, je crois, uniquement car il n’avait plus rien à perdre. Presque tout l’équipage est mort avant d’atteindre la banquise, à cause des maladies et du froid. Ils n’étaient plus qu’une petite dizaine au moment d’entrer dans le sanctuaire. L’entrée était dégagée, mais très vite à l’intérieur ils se sont retrouvés bloqués à cause d’éboulements qui condamnaient le passage. Ils ont mis un temps considérable avant de trouver une issue pour poursuivre leur exploration. Certains s’étaient suicidés entre temps, avec leurs piolets, ou leurs armes à feu. Quand ils ont enfin atteint le coeur du sanctuaire, ils n’étaient plus que trois : mon amie, un scientifique, et le navigateur. La pièce dans laquelle ils se trouvaient ressemblaient plus à une espèce de tombeau égyptien, ce sont ses mots, qu’à une grotte polaire. Il y avait tout un tas de vieilleries entassées, et des pierres rares, et de l’or, des minéraux précieux. Ses deux compagnons s’étaient précipités sur ces merveilles et étaient entièrement absorbés par leur découverte, mais mon amie, de son côté, s’était approchée d’une petite malle, dans un coin un peu encombré. Rien n’était marqué dessus ; elle semblait en bon état. Mon amie l’a ouverte, et a été surprise d’y trouver une maquette, une sorte de maison de poupées, avec trois figurines à l’intérieur. La scène dans la maison de poupées était macabre : une des figurines masculines était étendue sur le sol, et du sang avait été peint sur son visage. Elle a appelé ses compagnons qui ont examiné les figurines et se sont aperçus aussitôt de la scène macabre. Les visages des figurines n’étaient pas peints, mais les visages vides des figurines possédaient quelque chose de terriblement expressif. Le navigateur a demandé alors pourquoi l’une des figurines semblait morte. Mon amie a répondu qu’elle n’en avait aucune idée. Le scientifique a alors été pris d’une épouvantable crise de folie et tenta d’étrangler le navigateur, qui ne parvenait pas à se dégager de son étreinte. Mon amie a du éclater le visage du scientifique à coups de pied pour qu’il lâche le navigateur. Elle éclata son visage à un tel point d’ailleurs que le scientifique perdit la vie. Ni elle ni le navigateur n’ont compris pourquoi le scientifique s’était comporté de la sorte : peut-être avait-il pris cette mise en scène des trois figurines comme un signe, comme un reflet, comme l’aveu qu’un des deux hommes mourrait, et il s’est sans doute dit alors qu’il pourrait tuer le navigateur et devenir la figurine vivante, mais il a été trompé par ce qu’il avait cru déchiffrer et il est devenu la figurine morte. Par précaution, mon amie a refermé la malle et a fait promettre au navigateur de ne jamais plus l’ouvrir ni d’utiliser les figurines. Puis ils sont revenus, je ne sais plus comment ils ont fait, elle ne me l’a pas dit, en emportant la malle et quelques objets précieux, et les deux ont tenu leur promesse. Des années ont passé, quand la fille de mon amie est tombée sur la malle et a commencé à jouer avec les figurines. En jouant, sa fille a éventré malencontreusement l’autre figurine masculine. Elle a surpris sa fille en train d’éventrer l’autre figurine masculine et lui a interdit de jouer à nouveau avec ces figurines. Pendant longtemps mon amie a refusé de savoir si le navigateur était bel et bien mort éventré. Finalement, le navigateur n’est pas mort. Il lui a écrit, je ne sais plus à quelle occasion. Par superstition, elle refuse toujours que sa fille joue avec les figurines, et depuis elles prennent la poussière dans un coin de son grenier, conclut le premier inconnu. Le second, qui se basculait périodiquement dans son fauteuil, réfléchit un instant à l’histoire que venait de lui raconter son collègue. Mais alors, ces figurines n’étaient pas du tout un tableau du futur ?, demanda-t-il. Le premier inconnu contemplait la vue derrière une baie-vitrée. Non, pas du tout, répondit-il, les figurines, c’était une sorte de leurre. Et le scientifique a cru au leurre. Il est mort parce qu’il a cru au leurre. C’était un idiot. Il est mort avant tout parce que c’était un idiot. Et aussi parce qu’il a cru que les choses avaient un sens. Le second inconnu voulut prolonger la réflexion du premier inconnu, mais finalement il se tut. Les deux hommes se trouvaient dans une vaste pièce largement vitrée. Au centre, un bureau était recouvert de dossiers, et aux murs étaient punaisées des photographies, de lieux, de scènes, de véhicules, des portraits. Un long moment passa avant que l’un ou l’autre ne parle à nouveau. L’inconnu debout regardait imperturbablement par la baie-vitrée. Puis celui qui était assis ouvrit un dossier qui se trouvait devant lui et feuilleta les pages qui le composaient. Il écrivit quelques phrases sur ce qui semblait être la dernière page du dossier, puis la tamponna, puis demanda à son collègue de le rejoindre pour faire de même, mais son collègue ne l’écoutait pas, il demeurait immobile, comme fasciné, devant la baie-vitrée, comme fasciné par quelque chose derrière la baie-vitrée. Qu’est-ce que tu fais ?, s’apprêta à demander celui qui était assis pour le raisonner, mais il fut coupé par celui qui se tenait debout : Viens voir, vite (celui qui était assis accourut), regarde !
(J’ai créé une page pour Saccage, peu ou prou la même que sur le site de la maison d’édition, mais en interne.)
Depuis que je me suis tondu les cheveux, je porte une casquette. Je me suis tondu les cheveux car ils tombent, et je préfère les tondre qu’ils ne tombent (même s’ils tombent toujours). Je porte une casquette pour éviter que les lumières trop blafardes ne fassent scintiller mon crâne blanc, effet particulièrement désagréable, même si je n’en suis pas directement témoin (sauf au hasard d’un miroir). Exemples de lumières trop blafardes : les néons, la lumière dans les voitures du métro, la lumière au-dessus des lavabos souvent, la lumière du jour parfois, etc. Dans les lieux aux lumières plus tamisées, j’enlève plus facilement ma casquette ; ou chez moi. Par chance, je ne porte pas une casquette à cause d’une maladie (cancer, leucémie), ou à cause d’une créature démoniaque installée sur mon crâne, ayant pris possession de mon cerveau et contrôlant mes mouvements, et qu’il s’agirait de dissimuler. Je dis que j’ai une casquette, mais en réalité j’en ai quatre (une vert kaki avec un visage comme logo, une noire avec un flamand rose blanc comme logo, une beige, et une bordeau), et j’adapte ma casquette en fonction de mon humeur et de ma tenue. De plus, elle est pratique, car elle tient un peu chaud en extérieur, et protège du soleil quand il tape trop fort.
Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est à l’attraction qu’une casquette émet. Dans les conversations, ma casquette semble souvent être le centre de l’attention. On ne peut pas s’empêcher d’en parler, parfois au détriment de ce que moi-même je pourrais avoir à dire. On me demande de l’enlever, ou de la mettre, ou de l’essayer, on me fait telle remarque sur ma casquette, et par extension sur moi, parfois on me dit que c’est de mauvais goût, parfois on ne me dit rien mais on n’en pense pas moins. C’est très étonnant la puissance d’une casquette. Moi je ne la soupçonnais pas (cette puissance) avant d’en porter. D’après mon expérience, la casquette attire beaucoup plus l’attention que les chapeaux, et à peu près autant que les bonnets. Parfois je me demande si ma casquette n’a pas un pouvoir particulier pour qu’on en parle autant, pour qu’on se focalise sur elle à ce point. Parfois quand je rentre chez moi je regarde ma casquette et je lui demande : as-tu un pouvoir ?, et bien évidemment elle ne me répond pas, car ce n’est qu’une casquette. J’ai vérifié dans les textes de loi et les casquettes ne sont interdites nulle part, contrairement aux cagoules par exemple (c’est une question de visage visible) ; pourtant, elles gênent terriblement. J’en apprends beaucoup sur l’humanité depuis que je porte une casquette. C’est un bénéfice que je ne soupçonnais pas quand j’ai fait ce choix. Pour conclure, je vais vous faire une confidence : que ma casquette attire autant l’attention m’arrange bien, elle évite qu’on remarque le fusil que je tiens entre les mains.
J’ai imaginé une scène où, sur la même plage, des plaisanciers se baignent à côté de migrants qui se noient.
J’ai toujours dormi la bouche ouverte (car je respire par la bouche). Pourtant, c’est seulement depuis quelques semaines que je remarque à quel point ma gorge est sèche au moment du réveil.
(Comme chaque semaine, Bram aimerait se rendre à la pharmacie de la ville. Bram aimerait s’installer dans son bus habituel pour qu’il le dépose en ville à l’arrêt habituel. Seulement, il semblerait que cette fois le bus ait quelques soucis, et pas seulement le bus, mais presque tout entre Bram et la ville, tout ce que Bram n’avait jamais pris en considération mais qui pourtant le lie à la ville. Pour le plus grand malheur de Bram, il semblerait que la ville elle-même ne veuille pas de lui.)
« Le tremblement de terre écrasant sous les maisons croulantes un peuple entier ; le fleuve débordé qui roule sur les paysans noyés avec les cadavres des boeufs et les poutres arrachées aux toits, ou l’armée glorieuse massacrant ceux qui se défendent, emmenant les autres prisonniers, pillant au nom du sabre et remerciant un dieu au son du canon, sont autant de fléaux effrayants qui déconcertent toute croyance à la justice éternelle, toute la confiance qu’on nous enseigne en la protection du ciel et la raison des hommes. » – Guy de Maupassant, Boule de Suif.
(WIP) L’assistant de Rivage lui demanda ce qu’ils allaient faire maintenant, qu’est-ce qu’ils pourraient bien faire, inspecteur, quelle piste ils pourraient suivre, car plus grand chose ne tenait debout, car lui-même avait du mal à y voir bien clair, car il semblait que cette affaire les dépassât tout à fait, et l’assistant voyait bien que son trouble Rivage le partageait, il voyait bien n’être pas le seul à se retrouver complètement déboussolé, désorienté, par les méandres dans lesquels s’était perdue leur enquête ; Rivage lui-même, son supérieur pourtant, un inspecteur réputé, d’une intelligence et d’une finesse rares, se trouvait dans un embarras profond, dans une situation inextricable qui se présentait pour la première fois dans sa carrière, et à laquelle il aurait souhaité ne jamais être confronté, car il s’en rendait compte à présent, son talent et son acuité et son flair avaient des limites, et son assistant s’en rendait compte à présent, et de cela jamais Rivage n’aurait voulu que son assistant se rende compte, jamais il n’aurait voulu que son assistant constate à quel point parfois Rivage pouvait être un incapable et un râté.
Quand la magicienne demanda à la maire où se cachaient les bandits, la maire fut incapable de lui répondre. Aucun des soldats que la maire avait envoyés pour les débusquer n’était jamais revenu. Selon la maire, l’hypothèse la plus probable était que les bandits se trouvaient cachés dans la zone industrielle en friche à une cinquantaine de kilomètres de là, et qu’ils utilisaient les hangars comme repères et aussi du vieux matériel militaire pour leurs armes et leurs véhicules.
« Quelque peu maladif, la société des hommes me pèse, et je ressemble en cela à ceux qui ont renoncé au monde. Quand je médite sur les misérables erreurs que j’ai commises au fil des ans et des mois, j’envie parfois la sécurité qu’assure un emploi, et si parfois je fus tenté de franchir la porte de la retraite du Bouddha ou de la cellule du Fondateur, je me tourmente au gré des vents et des nuages sans but, je m’emploie à chanter les sentiments qu’évoquent les fleurs et les oiseaux, j’en ai même pour un temps fait le moyen de sustenter ma vie, si bien qu’en dépit de mon absence de capacité et de talent, j’ai fini par m’attacher à cet art. » – Matsuo Bashô, Notes de la demeure d’illusion.
Il est difficile de bien chauffer l’appartement sans avoir de grosses factures de gaz. Au-dessus des fenêtres il y a de l’air qui passe, et derrière l’évier de la cuisine, entre les parpaings, il y a un trou mais je ne comprends pas trop pourquoi. Par exemple, pour avoir 18 degrés dans l’appartement, il faut placer le thermostat sur 21 degrés, ce qui n’est pas tellement logique. Quand on touche les murs qui donnent sur la rue, ils sont froids. Il n’y a que la salle de bain qui soit agréable à vivre car c’est une petite pièce et qu’elle conserve bien la chaleur ; mais comme toutes les salles de bain, ce n’est pas une pièce dans laquelle on a grand chose à faire. Parfois je me dis qu’on paye bien cher des choses simples comme : avoir chaud, boire, manger. Qu’il faut beaucoup investir toute sa vie pour ces choses-là, et que parfois même en investissant beaucoup de soi toute sa vie il vient un temps où on ne peut plus rien faire de toute ça, ou alors dans des conditions déplorables. C’est incroyable, quand on y pense, que les choses les plus simples, après 200 000 ans d’évolution environ, soient toujours aussi compliquées à obtenir, alors qu’on aurait pu inventer des méthodes simples pour contenter tout le monde et éviter l’injustice d’avoir à payer cher la chaleur, la nourriture, et l’eau ; d’avoir à payer de sa vie, parfois, comme quand on se battait à mains nues dans les forêts et les plaines. Maintenant on ne se bat plus à mains nues mais avec des fusils ou des machettes par exemple mais on se bat toujours, ce qui est dommage, car peut-être pourrait-on ne plus se battre, et avoir chacun un endroit chaud où vivre, et de quoi manger, et de quoi boire.
Hier soir, dans le train, j’ai lu Article 353 du code pénal, et, même si c’est bien, quand on a lu Quelques rides, on voit que ça manque quand même un peu d’ambition. Après, j’ai lu Ronce-Rose, et j’ai trouvé ça moyen, même si par moments j’ai ri.
(Aira parle dans Anniversaire des dates à la fin de ses livres.)
La magicienne se positionna de trois-quart, les jambes légèrement écartées, puis elle propulsa avec les mains une boule de feu qui désintégra la cible en face d’elle et impressionna beaucoup la maire. C’est un sort de magie noire, dit la magicienne. Je ne suis normalement pas autorisée à l’utiliser. Je connais beaucoup d’autres sorts de magie noire, et aussi des sorts de magie blanche. Je connais aussi des formules incantatoires et je peux réaliser des potions explosives ou soignantes. La maire ne s’attendait pas à ce que la magicienne maîtrise autant de compétences, ait un arsenal aussi vaste à sa disposition. Comme les bandits sont très nombreux, pensez-vous pouvoir propulser sur leur groupe de grosses boules de feu ?, demanda la maire. J’ai d’autres sorts que les boules de feu pour m’occuper des bandes criminelles, répondit la magicienne. La maire n’avait aucune idée des autres sorts dont parlait la magicienne, mais elle lui fit confiance car la magicienne semblait connaître son sujet. Le conservateur du musée, de son côté, n’avait aucune confiance en la magicienne ni en ses pouvoirs, et doutait de sa capacité à neutraliser les brigands, et demeurait en retrait derrière la maire, les bras croisés, sceptique. Je sais que vous doutez de moi, dit la magicienne au conservateur, car elle savait également lire dans les pensées. Je respecte votre ressenti , mais n’essayez pas de me trahir. Le conservateur, les bras toujours croisés, fit demi-tour et disparut dans la pièce voisine, tandis que la magicienne adressait à la maire un large sourire.
La magicienne patientait sur le pont du cargo Marécage. Dehors elle entendait les vagues et quelques oiseaux, et les oiseaux dans les vagues plongaient et pêchaient. Elle se pencha vers les vagues mais ne vit rien ni n’entendit plus rien. Un marin l’appella et elle se retourna. Un autre marin la croisa et alla retrouver le premier marin qui ne l’avait finalement pas appelée elle. Les deux marins s’en allèrent vers la salle principale qui était éclairée et perçait l’autre flan du cargo d’un halo. Depuis déjà trente jours le cargo Marécage était en mer. La magicienne avait oublié comment était son île. Parfois la magicienne voyait dans la mer la forêt de son île, mais ensuite l’image se dissipait, et il ne restait plus que la mer. La magicienne aurait pu transformer la mer en forêt, mais jamais le cargo ne serait parvenu jusqu’au continent. La magicienne entendit les marins chanter dans la salle principale, et elle s’en approcha pour les observer. Les marins sont morts, pensa la magicienne. Elle fit demi-tour et retourna à l’avant du cargo. Elle retrouva dans la poche de son manteau des figurines et, tout en prononçant une incantation à voix basse, elle les jeta dans la mer. Elle n’entendit rien après les avoir jetées ; les figurines ne firent aucun bruit au contact de l’eau car les turbines du cargo en faisaient trop. Ensuite la magicienne patienta à nouveau. Le cargo avançait.
Parfois, une idée qu’on avait laissée en suspens revient.
Dans une lettre, Simenon écrit à propos de Bernanos (qu’il met en lien avec Lautréamont, d’Aurevilly et Nietzsche) : « Ils ne se satisfont pas du monde tel qu’il nous apparaît et ils osent, à leurs risques et périls, s’aventurer au-delà pour nous en rapporter des images qui nous troublent et souvent nous terrifient. »
Quand la magicienne débarqua du cargo Marécage, une foule formidable l’accueillit en applaudissant. Deux hommes de haute taille à l’arrière de la foule tendaient une banderole sur laquelle on avait peint Bienvenue, madame la Magicienne ! La magicienne fut émue car elle ne s’attendait pas à un tel accueil de la part des habitants du continent. La magicienne tenait dans la main droite sa mallette et de la main gauche salua la foule. Tout en saluant la foule elle disait Merci, merci, mais avec une telle modestie que la foule ne l’entendait pas. Les marins du cargo Marécage n’en revenaient pas que la magicienne soit aussi célèbre et aussi aimée dans cette ville, dans cette ville où pourtant elle débarquait pour la première fois. Les marins ne s’attendaient pas à ce que la réputation de la magicienne soit aussi importante, et ils étaient déçus de ne pas lui avoir demandée de réaliser un tour de magie durant le voyage. Les marins à présent regrettaient la magicienne, ils se disaient qu’ils n’auraient plus jamais l’occasion de transporter une telle personnalité à bord du cargo Marécage. Un des marins pleura et un autre passa son bras autour de son épaule pour le consoler. Au nom de tout l’équipage, c’est une grande tristesse que de vous quitter, dit le capitaine du cargo à la magicienne. Puis il lui offrit un pendentif qui représentait une petite ancre marine, laquelle était une reproduction à l’échelle de l’ancre du cargo. La magicienne déposa aussitôt sa mallette sur le sol et suspendit le pendentif autour de son cou ; le bijou lui allait parfaitement. La magicienne remercia le capitaine et lui adressa un salut militaire en guise d’au revoir.
Alors que la magicienne avançait au milieu de la foule et quittait les abords du cargo Marécage, la maire de la ville, escortée par le conservateur du musée, vint à sa rencontre et se présenta. Je suis la maire de la ville, dit-elle d’abord, et voici le conservateur du musée, poursuivit-elle en désignant de la main son compagnon, nous vous souhaitons la bienvenue ! Sans dire un mot, la magicienne salua la maire en exécutant une courbette de respect, ce qui était la tradition pour saluer sur le continent. Elle ouvrit ensuite sa mallette et en sortit une petite ampoule d’une lumière étincelante, c’est-à-dire qu’elle brillait à tel point qu’elle éblouit la maire et le conservateur du musée et toute la foule, jusqu’aux marins encore à bord du cargo Marécage. J’ai lu dans le journal que l’ampoule de votre phare avait explosé, dit la magicienne, celle-ci pourra la remplacer. Deux semaines plutôt, les bandits avaient en effet vandalisé le phare et détruit l’ampoule et saccagé les pièces et déchiré les coordonnées marines et attenté à la vie du gardien. Tout était à reconstruire, sans quoi les bateaux se perdraient aux abords du continent et sombreraient dans les flots. Le cadeau de la magicienne fut vécu par la maire comme une bénédiction. Vous êtes une bénédiction, dit la maire à la magicienne.
La magicienne avait été contactée par la maire pour freiner l’avancée des bandits ; ou pour les tuer, si ses pouvoirs le permettaient. Le temps qu’un messager fasse le voyage sur la mer jusque l’île où vivait la magicienne, puis qu’il arpente à pied l’île jusqu’à trouver la tour de la magicienne, puis qu’il rebrousse chemin, puis que la magicienne fasse son choix, puis qu’elle fasse elle-même le voyage à bord du cargo Marécage jusqu’au continent, il s’était passé un temps précieux qui avait permis aux bandits d’agir et de vandaliser et de terrifier davantage les habitants. Selon la maire, il était urgent d’agir.
(Aujourd’hui, j’ai encore lu, à propos d’un livre : Coup de coeur absolu. J’écris moi-même pour qu’on qualifie un jour ainsi mon travail.)
« – Et quand vous parlez de vous délivrer par des livres, vous me faites rigoler, ma petite. La littérature n’a jamais délivré personne. Et personne, d’ailleurs, ne réussit à se délivrer soi-même. Des blagues. On peut espérer l’oubli. Et encore ! Car l’oubli, voyez-vous, ça ne se trouve que dans le sommeil ou la débauche. » — Georges Bernanos, Un mauvais rêve.
Bram parvint sans comprendre tout à fait comment jusqu’à un château, ou plutôt un manoir, situé au terme d’une falaise. Bram ne savait pas qu’aucune falaise, qu’aucun rivage ne se trouvât dans les environs ; il n’entendit pas la mer. La porte du manoir était entrouverte et Bram pénétra à l’intérieur. Il prit la direction du salon, dans lequel une sorte de vieil aristocrate tenait sur ses genoux un livre particulièrement volumineux, qui aurait pu être une encyclopédie, ou un livre de botanique. Le vieil aristocrate tournait les pages très lentement, avec une profonde concentration, comme s’il craignait de les déchirer, de les détruire. Une couche épaisse de poussière s’était déposée sur les meubles et sur les tapis au sol. Bram ne voyait rien d’autre qu’un épais brouillard à l’extérieur, qui diffusait dans la pièce une froide atmosphère d’hiver. Le vieil aristocrate remarqua alors la présence de Bram, arrêta sa lecture, et l’invita à s’assoir en face de lui, sur une banquette en bois recouverte d’un léger tissu rouge. À peine Bram s’était-il assis que l’aristocrate se mit à lui parler d’un texte qu’il avait écrit durant son temps libre pendant une trentaine d’années, et qui détaillait toutes les étapes à suivre pour se rendre en ville. Sur la couverte du petit carnet était inscrit Méthode pour se rendre en ville. Bram comprit aussitôt que le travail du vieil aristocrate ainsi que son carnet étaient de la plus haute importance. Quand il eut fini l’histoire de son carnet, le vieil aristocrate le tendit à Bram. Il lui précisa qu’il était extrêmement rare, et qu’il ne devait être perdu ou vendu ou donné sous aucun prétexte. Bram remercia le vieil aristocrate pour son don avant de prendre congé et de quitter le manoir par le même chemin qu’à son arrivée.
Bram ne se souvenait plus où il avait rangé le carnet, ou à qui il l’avait confié, ou tout simplement ce qu’il en avait fait.
Il y a parfois de ces rajouts auxquels on aimerait trouver une place dans l’ensemble.
(-hôtel +auberge)
« Sacré pays ! Dès qu’on met le pied hors des routes, d’ailleurs étrangement zigzagantes, toute sérieuse estimation de distance devient impossible, et le plus habile y circule comme à travers un labyrinthe. »