2016
Dans le train pour Paris, à mi-parcours, une femme s’est levée et s’est installée entre deux voitures pour prier. Les voyageurs circulaient autour d’elle et elle demeurait imperturbable ; dans un virage, des valises mal accrochées lui sont tombées dessus. Dans ma voiture, les autres passagers dormaient. Dehors, il faisait nuit. Nous étions le 31 décembre 2016.
« Le crime est rare ; je veux dire le crime qualifié, authentique, tombant sous le coup de la loi. Les hommes se détruisent par des moyens qui leur ressemblent, médiocres comme eux. Ils s’usent sournoisement. » — Georges Bernanos, Un crime.
À la fin des romans de Aira, il y a toujours une date, par exemple 12 février 2013, ou 13 février 1987, ou 21 avril 2000, ou 15 décembre 1999. Ces dates, que Aira n’est d’ailleurs pas le seul à noter, et qui rendent comptent de la fin d’écriture du texte, m’ont toujours posé question. Car quand est considérée la fin d’écriture d’un texte ? À la fin de la première version, ou de la seconde, ou de la définitive ? Ou plus tard, au moment des épreuves, ou juste avant que le livre ne parte à l’impression ? Par exemple, pour La ville fond, est-ce que ça doit être le 7 mai 2016, date de l’envoi de la première version à Aurélien et Benoît ? Ou le 20 décembre 2016, date de l’envoi de la seconde version ? Ou plus tard encore ? J’avoue ne pas savoir tout à fait quand mettre un terme à mon travail, ni même s’il doit en avoir un. Qu’on puisse l’écrire sans broncher (et parfois, il y aussi la date de commencement !), voilà qui n’est rien, qui n’est qu’un détail, mais qui pourtant me questionne véritablement. Quel intérêt cet acte a-t-il d’ailleurs ?
(Et faisait glisser son doigt sous chaque ligne comme un enfant à qui on apprend la lecture.)
« Il y a peut-être un visage, il y a peut-être un individu (le boucher, la caissière, etc.), mais il n’y a pas de personne, c’est-à-dire de sujet. » – Éric Dufour, Qu’est-ce que le mal, monsieur Haneke ?
Après Varamo et Le Magicien, je lis en ce moment Les fantômes de César Aira. J’y retrouve tout ce que j’aime en littérature. Il déplace son curseur vers la fantaisie, ce qui lui permet de maintenir ses histoires dans de petites boîtes tout en ouvrant aux personnages un incroyable espace de liberté. Pourtant ses romans sont brefs, mais la narration ne se refuse rien. Cette caractéristique que j’affectionnais déjà chez Échenoz me séduit moins actuellement à cause de son caractère encore trop réalise (le monde contemporain). Et puis, une volonté dans mon propre travail : développer une esthétique de la figurine, du village miniature, de lampadaires en allumettes dans des vallées de mousse. Je ne crois plus tellement en la psychologie, davantage aux infimes déplacements.
(Le Magicien me fait d’ailleurs penser à Wizard Battle, l’épisode huit de la troisième saison d’Adventure Time, épisode dans lequel Finn et Jake infiltrent une compétition de magiciens pour empêcher Ice King de la gagner et d’embrasser Princess Bubblegum.)
« Dites-moi, que faites-vous ici au milieu des tombes des morts et des cadavres de ceux qui ne sont pas encore enterrés ? » – Robert Louis Stevenson, Le Maître de Ballantrae.
Quand j’étais enfant, suite à la lecture de je ne sais plus quel magazine de vulgarisation scientifique (Sciences & Avenir probablement), j’avais conçu une angoisse terrible à l’idée qu’une météorite (ou un astéroïde, ne sachant pas à l’époque distinguer les deux) s’écrase sur Terre et provoque l’extinction de l’espèce. Les revues mentionnaient une date à laquelle une météorite allait en effet s’écraser sur Terre, prochainement, peut-être 2018, ou 2026, quelque chose comme ça. Une météorite à ce point gigantesque qu’elle réduirait à néant toute vie sur Terre. Il m’a toujours semblé étrange que personne dans mon entourage ou à la télévision ne s’inquiète de cette menace absolue. Et puis, me raisonnais-je, cela créerait des mouvements de panique dans le monde entier, qui ne seraient peut-être pas pratiques pour affronter la fin du monde sereinement. Dans le même magazine, on disait que les scientifiques concevaient des méthodes inédites pour détourner cette météorite, comme de gigantesques miroirs, ou une peinture blanche, ou des explosifs (un peu comme dans le film de Michael Bay, Armageddon, si mes souvenirs du film Armageddon sont bons, film dont j’ai si peu de souvenirs que je me demande même si je l’ai bien vu en entier, ou même vu tout court). Toutes les méthodes des scientifiques pour détourner la météorite avaient une durée d’action très lente et donc il fallait envoyer ces dispositifs dès l’année où ces textes étaient écrits (il y a donc quinze ans maintenant) et, sauf si je me trompe, aucun de ces dispositifs n’a encore été envoyé dans l’espace à l’heure actuelle, ce qui remet fortement en question le bien-fondé des articles que j’ai pu lire, ou ma propre lecture, à tel point d’ailleurs que je me demande si de telles menaces ont bien pu exister, si une quelconque météorite propulsée à une vitesse inouïe dans l’immensité de l’espace finira bien sa course au contact de la planète Terre.
(Je n’ai pas osé vérifier si cette météorite était toujours en route vers la Terre ; merci de ne pas m’en informer.)
À table, hier, Arthur nous a dit que les nouvelles prothèses, disons par exemple du bras, étaient reliées aux premier nerfs encore intacts dans l’épaule, et qu’elles permettaient aux amputés de ressentir les contacts non pas au niveau des-dits nerfs, mais directement au niveau des doigts artificiels. Le cerveau du patient complétait le parcours de la sensation à travers le membre fantôme.
Hier soir, Bagui et Youssouf Traoré ont été condamnés respectivement à huit et trois mois de prison, à verser 7390€ de dommages et intérêts à chaque gendarme (2) et à chaque policier (7), et à une interdiction de séjour pour l’un dans le secteur de Beaumont-sur-Oise pendant deux ans. Cela, suite à un procès dans lequel plusieurs policiers ont reconnu avoir falsifié ou modifié leurs témoignages, ou s’être blessés à cause de leurs propres chiens ou gaz lacrymogènes, ou avoir été bousculés par un élu de la ville (lui-même absent des comparutions). Un des frères a été condamné uniquement en se basant sur la couleur de sa veste. Pour tous les enfants qu’il soumet, ce pays aura mérité ses flammes.

Mon oncle possédait un iMac G3 sur lequel mes cousins et moi nous jouions parfois à des jeux indisponibles sur Windows (Bugdom, Day of the Tentacle, The Incredible Machine, etc.). L’un d’entre eux était Holiday Lemmings 1993. Le principe est simple : de petits êtres tombent depuis une trappe dans un environnement sous-terrain, et il s’agit de les aider à franchir différentes épreuves pour qu’ils ressortent à l’extérieur (si un faible pourcentage de Lemmings meurt au cours du voyage, ce n’est pas pénalisant). Les Lemmings avancent toujours tout droit et, sans rôle particulier, ils se contentent de marcher. Quand ils rencontrent un mur, ils font demi-tour. S’ils rencontrent un vide, ils tombent dans le vide et meurent. Plus les niveaux deviennent difficiles et plus les Lemmings à sauver sont nombreux ; plus les énigmes sont complexes également. En fonction des niveaux, des rôles peuvent être endossés par les Lemmings : construire des escaliers de douze marches, creuser à la main (tout droit) ou à la pioche (vers le bas), bloquer les autres Lemmings, utiliser un parachute (pour ne pas s’écraser en tombant sur le sol), se faire exploser, etc. Grâce à tous ces rôles attribués à des Lemmings lambdas par nos soins, on résout les énigmes et on sauve la masse de Lemmings. Quand les Lemmings meurent autrement qu’en tombant dans un trou, ils nous regardent, lèvent les bras en signe d’impuissance, crient Oh no!, puis explosent.
Hier soir, en marchant vers le supermarché (++), j’ai remarqué, derrière le magasin du caviste, une jeune femme manger seule dans son petit appartement. Elle mangeait seule tout en regardant l’écran de son ordinateur, ordinateur qui devait diffuser un épisode d’une série américaine, ou un film lui aussi américain, film probablement téléchargé illégalement dans une qualité déplorable (240p), évidemment sous-titré en français pour mieux comprendre la trame (sous-titres eux-mêmes téléchargés simultanément au téléchargement du film), ou sous-titré en anglais si jamais la jeune femme en question est étudiante en langue anglaise à l’université de Rennes 2 Villejean, ou souhaite simplement progresser en anglais dans le cadre d’un futur voyage Erasmus à Cork, Irlande, destination disponible pour les étudiants moyens (au contraire des États-Unis, ou de l’Australie, destinations réservées aux élèves brillants). Il était très amusant d’observer le magasin du caviste bondé, car le magasin accueillait le vernissage d’une artiste locale, artiste qui avait invité tout son entourage pour célébrer sa réussite et son talent, talent d’ailleurs assez faible selon les grilles de lecture de mon propre jugement esthétique ; très amusant donc, d’observer le magasin bondé en comparaison du salon de la jeune femme, vide, sans personne pour l’accompagner durant son repas. Et tout ça, bien sûr, alors que je suis passé très vite devant, alors que j’y ai à peine jeté un oeil, alors que j’étais bien trop occupé par l’idée de me rendre au supermarché (++) pour faire mes courses, pour acheter de quoi moi-même cuisiner, de quoi moi-même être seul.
Alors que j’allais m’endormir, il m’a semblé que tous les êtres vivants à proximité de ma chambre s’étaient accordés pour faire le plus de bruit possible. Sensation très désagréable d’être le centre du monde qu’on déteste.
« Parfois le matin quand je prends le petit déjeuner seul, je pense que j’aurais bien aimé être détective, mener des enquêtes. Je crois que je ne suis pas un mauvais observateur et j’ai des facultés de déduction, outre le fait que je sois amateur de romans policiers. Si ça sert à quelque chose… En réalité, ça ne sert à rien… Il me semble que Hans Henny Jahn a écrit quelques mots à ce sujet : celui qui trouve le corps d’une personne assassinée, qu’il se prépare, car bientôt vont commencer à lui pleuvoir dessus les cadavres… » — Roberto Bolaño, La piste de glace.
J’avais noté dans l’application Calendrier de mon ordinateur le déroulement chronologique de la première partie de Rivage au rapport. J’avais choisi une semaine au hasard pour placer les événements. Comme je n’ai pas retouché mon texte depuis plusieurs mois, j’ai perdu cette semaine précise. Il y a ainsi mon projet quelque part, perdu parmi toutes ces années, et je ne sais pas comment le retrouver.
Sur demande de Maëlle, pour fêter l’anniversaire d’une de ses amies, j’ai gonflé quelques ballons de baudruche. Ils traînent depuis dans le salon, sur le sol, là, éparpillés. Bientôt, quelqu’un les éclatera (moi).
(Première partie : Quatre morts jamais tués)
Je n’écris presque plus ici. J’ai l’impression qu’une mutation stylistique est en train de naître qui m’oblige à lire et à réfléchir beaucoup à ce que je veux faire. Même si je semble me plaindre de mon inactivité aujourd’hui, je n’ai jamais autant écrit que cette année. Le fichier présent des Relevés pèse pour l’instant 468 KB. Les précédents, depuis 2012, pèsent chacun 107,3, 135,1, 383,5, et 379,4 KB. En plus de cela, il y a eu la rédaction complète de La ville fond, et le premier tiers de Rivage au rapport (sans oublier le projet Jimmy Arrow avec Fabien). C’est de loin mon année la plus productive. Sans doute l’écriture et l’attente pour Saccage m’avaient paralysé, et sa publication a produit une décompression totale à la fois quant aux attentes extérieures, mais également quant à mes propres ambitions.
« Dans ce conte, le défécateur renommé, dont on croit au début qu’il est si doué qu’il peut à proprement parler chier un classique, se révèle rongé par la haine de soi. Aller aux toilettes, pour lui, c’est se rappeler les mauvais traitements et l’humiliation qui ont mené à sa créativité. » – D. T. Max, David Foster Wallace.
Je me souviens que ma cicatrice au gros orteil m’a fait mal durant la nuit.
(WIP) Après que le commissariat de la ville eût explosé, Rivage fut contraint de louer un petit meublé au troisième étage d’un immeuble du port. Il y installa une ligne fixe ainsi qu’une armoire à classeurs où ranger ses affaires classées. L’armoire à classeur ne contenait pour l’instant aucune affaire classée, toutes les affaires classées par Rivage ayant disparu avec l’explosion du commissariat, toutes les affaires classées se rouvrant dès lors, toutes les prisons se rouvrant dès lors, tous les prisonniers à nouveau échappés dans la ville, tous les prisonniers à nouveau criminels, tous en route pour se venger de Rivage, au plus grand désespoir de Rivage, seul assis dans son petit meublé.
Sous les arcades, à République, deux types stationnent. En passant, un des deux types me demande : shit ? coke ? Je continue vers la Poste.
Moi aussi, j’ai peur de mourir sans avoir vécu.
« Il y a un moment, en me rasant, je me suis regardé dans la glace et je ne me suis pas reconnu. La solitude radicale de ces derniers jours fait de moi un être différent. Quoi qu’il en soit, je vis assez content mon anomalie, ma déviation, ma monstruosité d’individu isolé. Je trouve un certain plaisir à me montrer farouche, à escroquer la vie, à afficher des positions de héros radicalement négatif de la littérature (c’est-à-dire à jouer les personnages mêmes qui hantent ces notes sans texte), à observer la vie et à remarquer qu’elle manque justement un peu de vie. » — Enrique Vila-Matas, Bartleby et compagnie.
(WIP) La professionnelle attendait sur le bas-côté qu’un véhicule passe la récupérer pour rencontrer le Roi. La professionnelle attendait quand un véhicule qui n’était pas celui qu’elle attendait s’arrêta à sa hauteur. La vitre du conducteur se baissa progressivement et lentement et en sortit une tête d’homme qui lui demanda si elle était une pute, ce à quoi la professionnelle répondit en dégainant dans l’instant son revolver et en le plaçant dans la bouche du conducteur qui dès lors fut absolument incapable de parler ou d’ajouter quoique ce soit sinon quelques grommellements qui signifiaient sans doute qu’il voulait que la professionnelle épargne sa vie, ce qu’elle aurait sans doute fait si elle n’avait pas été motivée par la colère et le dégoût à l’encontre de ce conducteur, et qui la poussèrent donc à ajouter mon revolver est une pute puis à actionner la détente de son revolver qui fit exploser le crâne du conducteur dans l’instant. Puis la professionnelle rangea son revolver qui était recouvert du sang du conducteur et de petits éclats d’os dans son étui. Puis la professionnelle recula et attendit à nouveau immobile sur le bas-côté tandis que le véhicule du conducteur chauffait toujours et que de la fumée s’échappait du pot d’échappement en larges nappes dans l’air froid et que l’éclairage intérieur éclairait le corps du conducteur au visage éclaté sur son siège, son visage éclaté miraculeusement empêché de s’écraser tout à fait sur le bitume grâce à quelques tendons fragiles et quelques morceaux de chair. D’autres véhicules passèrent qui ne s’arrêtèrent pas ni ne soupçonnèrent l’effroyable scène qu’ils dépassaient, quand enfin le véhicule devant récupérer la professionnelle pour l’emmener chez le Roi arriva. La professionnelle ouvrit la portière et monta. Le chauffeur remarqua dans le rétroviseur une fois la professionnelle installée sur la banquette arrière à quel point elle était recouverte de sang et avait le regard noir et à quel point, se dit le chauffeur, sa rencontre avec le Roi risquait de dégénérer, à quel point il y avait peu de chances que la professionnelle et le Roi s’en sortent tous les deux vivants à l’issue de leur rendez-vous, sans que le chauffeur se doute un seul instant que lui-même n’en réchapperait pas et que ce même véhicule ferait d’ici quelques heures exactement la même route en sens inverse mais sans lui au volant.
(WIP) Rivage était assis dans la salle d’attente. Il était seul et ne put donc adresser la parole à personne. D’abord il se contenta de feuilleter une revue qui se trouvait sous la table basse, mais il la reposa aussitôt car d’abord elle ne l’intéressait pas tant que ça, et qu’ensuite il avait lui-même très peu l’habitude de feuilleter des revues chez lui, d’ailleurs n’importe où ailleurs que dans les salles d’attente, et doublement quand les revues en question traitaient d’engins agricoles, détaillaient les nouveaux moteurs et les nouvelles façons de moissonner, sujets qui indiffèraient Rivage absolument. Rivage alors attendit en se tournant les pouces et en regardant autour de lui et en sifflotant un air populaire qu’il connaissait bien. Puis un homme que Rivage ne connaissait pas entra dans la salle d’attente et aussitôt installé alluma une cigarette. L’homme était assis exactement en face de Rivage et il fumait exactement en face de Rivage et Rivage voyait la fumée de la cigarette de l’homme progressivement encombrer l’espace et bientôt encombrer la respiration de Rivage qui ne put s’empêcher de tousser tant la fumée encombrait cet espace absolument pas climatisé ni aéré. Rivage indiqua à l’homme qu’il était interdit de fumer dans la salle d’attente comme il était inscrit sur la porte d’entrée, mais l’homme fit comme s’il n’avait pas entendu Rivage et continua à feuilleter sa revue tout en fumant et tout en encombrant l’atmosphère de la pièce de la fumée épaisse et dégueulasse de sa cigarette. Rivage alors lui répéta ce qu’il venait de lui dire, mais l’homme ne sembla pas plus intéressé. Rivage alors se leva et prit la cigarette à moitié consumé dans la bouche de l’homme et la jeta sur le sol et l’écrasa avec la semelle de sa chaussure. Rivage alors retourna s’assoir et ouvrit la porte de la salle d’attente pour créer un courant d’air propice à chasser la fumée de cigarette stagnant dans les airs. L’homme alors sortit un briquet de sa poche et l’alluma et disposa la flamme du briquet sous sa revue et brûla le papier de la revue qui était un papier glacé qui s’enflamma aussitôt intégralement puis l’homme jeta la revue enflammée dans le tas de revues se trouvant sous la table basse ce qui enflamma toutes les autres revues de la salle d’attente et provoqua une épaisse fumée noire qui se répandit à nouveau dans la pièce et déclencha même au bout de quelques instants les arroseurs automatiques qui trempèrent complètement Rivage qui fixait toujours incrédule l’homme assis en face de lui.
(WIP) L’assistant de Rivage courut alors dans le couloir en direction de la salle d’attente et hurla que le bâtiment était en feu et hurla qu’il fallait sortir au plus vite et hurla enfin le nom de Rivage pour que celui-ci lui réponde mais Rivage ne lui répondait pas. Une fumée épaisse et dense encombrait tout l’espace et l’eau des arroseurs automatiques aveuglait l’assistant de Rivage et il ne voyait rien et il ne parvenait pas à distinguer Rivage qui alors sortit de la salle d’attente et de la fumée épaisse sous l’eau des arroseurs avec le pyromane de la salle d’attente sous le bras comme s’ils venaient de sa battre et comme si Rivage venait de l’étrangler ce qui (Rivage le confirma à l’assistant une fois dehors) venait en effet de se passer. Puis l’assistant de Rivage demanda à Rivage pourquoi au juste il avait dû utiliser la manière forte avec cet homme et Rivage répondit que cet homme avait refusé d’éteindre sa cigarette, puis il ajouta qu’il n’y avait vraiment plus aucun respect pour personne en ce bas monde. Il n’y a vraiment plus aucun respect pour personne en ce bas monde, nota aussitôt l’assistant de Rivage dans son carnet.
(WIP) Le pyromane avait été envoyé par le Roi pour éliminer Rivage.
En 2005, un soir à Los Angeles, avec Fabien, nous avons rencontré Jimmy Arrow, un réalisateur de films pornographiques inspiré considérablement dans son travail par l’oeuvre de Jack London. Nous racontons ce qui s’est passé ce soir-là (et les années suivantes) dans un article pour la revue En attendant Nadeau : Arrow, loup solitaire.
Un après-midi, alors qu’il rentrait du travail en train, il vit, de l’autre côté des rails, un peu au loin, un immense panneau sur lequel il était inscrit que des bureaux étaient à louer, et sur lequel il était également inscrit un numéro, sans doute afin de louer lesdits bureaux. Il se dit, tout en regardant cet immense panneau l’incitant à louer un bureau, qu’en effet pourquoi ne pas en louer un, après tout, un bureau, cela peut toujours servir, surtout s’il est vaste, et bien placé. Dans un bureau, on peut travailler, et bricoler, et patienter, se dit-il. Le lendemain, il appela donc au numéro indiqué sur le panneau et loua un bureau. D’abord, il ne sut pas trop quoi faire de son bureau, ni comment l’aménager, car il possédait déjà un emploi, et n’avait donc pas besoin d’un autre lieu où travailler. Son bureau était très grand et très blanc et très vitré, et depuis son bureau il voyait parfois passer le train. Depuis son bureau il voyait une large partie de la ville. Il marcha longuement dans son bureau avec l’espoir que cela puisse lui donner une idée, mais il ne lui vint aucune idée, il ne lui vint rien. Il meubla un peu l’espace, ici d’une table, là d’une plante. Ensuite il regarda la table et la plante dans son immense bureau. Ensuite il ne les regarda plus et s’assit sur le sol. Dans son bureau il y avait d’immenses vitres mais il n’y avait jamais de soleil, et les immenses vitres ne servaient qu’à voir le ciel gris et parfois noir et parfois orageux et parfois la nuit (rarement). Il se dit qu’il n’avait peut-être pas acheté le meilleur bureau, le mieux placé, qu’il aurait dû acheter un bureau donnant sur la cour de l’immeuble et non sur les rails du train. Mais il était trop tard et il fallait désormais faire avec ce bureau. Il ne savait pas quoi faire avec son bureau. Il n’avait pas tellement besoin d’un bureau. Un jour, quelqu’un frappa à la porte de son bureau. Il ouvrit et vit qu’il s’agissait du postier, qui lui délivra une lettre, qui était une facture. Il laissa aussitôt la facture trainer dans un coin de son bureau, remettant son règlement à plus tard. Le temps passa dans le bureau, la plante s’assécha et la terre s’effrita et le pot se brisa et la terre se répandit sur le sol et la plante également asséchée, et le bureau s’empoussiéra, et les immenses vitres se salirent, et le bureau fut complètement dégradé, complètement invivable, horrible. Au bout d’un mois, ne sachant déjà plus comment l’utiliser, il entreprit donc de le faire disparaître.
(WIP) La professionnelle descendit jusqu’à la grève, et là elle vit, à côté de la grève, mais pourtant invisible depuis le sentier des douaniers, la carrière dont lui avait parlé l’homme au masque de caméléon, qu’elle surnommait désormais le caméléon, bien qu’elle n’aimât pas le surnommer ainsi car lui-même ne se surnommait pas ainsi et car cela lui conférait une aptitude au camouflage, au changement d’identité et au mystère que pourtant il ne revendiquait pas et qu’elle ne percevait pas en lui. La carrière était accessible pour les camions et les employés qui y travaillaient par la départementale côtière mais il se trouvait un autre passage par la grève que seul le caméléon devait connaître, et dans lequel il n’était envisageable de s’enfoncer qu’avec la certitude qu’il déboucherait sur la carrière tant il y avait de ronces et de chardons qui l’encombraient. Le caméléon avait confié à la professionnelle qu’il y aurait dans la carrière des éléments qui pourraient l’intéresser, et la professionnelle n’avait pas su comment interpréter le terme élément à ce moment-là, et elle imagina alors tout le temps qu’elle avait mis pour atteindre la grève puis la carrière à travers les ronces et les chardons ce que pouvaient être ces éléments dont parlait le caméléon et qui devaient tant l’intéresser. Elle élabora de nombreuses théories mais comprit (une fois largement enfoncée dans la carrière, puis face à ce que le caméléon voulait sans doute qu’elle voie), que les éléments dont parlait le caméléon étaient en fait un seul élément étaient en fait un cadavre, qui pour l’instant n’intéressait pas particulièrement la professionnelle, mais qui pourrait peut-être l’intéresser par la suite, en fonction de qui était ce cadavre, des conditions dans lesquelles il avait été tué, et de pourquoi il se trouvait là justement, dans cette carrière de pierre voisinant la grève.
Dans Anvers, je lis : Des flics qui baisent des filles sans nom.
« Aujourd’hui, je me suis senti las, triste, abattu comme rarement je l’ai été. C’était quelque chose d’effrayant. Il me répugne de parler de moi, mais quand je pense à tous ces gens que je rencontre chaque jour, cela me fait du bien de les quitter pour rentrer en moi-même. » – Emmanuel Bove, Journal écrit en hiver.
Je me suis demandé, si jamais je partais d’ici, Rennes, France, à pied, et que je voulais me rendre, disons, à Maputo, au Mozambique, et tout ce trajet uniquement en marchant, sans jamais prendre aucun autre moyen de transport, est-ce que ça serait possible, envisageable. Dans le meilleur des cas, il faudrait que je traverse à la nage le Détroit de Gibraltar, ce qui (avec un peu d’entraînement) est sans doute possible, compte-tenu du peu de distance entre Algeciras et Ceuta. Mais si on ne me laisse pas passer, comme on ne laisse passer personne à notre époque, alors il me faudrait faire un détour par la Turquie, la Syrie, et Israël, ce qui rallongerait considérablement ma route, et n’est pas pour m’arranger. Ensuite, il me suffirait de descendre tout droit, et alors ça ne serait plus si compliqué, bien sûr il y aurait des déserts, et des jungles, et des monts rocheux, mais j’aurais fait le plus dur, avec des réserves d’eau et de nourriture il va sans dire. Il y a plus de dix-mille kilomètres entre Rennes, France et Maputo, Mozambique, mais somme toute, il est possible d’aller de l’un à l’autre à pied si on a un peu de temps devant soi. On me dira : et les conflits armés, et les barrages, et les douanes, et les animaux sauvages, et je dirais oui, en effet, il y a tout ça, et je remettrais mon projet à plus tard, car désormais être piéton n’est plus si anodin (est-ce que ça a seulement jamais été le cas ?).
Il est possible que bientôt la Terre explose avec nous dessus.
La Maison des épreuves (en janvier aux éditions de l’Ogre, traduit par Claro), est sincèrement un livre étrange, et il me fait presque mal de l’écrire tant le mot est galvaudé, et doublement mal d’ailleurs d’écrire que le mot étrange est galvaudé tant on écrit que le mot étrange est galvaudé pour donner l’impression, justement, que cette fois-ci il ne l’est pas, galvaudé, quand très souvent malheureusement il l’est, galvaudé, et que le livre n’est donc pas du tout étrange, mais seulement banal, et convenu, et inintéressant. C’est un livre déstabilisant car il ne cesse de nous ramener vers du non-écrit, vers de l’absent. Par moment, j’avais la sensation de lire un Livre dont vous êtes le héros, mais dont toutes les options auraient été sabotées, et tous les choix faits à votre place, et de manière parfois complètement désordonnée, sans aucune causalité entre les différentes étapes de la progression, ce qui oblige à une avancée terrible et obscure. Car c’est un livre qui vous demande à chaque paragraphe : où en êtes-vous de l’horreur, de la solitude, et de la mort ? Et comme vous n’avez aucune réponse, que vous ne souhaitez pas en trouver, vous tournez les pages incessamment, avec une frénésie propre au délire, et quand enfin on vous demande de parler, quand il ne reste plus rien devant vous, alors vous vous taisez, et vous comprenez qu’il faut vous mettre à table, et qu’il n’est plus possible de se cacher.
« Mais finalement vous vous apercevez que votre petite-fille est entrée dans la maison hantée depuis trop longtemps. Tous les gens qui sont entrés après elle sont ressortis depuis un bon bout de temps. Vous allez au guichet pour chercher de l’aide, mais le vendeur de tickets à disparu, l’entrée de la maison est condamnée et fermée à clé. Quelle est votre plus sombre peur concernant le fait que votre petite-fille n’est pas réapparue à la sortie ? Quelle chance y a-t-il pour que quelque chose d’une nature sombre et terrible se soit bel et bien produit, plutôt qu’il existe une explication plus terre à terre ? » — Jason Hrivnak, La Maison des épreuves.
En ce moment, je lis les livres d’un écrivain très vieux. Il est tellement vieux qu’il sera même bientôt mort. Quand il sera mort il deviendra très célèbre, et plein d’autres gens liront ses livres, et moi je ne les lirai plus, car je les aurai tous déjà lus. C’est triste que le vieil écrivain meure et qu’il ne puisse plus écrire d’autres livres, mais s’il ne mourait pas personne ne le lirait et alors ça ne servirait à rien. Moi-même j’aimerais mourir bientôt pour qu’on lise tous mes livres, bien que je n’en ai écrit aucun. Une fois j’ai tenté d’écrire un livre mais j’étais encore très jeune et comme je n’allais pas mourir personne n’allait le lire et je me suis dit que ça ne valait pas le coup de le terminer, alors je ne l’ai pas terminé, et personne ne l’a lu. Une fois qu’on est devenu très célèbre, même si c’est après notre mort, c’est comme si on n’était pas mort, et donc ça vaut tout de même le coup d’écrire des livres, je trouve. Si ça ne valait pas le coup de toute façon personne n’en écrirait et il n’y aurait aucun livre aujourd’hui ni dans les bibliothèques ni dans les librairies. Parfois quand je vois tous les livres écrits je me dis quand même qu’est-ce qu’il y a eu comme morts. Bien sûr il y en a qui écrivent avant d’être presque morts, mais ça ne vaut pas grand chose, et finalement ce sont des écrivains qu’on oublie, et qui vivent malheureux, et qui meurent tout aussi malheureux et oubliés. Il vaut mieux exercer d’autres professions durant notre vie, qui ne nécessitent pas qu’on soit mort, comme boulanger, ou facteur. Ce sont des professions qui procurent beaucoup plus de satisfaction au quotidien. Il est possible d’être facteur puis de se mettre à écrire sur le tard car on sent que l’on va bientôt mourir, même si très peu le font car le métier de facteur est usant et qu’on n’a plus le courage une fois vieux de se mettre à écrire, qu’on se dit que ça ne vaut plus trop la peine, et finalement on meurt dans le silence, et deux générations plus tard on est oublié. Ce qui vaut pour l’écriture vaut également pour les autres arts, même s’ils sont soumis à diverses contraintes. Par exemple, passé la soixantaine, soutenir une caméra est plus éprouvant que tenir un crayon. C’est un exemple parmi d’autres bien sûr. Écrire jeune alors qu’on a le projet de se suicider fonctionne, c’est une direction envisageable. On peut également se faire passer pour mort, mais les imposteurs sont souvent démasqués, et finalement leur oeuvre ne vaut plus rien, et ils passent de la gloire au mépris, et finalement ils se tuent réellement, mais plus personne n’a envie de lire les livres d’imposteurs, c’est compréhensible. De l’extérieur, on n’imagine pas tous ces embêtements. Pourtant, à quelles contraintes sont soumis les écrivains ! C’est presque à en perdre l’envie de lire.
« Dans ce pays de propriétaires fonciers, dit-il, la littérature est une extravagance et savoir lire n’est pas un mérite. » – Roberto Bolaño, Nocturne du Chili.
C’est la grande vague qui a rasé la ville. Les engins ont mis des années à dégager tous les gravas. Ceux qui ne sont pas morts se sont installés sur les hauteurs, entre les arbres. On leur a fourni des cabanons blancs et depuis ils logent dedans. Les cabanons sont collés les uns aux autres et on peut circuler entre grâce à de minces passerelles en bois qui évitent la boue. On ne sait pas quand la ville sera reconstruite, ni même si elle le sera. Au sol, il reste les fondations des anciennes maisons. Des architectes ont construit une maison commune à la lisière de la ville dévastée. Dedans on peut dormir si on est de passage, on peut lire, et on peut manger. Tout en haut de la maison pour tous il y a une terrasse qui permet d’avoir une vue imprenable sur la ville détruite.
J’ai écrit un livre qui n’a été traduit dans aucune autre langue que la mienne.
(WIP) La professionnelle se rendit à l’adresse qu’on lui avait communiquée durant la fête. Sur le morceau de papier contenant l’adresse on lui avait également ordonné de venir masquée. N’ayant aucun masque chez elle, la professionnelle s’était rendue dans un magasin spécialisé et avait été stupéfaite par le nombre de masques différents disponibles, et elle ne sut lequel choisir. Comme il n’y avait aucun loup suffisamment élégant à son goût, elle s’était dirigée vers les reproductions de visages d’hommes politiques, puis les jugeant finalement d’un goût trop douteux, elle avait fait son choix entre ceux représentant des gueules d’animaux, hésitant longuement entre le tigre et le gorille, choisissant finalement le gorille, ce qui posa de nombreux problèmes durant le rendez-vous, car un autre de ses six interlocuteurs portait lui aussi un masque de gorille, si bien qu’au bout de quelques minutes, tous étant habillés en costume et plongés dans une semi-obscurité et se tenant debouts en cercle à une distance égale les uns des autres (cela trahissant une certaine maniaquerie), sinon leurs voix, il ne fut plus possible de distinguer entre la professionnelle et l’inconnu lequel était lequel. En plus des deux gorilles, il y avait un lion, un caméléon, un cheval, une girafe, et un homme. Un des hommes avait un masque d’homme totalement inconnu, un quidam, personne, et cela troubla terriblement la professionnelle, bien plus d’ailleurs que l’autre homme portant un masque de gorille. L’entretien entre les hommes masqués et la professionnelle commença dans ces conditions mais le masque de girafe avait tendance à tomber régulièrement à cause de la quantité de matière plastique composant le cou et qui ne tenait pas sur la hauteur, et la professionnelle entendait son possesseur pester tout bas de même régulièrement à chaque fois que le cou se gondolait et pliait et tombait, si bien que celui qui parut être le chef et qui portait le masque de caméléon ordonna à la girafe de quitter la pièce et de ne pas revenir, ce que fit la girafe, puis tous les interlocuteurs en cercle se redisposèrent pour conserver la même distance entre chaque.
« Eaux de la forêt noire et touffue, terribles eaux noires, vous reposez si muettes. Terriblement tranquilles vous reposez. Votre surface ne remue pas, quand la tempête tourne autour de la forêt et les pins se courbent et les toiles d’araignées entre les branches se déchirent et tout se met à craquer. Alors vous reposez au creux de la vallée, eaux noires, les branches tombent. »
Nous vivons au pied d’un volcan. Avant mon père et ma mère et toute la ville étaient installés sur le volcan, car il n’existait pas. Mais un jour il est entré en éruption, a détruit toute la ville, et depuis nous vivons dans une autre ville, au pied du nouveau volcan. Il y a un port de pêche et il s’en est fallut de peu que la lave du volcan ne bouche l’entrée du port et toute la vie de l’île. Il n’y a pas beaucoup d’habitants en ville car c’est une petite île. En quelques pas à peine nous sommes déjà au sommet du volcan. Au sommet du volcan, des femmes font cuire du pain sous la terre. Le pain reste dix heures dans la terre brûlante du volcan et il cuit. Notre petite île se trouve à côté d’une île beaucoup plus grande sur laquelle nous nous rendons parfois. Il y a toutes les professions utiles en ville et nous n’avons pas besoin de nous rendre tellement souvent sur la grande île.
Arthur vient de nous annoncer qu’il allait devenir une femme. Après son départ, j’ai été pris à la fois d’une grande joie intérieure, et en même temps, sans bien comprendre d’où elle venait, d’une certaine tristesse, cette tristesse, disait Koltès je crois, qui est en fait, justement, la vraie joie. Et je suis heureux, infiniment heureux, que lui-même le soi. (À présent j’ai aussi peur pour lui, peur des incendiaires qui rôdent dans les rues.)
Au mur de la chambre dans laquelle je couche, chez ma grand-mère, son portrait est entouré des nôtres. Je l’ai longuement regardé avant de m’endormir.
« Un grand taureau blanc est mené dans la tuerie. Ici pas de vapeur, pas d’enceinte comme pour les petits cochons grouillants. C’est seule que pénètre la bête grande et forte, le taureau, entre ses bouviers par la grande porte. Ouverte devant elle la boucherie sanglante avec les moitiés, les quarts de bête appendus, les os débités. Le grand taureau a un large front. On le mène avec des coups et des bâtons devant le boucher. » — Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz.
Durant notre promenade avec Cécile dans Lamballe, nous avons croisé, dans un sous-bois, un pêcheur seul, un père et son fils à vélo, trois adolescentes en scooter qui nous ont klaxonnés, un agriculteur qui rentrait ses cochons dans la ferme. Ce qui pourrait être le point de départ de quelque chose.
J’ai toujours pensé que le faucon maltais était un avion, alors qu’il s’agit d’une statuette. (Le roman est incroyablement moins bon que Moisson rouge.)
Je ne trouve rien de spécial à raconter. J’ai davantage écrit cette année que les années précédentes. Peut-être suis-je sec pour quelques mois encore.
« Toute joie vient de Satan. Puisque je ne serai jamais digne de cette préférence dont se leurre mon unique ami, ne me trompe pas plus longtemps, ne m’appelle plus ! Rends-moi à mon néant. Fais de moi la matière inerte de ton oeuvre. Je ne veux pas de la gloire ! Je ne veux pas de la joie ! Je ne veux même plus de l’espérance ! Qu’ai-je à donner ? Que me reste-t-il ? Cette espérance seule. Retire-la-moi. » — Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan.
La satisfaction de se relire et de ne rien trouver à changer.
Un titre : Cargo Marécage.
Le jeune homme attend sur le pont du cargo Marécage. Dehors il entend les vagues et quelques oiseaux, et les oiseaux dans les vagues plongent et pêchent. Il se penche vers les vagues mais ne voit rien ni n’entend plus rien. Un marin l’appelle et il se retourne. Un autre marin le croise et va retrouver le premier marin qui ne l’avait pas appelé. Les deux marins s’en vont vers la salle principale qui est éclairée et perce l’autre flan du cargo d’un halo. Depuis déjà trente jours le cargo Marécage est en mer. Le jeune homme a oublié ce qu’était le monde. Parfois le jeune homme voit dans la mer une forêt, mais ensuite elle se dissipe, et il ne reste plus que la mer. Le jeune homme pourrait plonger mais il mourrait. Le cargo Marécage ne rentrera peut-être jamais. Maintenant le jeune homme entend les marins chanter dans la salle principale, et il s’en approche pour les observer. Les marins sont morts, pense le jeune homme. Il fait demi-tour et retourne à l’avant du cargo. Il retrouve dans la poche de son manteau des figurines et il les jette dans la mer. Il n’entend rien après les avoir jetées ; elles ne font aucun bruit car le cargo lui en fait trop. Ensuite le jeune homme attend. Le cargo avance.
Trop peu écrit ces derniers jours. Je n’ai d’ailleurs pas non plus repris le sport depuis un mois.
Achevé la seconde importante relecture de La ville fond. Je relis les deux exergues pour me donner du courage. Je me dis : ces deux exergues sont la meilleure chose de mon texte. Ce n’est pas très encourageant.
« Mains largement ouvertes sur le ciment. Il ramassa une énorme poignée de poudre. Plaqué au sol, il expédia l’azoture de plomb sur le visage du roi du couteau. Comme une boule de neige pleine de rage. Des grains d’explosif voltigèrent sur le bout enflammé du cigare. La tête du malfrat péta comme un sac crevé. » — Pierre Siniac, Carton blême.
Comme je m’y attendais, Saccage n’a pas été retenu dans la seconde liste pour le prix Révélation de la SGDL. Ça me rappelle, en primaire et durant le collège, une course sportive qui se déroulait à la fin de l’année scolaire, en juin, et faisait concourir toutes les classes par niveau, et qui s’appelait le chalanje. Un circuit était dessiné dans les terrains et sentiers autour de l’établissement, et les enfants couraient ensuite sur ce parcours jusqu’à ce que le meilleur gagne. Les trois premiers obtenaient des médailles et pouvaient monter sur le podium. Les autres ne gagnaient rien, sinon un bon pour un chocolat chaud et une pâte de fruit. Durant toute la primaire, c’est toujours Guillaume Morvan qui a gagné, invariablement (quand je venais jouer chez lui, je voyais toutes ses médailles accrochées au mur, les unes sur les autres, tellement d’ailleurs que je ne parvenais pas à les distinguer). Les deux autres places étaient dans mon souvenir plus disputées. De mon côté, je me suis toujours partagé les deux dernières places du classement, sur une trentaine d’élèves à chaque fois. Quand je ne finissais pas dernier, c’est qu’un autre était blessé, ou avait chuté durant la course (il faisait toujours un temps épouvantable ces jours-là, et les sentiers devenaient des mares). J’étais de ceux qui ne se retournent pas pour apprécier leurs concurrents, que les spectateurs pensent extérieurs à la course, et qui finissent épuisés alors que déjà plus personne ne se soucie de qui participe, que déjà tout le monde est parti s’occuper de ce qui suit. Je me souviens également, en classe de cinquième, à la fin de cette journée déjà horrible, avoir vu Lou Pichard embrasser dans la cour Marine Hercouët, dont j’étais secrètement amoureux. En classe de troisième, j’ai pris la décision de ne pas courir, de ne faire que marcher, de ne pas me soucier de la course, seulement de faire le parcours comme on me l’ordonnait. Je ne me suis jamais autant amusé. J’ai pu discuter avec les gens, m’assoir parfois, regarder le paysage qui était tout de même beau car on passait dans des sous-bois et le long d’un cours d’eau. J’ai compris seulement à ce moment-là, après huit années de tristesse, que je n’avais pas forcément à suivre les règles du jeu, et qu’il ne tenait qu’à moi d’avancer comme je le souhaitais.
(J’aurais quand même bien pris les 1500 euros.)
« Si le Vieux disait qu’une chose était ci ou ça, il avait sans doute raison, car c’était un de ces zèbres circonspects qui, regardant par la fenêtre tomber des trombes d’eau, déclarent : « Il me semble qu’il pleut », au cas où, par hasard, quelqu’un renverserait un seau d’eau depuis le toit. » — Dashiell Hammett, Le grand braquage.
(WIP) Vous voulez dire qu’il n’y a plus aucun policier en ville ? C’est à peu près ce que je veux dire en effet commissaire. Et que foutaient au juste tous les policiers en même temps dans le commissariat à la même heure ? C’est-à-dire que… Fermez-la Rivage ! Je vous envoie des renforts, puis le commissaire raccrocha. Rivage quitta la cabine téléphonique et rejoignit son assistant déjà assis sur le trottoir. Il sortit de son paquet une cigarette qui lui échappa des mains et tomba dans les égoûts. Il la regarda chuter dans le trou noir de la bouche d’égoût puis rangea son paquet. Sans que Rivage ne dise rien, son assistant nota quelque chose dans son carnet que Rivage ne prit pas la peine de regarder. Des passants s’arrêtaient devant le commissariat pour en observer les décombres, et de la fumée s’en échappait, et de la poussière, et de l’eau depuis quelques canalisations percées arrosait les plus distraits. Aucune équipe de secours n’était encore intervenue pour dégager les corps, qui devaient gésir là sous les gravas, peut-être certains encore vivants, asphyxiés. Quand ils eurent fini de ruminer, Rivage et son assistant se levèrent et s’éloignèrent de la scène. Quatre jours plus tard, les renforts n’étaient toujours pas arrivés.
« Aucune des deux personnes qui se trouvaient dans la pièce ne fit attention à la façon dont j’entrais ; pourtant, une seule d’entre elles était morte. » — Raymond Chandler, Le grand sommeil.
Je surprends un message de ma mère à ma grand-mère qui demande si elle peut passer, si ma grand-mère a le temps de la recevoir. Je dis à ma grand-mère de me prévenir de sa décision, que j’irai faire un tour si ma mère devait venir. Ma grand-mère part finalement trop tôt par rapport à ce qu’avait prévu ma mère, elle viendra un autre jour. Depuis deux ans que je ne l’ai pas vue. C’est étrange d’éviter qui vous a mis au monde (est-ce étrange ?).
Je repense souvent à mon adolescence. J’ai l’impression qu’il y a quelque chose que j’ai laissé, abandonné là-bas, à propos de l’amour surtout.
« J’étais allongé à plat ventre sur le sol de la salle à manger, la tête sur l’avant-bras gauche, le bras droit perpendiculaire au corps, la main crispée sur le manche rond, bleu et blanc, du pic à glace de Dinah Brand. La lame de quinze centimètres, pointue comme une aiguille, était plantée dans le sein gauche de la jeune femme. » – Dashiell Hammett, Moisson rouge.
Dehors, le bruit distinct des pales de plusieurs hélicoptères. Le ciel est dégagé et pourtant je ne vois rien. Il y a bien le bruit, mais aucune présence. Je rentre. J’ai peur qu’ils ne soient invisibles.
Dans un des derniers épisodes de la saison 2 de Twin Peaks, le personnage de Jean Renault, alors qu’il est cerné par les policier dans une maison (il finira par être abattu), confie à l’agent Dale Cooper (entravé), qu’il est le délencheur de tout un tas de problèmes en ville, que depuis son arrivée ses deux frères sont morts, qu’il ne peut plus vendre sa drogue tranquillement, ni manipuler ses prostitués au bordel One Eyed Jacks, etc. Twin Peaks s’ouvre avec le meurtre de Laura Palmer, qui nous persuade de son atrocité et de sa perturbation au sein de cette ville tranquille. Or, c’est l’inverse : le meurtre est anodin, un dommage collatéral, dans un environnement absolument pourri et manipulé. Twin Peaks est le Mal. Tandis que le Bon, venu de l’extérieur et incarné par Cooper, est l’élément perturbateur (il finira d’ailleurs lui-même par subir l’influence néfaste de la ville). C’est ainsi qu’on retourne la perception du spectateur, persuadé d’arriver là où le Mal est l’horreur, quand il n’est que le quotidien. On s’étonne de découvrir un lieu abominable, alors qu’on a simplement mal lu les panneaux d’affichage.
Terminé hier soir Un tueur sur la route. Bon. Bien sûr, on voit que c’est construit et réfléchi. Je parle d’après une traduction, je ne sais jamais quoi dire. Si : quand la traduction est bonne, ça se voit. Ici, pas tellement. Enfin, je veux dire, je ne sais pas qui a écrit ce livre. Les deux dernières pages sont magistrales. Ça se lit bien. Psychologiquement, le tueur est crédible. Il y a des tics d’écriture qui m’insupportent, comme les tic-tac à plusieurs reprises, ou les dialogues avec des personnages qui béguaient. Pas l’impression d’être face à un grand livre. Trop d’esprit de sérieux. Manque d’humour et de subtilité.
« L’autre sort et descend sur la cale en courant et regarde vers son bateau qui flambe sur l’eau au milieu du port. Il porte un pull rouge, un jean et une paire de bottes noires qu’il enlève avant de sauter dans le port et de nager vers le bateau en flammes. La nuit est tombée et on ne voit pas la fumée qui est noire mais seulement les flammes qui sont orange. » – Bertrand Belin, Littoral.
Je me souviens d’une phrase lue à propos de 2666, je ne sais plus où, et qui disait à peu près que dans la quatrième partie (La partie des crimes) les corps des femmes retrouvés à Santa Teresa comme sortaient de terre. Comme si la terre les expulsait mortes. Car en effet il n’y pas personne pour endosser toutes ces morts, or quelques épouvantails qui ne dupent personne.
Dans Un tueur sur la route, il y a un chapitre qui y ressemble également sauf que les corps sont disséminés sur une plus grande surface, mais un nombre incalculable encore, comme là encore vomis par le paysage. Mais on connaît l’identité du tueur. Le mystère ne se tient pas dans le même coeur. Quand Bolaño enlève le tueur, il enlève le crime, mais il n’enlève pas le mal. Toute l’horreur est dans le corps. Le meurtrier n’est qu’un bras, une main. On ne se trouble pas qu’il agisse, mais de ce que son acte dit de lui.
En fait, ce que je veux dire : il y a des crimes sans criminel, il peut y avoir le Mal sans aucun commanditaire.
Je suis passé à la librairie ce matin acheter quelques romans policiers, faire ma culture qui dans ce domaine est inexistante. J’ai feuilleté l’index des Chroniques de Manchette, et puis finalement j’ai pris trois romans de ceux qu’il estime être les patrons : Hammett et Chandler. Les couvertures sont à crever. C’est presque à éviter de les acheter tant elles sont dégueulasses. C’est vrai d’une manière générale des poches (surtout les Folio), mais là on enfonce tous les clichés et les photographies sont les plus insipides possibles. Il faut vite les lire pour ensuite les coincer entre deux autres livres dans les rayonnages de sa bibliothèque. Et ne plus jamais les rouvrir.
(Ça me fait penser aux couvertures des Frères Karamazov dans la collection Babel, qui étaient affreusement pixellisées. Le livre est aussi un objet. Parfois hideux, mal construit, mal assemblé.)
« Je les ai tous tués, et tous les meurtres et disparitions mentionnées dans les articles qui précèdent constituent approximativement les deux tiers de mon compte de corps, de 1974 à 1978. » – James Ellroy, Un tueur sur la route.
Hier après-midi, deux hommes se sont présentés à ma porte. Un autre locataire de l’immeuble les avait sans doute fait entrer (à moins qu’ils ne soient passés par derrière), et ainsi ils se trouvaient au quatrième étage, le dernier, face à moi. Je ne savais pas qui étaient ces hommes, ne les avais jamais vus. Ils se sont présentés comme étant d’une compagnie voisine du Gaz de France, mais je n’ai pas eu la présence d’esprit de leur demander une pièce d’identité (qui aurait été de toute façon falsifiée) pour vérifier leurs dires. L’un n’a rien dit de tout le temps qu’il a été là, se contentant de faire présence. L’autre parlait. Ils se sont installés à la table du salon sans que je les y invite, et m’ont demandé de présenter mes factures de gaz, ce que j’ai fait. Je me suis installé également à la table du salon, entre les deux hommes qui se faisaient face. L’homme qui parlait a tout de suite sorti un contrat, et m’a demandé plusieurs informations quant à mon identité. Il expliquait le pourquoi du contrat, et j’acquiesçais à ses explications, même si je n’y comprenais rien. Je ne regardais pas le deuxième homme. Le premier homme a justifié la présence du second en précisant qu’il était en formation, et qu’il n’était chargé que d’observer. Le premier homme écrivait sur le contrat des informations me concernant, nom, prénom, si j’avais moins de soixante-quinze ans, mon numéro de téléphone, si je payais mes factures à temps, etc. Je l’ai laissé écrire toutes ces informations en silence sur le contrat. Je posais quelques questions sur l’origine de leur entreprise, sur leur affiliation avec Gaz de France, sur l’obligation d’un tel contrat, de tels engagements, mais ses réponses étaient soit floues, soit absolument décousues, presque incompréhensibles. Quand il a eu fini de remplir le contrat, il me l’a tendu pour que je le signe. Il y avait deux encadrés dans lesquels signer. J’ai lu attentivement les mentions qui précédaient les encadrés, et qui disaient m’adhérer à leur assurance, et m’engager à payer une somme d’environ dix euros chaque mois. Ils précisaient également que tout cela était appliqué selon les Conditions générales de vente situées au dos du présent contrat. Je retournais le contrat mais au dos, rien de ce genre, qu’une pleine page publicitaire pour leur entreprise, dans un papier glacé bas-de-gamme. Je signais malgré tout le premier encadré, je ne sais pas particulièrement pourquoi, par paresse peut-être, parce que le deuxième homme ne disait rien, parce que je n’avais rien compris et que parfois on ne comprend pas des choses importantes qu’il nous arrive de signer. Puis, au moment de signer le second encadré, je me rends compte qu’il s’agit cette fois-ci d’autoriser un prélèvement bancaire mensuel. Je dis alors à l’homme qui parle que j’ai besoin de temps pour signer un tel encadré, qu’il me faut appeler quelqu’un pour vérifier l’utilité de ce contrat, et je les invite donc à me laisser le contrat et à revenir plus tard pour le récupérer, signé ou non. Le premier homme m’informe qu’il ne peut pas me laisser le contrat, que si je ne le signe pas dans l’instant, il sera dans l’obligation de le déchirer. Je ne comprends pas ce qui l’oblige à procéder de la sorte, et trouve absurde un tel fonctionnement. Je leur dis de repasser à la fin de la journée, quand j’aurai toutes les informations nécessaires de mon côté. Je leur dis que ce n’est pas contre eux, mais que j’ai besoin de comprendre ce que je signe. Les deux hommes acquiescent et partent avec mon contrat. Je m’empresse de téléphoner à mon père qui, en réunion, est injoignable. Je tape alors le nom de l’entreprise (que j’avais relevé au préalable) sur internet, et me rend compte en lisant les premiers résultats (et comment ne m’en suis-je pas rendu compte plus tôt ?) qu’il s’agit d’une arnaque. Je sors alors de mon appartement et rejoins les deux hommes, deux étages plus bas, en train de sonner à la porte d’un autre appartement. Je dis à celui qui parle de déchirer le contrat sous mes yeux. Il me demande si je suis allé voir sur internet, et lui réponds que non, il continue que sur internet on dit que c’est une arnaque, mais c’est pas une arnaque, je lui réponds que non je ne suis pas allé sur internet, mais qu’il m’a dit qu’il devrait déchirer mon contrat, or il ne l’est pas, donc s’il voulait bien le faire sous mes yeux, je lui en serais reconnaissant. Je m’assure qu’il le déchire bien en de petits morceaux. Le second homme ne dit toujours rien. Le premier me demande s’il repasse tout de même plus tard, et je lui réponds que oui. En remontant vers mon appartement, je les entends tous les deux chuchoter. Deux heures plus tard, ils frappent puis sonnent de nouveau à ma porte. Je n’ouvre pas.
C’est une réponse de Laura Vazquez à une question qu’on lui pose, parmi un entretien plus large et donc d’autres questions posées :
A quoi avez-vous renoncé ?
Aux humains. On présente toujours l’humain comme la quintessence du vivant, c’est ce qu’on nous apprend dès l’enfance, l’évolution, l’intelligence, la civilisation, les outils, le progrès, la technique, la technologie, on s’auto-présente comme le génie ultime du vivant, le maillon fort de la chaîne, le haut de la pyramide, la substantifique moëlle du vivant, le vainqueur de la vie, l’Homme, l’humanité, la glorieuse merveille !
Pourtant, c’est évident, nous sommes la pire des choses au monde, la défaite totale, l’infection qui s’étend. Il suffit de voir un peu l’état des océans, l’état des forêts, les animaux qui disparaissent, la manière dont on les traite, dont on les torture continuellement, dont on les utilise, comme des machines, comme des objets, parce que nous sommes convaincus, nous sommes sûrs que nous valons mieux que la mer, mieux que l’air, que la terre, et mieux que tous les animaux, mieux que les plantes et même mieux que notre corps, que notre propre corps d’animal, c’est ce que nous croyons.
En réalité nous sommes l’horreur, nous sommes la plaie de la vie. C’est un vrai désastre, un véritable désastre, il y a des chiffres terribles qui correspondent à des réalités terribles. En quelques années la population mondiale de poissons, mammifères, reptiles, oiseaux, a diminué de plus de moitié, c’est immense, ce sont des dizaines de milliards, des centaines de milliards d’animaux, un millier de milliards pour les animaux sous-marins. L’homme est convaincu de valoir davantage qu’un poisson, qu’un singe, qu’un oiseau, il est la vanité même, il est avide à l’infini. Je crois qu’il y a de la fureur dans notre sang. L’espèce humaine est dévastatrice, il y a de la fureur dans notre sang.
Sur la ligne ferroviaire, entre Vitré et Laval, le train passe à côté, vraiment juste au bord, d’un lac, un étang peut-être, une étendue d’eau tout de même assez vaste, et c’est comme si on était sur les berges de ce lac, et la vue est proprement magnifique, il y a un petit pont sur lequel les voitures roulent, et des chênes en bordure, j’aime passer là, à l’aller comme au retour, observer ce payage rassurant l’espace d’une dizaine de secondes, à peine. Pourtant, il suffirait que je me trouve sur une barque au milieu de ce même lac, et alors je m’exclamerais : quelle horreur cette ligne TGV ! à quel point elle coupe le bocage ! et tous ces pylones électriques ! et le bruit ! ils n’en finissent plus de détruire notre environnement… Et il ne s’agit pourtant que de quelques mètres à peine, pour passer de la splendeur au dégoût.
Dans Récit d’un avocat, on se fait avoir comme des bleus ; on dissimule les noms comme s’ils avaient une quelconque réalité, comme si l’auteur lui-même se sentait l’obligation de se cacher, car l’affaire est délicate, mais elle est autrement délicate qu’elle est complètement fausse, et pourtant il y a tous les indices du vrai : des dates, des noms, des lieux ; et puis le narrateur se fout de notre gueule, il a écrit ce livre peut-être en 2018, 2019, et puis finalement il se pend, enfin, c’est-à-dire qu’il ne se pend pas, puisqu’on ne peut jamais écrire qu’on meurt. Quand même : on a compris la leçon.
Joachim à propos de Saccage : Presque Saccage.
« Les sociétés ont les criminels qu’elles méritent », observait en son temps Lacassagne. Se doutait-il que la corporation des criminels peut être assez large pour englober ceux qui les jugent ? » — Antoine Brea, Récit d’un avocat.
(WIP) Un villageois alerta les autres que des groupes venaient de l’extérieur, qu’ils venaient de la campagne, de là où il n’y avait personne, et qu’ils disaient venir d’autres villages, d’autres villages sembables au leur, et comme eux ils voulaient atteindre la ville, mais ils n’y parvenaient pas, et tous leurs chefs s’étaient avérés être de véritables tyrans, et ils les avaient abandonnés, ou tués, ou pendus, ou crucifiés, et ils avaient entendu parler du trou, et le mot était passé jusqu’à très loin dans la campagne, jusque dans presque tous les autres villages, et tous s’étaient réunis, et tous avaient fait le voyage ensemble, durant des semaines entières, tous terriblement épuisés, amaigris, salis par la poussière et la terre des sentiers, et la pluie, et là ils arrivaient, des centaines, des milliers peut-être, pour eux aussi contribuer au trou, eux aussi parvenir en ville. Les villageois du trou confièrent des outils aux nouveaux arrivants et les installèrent sous des tentes déployées pour l’occasion. Puis ils leur expliquèrent leur propre histoire, qu’ils transformaient à mesure qu’ils la racontaient, et ce qui les avait amenés à rechercher la ville au fond du trou, et la façon dont ils procédaient pour progresser.
(Ou plutôt trois figurines, à l’effigie de chacun ?)
« – Karamazov ! cria Kolia. Est-ce que c’est vraiment vrai, ce qu’elle dit, la religion, que nous nous lèverons tous d’entre les morts, et nous ressusciterons, et nous nous reverrons, et nous tous, et Iliouchetchka ?
– Nous nous lèverons, absolument, absolument nous nous verrons, et nous nous raconterons, joyeux, heureux, tout ce qui se sera passé, répondit Aliocha, moitié riant, moitié pris par son exaltation.
– Ah, ce que ça sera bien ! laissa échapper Kolia. »
Imaginez une ligne droite, et aux extrémités de cette ligne droite un point A et un point B. Disons que le point A est votre maison, et le point B un étang, et que vous vouliez vous rendre du point A, votre maison, au point B, l’étang, en suivant cette ligne droite, qui s’avère être une route, ou plus vraisemblablement un sentier, un chemin. Le trajet est évident, facile, vous l’avez même déjà emprunté plusieurs fois, et il est tout aussi efficace que rapide. Vous ne remettez pas en cause ce chemin, car il exise depuis un temps qui vous précède largement, et durera sûrement autant après votre mort. Sa composition naturelle vous donne confiance en son avenir, en sa persistance, en son intégration immuable dans l’environnement.
Maintenant, imaginez que vous supprimiez la ligne droite entre ces deux points, imaginez qu’il n’y ait plus de chemin, qu’il ne reste que le point A et le point B dans un espace vide, dans un ensemble vierge. Imaginez qu’il y ait votre maison, et l’étang, et que les deux gravitent l’un par rapport à l’autre sans aucun lien possible. Pourquoi ensuite ne pas imaginer qu’ils s’écartent, éjectés comme l’ensemble des planètes depuis l’origine de l’univers, ou au contraire qu’ils s’attirent l’un l’autre, l’un dans l’autre, comme un trou noir, pour ne former plus qu’un, ou pour ne rien former. Pourquoi cette ligne ne pourrait pas s’opposer aux deux points, faire du chemin une frontière, un immense mur infranchissable, ou une barre d’immeubles peut-être, qui vous obligerait à les contourner, à augmenter votre chemin, mais à côté de la barre d’immeuble originale, il y aurait d’autres barres encore, et finalement le contournement ne se produirait jamais, vous ne pourrez plus jamais parvenir à atteindre l’étang, et votre maison deviendra isolée entre tous ces remparts colossaux, et vous serez seul, sans l’étang. Ou que la ligne s’enroule sur elle-même, ou procède d’interminables sinuosités, qu’on vous empêche par tous les moyens d’atteindre l’étang. Tenteriez-vous malgré tout votre chance ? Vous aventureriez-vous quoiqu’il arrive sur le chemin ? Quitte à ne jamais atteindre l’étang ? Le voyage vaudrait-il la peine ? N’est-ce pas trop d’efforts pour un simple étang ?
Et cela dans le meilleur des cas, quand vous êtes encore confortablement installé dans votre maison ; mais si la ligne venait à se déformer alors que vous êtes déjà parvenu à l’étang, et que vous cherchez à rentrer chez vous. Ne seriez-vous pas déjà mort ? L’idée étant de ne jamais faire confiance aux chemins (à moins que l’issue ne se trouve au fond de l’étang ?).
(WIP) Elle est partie au milieu du mois de décembre. Elle savait que son expédition durerait plusieurs jours, et dans des conditions intenables, dans les glaces, et le blizzard, et le danger des températures absolues. L’équipage était nombreux, notamment des scientifiques, qu’elle avait mis des années à rassembler, et qui devaient l’aider à trouver l’emplacement du sanctuaire. Le bateau appartenait à un ancien navigateur, qui accepta sa proposition, je crois, uniquement car il savait mourir bientôt, et n’avoir plus rien à perdre. Presque tout l’équipage est mort avant d’atteindre la banquise, à cause des maladies et du froid. Ils n’étaient plus qu’une petite dizaine au moment d’entrer dans le sanctuaire. L’entrée était dégagée, mais très vite à l’intérieur ils se sont retrouvés bloqués à cause d’éboulements qui condamnaient le passage. Ils ont mis un temps considérable avant de trouver une issue pour poursuivre leur exploration. Certains s’étaient suicidés entre temps, avec leurs piolets, ou leurs armes à feu. Quand ils ont enfin atteint le coeur du sanctuaire, ils n’étaient plus que trois : elle, un scientifique, et le navigateur. La pièce dans laquelle ils se trouvaient ressemblaient plus à une espèce de tombeau égyptien, ce sont ses mots, qu’à une grotte polaire. Il y avait tout un tas de vieilleries entassées, et des pierres rares, et de l’or, des minéraux précieux. Ses deux compagnons s’étaient précipités sur ces merveilles et étaient entièrement absorbés par leur découverte, mais elle, de son côté, elle s’était approchée d’une petite malle, dans un coin un peu encombré. Rien n’était marqué dessus ; elle semblait en bon état. Elle l’ouvrit, et fut surprise d’y trouver un miroir. Elle appela aussitôt ses compagnons et le tendit au scientifique pour l’examiner et qui, par réflexe, aperçut son reflet. Il fut alors pris d’une épouvantable crise de folie et tenta d’étrangler le navigateur, qui ne parvenait pas à se dégager de son étreinte. Elle dut éclater le visage du scientifique à coups de pied pour qu’il lâche le navigateur, à tel point d’ailleurs que le scientifique en perdit la vie. Ni elle ni le navigateur ne comprirent pourquoi le scientifique s’était comporté de la sorte : soit que le miroir avait eu sur lui une influence diabolique, soit, à cause du manque de vivres, avait-il compris être condamné pour le trajet retour, soit par jalousie, ou par faiblesse, par abandon. Par précaution, elle fit promettre au navigateur de ne jamais se regarder dans le miroir, quoiqu’il arrive. Puis ils revinrent, je ne sais plus comment ils ont fait, elle ne me l’a pas dit, mais les deux tinrent leur promesse et, au moment de savoir qui récupèrerait le miroir, elle accepta de le conserver. Elle m’a dit l’avoir accroché au mur d’une sorte de débarras, en face d’un autre miroir, et les deux se reflètent infiniment. Elle ne sait pas ce qui arriverait à celui qui aurait l’idée de passer entre ces deux miroirs, mais elle prévient chaque personne qui visite sa propriété de ne pas s’y aventurer, conclut le premier inconnu. Le second, qui se basculait périodiquement dans son fauteuil en cuir, réfléchit un instant à l’histoire que venait de lui raconter son collègue. Mais peut-être que ce miroir n’y est pour rien, répondit-il, peut-être qu’il ne provoquera absolument rien chez personne ? Le premier inconnu contemplait la vue derrière une baie-vitrée. Peut-être, en effet, c’est toujours un risque à prendre. Les deux hommes se trouvaient dans une vaste pièce largement vitrée. Au centre, un bureau était recouvert de dossiers, et aux murs étaient punaisées des photographies, de lieux, de scènes, de véhicules, des portraits. Un long moment passa avant que l’un ou l’autre ne parle à nouveau. L’inconnu debout regardait imperturbablement par la baie-vitrée. Puis celui qui était assis ouvrit un dossier qui se trouvait devant lui et feuilleta les pages qui le composaient. Il écrivit quelques phrases sur ce qui semblait être la dernière page du dossier, puis la tamponna, puis demanda à son collègue de venir pour en faire de même, une fois, deux fois, mais son collègue ne l’écoutait pas, il demeurait immobile, comme fasciné, devant la baie-vitrée, comme fasciné par quelque chose derrière la baie-vitrée. Qu’est-ce qu…, s’apprêta-t-il à dire pour le raisonner, mais il fut coupé : viens voir, vite, il accourut, regarde.
« – Pourquoi faire le mal ?
– Bah, pour qu’il ne reste rien nulle part. Ah, comme ce serait bien s’il ne restait rien du tout ! Vous savez, Aliocha, des fois, je me dis que je vais faire une quantité de mal terrible, et plein de saletés, et je les ferai longtemps, en cachette, et, d’un seul coup, tout le monde sera au courant. Ils vont tous m’entourer, ils vont me montrer du doigt, et, moi, je les regarderai tous. C’est très agréable. Pourquoi c’est tellement agréable, Aliocha ? »
Mon ami m’escorta dans divers couloirs et escaliers de sa maison jusqu’à une pièce exigüe, qui aurait pu être une cave si elle ne s’était trouvée au troisième étage. Une dizaine de machines étaient exposées sur un large bureau occupant presque tout l’espace, certaines qui m’étaient connu, d’autres non. Mon ami me précisa qu’il en avait inventé la plupart, pour l’aider dans ses travaux domestiques, et qu’il avait acheté les autres dans le magasin spécialisé situé rue des Charbons. Puis il me fit assoir sur un fauteuil dans l’angle de la pièce, et s’approcha de la machine la plus proche. Il sortit alors de sa poche le mécanisme étrange, l’incorpora à l’intérieur, fit deux pas en arrière, et s’assit à son tour sur un fauteuil situé symétriquement à l’opposé du mien. À présent, regarde, me dit-il, et la machine s’anima.
Je rentrai chez moi tard dans la nuit et ne pus m’empêcher de songer à nouveau aux bizarreries observées dans le cabinet de mon ami. Il m’était impossible de décrire précisement ce que le mécanisme avait eu comme influence sur les machines tant leur comportement dépassait mon imagination. Je craignais d’ailleurs que ce comportement n’influence mon ami dans la mauvaise direction, et ne l’amène à se mettre en danger. Car il en fallut de peu cette fois-là que la situation ne nous dépasse complètement. Nous dûmes d’ailleurs fuir son cabinet et verrouiller la porte, une machine encore sous l’emprise de l’étrange mécanisme, faisant encore sans doute à l’instant où j’écris un vacarme épouvantable. Mon ami me prévint qu’on attendrait que la machine se calme, mais lors de mon départ, rien n’avait changé, et je doute d’ailleurs que les choses se calment toutes seules. Peut-être va-t-il nous falloir affronter nos expériences, et l’étrange vie que nous avons créé là.
Il est toujours difficile, quand on le croit presque fini, de modifier encore son texte, d’incorporer encore de nouvelles choses, et de se rendre compte qu’elles perturbent à la fois notre vision de l’ensemble, mais également le déroulé des événements. C’est comme trancher à la pelle dans le tableau, et compléter au milieu ce qui manque. Mais lier ces deux morceaux de tableau séparés demande un important savoir-faire en peinture, en encadrement, et en soudure. Et ce tableau augmenté prend beaucoup plus de temps à réaliser que la pièce initiale (elle n’a d’ailleurs rien à voir).
« D’une façon ou d’une autre, pourtant, il sortit de la forêt : il se trouva soudain devant des champs moissonnés à l’infini de l’horizon. “Quel désespoir, quelle mort autour !” répétait-il marchant toujours tout droit, tout droit. » — Fiodor Dostoïevski, Les Frères Karamazov.
Ce soir, j’ai modifié mon text editor pour les Relevés, et suis passé de Sublime Text 2 (qui était une solution provisoire) à Atom. Ce logiciel est plus souple et modulable, ce qui me permet d’avoir une fenêtre extrêmement épurée sur laquelle ne demeure que le texte, sans rien autour. J’ai toujours distingué les Relevés, qui sont écrits sur un fichier HTML (index.html), et mes écrits plus longs, eux directement tapés dans Pages (avec une mise en page que je réutilise systématiquement).
Puis je me suis lancé dans la recherche d’un nouveau logiciel pour gérer mes emails, ce qui s’est avéré beaucoup plus laborieux que prévu, notamment car les nouveaux logiciels ne répondent plus à mes exigences esthétiques (c’est-à-dire : sobriété un peu datée, options basiques, maigre palette de couleurs).
Mon ordinateur actuel est un Macbook Air, acheté en janvier dernier. À son achat, je l’ai configuré exactement comme mon précédent (un Macbook Unibody que j’avais depuis 2009), à savoir : aucun fond d’écran, au maximum trois icônes sur le bureau (le fichier de mes Relevés et les manuscrits en cours), cinq logiciels dans le dock (Finder, Chrome, Mail, Pages, Cyberduck) et deux dossiers (Applications, Documents), un rangement rigoureux de mes dossiers pour créer l’arborescence la plus claire possible, et un nettoyage systématique de tous les fichiers inutiles. À cause d’un espace de stockage moindre, tous les fichiers musicaux et vidéos sont transférés sur un disque dur externe ; je ne conserve que les fichiers texte (donc : utilisation beaucoup plus soutenue des contenus déjà présents sur internet).
Je conçois mes ordinateurs toujours comme de très simples machines, utiles seulement à quelques fonctions (écrire, regarder, communiquer), et ne m’embarrasse pas de la plupart des fonctionnalités proposées. De même que tel logiciel doit remplir précisément sa fonction, sans déborder d’astuces ou de manipulations, mais tout en ayant une apparence solide (je déteste par exemple ces traitements de texte sans aucune option de mise en forme, juste le texte sur un fond crème : j’ai besoin de visualiser la machine autour). Quand j’utilisais encore Windows XP et Vista, je mettais systématiquement en place le thème de la version 2000, gris, austère). C’est une esthétique de la technologie que j’ai, et qui me satisfait : lignes de code, machines imposantes, claviers mécaniques et police Courrier. (Je me souviens d’ailleurs des premiers mois de mes Relevés, quand je n’avais encore aucun habillage CSS.)
(Maux de tête, sueurs froides.)
(À ma grande surprise, Saccage a été sélectionné dans la première liste du prix Révélation de la SGDL. Peu doué pour les compétitions sportives, je doute de passer cette première étape.)
Comme au milieu de la nuit ma gorge me brûlait, je me suis levé et j’ai avalé deux cuillèrées de miel. Puis je me suis rendormi.
Quand, dans mes Relevés, je lis des paragraphes des années passées, je ne retrouve rien de ce que j’étais venu chercher. On écrit toujours à côté de soi, c’est-à-dire qu’on s’efface progressivement. Et puis on ment. On ne sait plus qui on a aimé, ou pardonné, haï ; on observe un étranger rire. On se lasse d’être cet homme. (J’ai beaucoup écrit.) (Il y a des liens morts et des vidéos qui ne sont plus répertoriées.)
« Aujourd’hui, tout semble indiquer qu’il n’existe que des oasis d’horreur, ou que la dérive de toute oasis la mène vers l’horreur. » — Roberto Bolaño, Le gaucho insupportable.
Alors que je finis tout juste de payer, la libraire (vendeuse) décroche son téléphone et appelle un collègue se trouvant à l’étage, me tournant le dos, détachant et déposant mon ticket de caisse l’air de ne pas y être, me laissant ranger les livres dans mon sac sans un regard ni un mot, et partir de même, dans le silence déroutant de son impolitesse.
Je viens de terminer la lecture de Au pays de la fille électrique, de Marc Graciano, roman qui, encore une fois, possède une magie essentielle.
Quand je vois la liste des jeunes romanciers actuels dont Jean-Philippe Toussaint apprécie le travail, ça me donne quand même un peu envie de crever.
Dans Ducktales 2 se trouve une canne spéciale qui permet de sauter plus haut. Sans cette canne, certaines zones du jeu demeurent donc inexplorables. Ces zones ne font jamais avancer réellement le labyrinthe principal, mais dévoilent des pièces secrètes qui offrent quelques diamants, eux-mêmes cachés dans des trésors. Le cadre du jeu est délimité en haut par un rectangle indiquant les points de vie et le score général de la partie. Si on se trouve au plus haut du niveau, ou de la pièce, ce rectangle noir sert de plafond. Pourtant, grâce à cette canne spéciale, cette limite peut, à certains endroits, être brisée. Il s’agit donc de dépasser le cadre imposé, pour l’investir, et s’en servir de tunnel, de passage. Ducktales 2 n’est pas le seul jeu à utiliser la limite visible de l’écran pour dissimuler des issues (murs en creux, plateformes invisibles, etc.), mais celui qui m’a frappé pour la première fois durant mon enfance. Je voyais alors qu’il ne fallait pas faire confiance à ce qu’on me présentait comme étant la réalité, aux frontières, aux limites, et que même à l’intérieur d’un univers qui me semblait clos, ordonné, il y avait toujours des portes à ouvrir, des murs à escalader, des tuyaux à emprunter. Qu’il y a le cadre qu’on nous donne, et ensuite la façon dont on est capable de le remettre en question pour l’explorer et l’épuiser au maximum.

Quelque chose appelle votre regard à l’extérieur. Vous vous approchez de la fenêtre et voyez, en face, à l’autre bout de la rue, une silhouette immobile sous la lumière d’un lampadaire. La silhouette ne semble pas vous avoir vu ; vous ne parvenez pas à distinguer dans quel sens elle est tournée, ni si elle attend quelqu’un. Vous demeurez un long moment ainsi, debout dans l’obscurité de votre appartement. Soudain, elle sort du halo orange qui l’encerclait. Vous attendez un instant. Il n’y a plus personne. Vous hésitez à quitter la pièce. Le lampadaire finit par s’éteindre, mais vos yeux s’habituent au noir et vous observez toujours avec obstination l’endroit où se tenait la silhouette. Finalement, vous allez vous coucher. Dans la nuit, vous êtes persuadé que quelqu’un frappe. Vous hésitez longuement à vous lever. Le bruit ne cesse pas. Vous fixez le plafond de votre chambre. Du plâtre vous tombe dans les yeux et dans la bouche.
À chaque grondement de tonnerre, les enfants jouant dans la cour de l’école d’à côté crient.
Le lendemain, je sonnai chez mon compagnon qui ne répondit pas. Je me demandai si la machine ne l’avait pas captivé toute la nuit et ne l’avait pas empêché de se réveiller le matin. J’espérai que la machine ne l’avait pas tant obsédé qu’il en aurait perdu le sommeil et l’esprit. Je décidai de quitter son domicile et de retourner voir le marchand. Celui-ci n’était plus à son emplacement habituel. Il avait été remplacé par un autre marchand. L’autre marchand m’indiqua que celui dont je parlais ne présentait pas ses produits ce jour-là, mais reviendrait la semaine suivante. L’après-midi, alors que je travaillais chez moi, mon ami m’appelle. Viens vite, j’ai trouvé quelque chose !, m’assura-t-il. J’enfilai mon blouson et me précipitai chez lui. Je le trouvai assis dans son fauteuil, épuisé. Devant lui, sur le large tapis du salon, se trouvait la machine, absolument démontée, brisée, des pièces disséminées ça et là, sans qu’on puisse plus reconnaître ce qu’elle avait été au départ. Je lui demandai ce qu’il avait trouvé dans cette machine, comment elle fonctionnait, ce qu’elle produisait. Il me répondit n’en avoir aucune idée, mais qu’à l’intérieur, il avait trouvé ceci, et il me tendit alors une petite pièce, une sorte de rouage, mais que je n’avais jamais vu auparavant, dans aucun matériel, aucune construction. Cette pièce n’existe pas, me dit-il alors. J’ai cherché dans chacun de mes livres, dans les encyclopédies, dans des manuels d’ingénierie, cette pièce n’existe pas, je n’en trouve aucune mention nulle part, et son mécanisme même m’échappe. Ce n’est pas un engrenage, ni un écrou, ni une poulie, ni rien dont je comprenne le fonctionnement, l’utilité. On dirait que c’est une pièce en trop, et pourtant, si je ne l’incorpore pas à l’intérieur de la machine, elle ne fonctionne pas. Je le regardai, étonné : Car tu es finalement parvenu à la faire fonctionner ? Oui, facilement, mais c’est sans importance, me répondit-il. J’observai plus attentivement cette pièce étrange, qui tenait dans la paume de ma main. La matière m’était familière, et la forme également, bien qu’en effet elle ne corresponde à aucun autre moule habituel. As-tu essayé de l’intégrer dans d’autres machines ?, demandai-je. Enfin !, s’exclama-t-il, comme s’il attendait que je lui pose cette question depuis le début de notre conversation. Oui, oui, oui ! Et c’est là le plus étonnant !
Peut-être quelqu’un complote-t-il à votre encontre quelque part, dans une autre ville, un autre pays, peut-être dans l’appartement voisin, quelqu’un que vous avez déçu, que vous avez mal regardé un jour que vous le croisiez dans la rue, peut-être avez-vous fait du mal vous-même à un de ses proches et alors veut-il se venger, et peut-être êtes-vous désormais son pire cauchemar, et l’objet de toutes ses obsessions, et de toute sa haine. Parfois je m’imagine la cible d’une menace inconnue, pour une raison que j’ai oubliée, ou refoulée ; parfois je me dis qu’un de mes actes passés peut mériter que je meure, que c’est possible, probable, qu’un jour en effet un poignard puisse se tendre dans mon coeur, et qu’une raison existe pour expliquer un tel geste, une telle situation. En sursis.
Le marchand voulut sortir d’un de ses cartons une machine, qu’il nous indiqua être sa pièce la plus rare. Il mit un temps considérable à sortir la machine du carton, car elle était coincée dans ce contenant trop étroit, et il s’y prenait extrêmement mal pour l’en extirper, et ni moi ni mon compagnon n’osions lui proposer notre aide, et le marchand se mit à secouer la machine et le carton dans tous les sens, espérant que ce dernier se décroche enfin de la machine et tombe, ce qui finit par arriver, le bruit étouffé du carton tombant sur le sol attirant l’attention de quelques autres passants intrigués par les manoeuvres du marchand. La voici, nous dit le marchand en tendant la machine à bout de bras. C’était une machine sans originalité, en plastique principalement, peinte en rouge et blanc, qui ressemblait vaguement à une petite machine à laver, ou un micro-ondes, avec un hublot sur le devant. Et à quoi sert-elle, cette machine ?, demanda mon compagnon. Le marchand expliqua qu’il l’avait découverte dans un marché étrange, alors qu’il était en vacances à l’étranger, et que l’homme à qui il l’avait achetée n’avait pas voulu lui donner la fonction de l’objet, ou s’il l’avait donnée, le marchand ne l’avait pas comprise, car l’homme parlait une langue étrangère, du japonais peut-être, le marchand n’en savait rien. Rentré chez lui, le marchand l’avait branchée, mais n’était par parvenu à la faire fonctionner, seulement à ouvrir le hublot. C’est une machine dont la fonction n’est pas encore déterminée, conclut-il. Son prix était exhorbitant, et je ne savais pas si j’étais prêt à investir autant dans un objet dont la fonction (et l’utilité) n’était pas précisément définie. Mais mon compagnon semblait comme attiré, envoûté par cette machine, et l’acheta aussitôt, sans même me consulter. Le marchand s’empressa de la ranger dans son carton (heureux, je le supposais, de s’être débarassé d’un tel fardeau), et encaissa les billets de mon ami. Puis nous fîmes demi-tour vers nos logements respectifs pour achever notre journée, mon ami ne disant mot, sinon, parfois, étrangement, comme parlant tout bas à la machine. Tu me diras si tu parviens à percer son secret !, finis-je par lui dire, sans qu’il ne me réponde d’aucune sorte, et que je l’observe s’éloigner dans la ville, bousculé parfois par d’autres passants distraits eux aussi.
J’ai lu les Lettres luthériennes de Pasolini : parfois pertinent, mais parfois extrêmement jargonneux (et fantaisiste)…
Je me souviens également, toujours à propos du même jeu, d’un mythe qui entourait la capture d’un Pokémon extrêmement rare, Mew, introuvable dans le scénario principal. Dans la ville de Carmin-sur-Mer (la cinquième visitée, après Bourg Palette, Jadielle, Argenta, et Azuria), un camion se trouve à côté du paquebot Océane, sur une mince bande de terre, et est difficilement accessible. Ce camion m’a toujours extrêmement intrigué à cause : de son apparence (il est le seul véhicule motorisé dans tout le jeu), de son côté hors-limite (il est là tout en étant à part), de sa capacité à focaliser les spéculations. Le mystère ne réside pas forcément dans les phénomènes paranormaux : un simple camion peut l’incarner. Il suffit que ce camion dénote dans l’environnement général, ou se trouve, par sa position, placé dans une situation de contrariété, pour acquérir une aura étrange. Je soutiens de plus en plus une esthétique du presque (déjà à l’oeuvre dans Saccage, davantage encore dans La ville fond), qui donne à distinguer des objets qui semblent d’importance, mais sans jamais dévoiler leur réelle fonction ; ainsi, le joueur (lecteur) pressent que quelque chose qu’il ne comprend pas se passe en marge et peut tout bouleverser, ou peut-être ne rien bouleverser du tout, mais requiert toute son attention (c’est-à-dire à terme ne la requiert plus du tout, et le prend par surprise).

Addendum : Après des années de recherche, le camion ne contient aucune Pokémon, ni aucun objet, et ne provoque rien à son contact (il est impossible de le déplacer). Cependant, une autre manipulation permet d’attraper ce Pokémon rare, mais dans la ville d’Azuria (je l’ai réalisée récemment, et elle m’a procuré beaucoup moins de satisfaction que toutes les fables autour du camion).
Dans les premières versions de Pokémon, une ville cachée peut se présenter après plusieurs manipulations à l’intérieur du jeu : partir dans le Parc Safari, puis se mettre devant la sortie, puis sortir du parc, mais répondre non à la question pour savoir si l’on souhaite sortir du parc, ce qui nous ramènera dans le parc ; sauvegarder, éteindre, et rallumer à l’entrée du parc ; puis sortir du parc, ce qui fera apparaître un message semblable à l’entrée dans le parc ; répondre non à la question posée ; s’envoler vers une route quelconque du pays et marcher jusqu’à ce que le gardien nous dise qu’il faut sortir, alors même que l’on ne se trouve plus dans le parc : cela ramènera à l’entrée du parc ; enfin, sortir du parc :

C’est une ville constituée de chiffres, de morceaux de plans, ou de panneaux. Il est possible de surfer sur la ville, et de marcher sur l’eau. Il y a aussi des murs invisibles et des arbustes impossibles à couper. Cette ville n’a aucune utilité et peut faire dysfonctionner la cartouche.
« Parce que tout le monde dans notre siècle s’est séparé en unités, chacun s’isole dans son terrier, chacun s’éloigne des autres, se cache, et cache ce qu’il possède, et finit par se repousser lui-même des autres hommes et par les repousser. Il amasse, dans l’isolement, sa richesse et il pense : comme je suis fort en ce moment, comme je suis à l’abri du besoin, et il ne sait pas, le fou, que, plus il amasse, plus il s’enfonce dans l’impuissance suicidaire. »
Le roman policier que je suis en train d’écrire s’intitule Rivage au rapport (je l’ai sous-titré roman policier au cas où l’on veuille faire croire que c’est autre chose).
La tirade de Ivan à son frère Aliocha à propos des bourreaux et de la cruauté et des enfants et du pardon et du salut est l’une des plus belles choses que j’ai pu lire de ma vie.
Sur le trottoir d’en face, des riverains ont déposé un canapé pour que les agents d’entretien l’emmènent à la déchetterie. Le canapé est en bon état et peut encore servir d’assise confortable. À l’instant, trois femmes ont déposé leurs sacs de course, ont cueilli des mures dans les ronces qui courent sur le mur, et se sont assises dans ce canapé pour discuter (ce qu’elles font toujours). Les déchets parfois permettent d’habiter l’espace.
Plus tard, deux adolescents ont sonné à la porte puis sont partis en courant. Juste avant, je les avais entendus dire : et puis on part en courant !
« En fait, quand on parle parfois de la cruauté “bestiale” de l’homme, c’est une injustice terrible et blessante pour les animaux ; un animal ne pourra jamais être aussi cruel qu’un homme, cruel avec un tel sens artistique, un tel art. Le tigre dévore, déchiquette, tout simplement, il ne sait rien faire d’autre. Il ne lui viendra jamais à l’idée, à lui, de clouer les gens avec des clous par les oreilles pour la nuit, quand bine même il aurait la possibilité de le faire. » — Fiodor Dostoïevski, Les Frères Karamazov.
(WIP) La chaise que Bram avait vue sur le sol était à nouveau en place, et le fermier se tenait debout à côté de la table. Il s’était équipé d’un tablier et tenait dans sa main gauche un couteau de boucher ; un plat de viande était disposé au centre de la table. Le fermier invita Bram et le chauffeur à partager son repas et leur servit à chacun une large tranche de porc. Ce sont les meilleurs du pays, confia le fermier tout en découpant dans la carcasse de larges morceaux. Du sang coulait en abondance des morceaux découpés, et éclaboussait et salissait la nappe de la table et le tablier et les vêtements du fermier. Bientôt il n’y aura plus de porcs car toutes les cultures seront brûlées, continua le fermier après s’être assis. La ville souhaite tout remplacer par des surfaces en bitume et ne plus avoir ni de céréales ni de viande ni de verdure. Bram et le chauffeur n’avaient aucun appétit et observaient le fermier manger goulûment ses quartiers de viande ensanglantés. Un porc alors apparut sur le seuil de la cuisine et le fermier le chassa en lui donnant plusieurs coups de pied dans le museau ; ensuite Bram l’entendit fermer la porte d’entrée à clé. Voilà depuis une semaine maintenant qu’ils veulent à tout prix rentrer, confia le fermier depuis le vestibule. Puis il se rassit et finit son assiette en silence. Bram s’aperçut qu’à l’extérieur le porc chassé plus tôt avait le museau collé contre la vitre de la cuisine et les observait tous les trois de ses yeux noirs. Le fermier détourna l’attention de Bram en les informant qu’ils pourraient rester dormir s’ils le souhaitaient et ne repartir qu’au matin, qu’il avait deux lits disponibles et préparés à l’étage. Alors que Bram s’apprêtait à accepter la proposition, le chauffeur le coupa et expliqua au fermier qu’ils avaient beaucoup de route et préféraient ne pas perdre trop de temps, d’autant que la météo était particulièrement instable et que Dieu seul savait comment serait l’état de la route le lendemain. Le fermier comprit parfaitement leurs raisons et ne leur en tint pas rigueur.

On corrige avec attention quelques paragraphes conclusifs, et soudain c’est tout le début du texte qui nous apparaît misérable. On n’en sort jamais d’équilibrer son travail.
Et je me demande : les lecteurs auront-ils le courage de suivre Bram jusqu’en ville ? Car lui-même est la plupart du temps découragé, ou dépossédé, ou perdu, face à son aventure, ce qui l’entraîne dans des méandres qu’il ne soupçonnait même pas, et qui le perturbent, qui le sortent de ce qu’il croyait être la réalité, et la mémoire, et le temps. Mais qui est capable d’accepter, de tolérer cela ? C’est-à-dire : qui est capable d’être Bram, et de poursuivre obstinément vers son but ? Qui se sent la force de cela, sinon Bram lui-même ? Qui pourrait dire : comme lui, je l’ai fait, j’y suis parvenu !
On tourne souvent en rond face à la ville qui fond.
Titre d’un livre que je n’écrirai jamais : David Copperfield, personnage.
Depuis un mois et demi que je me suis tondu les cheveux, je commence à peine à m’appréhender dans les miroirs, à me croiser, me vivre.
Qui peut se qualifier de bon ? N’est-ce pas déjà l’aveu d’être horrible ?
Alice a quitté la colocation, part s’installer à Montpellier. Maëlle vit désormais dans sa chambre, depuis à peine une semaine. Je suis moi-même à Paris et n’ai donc pas encore vécu avec Maëlle. Je ne sais pas comment Maëlle vit dans l’appartement ; je ne sais pas tellement qui vit dans mon appartement, qui est aussi le sien, même si je ne sais pas qui elle est, disons que l’avoir vue une fois, une heure je pense, ne me donne pas la sensation de savoir qui elle est, et pourtant elle vit là où je vis, là où Alice vivait. Je ne reverrai sans doute plus Alice. Peut-être une ou deux fois dans l’année, au mieux. C’est tout.
Je pensais me sentir libre dans l’écriture. On n’est jamais libre. Il y a toujours des inconnus à remercier, des lieux où faire acte de présence, il y a toujours des relations à entretenir pour que son livre soit livre, il y a toujours des heures terribles à passer, comme le marchand qui espère vendre sur la place du village ses outils électroniques inutiles, et dont les passants se moquent, et que les mêmes passants ignorent, curieux qu’on puisse croire en de tels objets, curieux qu’on puisse les vendre, curieux de l’homme derrière la bizarrerie, curieux que quelqu’un ait conçu cela qui ne mérite pas d’être. J’ai déjà assez de moi-même à supporter et à contenter pour en plus ménager les attentes d’autrui. Ce n’est pas mon métier, ce n’est pas pour quoi je fais ce que je fais. Il y a des prix, des salons, où on remercie pour la place qu’on nous donne, pour l’attention qu’on nous porte, pour la médaille qu’on nous remet, comme le roi adoubait son nouveau chevalier. Mais quel honneur d’être félon ! Et de ne rien devoir à personne ! Et quand bien même tout cela serait pour rien, et qu’on n’y gagnait rien, et qu’on était détesté de tous, pourrissant inutile dans un trou de fosse, quel plaisir déjà, quelle joie ! Si vous aimez mon travail, achetez-le ; s’il vous déplaît, boudez-le. Mais ne me demandez pas de comptes : tout est déjà là (my job is done).
Ce que je recherche : utiliser les termes les plus justes pour détailler le plus simplement et honnêtement possible la scène que j’ai en tête. Il peut s’agir d’un aller-retour entre la porte d’une maison et une boîte aux lettres, ou de la pendaison d’un fou, toujours aller à la symbolique, c’est-à-dire à l’intemporel, c’est-à-dire à la justesse, à la précision, la perfection.
Je crois écrire désormais car je n’ai pas les compétences techniques pour réaliser un jeu vidéo. Donc je reprends tout mon imaginaire et je l’adapte au format. (Au fond, je ne crois pas trouver dans le jeu vidéo la liberté de l’écriture – mais j’y trouve le monde.) (Surtout, la plupart des jeux vidéo aujourd’hui sont figés dans une narration conventionnelle ; paradoxalement, plus le temps avance, plus la technique évolue, et plus on fait du jeu vidéo à la Balzac, qui m’ennuie au plus haut point ; je préfère contrôler un petit être fait de viande qui doit sauter entre diverses lames et dont les traces de sang sur le parcours témoignent des râtés successifs.)
Pavese fonctionne dans son journal comme dans un document universitaire : plein de retours en arrière, de confere, de réflexions continues, etc. Moi c’est à peine si je me souviens de ce que j’ai écrit à la veille.
« Le lieu mythique n’est pas le lieu individuellement unique, type sanctuaire ou lieux analogues […] mais bien celui de nom commun, universel, le pré, la forêt, la grotte, la plage, la clairière qui, dans son indétermination, évoque tous les prés, les forêts, etc., et les anime tous de son frisson symbolique. »
« Là on voit de nouveau comment le retour à l’enfance équivaut à assouvir la soif de mythe. Le pré, la forêt, la plage de l’enfance ne sont pas des objets réels parmi tant d’autres, mais bien le pré, la plage tels qu’ils se révélèrent à nous dans l’absolu et donnèrent forme à notre imagination transcendentale. »
Envie de lire La Maison des feuilles ; envie de me perdre dans les méandres d’une oeuvre mathématique.
Il me reste finalement des deux romans de Bolaño une espèce de mélancolie américaine, plutôt de mon idée de l’Amérique, et qui ne m’avait pas marqué à l’instant de la lecture, mais qui se retrouve dans l’errance et l’évaporation des êtres, et de leurs ambitions, de leurs souvenirs. Les Détectives sauvages me frappant d’ailleurs plus que 2666, plus d’humanité je crois, enfin quelque chose de l’humanité, de la mort aussi sans doute. Ça me conforte dans l’idée d’une littérature à effet : par l’assemblage de divers éléments (géographies, caractères, trajectoires) produire une sensation unique finale qui sera comme le produit de l’aventure vécue. Peut-être : vers où tirer sa voix. (La ville fond me comble dans son effet global, mais la dissonance des détails me saute toujours un peu plus aux yeux.)
(Peut-être ai-je écrit La ville fond trop vite après Saccage. Il y avait une urgence pour le second que je ne vis pas pour le premier, quelque chose d’instinctif qui cède sa place à l’élaboration minutieuse d’une entreprise : et cela même si le projet de La ville fond part d’un manque ressenti évident et quotidien.)
Pavese est chiant à transformer ses malheurs amoureux en misogynie absolue.
Tout est événement, et particulièrement ce qui ne s’est pas encore produit. On appâte le chaland, on lui fait croire qu’il va vivre un moment tout essentiel dans sa vie, mais l’événement n’est que supposé, qu’anticipé, rien ne se passe comme on l’imaginait, l’événement n’est pas – on a eu beau le dire, prévenir, annoncer : voilà l’événement ! ce sera du jamais vu !, l’événement n’existe pas, seulement son annonce, c’est-à-dire seulement l’envie, le désir dans le coeur de celui qu’on attire, et qui repartira déçu, car on l’a trompé, car il n’y a pas de lieu pour l’événement, car il n’y a pas d’endroit où être ou ne pas être ; il y a un événement dans la bogue de châtaigne que l’on aperçoit sur le sol et que l’on ouvre d’une simple pression du pied (il faut s’en contenter).
Par curiosité, j’ai feuilleté les premières pages d’un roman intitulé Petit pays, et qui sort en cette rentrée littéraire. Je ne vois pas d’autre façon de le dire : c’est à chier. Alors, j’ai feuilleté un autre roman de cette rentrée littéraire, intitulé Règne animal : nombre d’effets de manche, parfaitement somnifère. C’est le genre de texte qui me fait penser aux conseils qu’on me donnait en débutant le golf : ne force pas. Quand le geste n’est pas déroulé naturellement, qu’on crispe fort sur les poignets, qu’on arme les bras sans correctement pivoter le buste, on attaque la balle comme un bûcheron, et on perd en vitesse, on perd en naturel, on perd en projection. Il y en a qui forcent la phrase comme on force la balle : ils la veulent d’une telle façon, et la bourrent d’adjectifs et de participes présent, mais elle est rigide, elle est artificielle, elle n’est faite que pour entrer dans un moule absurde, elle ne se déroule pas, elle ne fait pas de poésie, elle fait du verbiage. Il n’y a pas de rythme, il y a de la force. Et la force ne mène à rien. On pousse toujours la phrase à bout, mais à terme elle ne dit plus rien, n’illustre plus rien ; certains oublient la pertinence absolue du manque. À force de braquer les yeux sur la chose, il n’y a plus de chose. À force de penser aux pieds que l’on avance, on ne sait plus marcher.
« Mais — il faut que le sache — la nouvelle oeuvre commencera seulement à la fin de la douleur. Pour le moment, je ne puis que rêvasser d’esthétique, rêvasser au problème de l’unité, et étudier des questions pour mettre fin à la douleur. » — Cesare Pavese, Le métier de vivre.
Plusieurs écrivains (Duvert, Barthes, Kertész, Gracq) retournent à la mère, dans sa proximité, dans son aura (de malheur et de haine parfois). Je m’interrogeais sur cette décision, il y a un temps. Aujourd’hui, je comprends pourquoi.
Hier soir, je suis arrivé vers vingt-deux heures trente chez ma grand-mère. Il n’y avait presque personne sur la route, mais les phares en face m’éblouissaient affreusement, et je passais parfois dans de longs tunnels d’obscurité, et je me demandais si j’étais bien encore sur la route, si je ne risquais pas de me déporter dans le fossé, ou d’écraser quiconque marcherait à cette heure sur le bas-côté, et la moindre voiture derrière me suivait dangereusement, j’étais mal assuré, me disais : peut-être vais-je mourir, et peut-être en effet mourir aurait été possible cette nuit-là (ce qui ne s’est pas produit).
Le Journal de galère de Kertész s’achève en 1991. Le même année, je nais.
Défendre les droits vestimentaires des femmes, quels qu’ils soient, pour défendre toutes les femmes (un article clair, concis, et bien référencé sur la question de l’habillement.)
Michel Butor est mort cette nuit.
(La chaleur m’empêche de me concentrer, et d’écrire, et de rien faire.)
« La race, l’espèce (humaine) vit de manière destructive sa vie aussi irrationnelle qu’injustifiable, elle engloutit l’individu, le dépouille de toute originalité et ne lui laisse aucune valeur individuelle. »
Nous cherchons souvent des mobiles aux agissements de nos politiques, quand tout est très simple : ils sont abominablement bêtes, d’une insondable bêtise qui n’a d’égale que leur ignorance, on en ferait d’interminables monologues bernhardiens de leur petitesse intellectuelle, qui engrange la haine, et la colère, et l’irrespect profond de l’être humain, de l’espèce humaine, et il n’y a rien à dire de plus, il n’y a plus besoin de lui trouver des prétextes, il n’y a pas à la questionner, il n’y a qu’à la combattre, de toute notre force, avec la plus intense volonté, presque avec aveuglement, sans faillir, perdre la bêtise, perdre les bêtes dans de profondes fosses et les recouvrir d’un drap noir.
Sur le burkini : tous ces gens contre, à chaque fois, font revenir le même ressenti : moi ça me choque, moi je prends ça comme une provocation, il y a le vivre ensemble qu’on devrait respecter, etc. C’est très étrange le sentiment d’attaque que subissent la plupart de ces personnes, de projeter leur peur dans des situations qu’ils ne comprennent pas, n’ont pas pris le temps d’assimiler, ou d’écouter. Et qui est, simplement, un défaut de communication, de respect même. Pour tout dire, je ne comprends pas comment on peut se sentir agressé par une tenue, ça me dépasse absolument. Il leur paraît inconcevable qu’on puisse porter cela par choix. Ce n’est pas possible. Car ça ne correspond pas à leur conception de la liberté, ça n’est pas possible, ça n’est pas légitime. Ce sont ces mêmes comportements qui ont toujours alimenté les mêmes hantises, les mêmes mesures absurdes et abjectes et ignoles, et qui replient sur soi, et qui indiquent : mangez ceci, habillez-vous de telle façon, ne faites pas autrement, ne prenez pas le risque de votre identité, faites comme tout le monde, faites comme les autres, ne faites rien, taisez-vous, circulez, regardez vos voisins, débusquez les traitres, débusquez les faux citoyens, traquez les fourbes, traquez les ennemis de la nation, mettez-les à nu, alignez-les, ne les écoutez pas, leurs paroles sont mensonges, ils parlent sous la contrainte de dieux obscurs, ils en veulent à vos libertés, tuez-les, chassez-les, n’ayez pas de pitié car dans leurs plans ils n’en ont pas pour vous, annihilez tout ce qui n’est pas de votre sang, annihilez tout ce qui n’est pas assimilé, annihilez, annihilez, et le bonheur vous trouvera, et la paix sera sur vous (la seule paix légitime).
Je ne sais plus quoi dire. Flaubert : Je sens contre la bêtise de mon époque des flots de haine qui m’étouffent. Le manque d’empathie dévore. À terme, on serre sa propre main, sûr de son bon droit ; on ne se rend pas compte qu’on est mort (et seul) déjà.
(Je ne comprends pas pourquoi les policiers, à une heure du matin, dans des boulevards déserts, actionnent les sirènes de leurs voitures — sinon pour parader ?)
« Nous savons désormais qu’en tant qu’objet, l’homme n’a aucune chance. Il doit dépasser l’objectalité s’il veut trouver un semblant de vie, la vérité, pour faire bref. »
Bientôt un terme à La ville fond. Texte à laisser reposer, et puis on verra dans quelques mois ce qu’il en est, ce qui persiste.
Il fait très chaud. Des vieux doivent en mourir, je pense.
« Je ne sais pas s’il y a d’abord la solitude, ou si c’est le travail de création qui rend solitaire ; je crois qu’il y a d’abord la conscience claire d’être solitaire et créateur : solitaire, parce que telle est la vérité ; créateur, parce qu’on peut ainsi déplorer sa solitude. »
Dans la ville, étrangement, beaucoup d’impasses, d’abord vers divers immeubles résidentiels, ensuite un lycée, alors prendre entre les lotissements, et les allées, voir un père et son fils jouer au tennis dans la cour d’un collège sans personne, ensuite d’autres boulevards inconnus, et on se demande comment de là où l’on vient on a pu arriver jusqu’ici, alors continuer droit, puis prendre un énième sentier dans une direction aléatoire, encore d’autres impasses, d’abord vers une entreprise au portail fermé, ensuite une espèce de jardin, plutôt des mauvaises herbes, enfin déboucher là où l’on sait ; prendre les perpendiculaires des grands axes, retrouver des quartiers résidentiels, et des cours et des entrées comme dans les terres, et des tuyaux qui fuient sur le trottoir, plus aucune tour, toujours le fleuve, ensuite on rentre, malgré tout, sans certitude d’avoir rien vu.
« Mon ambition d’écrivain : écrire quelque chose qui me tue » — Imre Kertész, Journal de galère.
Je vois souvent dire, à l’occasion de la parution du (premier) roman d’un ou d’une jeune auteur(e) : un avenir prometteur, les bases d’une oeuvre importante à venir, je pense qu’on entendra encore parler de, etc. Je préfèrerais au contraire qu’on n’entende plus jamais parler de moi : au moins tout aurait été accompli !
Le fameux journaliste littéraire Baptiste Liger le hurle à qui veut l’entendre : il en a marre de la littérature “pas mal” ! On aimerait le croire !
Mon corps n’a presque plus de vitalité. Depuis la semaine dernière, j’ai entrepris de lui en redonner. Je ne suis plus habitué aux exercices physique et je dois commencer au minimum, quand on peut à peine soulever son propre corps, ce qui est très ingrat, et humiliant parfois même sous son propre regard. Je me trompe encore dans les temps de repos, et ne sais pas si mon régime alimentaire est tout à fait le bon. Je persévère. (J’ouvre un rectangle qui consignera mes séances d’exercice, ce à quoi sert parfois aussi un journal.)
« Comme tant d’autres Mexicains, moi aussi j’ai abandonné la poésie. Comme tant de milliers de Mexicains, moi aussi j’ai tourné le dos à la poésie. Comme tant de centaines de milliers de Mexicains, moi aussi, à l’heure venue j’ai cessé d’écrire et de lire de la poésie. »
« Ce que j’écris aujourd’hui en réalité je l’écris demain, qui sera pour moi aujourd’hui et hier, et aussi d’une certaine manière demain : un jour invisible. »
Je porte une mélancolie en moi qui sera mon meilleur livre mais que je ne parviendrai jamais à écrire.
J’ai suivi la Vilaine vers le sud ouest, il y avait une maison éclusière, ensuite l’immense stade, ensuite, ou avant, une sorte de centrale électrique, c’était sans doute avant, et puis la rocade sous laquelle je suis passé, un pont où alors j’ai croisé les pompiers plongeurs, un immense centre commercial, et le parking qui débouchait directement sur l’affluent, et ce que j’ai pris pour une aire d’autoroute (en vérifiant aujourd’hui il s’agit en fait de la zone d’entraînement des sportifs), alors je me suis assis contre un arbre, en face trois hommes pêchaient, j’ai hésité à continuer plus loin mais la pluie se dessinait dans les nuages sombres, je me suis demandé malgré tout : qu’y a-t-il plus loin ? (des marais) avant de faire demi-tour, et apercevant un adolescent vêtu de blanc entre les buissons de cette fausse aire, croyant qu’il attendait là quelques clients à qui vendre, ensuite le chemin inverse, beaucoup moins aventureux, quelques lotissements, les routes habituelles enfin, chez soi.
« J’ai parcouru un long chemin, j’ai publié quatre livres et je vis à l’aise de la littérature (même si pour être sincère, je n’ai jamais eu besoin de grand-chose pour vivre, à part une table, un ordinateur et des livres). […] Je n’ai pas encore trente ans et le futur s’ouvre comme une rose, une rose parfaite, parfumée, unique. Ce qui commence en comédie s’achève en marche triomphale, non ? » — Roberto Bolaño, Les Détectives sauvages.
La semaine dernière, en plein après-midi, j’ai été témoin d’un vol. Je regardais (après manger je crois, ou parce que je n’avais rien de particulier à faire), par ma baie-vitrée, la rue en face de chez moi. Il y avait dans la rue deux femmes, dont une avec une poussette, deux enfants, et ils étaient arrêtés sur le trottoir, à côté du portail et du mur délimitant la propriété d’une maison. Je ne savais pas ce qu’ils faisaient en particulier et ne le questionnait pas (parfois de vieilles personnes restent discuter dans cette rue peu utilisée par les voitures). Quelques jours encore auparavant, deux équipes de police avaient arrêté des adolescents, un notamment dans le jardin de cette maison à côté de laquelle les femmes et les enfants patientaient. Soudain, deux adolescents sont apparus dans la cour de la maison et ont fait passer par-dessus le portail deux vélos et une pompe à vélo, et sont partis dans le boulevard avec les femmes et les enfants, mine de rien, en pédalant comme si les vélos leurs appartenaient.
J’ai su à l’instant où j’observais la scène qu’il s’agissait d’un vol. Pourtant, je n’ai rien dit. Je n’ai pas ouvert ma baie-vitrée pour les interpeller, je ne suis pas descendu pour aller à leur rencontre, je n’ai pas appelé la police. Sur le moment, je n’ai pas très bien vu pourquoi j’aurais fait une telle chose. La famille volée semble avoir de l’argent, il ne s’agit que de deux vélos, me rendre au commissariat et témoigner m’ennuyait au plus haut point.
Aujourd’hui, en allant faire une course, j’ai vu trois agents de police s’approcher de la maison. Apparemment, le vol a été déclaré, quelqu’un s’est rendu au commissariat — pas la famille car elle ne me semble pas encore rentrée, mais peut-être un voisin, ou un ami. Je suis passé à côté d’eux comme si de rien n’était, alors que je suis sans doute le seul et principal témoin de cette affaire (le mot est grand). C’est-à-dire que leur meilleure chance de retrouver les malfaiteurs passait mine de rien à côté d’eux. Je n’en tire aucune fierté, mais ce rapport entre connaissance et ignorance m’intéresse, et tient parfois à peu. Il m’a amusé qu’ils soient à la fois aussi proches et aussi loin de la réponse, de la solution. En revenant de la course, d’autres agents de police sont arrivés, en civil cette fois-ci, équipés de gants et de produits révélateurs (je suis d’ailleurs étonné du développement de tels moyens pour deux vélos), pour relever les empruntes, tenter de déterminer les causes du délit et le nombre de voleurs. Je leur souhaite bon courage.
(J’ouvre le volume de Collobert à nouveau, dans Dire I : On allait d’un bord à l’autre de la ville limitée. Les arrêts marquaient notre fin, notre vaillance. On persistait partout à tenir solide à l’aventure, aux commencements. Des villes, d’autres villes sans fin apparaissaient. Repoussés des limites — sans cesse le voyage.)
En ce moment j’écris beaucoup de choses que je supprime immmédiatement après. En permanence la même lassitude. Tard, un peu avant minuit, parfois, j’entends des rires autour de ma chambre. Je ne sais pas d’où ils viennent. Je sors dans le salon pour regarder par la baie-vitrée, mais dans la rue il n’y a que quelques véhicules fantômes, une passante qui marche en silence, et la lumière au loin des immeubles. Alors je me couche à nouveau, et j’entends les rires encore. Il pourrait s’agir de la grand-mère qui loge à l’étage inférieur, et écoute toujours sa télévision le son poussé au maximum, parfois la messe d’ailleurs, mais je ne l’imagine pas discuter aussi fort, ça me semble impossible, quand je la croise dans l’escalier elle tient à peine debout, elle met un temps infini à gravir ses trois étages, je lui dis bonjour, je me dis quelle femme. Les voisins d’à côté peut-être, mais leur salon est loin. Ou ceux de l’immeuble jouxtant le mien, et que je n’ai jamais vus, dont j’ignore même quelle porte mène à leur appartement, comment accéder là, juste pourtant de l’autre côté de la cloison. Alors j’attends que les rires se taisent, et je me dis qu’ils viennent de partout, et que tous rient autour de moi, à mon propos peut-être, ou d’un étrange phénomène que je ne peux pas observer, ou de rien, uniquement pour empêcher mon sommeil. Je me dis toutes ces choses qui finalement m’endorment.
La couverture de mon exemplaire des Détectives sauvages s’est décollée, de même qu’une page centrale, qui dépasse comme un membre malade, et tout tombe en lambeaux, et je déteste absolument ça, comme il y a quelques semaines avec Aminadab, je déteste avoir l’impression que tout se désagrège quand je n’en ai même pas encore profité jusqu’au bout.
« Car enfin qu’est-ce qu’un homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. La fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable. » — Blaise Pascal, Pensées.
J’avais écrit ici un paragraphe théorisant un passage de La ville fond, mais comme ce passage n’est finalement pas convaincant, et qu’il sera sans doute supprimé (au moins modifié, voir paragraphe suivant), sa théorie n’a plus aucune raison d’être.
(Alors que les policiers et les guerrières s’entretuent dès le premier paragraphe = désillusion de Bram à propos des guerrières, le chauffeur attire Bram dans la forêt ; permet de casser la répétition, et de maintenir les liens avec les deux segments ; trouver ce qui se passe dans la forêt.)
« J’ai pensé : malgré toute mon astuce et tous mes sacrifices je suis perdue. J’ai pensé : quel acte poétique que détruire mes écrits. J’ai pensé : il aurait mieux valu que je les avale, maintenant que je suis perdue. J’ai pensé : la vanité de l’écriture, la vanité de la destruction. J’ai pensé : parce que j’ai écrit, j’ai résisté. »
J’ai des ambitions beaucoup trop élevées pour mes pauvres moyens. Je ne sais plus comment écrire, ni si je dois, ni pour quoi dire, etc. Je regarde les immeubles alors que je marche dans la rue, mon reflet dans les vitres du métro, et je regarde le mouvement du véhicule, et le possible infini de son déplacement horizontal, sans aucun arrêt, aucune sortie, sinon le même retour de moi-même en miroir ; ou des inconnus qui rentrent et sortent et soi qui reste. Les bâtiments ne me convainquent, ils pourraient aussi bien ne pas être là, remplacés, calqués, encore dernièrement une importante maison a vu ses fenêtres condamnées par des parpaings pour que personne n’incendie les restes, ne couche dans les décombres ; ensuite il y aura un immeuble ; ensuite il y aura quoi : on détruira l’immeuble sans doute, pour en reconstruire un nouveau d’une taille colossale, aux vitres réfléchissantes comme partout, Dubaï, le soleil là, disons les rayons infernaux, je ne sais pas ; ou un parc pour enfants, et plus d’enfants, des structures en métal qui gisent sur le sol, bientôt les structures détruites par leur propre pourrissement, est-ce le mot pour le métal, et de l’herbe par-dessus, et alors un homme érigera quatre murs, qu’on viendra lui contester, avec une massue ou un fusil, et ainsi, enfin, des siècles durant, jusqu’à ce que plus d’hommes, des bêtes seulement, entre les ruines, et plus de bêtes, et plus de ruines, et plus de sol, plus de souvenirs, plus rien nous rappelant notre propre mémoire, plus aucun souvenir, aucune tentation de soi dans le passé, aucune trace des ombres et des mots, aucune présence d’aucune sorte et des végétaux en tous sens, et de la fougère, partout, des pins immenses, un bruit diffus dans l’air, le soleil peut-être, un météore, le choc brutal, aucun souvenir du choc, aucun témoin, pas de choc, pas de fin, pas de mort, morts déjà.
(Je disais à Émilien : parfois il m’est difficile de comprendre la façon dont je construis les événements, l’ordre, le temps, car rien n’a de sens, et cet illogisme même que j’invente ne rentre pas dans ma logique ; en somme, je suis lassé des récits qui savent où ils vont. On disait aussi : filme un mur avec ton téléphone ; sur le téléphone soudain le mur s’altère, se déforme, se fissure, s’écroule ; quitte l’écran, observe le mur, et il n’a aucunement changé, pourtant tu l’as vu, il était écroulé ! il est les deux, tu as vu le même mur, écroulé et non ; les deux murs existent ; des infinités du même mur existent en même temps ; des infinités de tout élément, de soi également. Alors : de quel mur parle-t-on lorsque nous parlons du mur ? De qui parlons-nous lorsque nous parlons de nous ? Celui-ci qui se tient debout, ou le démembré ?)
(Peut-être qu’il y aurait quelque chose qui ne serait plus de l’innommable, mais comme du sur-nommé, ou sous-nommé, ou mal-nommé ; c’est-à-dire plus l’impossibilité de dire, mais comment dire trop ou pas assez ou n’importe comment. Disons : un texte à propos d’un homme en gavant de cet homme ; en n’en parlant jamais ; en parlant des règles du ping-pong — c’est un exemple.)
Il y a de ça un peu chez Chevillard (Palafox), avec remise en cause permanente du référent : il est quoi ? tout ? Mais il n’y a pas d’aventure, alors à quoi bon (on s’ennuie un peu).
La ville fond prend aussi le parti pris de mettre en scène un personnage qui n’est aucunement central concernant l’histoire, les enjeux, et les déplacements principaux. Bram est réellement inutile, ne sert sincèrement à rien pour personne dans ce texte. Il est pourtant le seul nommé, mais ce nom ne lui donne aucune fonction, aucun pouvoir. Beaucoup de romans forgent la singularité de leurs personnages principaux sur les noms (prénoms) qu’ils portent, et qui donc les identifient comme uniques. Bram est en effet unique, car il est le seul à se nommer Bram, à se nommer tout court, mais ce nom ne donne que l’illusion d’un pouvoir. Il est ce que sont chaque homme : une solitude manipulée parmi d’autres, qui elles aussi doivent se sentir dépossédées et impuissantes face aux événements qui se produisent, qui les dépassent, et dont elles ne sont aucunement responsables.
Le fermier est utile car il a un tracteur et un fusil ; le chauffeur car il conduit le bus et connaît le chemin jusqu’en ville ; la veuve car elle tient un bar. Eux sont des caractères, eux bénéficient d’une reconnaissance. Eux servent à quelque chose.
« Aujourd’hui il ne s’est rien passé. Et s’il s’est passé quelque chose, le mieux est de le taire, parce que je ne l’ai pas compris. » — Roberto Bolaño, Les Détectives sauvages.
J’avais écrit quatre paragraphes, puis je les ai effacés.
La question demeurant : qu’ai-je à dire ? Si rien, autant me taire.
Il est difficile de se résigner à l’Art. Mais parfois, il ne peut plus rien pour vous, et vous n’avez plus rien pour lui.
Je viens de voir une série de carnets commercialisés par Gallimard, et qui empruntent leurs titres à certaines oeuvres de leur catalogue. L’un d’entre eux s’intitule Le livre à venir. Qu’en dirait Blanchot. On souille bien les morts.
« Ce n’est pas dans cette chair mutilée que je trouverai la source de ma fierté d’être. »
La fille était assise et on aurait dit qu’elle attendait quelque chose. Nos deux vélos étaient encore couchés sur la terre battue de la cour. Quand je suis arrivé la fille a fait semblant de ne pas me voir alors je me suis assis dans le salon et la fenêtre était ouverte. Je me suis allongé sur le canapé et j’ai attendu un moment. La fille m’a dit : Je ne sais pas quand ma grand-mère rentrera. Parfois je regarde la mer et je me dis qu’il y a plein de morts dedans et qu’un jour ils sortiront de l’eau et ils viendront dormir dans mon lit. Des fois je les sens qui dorment avec moi et ils me murmurent des choses dans la nuit. Mais ils ne peuvent pas rester longtemps et le matin il n’y a plus personne. Elle m’a dit : Après je n’y pense plus. Il y a eu un silence, et puis je me suis endormi.
Contrariété maximale par rapport à l’écriture : trouve tout chiant, compliqué, ai lu deux Volodine : frôle le sommeil, incapable d’avancer, manque de moyens, impossibilité de dire, frustration, haine d’être aussi désoeuvré. Tant à jeter. Aimerais bien une tombe comme Châteaubriand, sur un îlot face à la mer.
Où trouver le courage et le talent d’être meilleur que soi ?
« J’étais assis sur le rebord du lit et je tremblais. Il va se produire quelque chose, pensais-je avec une obstination lancinante. Il va se produire quelque chose, et certainement, cette fois-ci, je serai au contre de toute l’horreur. » — Antoine Volodine, Biographie comparée de Jorian Murgrave.
Je tue des hommes. C’est une des choses que je fais, et pour lesquelles je suis payée. Je tue uniquement des hommes. Dans les annonces que je poste, il est bien précisé que seuls les hommes peuvent être mes cibles. S’il s’agit d’une femme, ou d’un animal (cela arrive), alors, je décline. Par exemple, en ce moment, je tue un homme. Bien sûr, ma qualité de femme vous a surpris à la fois quant à ma profession (qui met bien plus de temps à rentrer dans les moeurs que conductrice de poids lourds, ou pilote de chasse), mais également au moment de ma prise de parole qui, selon des schémas plus conventionnels, m’aurait placée dans une cuisine en train de préparer un repas, ou derrière le coffre de ma voiture, à l’instant de charger les courses. J’ai suivi cet homme sur plusieurs jours, recueillant les traits caractéristiques et emplois du temps de sa famille (femmes, enfants, parents) et, à présent, je le tue. En toute quiétude, je vous rassure. Pris par surprise, il n’a pu opposer aucune résistance, et désormais il subit un châtiment décrit en détail par mon client (horrible, mais à la mesure du préjudice estimé, car chacun ici se fait justice comme il l’entend ; moi, je ne fais qu’appliquer). Évidemment, le ton détaché que j’emprunte empêche de se faire une idée précise des actes que je suis en train de commettre ; à dessein, car ils sont épouvantables. Quiconque me verrait actuellement serait incapable de soutenir la moindre conversation et s’évanouirait ou s’enfuirait en courant, et c’est pourquoi je prends la liberté d’entamer cette conversation, qui tient moins du dialogue que de la confession, voire du remplissage. Je tue en fonction des ordres qu’on me donne. Les ordres donnés cette fois-ci sont précis, exigeants, et demandaient une bonne préparation matérielle en amont. Je pense que la rancoeur était grande envers cet homme, elle l’est encore d’ailleurs à l’heure qu’il est sans doute, à moins que divers remords se soient emparés du client (souvent des gens sans histoire), et le remord alors aura disparu quand j’annoncerai au client la bonne conduite de ma mission. Laissant ensuite place à d’autres sentiments, comme le soulagement, ou l’impression (souvent fausse) de justice. Je ne promets rien, sinon la mort des hommes désignés. Je n’ai jamais éprouvé de réelles difficultés à tuer les hommes, si bien que, ce temps de cerveau disponible, je l’utilise comme bon me semble. Pour parler, souvent, mais parfois autrement. Je n’entrerai pas ici dans les détails. Chose étrange : quand je ne tue pas d’homme, je parle peu. Quand je suis trop longtemps sans tuer des hommes, je peux éprouver un réel manque à l’endroit du langage. Je ne sais pas s’il s’agit d’une maladie particulière ou de ce syndrome dont le nom m’échappe, quand l’envie d’aller aux toilettes vient alors qu’on entend couler de l’eau. C’est un syndrome qu’on prête souvent aux animeaux domestiques, mais que finalement nombre d’êtres humains partagent. J’ai parfois peur de cultiver une dépendance criminelle, qui pourrait nuire au détachement nécessaire afin de mener à bien et avec sérénité toutes ces missions risquées et terribles. C’est un métier bien plus exigeant qu’il n’y paraît. L’homme se débat et cela empêche ma réflexion d’avancer de façon plus aboutie. J’ai du mal à élaborer. Si les hommes se laissaient faire et souffraient en silence durant plusieurs heures, sans doute que mes capacités intellectuelles pourraient se développer à leur aise, et ainsi me permettraient de réfléchir à des questions extrêmement complexes comme les paradoxes temporels, l’existence de Dieu, ou divers conflits géopolitiques inextricables. Mais surtout, d’y trouver des réponses, ce que nombre de scientifiques, pourtant payés des sommes faramineuses, et subventionnés grassement par l’état, n’ont pas encore réussi à faire. Pour être parfaitement honnête, voilà ce qui m’énerve : qu’ils ne se laissent pas faire, et m’empêchent de révéler tout mon potentiel. Ah, ça y est, l’homme est mort. Encore une occasion manquée. Je vais devoir m’arrêter.
Cette faculté des vieux d’avoir toujours une anecdote à raconter. Une seule, qu’il s’agit d’oublier, puis de raconter à nouveau, etc. À terme : feindre l’émerveillement, ou se boucher les oreilles.
« Tout ça pour dire que ce n’est pas parce que « tu écris » que tu en sors moins embrouillé ; ça déplace l’embrouille et voilà. » — Nathalie Quintane, Crâne chaud.
Mon bataillon fut pris en tenaille par deux armées, la première venant de la rivière, la seconde de la forêt. Nous ne les avions pas entendues arriver. Le musicien chantait quand sa gorge fut tranchée. Sous les tentes ceux qui dormaient ne virent sans doute que des ombres affolées allant ainsi que des braises dans la nuit. Les toiles devinrent des torchons dans lesquels lessiver le sang répandu. Quelques-uns seulement furent constitués prisonniers ; menottés par les poignets et les chevilles dans une lente procession aveugle. Nous allions sur des braises qui étaient d’épines et de chrysalides, à travers les mêmes rivières et les mêmes forêts que nos ennemis avaient plus tôt traversées. Là entre les branches des plus hauts arbres des ponts suspendus desservaient leurs baraques de commandement. Ils semblaient ne nous craindre d’aucune manière, ne pas s’intéresser à notre présence. Un peu à l’écart de leurs voies aériennes, sur une lande rase brûlée par un incendie passé, une fosse ; nous devinant alors quels prochains hôtes entreraient dans nos bouches.
Que faire contre le dieu, contre le feu qui tombe ?
« Aucune révolution ne se déclenchera dans les métropoles, aucune insurrection populaire, seulement notre folie et son débordement incontrôlable de sale guerre, infinie et sans raison d’être. » — Antoine Volodine, Des enfers fabuleux.
Reprise des travaux forcés.
Cher journal,
Hier, j’ai fêté mon anniversaire. Pour le goûter j’avais invité Papa et ma belle-mère chez ma grand-mère. Il y avait Cécile aussi qui était là. Le temps était gris mais ma belle-mère avait amené un gâteau au fromage et moi et Cécile on avait fait un gâteau aux carottes et ma grand-mère avait fait une tarte à la rhubarbe. Papa et ma belle-mère sont arrivés plus tôt que prévu et le gâteau aux carottes était pas prêt mais c’était pas grave. On s’est assis sur la terrasse avec Papa et ma belle-mère et Cécile et ma grand-mère nettoyait la vaisselle qu’on avait utilisée moi et Cécile pour faire le gâteau aux carottes. Papa et ma belle-mère ils voulaient rien à boire alors je leur ai rien donné mais moi j’ai pris un verre de coca et Cécile elle a pris un verre d’eau. Sur la terrasse Papa et ma belle-mère ils nous ont pas posé de questions à Cécile et à moi alors Cécile elle a posé des questions et moi j’ai raconté la semaine mais ça avait pas trop l’air de les intéresser vu qu’ils répondaient rien et qu’ils laissaient beaucoup de silence. Après une dame a appelé ma grand-mère pendant qu’elle faisait la vaisselle et elle s’est invitée à mon anniversaire et Papa a dit elle est très gentille pas comme sa soeur. Moi je ne voyais pas qui c’était cette dame mais j’ai dit à ma grand-mère que bien sûr elle pouvait venir si Papa disait qu’elle était très gentille pas comme sa soeur et que en plus elle connaissait bien ma grand-mère.
Un peu plus tard la dame est arrivée et elle s’est installée sur la terrasse avec moi et Cécile et Papa et ma belle-mère et le gâteau aux carottes cuisait toujours dans le four de la cave. La dame non plus elle a pas posé de questions à moi et Cécile alors que pourtant c’était mon anniversaire. Elle a préféré rire avec Papa et ma belle-mère des gens pauvres qui font des enfants pour gagner plus d’argent et elle a dit aussi qu’elle gardait des enfants comme une famille d’accueil quoi mais que comme ils avaient pas eu le bon modèle de leurs parents ils faisaient rien de leurs journées comme qui dirait que c’était des fainéants et moi je me suis dit que j’avais eu de la chance que Papa soit un gros travailleur pour me donner le bon modèle sinon j’aurais aussi été un gros fainéant et un moins que rien et peut-être qu’on aurait ri de moi sur la terrasse et ça m’aurait fait de la peine je pense alors avec Cécile on est allés vérifier la cuisson du gâteau aux carottes pour pas avoir trop de peine. Après la dame elle a dit qu’une fille qu’elle gardait qui avait quinze ans une métis elle avait quatre ans d’âge mental et que comme tous les martiquinais elle ne faisait rien elle laissait les serviettes trainer dans la salle de bain alors qu’elle avait quinze ans quand même et la dame elle a dit heureusement qu’elle a le sourire ça compense et moi je me suis dit pourtant mes cousins des fois je les ai vus laisser trainer leurs serviettes dans la salle de bain et moi aussi des fois je l’ai fait alors est-ce que je suis peut-être martiniquais aussi je me suis demandé. En plus Cécile elle a une de ses meilleures amies elle est martiniquaise et c’est pas du tout une fainéante alors à un moment avec Cécile on s’est quand même demandé si la dame elle racontait pas que des conneries et maintenant cher journal je pense que si que la dame elle racontait rien que des conneries mais c’était comme si que personne s’en rendait compte sur le moment, c’était bizarre. Du coup avec Cécile on est allés voir où en était la cuisson du gâteau aux carottes et cette fois-ci il était prêt.
Après on s’est installés sur la grande table du salon pour manger les gâteaux et on a pris des photographies de moi qui souffle les bougies et des photographies de groupe avec Papa et ma belle-mère et avec Cécile aussi et on a goûté tous les gâteaux et ils étaient délicieux. On a trinqué et la dame elle posait toujours pas de questions à moi et à Cécile elle a préféré parler avec Papa et ma belle-mère d’un vieux expert comptable qui maintenant a tout perdu parce qu’il a fait des affaires pas nettes mais avec Cécile on s’embêtait parce que on s’en fichait de l’expert comptable c’était chiant et depuis que la dame elle était arrivée on avait pas parlé alors on commençait à en avoir un peu marre de rien dire comme ça et d’écouter la dame dire que des trucs négatifs et des conneries sur des gens qu’on connaissait même pas alors que c’était mon anniversaire et que c’était la fête.
Après la dame et Papa et ma belle-mère ils ont dit c’était mieux avant et avec Cécile on a dit que quand même c’est bien aussi aujourd’hui. La dame elle a dit que les jeunes avec leurs tablettes ils se rendaient même pas compte de ce que c’était la vie sans voiture et sans télé et moi je me demandais si elle se rendait compte qu’il y a des milliers d’années elle aurait même pas été considéré comme un chien mais à mon avis je pense pas. Ensuite j’ai dit à Papa qu’on était bourgeois et il m’a dit non on n’est pas bourgeois et j’ai dit si quand même un peu vu qu’on a une grande maison et un 4x4 et une moto et que ma belle-mère elle a des robots de cuisine qui coûtent mille euros mais Papa il disait non on est pas bourgeois alors à la fin j’ai dit d’accord vu que c’est mon Papa il sait mieux que moi je pense la vérité et la dame elle a conclu en riant que les bourgeois ils seraient pas contents de savoir que nous on se croit en être. Après Papa s’est moqué comme j’avais dit qu’on était bourgeois et Cécile a voulu m’offir mon cadeau mais j’avais le coeur un peu agité à cause de la discussion avec Papa et qu’il se moquait de ce que j’avais dit alors j’ai dit à Cécile d’attendre un peu que je me calme pour m’offrir son cadeau et ma belle-mère ça l’a énervée et elle a dit ça va pas faire comme la dernière fois et elle est partie dans la voiture et je me suis retrouvé tout seul à table avec Cécile parce que la dame aussi elle était partie et ma grand-mère et Papa aussi. Après Papa est revenu tout seul et il m’a dit j’ai pris exprès ma journée pour venir et j’ai pensé heureusement vu que c’est mon anniversaire et que je l’ai fait aujourd’hui juste pour que vous soyez là tous les deux toi et ma belle-mère et après Papa il m’a dit que j’avais beaucoup de problèmes avec le ton de ma voix et que ça mettait une mauvaise ambiance et des tensions et la preuve ma belle-mère elle était partie.
Après avec Papa on a discuté dans le salon et j’ai pleuré et Papa il m’a expliqué que j’avais plein de problèmes et au bout d’une heure Papa il m’a dit que ma belle-mère elle attendait dans la voiture depuis une heure et qu’il était temps qu’il parte et il m’a laissé malheureux dans la maison. Mais c’était normal vu que ma belle-mère elle était toute seule dans la voiture depuis une heure et qu’elle avait même pas de livre pour s’occuper, et même pas la radio, la pauvre. Après avec Cécile et ma grand-mère on a fait un câlin et ça m’a bien consolé et Cécile m’a offert des beaux cadeaux avec des arbres et des dessins et je suis content que Papa et ma belle-mère et la dame les aient pas vus sinon la dame elle aurait encore dit que des trucs nuls sur mes cadeaux vu que toute la journée elle a fait que dire des trucs nuls sur tout le monde. La prochaine fois moi aussi je vais m’inviter à son anniversaire à la dame et parler mal tout le temps que de gens qu’elle connaît pas et on verra si elle sera contente de son anniversaire mais à mon avis je pense pas même si elle a des beaux cadeaux.
Après avec Cécile on a regardé la télé et on s’est couchés et je me suis endormi mais pas très longtemps. J’ai pensé : j’espère être vite grand pour plus mettre en colère Papa à dire des bêtises et pouvoir rire aux histoires de la dame avec les martiniquais fainéants et les gens pauvres mais en fait riches parce qu’ils ont plein d’enfants et aussi pour pas me retrouver tout seul à la grande table du salon à la fin de la journée de mon anniversaire. Pourtant toute l’année j’avais travaillé très fort et je pensais que cette fois j’aurais été grand. Après j’ai pensé : peut-être que quand je serai grand Papa sera mort et peut-être que c’est seulement quand Papa sera mort que je serai grand j’ai pensé, et puis je me suis levé et la journée a commencé.
Nous mourons tous les jours, nôtre vie s’altere à tous momens, & cependant nous croyons estre immortels. Le tems que j’employe à dicter, relire, & à corriger ce que j’écris, est autant de retranché sur ma vie. Autant de traits de plume que donnent ceux qui écrivent sous moy, sont autant de momens qui sont rabattus sur mes jours. Nous écrivons, nous faisons des réponses : nos lettres passent les mers ; & les vagues que le vaisseau qui les porte excite en fendant les eaux, sont comme autant de momens de nos vies qui s’écoulent. L’unique avantage qui nous reste, c’est de demeurer unis les uns avec les autres par l’amour de Jesus-Christ.
Derrière nous, sur la terrasse, un couple se sépare, et la jeune femme pleure (fume une cigarette).
Vacances.
Saccage : L’Outrenoir, par Camille Cloarec, dans Le Matricule des Anges.
« J’ai vingt-quatre ans, mais aux yeux des gens que j’aime mon image passée m’est déjà presque douloureuse, intolérable, je suis enclin à la cacher, j’ai peur qu’ils aiment l’image et qu’ils s’y arrêtent. » — Hervé Guibert, L’image fantôme.
J’ai regardé aujourd’hui deux films de Christopher Nolan que je n’avais pas vus et dont on m’avait vanté les mérites : Memento, et Le Prestige. Ces deux films m’ont amené à réfléchir au principe de chute, de dénouement. Memento est un excellent film, dans sa construction particulièrement, et dans sa résolution. Heureusement, le scénariste n’a pas axé sa fin uniquement sur une schizophrénie possible du personnage principal, mais davantage sur une habile manipulation : le personnage principal est conscient de ses troubles mentaux et, pour se libérer d’une culpabilité dévorante, choisit de s’inventer un homme à tuer (peut-être un nouveau parmi des dizaines). Ainsi, nous acceptons de nous être laissés tromper par la narration (volontairement dirigée vers un faux coupable) pour nous soulager ainsi que le personnage ; et c’est cela qui rend toute la quête, et toute la résolution, aussi fascinante.
Le Prestige, à l’inverse, me semble beaucoup plus pauvre dans sa conception, et pour une raison qu’un personnage dénonce lui-même au cours du film : la divulgation du secret.
Je résume : deux magiciens rivaux, Borden et Angier, s’affrontent durant l’intégralité du film, jusqu’à arriver à un point de frustration : l’un comme l’autre ne comprennent pas les tours de magie majeurs de leur concurrent. Ces tours ont un méchanisme similaire : une illusion de téléportation. On rentre à un endroit, et on ressort comme si de rien n’était cinquante mètres plus loin, en une seconde. À la fin du film, Angier meurt lors d’un de ces tours, qui râte, et fait condamner Borden à la pendaison pour son meurtre. Seulement (stupeur !) Angier n’était en réalité pas mort, et vient narguer Borden en prison (lui enlevant même, comble de la cruauté, la garde de sa fille). Borden est pendu. Angier, alors seul chez lui, se fait tirer dessus par un homme, qu’on croit être Borden : il lui ressemble trait pour trait. Cet homme n’est pourtant pas Borden, mais son frère jumeau, Fallon. Borden et Fallon se grimaient alternativement et se faisaient passer l’un pour l’autre. Angier comprend alors le secret du tour de Borden : ils étaient deux ; quant à Borden, il refuse de comprendre le secret du tour de Angier. Celui-ci était que Angier se clônait et atterrissait dans une machine à l’autre bout de la salle, grâce à une invention électrique du savant Tesla, puis noyait son double immédiatement dans un large bocal cadenassé dissimulé sous la scène.
Bien, ce récapitulatif était certes laborieux mais nécessaire. Cette multiplication des pirouettes scénaristiques montre d’ailleurs à mes yeux le peu de mystère et d’intelligence que possède ce scénario. Un personnage dit donc, au milieu du film : le secret, lorsqu’il est habilement dissimulé, impressionne tout le monde mais, une fois dévoilé, déçoit par sa simplicité. Le même rouage ici se met en place : tant qu’on assiste à la résurrection étrange de Angier, tout est de l’ordre de la magie. Mais dès qu’à l’écran nous sont révélées les astuces (clonage, gémellité), tout s’effondre. Le scénariste ne respecte pas cette précaution essentielle : il place sa résolution dans l’éclaircissement, et non dans l’effet. Car à ce jeu, pourquoi ne pas inventer un triplé, et finalement une armée de clônes, ou un immortel, ou des paradoxes temporels, etc. ? J’y vois des effets de manche, couplé d’une difficulté à conclure. Je me fiche de savoir comment il a fait, je veux l’effet produit par rapport à la situation mise en place. J’avais compris le rapport de force, la rivalité horrible, qui pousse à mimer sa mort, à tromper jusqu’aux limites humaines, à partir du moment où il ressuscitait comme par magie, justement. Les dix minutes suivantes nous expliquant quel était son dispositif pour être meilleur que l’autre, puis finalement non, c’est du bavardage, de la faiblesse. L’important n’est pas comment, mais jusqu’où.
(Le principal problème de Philippe Vilain est qu’en fait il ne connaît absolument pas son sujet, n’a aucune vision de la littérature contemporaine, brille par son ignorance, comme il y a quelques années Montety s’indignait de la présence de Marie Cosnay dans une anthologie, car, comme il le disait en effet parfaitement : mais enfin, qui est Marie Cosnay ? Comme tous les réactionnaires, Vilain ne s’attaque qu’à une frange du secteur du livre qui a toujours existée et qui existera toujours ; il frappe à côté ; de manière très ironique, d’ailleurs, il se frappe lui-même, son éditeur étant un des plus ardents commerçants de cette littérature qu’il déteste et qui le chagrine, une littérature de merde, comme on pourrait s’aventurer à la qualifier ; Pour comble : il trouve que Serge Joncourt écrit des livres formidables ; à partir de là, que voulez-vous argumenter…)
(Une constante, donc : les défenseurs du style ont toujours des goûts de chiotte.)
Dans mes écrits, il y a souvent des symboles et des scènes qui me dépassent, dont je ne comprends pas la signification, mais qui se suffisent à mes yeux par le simple fait qu’elles existent, que je les aie inventées, mises en place.
Avant-hier, 200 morts dans des attentats à Baghdad, d’une menace qui nous concerne tous ; aujourd’hui, le métier de caviste fait les gros titres du journal télévisé.
Il est important de ne pas oublier ce que sont mes Relevés en premier lieu : un bloc-notes.
« Les anciens mots toujours déjà prononcés se répètent, racontent toujours la même vieille histoire de siècle en siècle, reprise une fois de plus, et toujours nouvelle… »
La ville fond a parfois réellement des logiques de jeu vidéo. Elle fait prendre différents chemins, à partir de situations sensiblement ou parfaitement les mêmes, mais ces chemins se trouvent souvent être des impasses. Si bien qu’une fois au pied du mur, il n’y a plus qu’à se laisser mourir et repartir depuis le dernier check-point ; trouver alors encore un autre chemin, une autre voie, vers le but final. C’est une dynamique par l’échec, par la reprise. (Et parfois, comme dans tout jeu vidéo, il y a des bugs, et des retours aléatoires, et des textures déformées.)
Ma grand-mère me raconte : un buraliste du pays de Trégon possédait, à l’un des feux rouge de cette même commune, un bar habilement nommé Le Feu rouge, qui s’est trouvé incendié et reconstruit par deux fois ; le buraliste l’a finalement transformé en restaurant et l’a installé de l’autre côté de la rue : il vient de se faire cambrioler. J’te jure, me dit-elle, y a d’quoi s’dire : mais merde !
« Wallon s’en rend compte à présent : depuis qu’il est entré dans cette rue provinciale, à l’écart de tout trafic, il n’a plus rencontré âme qui vive ni entendu quoi que ce soit, sauf par instant le crissement de sa propre chaussure contre une aspérité du sol. » — Alain Robbe-Grillet, La Reprise.
J’ai toujours une réserve pour trouver des noms à mes personnages. À la fois car c’est une science dans laquelle je suis piètre savant, ensuite car ils n’ont souvent aucun intérêt dans mes intrigues. Ils peuvent certes fonctionner comme de bonnes béquilles rythmiques, mais je préfère m’en passer.
J’entretiens un rapport compliqué avec les lieux réels, que ce soit les villes, ou les pays. J’aime les utiliser, les arranger, mais déteste, enfin, me trouve emprisonné, dès qu’il s’agit de les rendre nommément. Quand je vois, par exemple, Bernhard fustiger l’Autriche, je me demande quel positionnement par rapport à sa patrie il faut construire pour la distancier à ce point, mais surtout pour la comprendre et la qualifier. Je ne sais pas ce qu’est la France, je ne sais pas comment est le peuple français, hors les habituels préjugés, les habituelles images d’Épinal, qui sont de peu de valeur, et surtout de peu de vérité (la vérité est-elle la question ?). D’où mon impossibilité à utiliser par exemple Lamballe, ou Matignon, ou Rennes, dans certains travaux de fiction, car je me sentirais obligé de placer correctement et les rues, et les fleuves, et les lacs, et les places, et chaque arbre, et chaque banc, et c’est épuisant, et je n’y trouve pas mon compte, ma poésie.
Ce soir, Yves Bonnefoy est mort. Je n’ai rien lu de lui.
« En même temps, il désigne de la main une grande baie, au cinquième étage, où, derrière les rideaux de tulle transparent, une silhouette d’homme se découpe en noir sur le fond lumineux, regardant au dehors l’avenue déserte, avec seulement un vieux taxi rangé au bord du trottoir, le chauffeur courtois qui referme la porte sur le client qui vient de s’installer à l’arrière, puis qui monte à son tour sur son siège, à l’avant, démarre sans trop de mal, et s’éloigne à une allure de pousse-pousse. » — Alain Robbe-Grillet, La Maison de rendez-vous.
il entre dans la pièce et il entre dans la pièce et remarque le carrelage noir et blanc et il entre dans la pièce et remarque le carrelage et roule sur le côté et saisit le fusil et tire et il entre dans la pièce et roule sur le côté sans s’attarder sur le carrelage et saisit le fusil et tire sur le tueur et le tue et s’avance dans le couloir et s’attarde sur le carrelage toujours noir et blanc et se penche sur le corps du tueur et il entre dans la pièce et saisit le fusil tout en roulant sur le côté et tue le tueur et court dans le couloir et se fiche parfaitement du carrelage et arrivé au niveau du corps se cale derrière une paroi et attend et soudain se rélève et tire sur l’autre tueur et il entre dans la pièce et sort un couteau et en ligne droite va le planter dans le tueur et il entre dans la pièce et roule en avant et plante le tueur au couteau et roule en arrière et se saisit du fusil et avance jusqu’au croisement et toujours caché tue le second tueur et lance son couteau sur le troisième et avance dans le second couloir et récupère des munitions sur le corps du second tueur et se méfie de l’absence d’autres tueurs et il entre dans la pièce etc.
L’arrivée des technologies a toujours eu un effet en deux temps sur la littérature. D’abord, les moins habiles s’emparent des objets qui, à vrai dire, sont de peu d’importance, et placent leurs personnages devant des ordinateurs, tapant sur des claviers, ou dans des voitures extrêmement modernes avec nombre de fonctionnalités inutiles, toujours ayant à l’oreille un téléphone dernier cri, et des costumes de marque, et des villas au bord du Pacifique. Il est facile de dépeindre la société dans ses changements matérialistes, car ils n’amènent que de mineures modifications de moeurs, et quelques descriptions honnêtes, qui étaient celles des premiers paquets de cigarette, ou des premières automobiles. Ce que fait Proust avec le téléphone, ou Butor avec le train, voilà les résultats de réflexions abouties à propos de la narration. De même l’informatique et les jeux vidéo amènent leurs logiques, leurs ruptures. Il ne faut pas dire : Regardez cet adolescent rivé à son écran ! Et cette manette aux nombreux boutons ! Comme il vit dans un monde parallèle ! Comme il est loin de mes vieux jouets en bois ! Il faut être le jeu vidéo lui-même, être ce monde parallèle, être cet univers où parfois les graphismes déconnent et où l’on peut mourir des centaines de fois sans aucune incidence réelle.
CAR LE CIEL! C’EST LE FEU!
alors je me suis dégagée j’ai saisi le couteau sur le plan de travail et j’ai frappé au couteau dans son visage et il a hurlé pourtant j’ai continué le couteau bientôt partout sur son corps et toujours je le plantais et je le dégageais de sa chair et plus je le dégageais plus il hurlait bientôt le carrelage est devenu intrégralement rouge à cause du sang qui s’était déversé de toutes ses plaies que j’avais faites au couteau et ses hurlements résonnaient partout bien au-delà de la cuisine bien au-delà de la rue alors j’ai pris le chiffon et je l’ai coincé dans sa bouche et il hurlait toujours et plus il hurlait plus j’appuyais le chiffon dans sa bouche et j’ai crevé ses yeux pour qu’il ne me voie plus il a hurlé quand j’ai crevé ses yeux il n’était plus personne il ne voyait rien je l’ai abandonné sur le carrelage rouge le couteau à côté je ne me suis même pas enfuie j’ai attendu dans la chambre des journées entières personne n’est venu un jour quelqu’un est venu je suis descendu ouvrir évidemment quelqu’un a vu aussitôt le sang l’odeur je ne sais pas si on m’avait jugé si on m’avait traduit comme ils disent mais qui peut me traduire on aurait dit de moi tu es la meurtrière mais qui peut dire ce qui s’est produit avant qu’il ait fait de moi la meurtrière qui peut dire ce qu’est le monstre avant d’être créé ?
Dans le train, à côté de moi, il y avait cette place vide qui, parmi une dizaine d’autres places vides (c’est-à-dire toutes celles du wagon, possiblement même du train dans son intégralité), n’était rien, car elle était constituée du même vide, de la même absence de passager que toutes les autres places. Mais, une fois la totalité de ces places occupées, une fois les voyageurs progressivement installés, celle à côté de moi, toujours vide, recelait la potentialité, la possibilité d’une présence, conditionnée par ma propre imagination, et le moment de la journée, et tour à tour elle prenait une infinité de formes, de contours possibles, elle était la propriété du monde entier en puissance. Si bien qu’en gare du Mans, lorsque enfin l’inconnu prit forme (et peu importe qui : la déception est là quoiqu’il arrive, car on attend toujours autre chose), s’installa là où il n’y avait rien, je m’absentai et dans la rêverie alors me suis libéré.
Moi aussi, j’aimerais être consacré par le jury d’un opérateur téléphonique !
Saccage : De la destruction créatrice, par Ulysse Baratin sur En attendant Nadeau.
« des couples d’hommes pas sur les premières plages, sur les dernières où les dunes se modifiaient au gré des marées, si je me trouvais avec eux je creuserais un trou dans le sable et au fond du sable encore du sable et au fond du fond du sable encore et toujours du sable de la même façon qu’au fond de la peur encore de la peur et au fond du fond de la peur une voix » — Antonio Lobo Antunes, Mon nom est légion.
Je me suis vu, une fois, sincèrement, je ne m’y attendais pas, je me suis croisé dans la rue, j’avais la même allure que moi, et je marchais du même pas, en tout point semblable j’étais à celui que je voyais, et qui était moi. Je n’ai aucunement eu besoin de parler car il savait parfaitement ce que j’allais dire, le disant lui-même, lui étant moi, et sachant donc ce que je dis comme ce que je pense, ainsi ce qui est là. Il n’y avait donc aucune surprise pour lui à me voir sachant que je serais là, et lui de même, me croisant peut-être volontairement et non, comme je le supposais, par hasard, lui sachant tout de moi quand moi rien, ce qui lui donnait un avantage indéniable pour la suite, que lui connaissait, et que moi non. Je me suis souvenu, et là peut-être lui de même, ne l’avoir jamais croisé, c’est-à-dire pas vraiment souvenu puisque de souvenir, il n’y en avait pas, puisque je ne l’avais jamais croisé, et que donc, conséquemment, ainsi. Bien. Il se trouvait donc là, ne disait rien, comme moi non plus, comme moi aussi, et donc patientait, je crois, car quoi d’autre, sinon patienter, au milieu de la rue, quand tous les commerces sont fermés, sans être pourtant la nuit, ce qui aurait rendu la situation glauque, alors qu’elle ne l’était pas, en aucun point, pour moi en tout cas, pour lui, je ne sais pas, je ne pense pas non plus, sachant comme moi cela ne m’inquiétait pas, et lui sachant tout de moi, logiquement. Il n’a pas tenté de me serrer la main, et moi non plus, ne le voyant pas la tendre, lui déjà peut-être ne la tendant pas car sachant comme je n’allais pas moi-même la tendre, bien qu’il ne l’ait pas tendue, ce qui rend cela, somme toute, caduque, disons. Voulait-il me dépasser, il l’aurait fait, bien sûr, je l’aurais laissé, il avait tous les droits sur moi, et moi aucun sur lui, car ne pouvant présumer chez lui aucune animosité, lui-même sachant tout le bien que je pensais de lui, mais en pensais-je vraiment, cela, à définir, à préciser, plus tard, lorsque seul à nouveau, sans la pression qu’il met sur mes épaules, je serai capable de juger de la situation en son intégralité, posément, disons, enfin seul. Alors, tentons, il est là, ne fait rien, comme attendu, de s’écarter, de m’écarter, de lui laisser le passage libre, en changeant de trottoir pourquoi pas, attention à la route, la circulation est dense, et mon esprit embrouillé, et saurait-il en profiter pour aller son chemin, ouf, il n’est déjà plus là.
J’ai souvent l’idée, fausse je suppose, que si je m’amuse à écrire, alors ça n’a pas de valeur poétique. L’écriture comme labeur, douleur : préjugé dont je ne me sors pas.
Saccage : un nouveau bel article, par Hugues Robert, de la librairie Charybde.
Après manger la fille m’a dit : La fête foraine s’est installée sur la digue. On pourra y aller ce soir. Comme elle voulait ranger la maison avant de partir pour la fête, j’ai été me promener sur la plage. La mer s’était retirée. J’ai vu du sang sur le sable alors j’ai suivi les traînées jusque derrière les rochers. Il y avait là une jeune femme avec un trou ensanglanté au milieu du front, et des giclées pourpres sur son chemisier. Ses yeux avaient basculé en arrière et une large surface laiteuse parfaitement lisse remplaçait sa pupille. Aucun couple ne se touchait entre les rochers. J’ai levé la tête vers la Pointe de la Garde ; un homme à contre-jour semblait m’observer. Je n’ai pas pu le détailler à cause du soleil qui m’éblouissait. De très loin j’ai entendu la fille m’appeler. J’ai laissé la jeune femme en proie aux goélands, et l’homme m’a suivi le temps que je disparaisse à l’angle d’un promontoire.
La première phrase de La ville fond est : C’est sous le soleil pourtant rare du mois d’octobre que la ville s’était mise à fondre. Amusé de découvrir, en entamant la lecture de Tango de Satan en début de semaine, qu’il s’ouvre ainsi : Un matin, à la fin du mois d’octobre, peu avant que les premières gouttes des longues et impitoyables pluies d’automne commencent à tomber sur le sol craquelé [.]
À propos de Saccage (encore) :
- Le monde saccagé des carcasses, par Alain Nicolas dans L’Humanité.
- Le livre étrange, par Jean-Philippe Cazier sur Diacritik.
- Un article par Lou Darsan sur son blog.
Alors que je m’affairais dans la cour, la fille est venue me voir. Elle était contente car sa grand-mère était rentrée. Elle m’a dit : Tu peux venir la voir si tu veux. On est montés à l’étage et la fille a ouvert la porte de la chambre. J’ai senti une forte odeur de moisi. Sa grand-mère était allongée sur son lit, les bras en croix sur sa poitrine. Elle n’était pas rentrée car elle avait toujours été là. Peut-être depuis le jour de mon arrivée sa grand-mère moisissait sur le lit de la chambre. Les volets n’avaient pas été ouverts. Le papier peint se décrochait çà et là ; l’eau s’infiltrait par une extrémité de la fenêtre. D’étranges insectes suçaient ses plaies ; une nuée de mouches s’encombrait autour du lustre. Sur ses bras la peau s’était putréfiée et je voyais les os blancs. Déjà sa robe de chambre semblait ne faire qu’un avec les draps du lit. La fille m’a dit : Il ne faut pas la réveiller, elle est épuisée par son travail au marché. Elle m’a dit : Demain on pourra revenir la voir, elle sera contente. Puis la fille a fermé la porte et est redescendue dans la cuisine comme si de rien n’était. Je suis ressorti dans la cour. La brume persistait. J’ai fait le tour de la maison et me suis arrêté sous la fenêtre de sa grand-mère. J’ai saisi une pierre et l’ai jetée contre la fenêtre. Elle a rebondi sur un carreau avant de rouler à mes pieds. Puis j’ai fait demi-tour.
Ce matin, la boulangère m’a fait cadeau de cinq centimes.
« Elle ne parvenait pas à imaginer ce qui était arrivé au docteur, le seul homme qui l’avait veillée toute une nuit en épongeant son front couvert de sueur, que s’était-il passé pour que maintenant elle soit presque obligée de se battre pour l’empêcher de la bousculer, mais elle ne pouvait pas lâcher le bas de son manteau et elle n’abandonna que lorsqu’elle vit qu’autour d’eux — brusquement — tout se cabossait, s’étirait, elle eut beau lutter pour retenir le docteur, il n’y avait plus rien à faire : elle regarda, épouvantée, le sol se fissurer derrière eux et elle le vit — le docteur — tomber au fond du précipice. » — Laszlo Krasznahorkai, Tango de Satan.
Finalement la nuit est tombée et les couples sont partis. Le sol de la forêt a absordé toute l’eau de la pluie et du lac mêlées. Il y avait tant de canettes et de mégots déposés par la décrue qu’on aurait dit une déchetterie. J’ai avancé parmi les arbres pendant que la fille se baignait. J’ai bu la fin d’une canette pleine de terre meuble et de cendres. Le sol avait parfois conservé l’empreinte des corps. C’était la première fois que je voyais le lac déborder. J’espérais que ça ne se reproduise pas. C’était sans doute à cause de la montée des eaux qu’il y avait eu autant de couples dans la forêt. Sans que je m’en rende compte, la fille m’avait rejoint. Elle m’a dit : J’ai nagé jusqu’au barrage. C’est bizarre, il y avait des hommes avec des casques de chantier qui discutaient. Elle m’a dit : S’ils font sauter le barrage, il n’y aura plus de lac. Elle m’a dit : Peut-être qu’ils ne veulent plus que les couples se touchent dans la forêt, et que la forêt devienne un marais. On ferait mieux de rentrer. On a marché jusqu’à la maison de sa grand-mère. Une brume épaisse stagnait dans la cour. J’ai entendu des coups de feu qui venaient de la plage. Quelque chose arrive, je me suis dit.
« Il se trompait, affirma-t-il à quelques pas de sa maison, quand il jugeait que le fondement de la réalité était l’éternelle dégradation, puisque cela revenait à affirmer avec force qu’il restait des choses positives alors qu’il n’y avait plus rien de positif, et sa promenade l’avait persuadé qu’il ne pouvait en être autrement, et que ce « paysage dans son ultime version », n’avait pas perdu son sens mais avait toujours été dénué de sens. »
Quand je me suis réveillé, la fille regardait la télévision dans le salon. Il n’y avait pas de son mais je voyais un reportage dans la carrière. Les policiers avaient retrouvé le corps incendié et devaient mener une enquête. Il y avait beaucoup de policiers dans la carrière. La journaliste interrogeait des riverains. Ensuite la journaliste a parlé face à la caméra. Je ne savais pas ce qu’elle disait. La fille m’a dit : Ils ont retrouvé le corps. Peut-être qu’ils vont nous retrouver nous aussi. Il faudra se cacher. Elle m’avait préparé à manger. Elle m’a dit : On pourrait aller au lac cet après-midi. J’aurais préféré ne pas y aller à cause de tous les couples dans la forêt, mais la fille semblait décidée. Je me suis assis à table pour manger. Dehors le vent s’était levé. Je me suis balancé doucement sur ma chaise tout en regardant dehors. Sur la plage j’ai vu une femme retenir son chapeau de s’envoler. J’ai fait la vaisselle puis finalement on est partis pour le lac. Quand on est arrivés dans la forêt on a remarqué une pellicule d’eau sur le sol. Il y avait déjà beaucoup de couples allongés un peu partout entre les arbres, et ils se roulaient dans l’eau et les feuilles et la terre humide. On marchait entre les couples et parfois la fille me donnait des coups de coude dans les côtes pour que je les regarde. Elle ne semblait pas décidée à aller jusqu’au lac. Elle préférait rester dans la forêt pour regarder les couples se toucher dans la pellicule d’eau. Le lac n’avait jamais débordé comme ça les années précédentes. C’était sans doute à cause de l’orage. Plus on avançait vers le lac et plus il y avait de couples sur le sol, et plus il était difficile d’avancer. Parfois je butais sur un visage, ou sur un bras, ou sur une poitrine. Les couples se susurraient des choses que je n’entendais pas. Une rumeur malsaine se dispersait autour de moi. Il y avait de l’eau partout et plus rien ne permettait de distinguer le lac. Les berges avaient disparu. La fille s’est déshabillée et a plongé dans l’eau. Ses sous-vêtements flottaient à la surface. J’ai regardé toute cette eau qui n’était pas la mer, et qui n’était plus le lac. Où est le lac ?, j’ai demandé.
« Ce qu’eux bâtissent et bâtiront, le factotum traduisit le gazouillis immédiat et encore plus aigu, ce qu’eux font et feront est mensonge et déception. Ce qu’eux pensent et penseront est complètement ridicule. Eux pensent parce qu’eux ont peur. Et qui a peur sait rien. Lui dit que lui aime quand tout s’effondre. Dans construction il y a ruine. Mensonge et déception sont comme oxygène dans glace. Dans construction les choses sont à moitié faites, dans ruine, les choses sont un tout. » — Laszlo Krasznahorkai, La mélancolie de la résistance.
Le soir la bande est arrivée. On a vu les phares des mobylettes à travers l’ouverture du blockhaus. Elle a dit : Les voilà ! Ils descendaient depuis la digue. Il y avait quatre mobylettes, mais parfois ils étaient assis à deux sur une seule. Ils se sont garés un peu avant la carrière à cause d’une barrière qui empêche les véhicules de passer. Elle m’a dit : Quand ils seront dans la carrière on mettra le feu à leurs mob. Après on a vu la bande s’éloigner vers la carrière, et on est descendus à côté des mobylettes. L’orage n’avait pas encore éclaté. La fille a sorti son briquet de sa poche et de l’alcool de son sac. Elle a aspergé les mobylettes avec l’alcool et ensuite elle y a mis le feu. Les mobylettes ont pas été longtemps avant de s’enflammer. On est remontés aussitôt dans le blockhaus et on a vu la bande arriver vers les mobylettes en flammes et essayer de les éteindre en tapant du pied dessus. Il y en a un de la bande qui s’est fait brûler son pantalon. Il a pas réussi à éteindre le feu sur ses jambes alors les flammes l’ont brûlé lui, et on l’entendait crier et on le voyait courir dans tous les sens. Les autres ne savaient plus quoi faire alors ils se sont enfuis vers la digue. Ensuite il s’est mis à pleuvoir et on a vu les éclairs. La pluie a éteint l’incendie. Le corps s’est mis à fumer, comme quand on verse une bassine d’eau sur des braises chaudes. On a attendu longtemps que la pluie s’arrête avant de sortir. Finalement elle s’est calmée et on a pu sortir du blockhaus. La fille a tapé un peu avec sa batte sur la dépouille fumante. Elle l’a renversée sur le dos avec son pied. Le visage avait complètement fondu. Elle m’a dit : On ferait mieux de partir. La marée était particulièrement haute, parce que même en marchant sur la digue des vaguelettes éclaboussaient nos pieds. On n’avait pas eu besoin de la batte et de la barre. Elle m’a dit : Ça sera pour une autre fois. On a pédalé sur nos vélos dans la nuit. La fille roulait devant moi avec sa batte accrochée dans le dos. La diode rouge à l’arrière de son vélo éclairait la route. Je n’y voyais rien. Devant la lune les ombres des grands arbres bougeaient. Dans la cour de sa grand-mère on a jeté les vélos avec fracas et sur la terre battue et les herbes mouillées et l’odeur de pétrichor la fille s’est allongée sur moi. Dans sa bouche il y avait le goût des mégots et des canettes. Je n’ai rien dit.
La difficulté de renouer avec les impressions simples de l’adolescence.
« Les cheveux des arbres sont touffus, dessinent des monts d’étoffe au ciel. Je me repose d’avoir à tout prix voulu défaire les espaces d’oubli, ces endroits où quelque chose gît, corps ou aveu, puis doucement est cousu dans les draps qui couvrent. Je me repose d’être descendue au pays des ombres gardé par le chien aux têtes multiples. » — Marie Cosnay, André des Ombres.
Après la nuit au lac, on est rentrés chez sa grand-mère. Elle n’était toujours pas là. La fille est partie dans le hangar à côté de la maison, et elle est revenue avec deux battes et des barres de fer. Elle m’a dit : Tu préfères une batte ou une barre ? J’ai pris une barre, et elle a pris une batte. Elle m’a dit : Avec ça, on va les cogner fort les puceaux de la carrière. Elle m’a dit : On ira pas ce matin, ils seront pas là. On ira ce soir plutôt. Comme c’était le matin je me suis allongé sur le canapé du salon. Elle a allumé la télévision et elle a regardé une cassette d’un vieux film en noir et blanc. Dans le film il y avait une très belle femme qui déclarait son amour à un homme, mais l’homme s’en allait en Algérie, et la femme ne le revoyait plus jamais. La fille m’a dit : Ma grand-mère regarde ce film souvent, elle voit les palmiers et la chaleur, elle a la nostalgie. Parfois elle regarde la mer et elle a la même nostalgie. Parfois elle regarde dans le vide. Je me dis : Elle a la nostalgie. Alors je regarde le film aussi pour avoir la nostalgie, mais ça vient pas. Je regarde les choses comme ma grand-mère mais rien vient, ni la nostalgie ni rien, que de l’ennui même. Elle m’a dit : Toi parfois tu t’ennuies ? Ça m’arrive, j’ai dit.
J’étais toujours allongé sur le canapé et je regardais le plafond et j’entendais par la fenêtre les pinsons et les rouges-gorges. J’entendais aussi bruisser le feuillage du grand chêne planté dans la cour, et tous les arbustes secoués par le vent. La fille a fait cuire des oeufs et elle les a mangés à côté de moi. Quand elle a fini de les manger elle a laissé son assiette sur la table basse et les couverts dedans, et elle s’est allongée à côté de moi dans le canapé. On était serrés. Elle me tournait le dos. Un moment elle m’a dit : Tu entends les bruits qui viennent de la fenêtre ? Je crois que c’est la nostalgie. Elle avait laissé la télévision allumée et il y avait de la neige à l’écran. Elle ma dit : Des fois j’imagine que des fantômes sortent de la télé. Après elle s’est levée et elle a passé du temps dans la salle de bain. Je suis resté allongé sans rien faire. Un moment c’est possible que je me sois endormi, parce que sans que je m’en rende compte la télévision s’est éteinte. J’ai pris un bol de céréales dans la cuisine, que j’ai mangé debout, sur le seuil de la porte d’entrée. J’avais les pieds nus sur la pierre au sol, et elle était fraiche, et l’air était lourd, et chaud. Un orage arrivait. La fille est sortie de la salle de bain. Elle avait maquillé ses yeux et ses lèvres, et j’avais envie de l’embrasser. Elle m’a dit : Prends ta barre et ma batte, on va aller à la carrière. Même si c’est pas le soir encore on va les attendre là-bas pour les prendre par surprise. Ils vont chier dans leurs frocs. Une fois il y en a un qui m’a touché un sein sous mon gilet, je lui ai cassé une couille. Il est parti à l’hôpital pendant deux semaines. Depuis ses potes l’appellent le sans-couilles, et il reste à pleurer chez sa mère. On a pris les vélos comme la veille et on a roulé jusqu’à la carrière. Devant nous dans le ciel on a vu les nuages gris et épais qui se rapprochaient. Elle m’a dit : On va se cacher dans le blockhaus pour pas se faire saucer. On a caché nos vélos dans les hautes herbes et on s’est assis dans le blockhaus. L’ouverture dans le blockhaus donnait directement sur la carrière. Elle m’a dit : Tu imagines là ils mitraillaient tout le monde qui arrivait de l’océan, tous les soldats. Elle a fait le bruit des sulfateuses avec sa bouche. Elle m’a dit : Ma grand-mère m’a dit que le lendemain que les soldats sont arrivés la mer était rouge. Après elle a fouillé dans son sac et elle a sorti un pack de bières. Elle m’a tendu une bière mais je l’ai pas prise tout de suite. Elle m’a dit : T’en veux pas ? Si si, j’ai dit.
Quelques lettres de l’immense enseigne pendent au-dessus de l’entrée, menacent à tout instant de chuter sur les clients. Des réfugiés secouent des drapeaux aux balcons, ovationnent l’armée qui défile dans la rue. Personne n’était prévenu. C’est la mise en scène habituelle. Les soldats écartent les piétons, forcent le passage au char et au blindé. Un premier rebelle se fait mitrailler ; ils lui ôtent sa cagoule, les réfugiés couvrent la plaie de leurs cris. Le cortège semble interminable. Alors que deux soldats fusillent l’air de concert, trois avions de chasse fusent à l’horizontale. Les réfugiés applaudissent. Un client se retrouve écrasé par une des immenses lettres tombée au sol ; un pillard dérobe ses affaires. Le convoi achève sa démonstration, les réfugiés rangent leurs drapeaux et disparaissent des fenêtres ; l’immense lettre gise sur le sol ; trois enfants y font leur cabane et gribouillent sur le visage du mort des grimaces hilarantes.
(Dernièrement, je me sens faible face à ma propre langue.)
« Finalement, on le porte inconscient, en nage perdue dans les souvenirs du visage d’Orque-Anne, des trop grands disques autour d’elle, et de son ami Levant. On aimerait le croire ainsi, mais peut-être est-il juste déjà mort. C’est ce corps obscurci et impossible qu’on hisse un peu plus haut que le socle de la sculpture, et qu’on laisse faire des ronds inutiles dans le vide, pendu à la proue du navire de pierre, la statue du second et du quatrième couronnement. » — Fabien Clouette, Le Bal des ardents.
Sous cette grêle brune, son vêtement déjà comme taché de gouttes sales, l’enfant découvre son visage. Elle laisse sa cape et ses empreintes dans la boue, avance ainsi à petits pas jusqu’à la bâtisse en ruines. Un homme se tient assis sur un morceau de mur écroulé ; il regarde l’enfant venir à sa rencontre. La lumière se couche, accentue les ombres du mur et de l’homme, qui s’étalent et s’étendent jusqu’aux pieds de l’enfant, à l’intérieur desquelles elle marche enfin, comme progressivement mangée par l’obscurité, par la nuit qui se fait dans la lente disparition du soleil, dans l’ombrage donné aux pierres. L’enfant tient un seau qu’elle pose devant l’homme. Celui-ci voit comme il est rempli de sable, et demande à l’enfant où elle a trouvé tout ce sable. Elle répond qu’une oasis asséchée à ce sable en son milieu, et qu’il est possible en le pressant très fort entre ses paumes de recueillir un peu d’eau. Alors dans ton sable il y a de l’eau, lui dit l’homme. Oui, mais si je renverse le seau, rien ne s’écoule, répond l’enfant. C’est un miracle, dit l’homme, descendu après une petite impulsion de son promontoire. Peut-être, lui répond l’enfant, et j’en suis la détentrice. Les deux regardent alors vers le ciel : une terrible explosion se disperse silencieusement dans l’espace.
À propos des dégradations sur l’hôpital Necker, dont il était bon hier soir de s’indigner à profusion. On voit distinctement, à 4 min 30, sur une vidéo prise en direct : un homme avec une petite masse, faire quatre impacts à la va-vite dans quatre vitres, sans vraisemblablement saisir quel est le bâtiment auquel il s’attaque (ce qui condamnable), puis être immédiatement arrêté par un autre homme lui disant : Eh, c’est un hôpital de gosses ! Là, un deuxième homme donne ce qui semble être un coup de pied dans une vitre, sans effet. Puis l’attention de l’ensemble des manifestants est détourné de ce lieu, et plus rien ne les y ramènera. Voilà ce qu’en dit la presse : Les casseurs s’en prennent à l’hôpital, Hôpital Necker vandalisé, Les baies vitrées de l’hôpital brisées par des casseurs, L’hôpital Necker, cible des casseurs, L’hôpital pour enfants visé par des casseurs, Le gouvernement condamne les casseurs de l’hôpital pour enfants, etc. Ensuite, on viendra me dire qu’il n’y a pas de manipulation, qu’il n’y a pas de l’amateurisme absolu, dans des faits pourtant si simplement vérifiables, et dans des titres si peu en accord avec la réalité. Enfin, il suffit de regarder un plan de l’hôpital pour constater la place mineure de ces vitres, situées à un endroit isolé, sans chambre ni enfant.
Ce qui en suit (car le symbole est fort : des hommes cagoulés de noir s’en prennent à un hôpital pour enfants) : Le premier ministre souhaite interdire les manifestations. Il y a un monde dans lequel on vit et dans lequel on avance, mais qui n’est aucunement en adéquation avec la réalité. Nous sommes constamment la cible d’un univers mensonger, falsifé, erronné, dans lequel, bien malgré nous, nous vivons, et face auquel nous faisons l’erreur monumentale de nous laisser embarquer.
Je me souviens Michon, dans une interview je crois, je ne sais plus laquelle, parlant d’un livre, je ne sais plus lequel, mais ce détail qui m’avait marqué, quand il avait confié s’être inspiré d’un costume du film Gladiator pour décrire un homme du Moyen Âge, ou peut-être des cavernes, ou je ne sais plus, peut-être dans Mythologies d’hiver, et donc comme inspiration pour l’habit, avec un loup autour du cou, quelque chose comme ça. J’avais trouvé ça particulièrement intéressant. Michon qui regarde le film Gladiator et se dit : ce costume, je le fais mien.
On sait, ou on désire savoir, d’où vient la terre du potier, l’arbre de l’ébéniste, le métal du forgeron ; pourquoi pas les phrases, les mots de l’auteur ?
Rentré à Rennes après dix jours à Paris. Comme si personne n’avait vécu dans l’appartement entre temps. Est-ce qu’Alice passe encore par ici, ou prend seulement un peu de linge avant de repartir chez son ami ? Ou ne prend plus rien du tout, et le lave chez lui ? Et disparaît progressivement de l’atmosphère du lieu. La poussière se dépose, du moisi dans la poubelle, une étrange odeur morte d’humidité et de seigle.
« les yeux fixes, perdus, regardant chaque soir les ombres ramper lentement sur les prés, envahir le vallon, ensevelir l’un après l’autre les bois, les haies, noircir peu à peu l’émouvant profil du coteau découpé sur le ciel, épaissir l’obscurité sous les feuillages de l’allée d’ormeaux, étendant comme un noir manteau le nostalgique et silencieux crépuscule déchiré de loin en loin par l’aboiement affaibli du chien. »
Il faudra, pour tenter de faire comprendre mes influences, que je décompose certains éléments de Saccage. Par exemple l’incipit, inspiré des jeux vidéo en open-world qu’on voit se construire au loin progressivement, comme certains GTA, ou Minecraft. De même que la scène d’ouverture, à la fois forgée d’un texte de Beckett (lequel déjà ?) pour les ténèbres, et de la première cinématique d’Alone in the Dark 2 pour le lieu (hôtel, haie, nuit). Presque, en fait, éclaircir l’intention d’auteur.

Il y a dans ce document des choses écrites puis supprimées, invisibles.
Je viens de lire le premier morceau de cette phrase qui ouvre le prochain roman de Laurent Mauvignier : « La veille, Samuel et Sibylle se sont endormis avec les images des chevaux disparaissant sous les ombelles sauvages et dans les masses de fleurs d’alpage ; […] ». Suis-je le seul à le trouver affreusement bancal ? Ce avec les images des chevaux disparaissant, aux oreilles comme l’ongle qui crisse un tableau.
« à savoir que le droit n’est pas une question de morale ou de justice discutée par des philosophes et appliquée par des parlements ou des assemblées mais, en fait, une simple affaire de conventions et que la seule légalité conforme à la nature des choses consiste à posséder un revolver en face de quelqu’un qui n’en possède pas » — Claude Simon, Les Géorgiques.
Mâcher-recracher est un cours texte écrit à la demande de mes éditeurs, et dans lequel je reviens sur mon ambition démesurée d’écrire. Il y a aussi un extrait de Videodrome, mais finalement je ne vois plus bien son rapport avec ce que j’avais voulu dire.
Claro a écrit une très belle critique à propos de Saccage, et je l’en remercie infiniment. Surtout, à la lecture, ce plaisir intact (comme on en parlait avec Fabien) d’être tout à fait compris, et qui vaut presque tout, je crois.
Il est particulièrement étrange de construire une enquête policière ; à la fois son intrigue, et sa résolution. Ça demande par moments une exigence que je n’ai pas.
Joseph Andras, autre facette du syndrome Catherine Poulain, dans un registre différent. Cette fois-ci, le transgressif, l’insoumis, le révolutionnaire, le discret. Celui qui dit : Je ne parle pas, mais parle. Derrière tout ça, qu’en est-il du texte, presque jamais évoqué ? Des tic-tac tic-tac pour rendre le compte à rebours d’une bombe, ok, je ne sais pas. Les journalistes ont leurs mythes. Peu importe qui on est, on n’y échappe jamais. Surtout, des romans, on aime bien les histoires. Le style, c’est trop compliqué à expliquer.
Le narrateur est en fait une espèce d’amnésique qui, non content d’oublier certains événements, a en plus le malheur de tous les mélanger, sans aucune considération pour leur singularité ou leur place dans le temps (d’où la mort antérieure de certains personnages, dans une suite d’événements pourtant déjà produits).
La ville fond et ce projet sans titre en cours pourraient être des exemples, des mises en pratique, de narrateurs-limites. (Comme les Trois contes de Flaubert, les publier dans le même recueil : Deux glitchs.)
Décidément, des écrivains, on ne sortira jamais du portrait. De Catherine Poulain, dont le roman est apparement sensationnel, on ne nous retrace pourtant que son quotidien dans les alpages, et sa vie passée en Alaska. On en oublie parfois qu’un livre n’est pas qu’une vie. Qu’il n’est même, dirons-nous, surtout pas que la vie de celui qui l’écrit (quand bien même il serait une autobiographie, ce qu’il n’est pas dans le cas présent). Faut-il être absolument funambule, bucheron ou dompteur de lions ?
Une fois les pompiers, les ambulanciers et les policiers partis, une fois la femme, toujours enroulée dans son tapis, allongée sur un brancard, lui-même inséré dans le camion des pompiers en direction de la morgue ou de la police scientifique, une fois la voie absolument libre, Bram et le boucher se précipitèrent vers la baie du port, tenant, l’un par les épaules (Bram), l’autre par les jambes (le boucher), toujours enroulée dans son tapis, le corps sans vie de la femme. Ils avaient marché depuis chez Bram avec ce cadavre enveloppé particulièrement lourd, comme une espèce d’immense et morbide saucisson, se dit le boucher, se cachant durant leur parcours derrière des buissons, ou un bus à l’arrêt, ou un muret de briques, quand la prudence le requérait. Après s’être postés devant l’eau de la baie, dans un coin suffisamment délaissé pour ne pas qu’on puisse trouver tout de suite le corps, et suffisamment discret pour ne pas qu’on les surprenne durant leur méfait, ils accomplirent un mouvement de balancier de droite à gauche, prenant à mesure plus d’ampleur, et à trois jetèrent dans la baie le corps toujours enveloppé, qui s’enfonça dans l’eau progressivement, assez rapidement, en ligne droite, lesté par quelques pierres auparavant savamment accrochées, rejoignant ainsi les profondeurs de la baie pourtant assez peu profonde. Puis, une fois débarrassés de leur fardeau, ils s’assirent côte à côte sur une roche à l’abri d’un beau saule, et contemplèrent calmement l’étendue d’eau en face d’eux. Les lanternes de petits bateaux de pêche s’éloignaient vers le large, comme des flammèches dérivant à la surface de l’eau. Bram alluma une cigarette en se demandant si le feu pouvait se répandre sur l’eau, n’imaginant pas un instant qu’un feu grégeois décimait il y a des siècles de cela toute une flotte militaire à l’exact même endroit. Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?, demanda le boucher. On se cache, répondit Bram, et on attend.
Le mercier, caché à l’angle d’une rue, et qui avait suivi le déroulé de la scène dans son intégralité, c’est-à-dire depuis que Bram et le boucher étaient sortis de chez Bram, et qui vit donc le corps de la femme de Bram enroulé dans un tapis jeté dans la baie, ou du moins devina la présence du corps de la femme de Bram à l’intérieur du tapis, car sinon pourquoi jeter ainsi un tapis vide dans la baie plutôt que de l’emmener à la déchetterie, et pourquoi à cette heure de la nuit, et pourquoi à deux, car sans femme à l’intérieur il n’est sans doute pas si lourd, se précipita vers une cabine téléphonique pour prévenir les autorités compétentes de ce terrible méfait. Il composa le numéro d’un inspecteur dont il avait vu la publicité à la télévision, et qui lui inspirait confiance, et qu’il s’était juré de contacter si jamais ses soupçons quant au meurtre de la femme de Bram par Bram venaient à être confirmés. Après trois sonneries, alors que le mercier scrutait autour de lui afin que personne ne le surprenne, on décrocha. Qui est à l’appareil ?, demanda l’inspecteur, surpris par la mention appel masqué qui s’était affichée sur l’écran de son téléphone. Une femme vient d’être jetée dans la baie, enroulée dans un tapis, dit le mercier, après avoir modifié sa voix à l’aide d’un mouchoir placé devant sa bouche. Je suis au courant, répondit l’inspecteur, les pompiers l’ont transportée à la morgue. Mais qui est à l’appareil ? Le mercier raccrocha aussitôt. Il se demanda comment une femme qui venait d’être jetée dans la baie pouvait déjà se retrouver à la morgue. Il fut désespéré par la réponse de l’inspecteur et, tout en serrant le poing, jura que, lui vivant, Bram et le boucher ne s’en tireraient pas à si bon compte. Puis la pluie se mit à tomber violemment, faisant résonner la cabine et la tête du mercier aussi fortement que si elles avaient été saisies entre deux gongs.
Comment résoudre une enquête lorsque les éléments ne sont pas dans l’ordre ?
« Elle pense que le lac est une chose bien triste où sont plongés les choses qui furent, les sommeils, les petits morceaux de corps, les tout petits morts qu’on ne veut pas laisser passer. » — Marie Cosnay, Noces de Mantoue.
L’inspecteur et son assistant roulaient à vive allure dans la ville en direction du port. L’assistant avait déposé le gyrophare sur le toit de la voiture de l’inspecteur et sa lumière et sa sirène leur permettaient d’aller vite et de franchir tous les obstacles, bien qu’il n’y eut aucun obstacle, bien que personne ne circulât dans la ville, bien que le gyrophare ne servait donc à rien particulièrement. Ils roulaient vite car on leur avait signalé la découverte d’un corps de femme dans la baie, repêché enroulé dans un tapis. L’inspecteur se demandait quel était ce mystère et qui avait pu tuer cette femme et qui était cette femme et pourquoi l’avoir enroulée dans un tapis et est-ce qu’elle ne s’était pas simplement suicidée et si non pourquoi l’avoir jetée dans la baie du port et pourquoi la veille particulièrement. L’assistant avait ouvert une chemise verte dans laquelle il triait ses papiers et qu’il portait toujours sous le bras, et il transmettait à l’inspecteur d’autres éléments qui lui seraient utiles dans le futur et que l’inspecteur écoutait d’une oreille distraite en essayant d’élucider ses questions. L’inspecteur conduisait particulièrement mal et souvent il faisait des détours là où la route était pourtant claire et droite et facile, et il se retrouvait perdu dans la campagne ou bloqué dans une impasse ou en panne sur une bande d’arrêt d’urgence, et il fallait toute la patience de son assistant pour le sortir de l’embarras. L’assistant estimait que l’inspecteur se perdait aussi souvent à cause de toutes les pistes qu’il élucidait en silence et qui l’empêchaient de se concentrer sur son trajet. L’assistant n’ayant pas le permis de conduire, il acceptait cette déviance de l’inspecteur, cette bizarrerie. Aussi car il avait beaucoup d’estime pour le travail et la perspicacité et l’intelligence de l’inspecteur. Cette fois l’inspecteur ne se perdit pas et ils parvinrent rapidement jusqu’au port. D’autres véhicules étaient garés dans le port, comme un camion de pompier, et deux ambulances, et d’autres voitures laissées par les civils durant la nuit, et que l’inspecteur comprit aussitôt n’être d’aucune utilité pour son enquête. Il y avait beaucoup de places libres alors l’inspecteur ne réfléchit pas à la façon de stationner, et se gara donc de la pire des façons, un peu en travers de la route, moitié sur un trottoir, moitié sur la chaussée, bloquant le peu de circulation qu’il y avait à ce moment-là de la nuit. L’inspecteur et son assistant sortirent ensuite de la voiture et se dirigèrent vers là où un petit groupe de pompiers et d’ambulanciers semblait affairé. Ils se faufilèrent entre les rubans et les hommes et les femmes et portèrent toute leur attention sur l’objet de leur présence : une femme morte enroulée dans un tapis.
Après avoir longuement discuté autour du corps, l’inspecteur, les pompiers et les ambulanciers convinrent tous avoir été alertés de la repêche de cette femme par le même appel étrange et anonyme. Le pêcheur ayant découvert le corps est peut-être celui ayant appelé. La logique voudrait qu’il ait appelé étant le premier à avoir découvert le corps, avança l’inspecteur. J’ai déjà interrogé le pêcheur, et il m’a dit n’avoir pas été celui nous ayant appelé, répondit l’un des pompiers. Comment savez-vous qu’il ne vous a pas menti ?, demanda l’inspecteur. Simplement, je n’en sais rien, Monsieur l’inspecteur, lui répondit le même pompier. Simplement, je n’en sais rien. Le ton du pompier sembla étrange à l’inspecteur, qui en tira quelques conclusions quant à l’enquête en cours. L’inspecteur demanda à son assistant à ce qu’on mette le pêcheur en garde à vue comme principal suspect, et lui demanda également dans la confidence à ce qu’on surveille de près ce pompier, second suspect. Le pêcheur fut menotté et emmené au commissariat aussitôt, sans même que l’inspecteur ne l’interroge. Avant d’être embarqué le pêcheur protesta vivement mais on lui signala que selon la procédure tout ce qu’il dirait pourrait être retenu contre lui, notamment les injures, les menaces, et les malédictions, et tout le reste, même ce qui semblait n’être d’aucune importance pour l’enquête, même ce qui semblait n’être qu’un détail. Le pêcheur n’eut cependant que faire de ces avertissements et, avant qu’il ne soit rendu muet par son entrée forcée dans la voiture de police, il continua à proférer nombre d’injures, de menaces, et de détails sans importance pour l’enquête qui pourtant ne manquèrent pas de tomber dans l’oreille alerte de l’inspecteur.
Nikola de l’émission Paludes a très élogieusement parlé de Saccage. Je l’en remercie. Il est possible, pour les intéressés, d’écouter l’émission à cette adresse.
Alors qu’il détaillait le corps de la femme de Bram allongé sous le tapis de son salon, le boucher entendit qu’on sonnait. Il remit le coin de tapis découvert sur le corps de la femme de Bram, et ouvrit à celui qui sonnait. À sa grande surprise, suivit de son plus grand effroi, Bram se tenait sur le seuil de la porte. J’ai un problème, dit Bram au boucher, j’ai tué ma femme, et je l’ai cachée sous mon tapis. Ce que lui avait dit le mercier était donc vrai : la femme de Bram avait bien été tuée, par Bram lui-même. Le mercier, depuis le début, avait parfaitement raison, et le boucher n’avait pas voulu le croire, et à présent la femme de Bram se trouvait sous le tapis de son propre salon, et sans doute même que le boucher l’avait tuée. Il faut absolument que tu viennes, poursuivit Bram, j’ai besoin de ton aide. Le boucher et Bram ne se connaissaient pas si bien que ça, et le boucher se demandait pourquoi Bram se permettait ainsi de le tutoyer, sinon sous le coup de la panique. Il ne lui en tint par rigueur. À cause de la femme de Bram morte sous son tapis, il n’était pas tellement en mesure de lui en tenir rigueur. Le boucher prit donc aussitôt son manteau dans l’entrée et sortit en compagnie de Bram. Sur le chemin jusque chez Bram, Bram exposa au boucher toute l’affaire, que le boucher écouta comme s’il l’entendait pour la première fois, quand bien même le mercier la lui avait contée sensiblement de la même manière un peu plus tôt. Il faisait nuit et la lumière diffuse des lampadaires accompagnait leur chemin. Ils avaient pris des raccourcis en naviguant entre les maisons des quartiers car, selon Bram, il valait mieux éviter les rues principales, où la police avait davantage de chance de les surprendre. Il était suspect de circuler à pied de nuit au village. Rien ne justifiait qu’on circulât à pied de nuit dans le village, et donc la police aurait été vite alarmée par une telle situation : deux hommes marchant de front dans la nuit dans le village. D’autant que ni le boucher ni Bram n’avaient encore eu affaire à la police, et les deux donc la craignaient beaucoup. À une rue de là, au même moment, la police patrouillait dans le village, suite à un appel anonyme étrange leur rapportant la mort d’une femme.
Arrivés devant chez Bram, Bram dit au boucher qu’ils feraient mieux de contourner la maison et de passer par derrière, ou par une des fenêtres de l’étage, au cas où quelqu’un ait piégé la porte d’entrée. Le boucher se demandait bien qui aurait pu piéger la maison de Bram. En faisant le tour de la maison, le boucher remarqua à quel point le jardin de Bram était mal entretenu. Puis il fit la courte échelle à Bram afin qu’il rentre dans la maison par une des fenêtres de l’étage. Celle de la salle de bain, lui avait précisé Bram. Le boucher attendit un moment dehors que Bram vienne lui ouvrir. Décidément, le jardin de Bram était un capharnaüm absolu. Il y avait des outils de jardinage, et des mauvaises herbes, et des pièces de mécanique qui jonchaient le sol un peu partout. On aurait facilement pu se blesser. Il n’aurait pas fallu qu’un enfant coure par ici. Le boucher voyait les fenêtres s’allumer à mesure dans la maison, et pouvait ainsi suivre la progression de Bram à l’intérieur de la maison, jusqu’à la porte de derrière, que Bram ouvrit, et qui donnait dans la buanderie. Le boucher pénétra dans la maison de Bram afin qu’il lui montre le corps de sa femme tuée. Le boucher ne savait pas pourquoi il avait décidé de suivre Bram plutôt que d’aller le dénoncer à la police. Sinon qu’il avait la femme de Bram morte sous le tapis de son propre salon, et qu’il se demandait bien, de fait, quelle pouvait être la femme morte sous le tapis du salon de Bram. C’était un des mystères les plus incroyables auxquels avaient été confrontés le boucher dans sa vie. Il ne voyait d’ailleurs aucun autre mystère survenu dans sa vie qui puisse concurrencer ce mystère-là. Ma vie n’a jamais été particulièrement mystérieuse, songea le boucher. On ne peut pas dire que le mystère ait été la caractéristique principale de ma vie, non. Mon travail de boucher est sans doute la caractéristique principale de ma vie, conclut le boucher. Bram et le boucher se dirigeaient donc à présent vers le salon. À cause de son angoisse, le boucher ne pensait pas tellement à regarder la décoration de chez Bram. Bram et le boucher passèrent devant le vestibule de l’entrée, sans se douter un instant, bien que Bram l’ait pressenti, qu’un piège les y attendait.
Hier, des agents de police ont blessé onze enfants, envoyé trois à l’hôpital.
Tueur à gage, assassin, les petits métiers de demain.
Une fois sorti de chez Bram, le mercier se précipita en courant chez le boucher, traînant derrière lui son énorme valise qui n’en finissait pas de bringuebaler. Bram a tué sa femme !, dit le mercier au boucher, avant même de s’enquérir de la présence d’une quelconque clientèle à l’intérieur de la boucherie. Comment le sais-tu ?, lui répondit le boucher. Il l’a planquée sous son tapis !, dit le mercier. Et qu’est-ce que tu as fait ?, dit le boucher. Rien, j’ai fait comme si je n’avais rien compris, dit le mercier. Mais il faudrait peut-être prévenir la police. À mon avis non, dit le boucher. Déjà, pourquoi Bram aurait mis sa femme sous le tapis ? Pour cacher son crime !, dit le mercier. Elle dormait peut-être sous le tapis, dit le boucher. Ma femme fait ça aussi parfois, ça la rassure. Ah bon ?, dit le mercier. Eh bien oui, pourquoi non ? J’ai bien entendu dire que ta femme dormait avec votre grille-pain !, dit le boucher. Le mercier dut en convenir, la femme de Bram dormait peut-être réellement sous le tapis. Le mercier s’en voulait d’avoir ainsi jugé Bram, de l’avoir pris pour un criminel, lors qu’il n’était qu’un mari attentionné. Le mercier sortit de chez le boucher sans même avoir acheté une tranche de rôti, sans même un pâté. Le boucher n’aimait pas beaucoup le mercier car il le trouvait bête. Peut-être bien Bram a-t-il tué sa femme, se dit le boucher. Peut-être l’a-t-il tuée et l’a-t-il cachée sous son tapis. Puis le boucher songea à sa propre femme sous son propre tapis et se dit alors : Et si ma femme ne dormait pas sous le tapis, et si elle était morte elle aussi ? Et si elle aussi avait été tuée par Bram ? Ou si je l’avais tuée de mes propres mains ? Et qu’elle ne dormait pas car je l’avais tuée et cachée sous le tapis de mon propre salon ? Le boucher était ainsi plongé dans ses pensées qu’il avait complètement oublié la clientèle qui commençait à s’accumuler dans sa boucherie. Bram, de son côté, toujours assis sur son canapé, était bien loin d’imaginer avoir été sauvé de la police par la méfiance du boucher à l’égard du mercier.
Après sa journée de travail, quand le boucher est rentré chez lui, il a surpris sa femme sous le tapis du salon. Il s’est approché et il a constaté que sa femme était celle de Bram.
On était beaucoup sur le bateau. On ne venait pas tous du même endroit mais on s’était tous retrouvés sur le même bateau. On nous avait tous mis sur le même bateau en nous disant qu’il n’y avait que ce bateau pour faire le voyage, et après avoir payé très cher. Je ne sais pas si tous ont payé aussi cher que moi j’ai payé, d’ailleurs je n’espère pas pour eux, car j’ai dû tout vendre pour payer le bateau. Mes parents aussi ont tout vendu pour que moi seule puisse voyager. Et maintenant ils sont très pauvres et peut-être même qu’ils sont morts. La distance à faire en bateau n’était pas si grande, mais c’était un bateau ridicule, et je n’étais pas tellement rassurée. Comme le bateau n’était pas très large et qu’il n’était pas non plus très solide, à la moitié de la distance à peu près je dirais, il a coulé. Tout le monde s’est retrouvé à l’eau, peu importe combien on avait payé avant d’embarquer. Pas beaucoup ne savait nager et même ceux qui savaient nager ont commencé à se noyer. Tout le monde se débattait hors de l’eau et appelait à l’aide, mais personne ne venait. Il y avait beaucoup de remous à cause de tous les gens comme moi qui battaient des bras dans l’eau. Personne n’avait de boué ou de gilet de sauvetage, car c’était plus cher, et personne n’avait les moyens. Pour un gilet de sauvetage, c’était le double du bateau. J’entendais les pleurs des bébés et les cris des femmes et des hommes. Les pleurs des bébés et les cris des femmes et des hommes ne différaient pas trop de ceux de mon pays sur lequel des bombes tombaient. D’une certaine façon, je me sentais à la maison. J’ai distingué des montagnes à l’horizon et je me suis dit qu’on n’était pas très loin du rivage. Je me suis dit aussi que si on ne venait pas nous repêcher rapidement on se noierait tous. On serait des milliers à se noyer après avoir payé très cher pour embarquer sur un bateau. Et ça serait dommage, je me suis dit. Mais c’est comme ça, je crois.
Je suis à la recherche de quelque chose de moi que je n’arrive pas à mettre en mots.
Je ne sais si c’est à cause de la chaleur, mais tout ce que j’écris m’épuise et me dégoûte. Et tout ce que je n’écris pas d’avance me déprime.
Découragement. Échec.
Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon. Pas assez bon.
Je suis descendu jusqu’au lac. Je connaissais un chemin que les autres n’empruntaient jamais, à travers la forêt. Sur le chemin, il y avait des canettes de bière. J’ai bu la fin de l’une d’elles ; ça avait le goût des mégots et de la pluie. Il y avait des feux éteints car parfois je crois des touristes baisent ici. Au lac il n’y avait personne à cause de la nuit, et je me suis baigné. Longtemps je crois, car mes pieds se sont fripés. Je sentais les galets là où j’avais pied, et parfois d’étranges poissons qui me suçaient les orteils. Quand je suis sorti de l’eau, une fille était installée à côté de moi. Elle m’a dit : Parfois je me baigne ici la nuit, comme toi, car il n’y a personne. Et je passe par la forêt, comme toi, pour boire les mégots et la pluie. Parfois je bois dans la même canette que toi pour avoir le goût de ta salive. Elle s’est allongée sur sa serviette, mais elle n’était pas mouillée. Il y avait du vent dans les arbres et la fille m’a dit : Ce sont des pins. Je savais que c’était des pins, mais ça m’a fait du bien de l’entendre le dire. Ensuite la fille m’a dit : Je suis là pour les vacances, avec ma grand-mère. Ma grand-mère habite une des maisons de pêcheur dans la rue du Vieux Passage. Je voyais où était la rue du Vieux Passage et les maisons de pêcheur. Elles donnaient directement sur la plage. Un muret de pierre balisait la route, et parfois il m’était arrivé de m’assoir sur ce muret en mangeant une crêpe. Ensuite j’avais du sucre fondu sur les doigts. Elle m’a dit : À côté de la maison de ma grand-mère il y a d’autres maisons mais elles sont toutes vides, et à l’intérieur parfois je retrouve des souvenirs. Parfois je m’y endors aussi, et ma grand-mère me retrouve le lendemain matin. Il faudrait que quelqu’un habite dans ces maisons, sinon bientôt elles seront détruites. Et toi, elle est où ta famille ? Détruite, j’ai dit.
Quand on est reparti il était très tard, alors elle m’a dit : Viens dormir chez ma grand-mère si tu veux. Je l’ai suivie et sur le chemin on a regardé les feux éteints et elle m’a dit : Les touristes baisent ici parfois. Regarde, il y a des capotes. On a longé longtemps la plage, et on entendait des oiseaux. Elle m’a dit : Ce sont les goélands. On dit qu’ils pleurent ou raillent. Moi je ne sais pas. Elle m’a dit : Tu vois comme la marée est haute. Parfois il arrive qu’elle inonde la cour de ma grand-mère, et parfois elle se retire très loin, ça laisse des bancs d’algues qui puent, et des petits crabes. Si on veut se baigner, on dirait qu’elle est au bout du désert. Chez sa grand-mère il n’y avait pas d’autres chambres pour moi, alors j’ai dormi dans le salon. Elle a ouvert une armoire en bois, et elle en a sorti du linge et des draps. Elle m’a dit : Il n’y a pas de matelas alors tu peux prendre tout le linge et faire un tas si tu veux. Avant de monter dans sa chambre, elle m’a dit : Si tu veux demain on ira à la carrière regarder les touristes baiser. Et on leur jettera des pierres. Elle est montée et je l’ai entendue se déshabiller, les vêtements frottés contre sa peau, son pull qu’elle ôtait par le cou. Elle n’a pas tout de suite fermé sa porte, alors un rai de lumière a éclairé le mur à côté de moi. J’ai vu un tableau avec un grand voilier dessus, et une forte tempête. Puis la fille a éteint la lumière de sa chambre et je n’ai plus rien vu. Une voiture est passée. Les goélands continuaient de crier. Ils pleuraient, j’aurais dit.
Le lendemain matin, j’ai été réveillé par un bruit de vaisselle. Quand j’ai ouvert les yeux, j’ai vu la fille dans la cuisine. Elle m’a dit : Ma grand-mère est déjà partie, alors on va manger tous les deux. Elle m’a dit : Ma grand-mère part tôt pour faire le marché. Comme elle n’a pas de voiture elle doit marcher longtemps. Elle ne vend jamais grand chose. Elle vend du tissu, ou des galets qu’elle peint. C’est très joli, mais les gens du coin n’aiment pas beaucoup ça. Ils préfèrent les maquettes je crois, c’est ce qu’elle me dit. Sur la table il y avait du beurre et du pain, et du jus. On a mangé et pendant qu’on mangeait on n’a pas parlé. Parfois, quand une voiture passait, la fille regardait par la fenêtre. Parfois par la fenêtre elle regardait la mer, quand il n’y avait pas de voiture. Elle m’a dit : Aujourd’hui la mer est belle, on pourrait se baigner. Sauf si tu veux retourner au lac. Non, j’y vais que la nuit, j’ai dit.
Après le petit-déjeuner elle m’a montré la salle de bain et j’ai pris une douche. À un moment je crois qu’elle a regardé dans l’entrebâillement de la porte, mais je ne suis plus sûr. Elle avait laissé la fenêtre ouverte et le bruit des vagues et l’eau chaude sur mon corps. Quand j’ai eu fini de me doucher je me suis séché et je suis descendu dans le salon. Elle m’a dit : Tu as remis tes habits d’hier. Elle a senti mon tee-shirt et elle m’a dit : On dirait que tu sens le lac. Après elle a pris sa douche et elle a laissé la porte ouverte pour que je regarde je pense, mais je n’ai pas regardé. J’ai regardé le tableau avec le voilier et la tempête, et le bruit de l’eau chaude sur son corps. Puis j’ai rangé les draps dans l’armoire et je me suis assis sur le canapé. Il y avait un livre à côté alors je l’ai pris et je l’ai lu un peu, mais je n’ai pas tout compris à l’histoire. Finalement la fille est descendue, elle avait encore les cheveux mouillés, et elle m’a dit : C’est bête si on va à la mer, je vais devoir me les relaver. Elle m’a dit : Attends je prends ma serviette, comme ça on sera mieux sur le sable. Elle est redescendue avec sa serviette et un petit sac de vacances. Elle m’a dit : On débarrassera la table plus tard. On est sortis de la maison et elle n’a pas fermé à clé. Dans la cour il y avait un peu de bazar et des mauvaises herbes. Elle m’a dit : Ma grand-mère ne peut plus trop entretenir la cour et moi ça ne m’intéresse pas. Elle a pris par son anse un seau qui trainait et on a traversé la route pour s’assoir sur la plage. Comme c’était le matin il n’y avait encore personne, alors on s’est mis dans un coin à côté des rochers. On était à l’abri du vent. Elle m’a dit : Si tu veux après on ira escalader dans les rochers. Et peut-être qu’on verra des touristes cachés qui s’embrassent et se touchent. Elle a déplié sa serviette et on s’est assis dessus. J’ai pris quatre galets pour la coincer sur le sable et qu’elle ne s’envole pas. Elle m’a dit : Je viens souvent là, c’est mon coin préféré. Il y a une autre plage où j’allais avant mais ils ont tronçonné un arbre alors je n’y vais plus. L’arbre faisait de l’ombre et j’étais bien à son pied, mais maintenant il n’y a plus ni arbre ni ombre, alors je n’y vais plus. La mer était assez loin. Il ne faisait pas tellement chaud. Une voiture est passée dans notre dos. Elle m’a dit : Les voitures ne s’arrêtent plus ici, ils préfèrent aller à l’autre plage où moi je ne vais plus. Elle a enlevé son tee-shirt et j’ai vu son ventre. Elle m’a dit : Je vais me baigner, tu viens ? J’arrive, j’ai dit.
J’ai regardé la fille avancer sur la plage devant moi. Après j’ai regardé mes pieds dans le sable. Je les ai enfoncés au maximum dans le sable, jusqu’aux chevilles. Quand j’ai relevé la tête je n’ai plus vu la fille. Puis je l’ai vue dans la mer, et puis je ne l’ai plus vue. Alors j’ai enlevé mon tee-shirt et j’ai marché jusqu’à l’eau. Il y avait une démarcation entre le sable sec et le sable mouillé. Le sable sec m’a brûlé la plante des pieds et après le sable mouillé me les a rafraîchies. Mes pieds s’enfonçaient moins dans le sable mouillé mais laissaient des empreintes. Il y avait les empreintes de la fille aussi et j’ai marché dedans pour disparaître. Arrivé au bord de l’eau il y avait des petits coquillages qui faisaient comme des lames sous les pieds. La fille est sortie d’une vague et elle m’a dit : Elle est bonne. Alors j’ai mis un pied dans l’eau mais elle était froide. Elle m’a dit : Trempe-toi la nuque. Je me suis trempé la nuque et mon corps s’est frigorifié. Alors je me suis jeté dans l’eau d’un coup. J’ai nagé jusqu’à la fille et sans que je la vois venir elle m’a enlacé la taille avec ses jambes. Elle m’a dit : Maintenant tu es prisonnier. Puis elle m’a entraîné sous l’eau. L’eau est entrée dans ma bouche et j’ai bu la tasse. J’ai voulu reprendre de l’air car j’étouffais mais la fille m’a maintenu sous l’eau avec ses jambes et elle rigolait je crois. Après elle m’a relâché et j’ai pris une grande bouffée d’air en me frottant les yeux. Je suis sorti aussitôt de la mer et suis retourné m’assoir sur la serviette. Sur la serviette il y avait du sable à cause du vent. Je me suis frotté les yeux encore car ils me piquaient, et je me suis frotté les mollets pour les débarrasser du sable. Après un temps la fille est revenue s’assoir à côté de moi et tout en nouant ses cheveux sur son épaule elle m’a dit : C’était drôle non ? Oui, j’ai dit.
Je me suis endormi et quand je me suis réveillé la fille n’était plus là. Je me suis assis et j’ai regardé autour de moi mais je n’ai pas vu la fille. J’ai regardé la mer et la plage et les rochers mais je n’ai vu personne. Il n’y avait ni la fille ni personne. J’ai marché jusqu’aux rochers et j’ai commencé à en escalader quelques-uns. J’ai avancé un peu et j’ai vu la fille alors je l’ai appelée mais elle m’a fait chut en posant son doigt sur sa bouche. Après, tout bas, elle m’a dit : Baisse-toi. Alors je me suis tu et je me suis baissé à côté d’elle. Elle se tenait cachée derrière un rocher, et moi aussi. Elle m’a dit : Regarde. J’ai regardé par-dessus le rocher et il y avait deux touristes qui s’embrassaient. Elle m’a dit : Je t’avais dit, ils viennent là parfois pour s’embrasser et se toucher. Là ils s’embrassent, et après ils vont se toucher. Des fois il y en a plein en même temps à différents endroits des rochers, on dirait une partouze. Elle a ri tout bas. Moi aussi j’ai ri. Elle m’a dit : Regarde comme il lui caresse le ventre, et les épaules. Regarde il lui embrasse le cou et il la déshabille. J’ai vu les seins de la touriste et la fille m’a dit : Regarde ses seins, ils sont gros. En même temps qu’elle parlait elle sentait ma peau et elle m’a dit : Tu sens le sel. Après je n’ai plus regardé les touristes car ça me gênait. Elle m’a dit : Ça te gêne qu’ils se touchent ? Un peu, j’ai dit.
On a contourné les touristes en escaladant encore les rochers. La fille était devant moi et elle avançait vite. Elle m’a dit tout bas : Regarde là, y en a d’autres. Mais je n’ai pas regardé car je ne voulais pas être gêné encore. Après avoir beaucoup escaladé on est arrivé en haut des rochers, au bout d’une sorte de falaise, et elle m’a dit : C’est la Pointe de la Garde, c’est beau. À l’horizon il y a l’Angleterre, mais c’est loin. J’ai regardé en contre-bas et j’ai vu tous les touristes qui se touchaient dans les rochers. Ça faisait comme un tableau classique. La fille m’a dit : Et là à droite c’est la carrière. On ira cet après-midi. Il y avait du soleil mais aussi des nuages et beaucoup de vent. Elle m’a dit : Tu préfères qu’on rentre par la route ou par les rochers ? Par la route, j’ai dit.
On est passé au milieu d’un quartier, à côté de la Pointe. Elle m’a dit : C’est les maisons des Parisiens. Ils viennent que l’été. Ils arriveront bientôt. Viens si tu veux on peut aller chez eux. Elle a sauté par-dessus une barrière jusque dans le jardin. Sur le portail il y avait écrit chien méchant mais dans le jardin il n’y avait pas de chien. Quand je suis arrivé dans le jardin elle faisait déjà de la balançoire. Je me suis assis sur l’autre balançoire et on a fait le concours de qui irait le plus haut. À un moment je suis arrivé très haut et avec mes jambes j’ai touché les branches d’un cerisier. Puis on a arrêté et on s’est assis dans l’herbe haute. Elle m’a dit : Ça fait du bien ce silence. J’entendais le bruissement du blé balayé par le vent. Les volets de la maison étaient écaillés. Un tuyau d’arrosage serpentait dans l’allée. Elle m’a dit : Toutes les maisons ici sont comme ça. C’est triste. Mais si les Parisiens ne venaient pas, les commerçants seraient pauvres, et plus personne ne vivrait ici. Même pas ma grand-mère. Elle vend beaucoup de sa marchandise aux Parisiens, car ils ont beaucoup d’argent, et ils aiment les petites choses. Toi t’en as des petites choses ? Des souvenirs ? Non, rien, j’ai dit.
On est sortis du jardin et on a continué notre chemin. Il n’y avait pas de trottoir, alors on a marché sur la route principale qui passe devant la maison de sa grand-mère. Quelques voitures nous ont doublés. Elle m’a dit : Ce sont les touristes qui rentrent manger. Il y a des touristes au camping, et des touristes à l’hôtel. J’ai des amis au camping, il faudra que je te les présente. On voyait les voitures arriver très vite face à nous, klaxonner, puis s’écarter. Avant d’arriver à la plage elle m’a dit : J’espère que personne nous aura piqué nos affaires. Sur la plage nos affaires étaient toujours là alors on les a rangées et on est rentrés à la maison. D’un coup il y eut moins de soleil et il a fait froid. Sa grand-mère n’était pas là. Elle m’a dit : Ma grand-mère ne rentre pas déjeuner. Elle rentrera peut-être très tard ce soir, quand on dormira. Dans la cuisine la fille m’a dit : On peut faire une salade. Alors j’ai coupé des tomates, un concombre, et un peu de fromage. Elle a disposé des feuilles de chêne au fond d’un saladier puis versé de l’huile d’olive par-dessus. Elle m’a dit : Avec les légumes, ça nous fera un bon repas. J’ai mis le couvert sur la table du jardin, après avoir dépoussiéré les chaises. Puis j’ai déplié le parasol et l’ai planté dans le trou au milieu. On s’est installés pour manger. Les cheveux de la fille avaient séché. J’ai regardé la pulpe des tomates s’écraser sur ses lèvres, et l’huile couler au coin. J’avais le goût des mégots et de la pluie dans la bouche. Comme je ne mangeais pas elle m’a dit : Tu n’as pas faim ? Si si, j’ai dit.
On a débarrassé la table puis fait la vaisselle. Elle m’a dit : Si tu veux on peut faire une sieste dans ma chambre. On est montés dans sa chambre et elle a fermé les volets. Dans les volets il y avait de petites ouvertures à travers lesquelles le soleil passait. La fille s’est mise en sous-vêtements et s’est allongée sous les draps. Je me suis déshabillé aussi et me suis allongé à côté d’elle et sa peau sentait le chaud. J’ai entendu les vagues et me suis imaginé au lac. Elle m’a dit : Tu peux poser ta tête sur mon ventre si tu veux. J’ai posé ma tête sur son ventre et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé la fille n’était plus dans le lit. Elle n’était même plus dans la chambre. J’ai entendu du bruit au rez-de-chaussée alors je suis descendu. Elle avait enfilé une robe. Elle m’a dit : Prépare-toi, on va aller à la carrière. Je sors les vélos. Je me suis habillé et l’ai retrouvée dans la cour, où elle tenait les deux vélos. Elle m’a dit : Tu me suis, on en a pour un petit moment. On a roulé l’un derrière l’autre pendant deux ou trois kilomètres. On a longé la côte, et des touristes marchaient sur les sentiers des falaises. Elle m’a dit : Il y en a un qui est tombé dans l’eau l’année dernière. Il s’est fracassé la tête sur les récifs. C’est très dangereux, ils n’imaginent pas. Ils veulent prendre des photos et puis finalement ils meurent. Après on en parle dans les journaux, et puis une fois que tout le monde en a bien parlé plus personne n’en parle. On est arrivés dans un village et on a posé nos vélos contre un arbre. Au milieu du village, entre les maisons, il y avait de larges bandes d’herbe, et des cèdres. Il y avait un casino, des restaurants, un supermarché, des marchands de bateaux. Elle m’a dit : Normalement on ne peut accéder à la carrière que par la route, mais moi je connais un autre passage. On s’est avancés dans les fourrés, à travers des fougères et des ronces, jusqu’à une sorte de blockhaus. Elle m’a dit : C’est de la dernière guerre. C’est dangereux à l’intérieur. Il y a des tessons et parfois des clochards. Les clochards viennent là l’été pour la fraîcheur, et pour aller dans la carrière avec les touristes aussi. J’avais des griffures sur les avant-bras. Elle m’a dit : Ne gratte pas. On a continué entre les pins, on marchait sur les épines, et finalement elle m’a dit : Voilà, la carrière. Elle est impressionnante, hein ? Je n’ai rien dit.
D’énormes blocs de pierre entouraient une vaste zone de cailloux. Elle m’a dit : Les camions ne passent plus dans cette partie de la carrière, alors on peut y rester tant qu’on veut. Au bout de la carrière, une sorte de débordement détruit donnait directement sur la mer, d’où s’échappaient des tiges de fer, et des briques. Elle m’a dit : Ça aussi a été bombardé pendant la dernière guerre. Beaucoup des choses qui ont été bombardées n’ont pas été reconstruites. Ma grand-mère dit que c’est la mémoire. On s’est assis les jambes dans le vide. Elle m’a dit : Regarde, des poissons. J’ai regardé au loin et j’ai vu des navires qui avançaient très lentement. Des navires de pêche. Elle m’a dit : Allez, on va pas rester là, on va mater les touristes. On a quitté le débordement pour pénétrer plus en avant dans la carrière. Il y avait de larges tas de sables, de graviers et de pierres, disposés un peu partout autour nous. La fille s’est aussitôt allongée sur un tas de graviers, et je l’ai rejoint. Elle m’a dit : Écoute. J’ai écouté et j’ai entendu les vagues et j’ai entendu des hommes. Elle m’a dit mais j’ai préféré écouter les vagues. Elle s’est avancée un peu sur le tas de graviers pour regarder et moi je suis resté immobile. Elle m’a dit : Tu aurais dû voir, ils en avaient des énormes. Parfois ils crient. On les entend même dans les restaurants de la ville. C’est le plus drôle. Quand on est revenus, il y avait des enfants qui s’amusaient à plonger dans l’eau depuis le débordement. Elle m’a dit : Viens, on va voir qui c’est. Arrivés à leur hauteur, un des garçons a aussitôt embrassé la fille sur la bouche. Pendant qu’ils s’embrassaient un deuxième s’est avancé vers moi et m’a dit : T’es qui toi ? Lucas, j’ai dit.
Un des garçons fumait une cigarette et il me l’a tendue. J’ai fumé un peu de la cigarette et je me suis retenu de tousser. Je n’étais pas très à l’aise et voulais retourner au lac. La fille ne semblait pas décidée à partir, alors je n’ai pas attendu plus longtemps et j’ai fait demi-tour. J’ai entendu les cris qui venaient de la carrière et me suis bouché les oreilles. J’ai couru avec les doigts dans mes oreilles jusqu’à retrouver les vélos. J’ai pris le mien et j’ai roulé au hasard dans la ville. Puis j’ai roulé jusqu’au lac. J’ai laissé le vélo en vrac dans l’herbe à l’entrée de la forêt et j’ai couru encore. J’ai bu une des canettes de mégots et de pluie jusqu’à ne plus sentir mon palais. Je me suis assis à côté d’un feu éteint. J’ai attendu. Je suis allé me baigner. J’ai essayé de me noyer mais je n’ai pas réussi, car je n’étais pas assez lourd. Quand je suis ressorti, la fille était là, assise au bord de l’eau, sur la berge. Elle m’a dit : Si tu es jaloux tu peux m’embrasser aussi. Je l’ai embrassée sur la bouche mais ça n’avait pas le goût des canettes. Elle m’a dit : Si tu veux on pourra dormir ensemble ce soir. D’accord, j’ai dit.
On est restés un peu assis l’un à côté de l’autre à regarder le lac, sans rien dire. Elle m’a dit : Les garçons parfois m’embrassent. Mais ils m’intéressent pas trop. Surtout ceux qui fument des cigarettes, à cause de leur haleine. Toi c’est pas pareil, avec les mégots et la pluie des canettes. Si tu veux demain on retournera à la carrière avec des barres de fer et on tabassera les garçons. Et peut-être qu’on tabassera des touristes aussi. Une barque est passée sur le lac. Le pêcheur à son bord nous a salués. Il a tiré fort sur sa canne à pêche et un énorme brochet est sorti de l’eau. On voyait la silhouette du brochet se débattre dans la barque, pris de convulsions. Elle m’a dit : On reste combien de temps encore ? Toute la nuit, j’ai dit.
j’avançai dans le noir, et les ruelles comme des couteaux, après les chiens encore, leurs maîtres, à me souffler leurs dégueulasseries et l’haleine de vieille pisse, de la vinasse à plastique blanc, et qui me frôlaient face aux murets, parfois aux fenêtres je guettais un regard, et le halo des salons reposait nos visages, inclinait les mains sur mon visage, et les tissus, inclinait la douleur d’être là dans le noir mine de rien
ils me suivaient jusque dans les parcs, et la nuit complètement, la lune autour des pins comme une torche obstruée, ils se mettaient là se reniflaient autour des bancs, moi j’y étais allongé on aurait dit un roi je disais merde aux fous
les wagons de marchandise derrière trois haies trop hautes, et le bruit de la rouille comme l’odeur se mêlaient à la bruine, crachée parmi la pénombre sur les visages et dans les bouches en pleurs, des vierges baveuses, il serait passé un clochard on l’aurait crucifié
la blessure que je traîne, balafré quatre fois, ils ont vissé mon ventre à la matraque, dégénéré qu’ils disaient, vicieux, tous cagoulés, flics je pense, après ils sont partis, même sanction pour mon chien, il a perdu un oeil, trois jours il a vomi du sang
Dans le fond du jardin, des pommiers qui donnaient l’été de minuscules pommes grises à la chair acide, et à la peau comme une douloureuse pellicule, toujours saignant la gencive, les dents éclatées sur le fruit aussitôt jeté dans l’herbe, dans la voracité inouïe des stégosaures à mandibules.
Simon, pour The Paris Review : My project is different every time. To repeat the same things is of no interest.
(Vu Marie à Rennes — au sortir de la salle, immobile et clope aux lèvres, un homme la fixe avec insistance.)
« sensible aux moindres impressions, j’escaladais des buttes, des remblais, traversais des chantiers boueux, découvrais l’ancien village en suivant des rues hautes et voyais face à moi, sur de lointaines collines toutes construites de petits pavillons, d’innombrables lumières, jaunies par la profondeur des pièces d’où elles jaillissaient, piquées dans l’étendue noire de l’horizon vallonné, chaleureuses sous la froideur des étoiles »
Bram recouvre en vitesse le corps de sa femme avec le tapis du salon, et se dirige vers la porte d’entrée. Il ouvre, reconnaît alors le mercier. Le mercier, habile commerçant, gagne du terrain à l’intérieur de la maison sans trop que Bram s’en rende compte, bientôt même jusqu’à l’entrée de la cuisine, à côté de laquelle ils ne s’attardent pas, puis l’entrée du salon, constatant alors la présence incongrue de la femme de Bram, allongée sur le sol, ne pouvant s’empêcher de glisser à Bram, Dis-donc mon vieux, je voudrais pas paraître indiscret, mais y a comme qui dirait votre femme qui dort sous le tapis du salon. Alors Bram, satisfait de son subterfuge, acquiesce, un peu gêné, et le mercier comprend, il n’est pas toujours facile de composer avec les manies des femmes, surtout lorsqu’elles sont aussi étranges que s’allonger sous le tapis du salon, ou, je ne sais pas, dormir avec le grille-pain, dit le mercier. Car votre femme dort avec le grille-pain ?, lui demande Bram, intrigué. Oui, bien sûr, cela lui arrive, certaines nuits, enfin, c’est une présence qui la réconforte je crois, comme ce tapis pour votre femme. Bram se demande si tous les commerçants du village ont des femmes avec des pratiques aussi saugrenues, et si les commerçantes ont des maris pareillement saugrenus. Il se trouve enfin que le mercier voulait lui vendre quelques produits, qu’il sort un à un d’une énorme valise. Bram n’avait pas remarqué la taille de cette valise, trop occupé qu’il était par la situation de sa femme. Mais à présent, il ne voit plus que cette valise, cette immense valise, bien trop grande pour le mercier, bien au-dessus de tous les autres types de valise observés par Bram jusqu’alors. Bram se dit qu’ainsi le mercier doit être un redoutable commerçant, car il semble pouvoir sortir de sa valise tout ce qu’on peut imaginer, et si chaque chose nous déçoit, il a toujours autre chose à nous montrer. Le mercier peut s’adapter à tous les besoins, à tous les désirs. Le mercier lui expose des tissus, de la toilette, de petites bourses, insistant sur le merveilleux cadeau que cela pourrait être à sa femme une fois celle-ci réveillée ; l’émerveillement qu’elle ressentirait à la vue de telles choses, ce sont des bonheurs indescriptibles que seules les femmes peuvent ressentir, conclut le mercier. Bram achète un peu à contre-coeur un bijou (une espèce de broche) et, une fois le mercier parti, le dépose délicatement à côté du corps de sa femme, toujours sous le tapis ; puis il s’assoit sur le canapé, soulagé. Il observe alors la scène, s’amuse de la composition des éléments : sa femme, le tapis, le bijou, et se dit que s’il avait été peintre il en aurait sans doute fait un chef d’oeuvre.
Les serviettes trempées parfois sentent la plage ; ensuite, le moisi.
j’étais sur le quai je ne connaissais pas la gare, un clochard pissait dans un coin, je n’étais même plus sûr qu’aucun train passât, j’attendais quelqu’un qui ne viendrait jamais j’avais caché mon visage on ne m’aurait pas reconnu, et des chiens, un bruit sourd d’un coup un train est passé il ne s’est pas arrêté, je me suis assis dans un abri au milieu de la rue, le clochard est venu il m’a caressé les cheveux
« ces soirs-là je me fabriquais quelqu’un, je plaçais un deuxième verre sur la table et je le remplissais, pour faire des traces de présence lui que je renvoie ce matin, lui que je trouve ce soir, et j’étais là, seul, épuisé, stupide, à bouffer des nouilles en inventant je ne sais qui » — Tony Duvert, Interdit de séjour.
L’arrivée en ville, non pas, ainsi qu’on se le représente, une fois franchi le panneau indicatif depuis une fin d’autoroute, mais en longeant ce fleuve bordé de péniches, pour voir, après les premiers lampadaires, alors qu’on quitte un jardin riche et entenébré, les halls d’une résidence, d’un immeuble, un chat gris accompagnant le chemin, comme un mendiant transformé devant les vitrines éblouissantes de restaurants à la mode ; et des silhouettes qui marchent, parfois solitaires, parfois en couple, qui se séparent de ne plus s’aimer, de ne l’avoir jamais été, ou de ne pas oser se le dire — alors on retrouve les trottoirs déjà empruntés, les passages, l’ombre sous les ponts, les voitures comme d’étranges habitacles qu’on imagine vides, d’autres rues encore, d’où parfois, au hasard d’un volet ouvert, on distingue une vide de fête ou de chagrin — et enfin, avant de pousser la dernière porte, quelques airs de jazz depuis une fenêtre invisible.
Le racisme, le sexisme, l’homophobie, comme sensiblités, opinions (dans la bouche du directeur de publication de Libération). Décidément, les hommes de pouvoir n’ont pas fini de déverser leur répugnance sur le malheur.
Une espèce de punaise (bien que je ne sache à vrai dire aucunement quel est le nom véritable de cet insecte) se balade sur mon bureau, à côté de l’ordinateur. Se demande-t-elle quelle est cette espèce d’étrange montagne mouvante dont je ne connais pas le nom ?
Bram ne sait pas ce qui lui a pris. Il n’a pas l’habitude de réagir de la sorte. Du moins, il ne réagit que rarement de la sorte, uniquement lorsque la situation devient irréversible, lorsqu’elle devient absolument intenable. Alors il réagit de façon absolument disproportionnée, tout comme la situation est absolument intenable, et bien sûr, très vite, parfois dès le lendemain, il s’en repend. Il vaut mieux n’être pas dans les parages lorsque Bram se comporte de la sorte. Il vaut mieux n’être nulle part, ne pas exister du tout, sans quoi on risque la colère de Bram, et il est incapable de la contrôler. Il s’isole parfois, mais il arrive que ce soit trop tard. Souvent c’est trop tard. Bram observe les dégâts avec un peu de tristesse, et de culpabilité. Il observe les dégâts faits à sa femme et il se demande si elle méritait bien cela. Bram se demande souvent après coup, après avoir constaté ses ravages, si tout cela était bien nécessaire. Parfois il se dit même : Je suis infernal, car il l’est, en effet. Parfois il pleure, ce qui ne l’empêche pas d’être infernal. La femme de Bram ne se demande rien car elle n’est plus en état. Elle devait se dire que Bram était infernal alors qu’il s’en prenait à elle, mais désormais elle ne se dit plus rien. Un passant se trouvant devant la maison au même moment n’imagine pas ce qui se passe à l’intérieur de la maison, à l’intérieur de la tête de Bram. Il voit Bram par la fenêtre du salon, semblable à lui-même. Bram le salue de la main, même s’il ne le reconnaît pas. Bram s’en veut aussitôt de l’avoir salué car le passant pourrait venir sonner à la porte d’entrée, et même vouloir entrer, et même vouloir passer un moment avec Bram, et même peut-être avec sa femme, et Bram n’est évidemment pas en état de le recevoir, et sa femme non plus, bien sûr. Comme sa femme, Bram n’est en état de rien, mais pour des raisons différentes. Comme il le craignait, le passant s’avance à présent dans l’allée ; sonne. Bram regarde sa femme, écoute la sonnette retentir, et se demande alors : Qu’est-ce qui m’a pris ?
« […] et, au même moment, je me suis mise à réfléchir que le feu était une invention trop dangereuse. Comment être sûre que ceux qui me l’achèteraient n’en feraient pas mauvais usage ? Et si, au lieu de l’utiliser comme moyen de chauffage, ils se mettaient à déclencher des incendies et à brûler des maisons, des usines, des gens ? Ou à fabriquer des bombes et des lance-flammes ?… » — Manuela Draeger, Pendant la boule bleue.
Le journal télévisé actuel est presque un rêve propagandiste, tant (sous couvert d’une supposée ouverture éditoriale) il camoufle et déforme les faits, les violences, les revendications. Déclinant la pénurie d’essence sur presque dix minutes, à savoir comment se rendre en famille ce weekend ? va-t-on devoir annuler le barbecue ? où faire la queue sans trop passer pour un con qui ne peut s’abstenir deux semaines d’essence, et qui ne peut évidemment pas prendre part au combat en place ? Donnant un droit de parole profondément idiot aux égoïstes n’ayant aucune conscience sociale, et estimant que ces gars-là sous leurs barnums et derrières leurs rangées de pneus en flammes ne se battent pas pour eux, pour leurs droits. Alors que s’ils rejoignaient les rangs, le problème serait réglé sans doute cent fois plus vite. Et ainsi on éteint son poste, persuadé d’être au bord de l’anarchie, avec des pompes lessivées, avec à nos portes des combattants masqués armés de fourches et de torches, prêts à tout saccager, à tout rendre au chaos. On se précipite alors pour raconter cette horrible découverte au voisin, qui à son tour (l’histoire fait trembler !) se précipite vers la connaissance la plus proche, qui elle-même allume son poste le soir, et se voit confirmé tout ce qu’on lui a dit plus tôt, et alors elle-même persuadée accourt vers un troisième luron, et le mal est vite fait, et le mot est vite passé, et rien n’est compris, rien n’est vu, rien n’est su. On ferme même sa porte à clé, au cas où.
Il faut en effet, dès aujourd’hui, préférer le néant à la médiocrité.
Ma grand-mère, me le désignant de la tête : J’ai presque fini ton livre. Mais pourquoi c’est noir comme ça ? C’est noir de chez noir. Malaise profond que d’expliquer une démarche artistique et poétique à ses proches, qui vous connaissent en recoins, et pour qui, paradoxalement, le décalage est trop grand.
(Comment faire : où retrouver la poésie ?)
Les bâtiments royaux étaient creusés à même la roche, comme enfoncés dans la montagne, tandis que les dômes des paysans s’élevaient depuis la poussière de terre, quelques briques dénichées non-loin, et tout à trac assemblées ainsi, qu’une seule poutre maintenait depuis l’intérieur. Les paysans étaient interdits d’entrée dans la montagne des rois ; ceux-ci les jugeaient depuis une plate-forme surplombant la ville, et vers laquelle chacun devait hurler pour revendiquer son droit.
La lune parfois se montre ; elle guide mon chemin sur des sentiers tortueux, où les ténèbres s’allongent, et il me vient toujours la froide impression que l’ombre de voleurs me frôle. Les branches des chênes se distendent, s’entrecroisent, leurs feuillages fouissant dans un étrange murmure, comme si un aïeul attentif me soufflait de prochaines misères.
« L’idée tout à coup vous traverse qu’on pourrait s’étendre là, ne plus penser à rien, enfoui dans le manteau épais et l’odeur de feuilles fraîches, le visage lavé par le vent léger, le bruissement doux et perpétuel des peupliers dans les oreilles vous apprivoisant à la rumeur même de la plénitude. » — Julien Gracq, La Sieste en Flandre hollandaise.
non, oh non, oh, hm, non non, oui ben je vois bien ce que vous voulez dire mais non, hm, hm, mais me faites pas dire c’que j’ai pas dit ! c’est fantastique ça ! oui, oui ! ah mais vous les gens d’la ville vous avez la manière hein, ah ça, hm, je vous écoute oui, hm, attendez, hm, oui mais ça encore une fois c’est vous qui l’dites, hm, ah tiens, vous permettez ? oui ? ah oui ! tu me rappelles plus tard ? oui j’ai du monde, hm ? oh rien je te raconterai, oui, arrête ! oui, bon je raccroche, oui, oui, allez, oui, excusez-moi, encore du café ? alors, oui oui je me souviens, ça fait un moment, j’ai plus forcément tout en tête en détail, y en a qui pourraient mieux vous dire, et puis, c’est plus pareil maintenant qu’j’ai perdu mon Flime, enfin, je l’dis, c’est pas un secret, j’le vois encore parfois dans l’couloir là-haut, c’est c’qui fait qu’j’oublie, j’ai plus toute ma tête sans doute, parfois j’descends à la cave j’me dis qu’est-ce que j’étais v’nue chercher, je r’monte, et là j’me souviens, souvent c’était juste pour le beurre, un torchon, rien d’grave, mais après, qui sait, j’vais plus savoir qu’j’ai allumé le gaz, on m’retrouvera étouffée dans la cave, alors, j’aurai r’trouvé mon Flime au moins, enfin, c’que j’vais vous dire, sans doute, peut-être, enfin, vous êtes habituée je suppose, oui oui, mon Flime il aurait bien su ça vous dire, ah il avait le parler, il savait s’faire entendre ! oh, j’ai du vendre, le bout d’terrain bien trop grand pour moi à entret’nir, j’ai vendu, les enfants z’étaient pas pour, oh ça, ah vous verrez ! j’ai la p’tite maison là maint’nant, ça m’va, le quartier est tranquille, c’est plus l’potager ou quoi mais ‘fin, pour l’peu d’temps qui m’reste ici, sans mon Flime, tout ça, hm, enfin, les jours, hm, oui, pardon, oui, alors, j’remont’rais un peu avant la nuit-là, y s’trouvait toujours une heure où que j’étais seule à la maison, qu’le Flime il était j’sais pas où, la chasse, la crapette, des heures, j’demandais pas, y partait, y m’disait pas donc, j’demandais pas, voilà, hein, oh, dans la journée, sur le coup d’trois heures disons, que j’vois filer dans l’allée du Gave une voiture qu’j’avais jamais vue par là auparavant, alors j’m’approche d’la f’nêtre, là, mine de rien, j’regarde, ‘fin, on voit jamais très bien chez l’Gave à cause d’ses grands pins là, enfin vous pourrez r’tourner voir chez l’Gave, j’sais pas si les pins y sont toujours, on voit à peine sa cour, mais j’vois qu’la voiture s’arrête quand même, qu’le Gave sort d’sa maison et va comme qui dirait à la rencontre de la voiture, et qu’une femme en descend, inconnue, pas de M. dans tous les cas, enfin, pas qu’j’ai jamais vue au marché ou nulle part ailleurs, au coiffeur ou quoi, et puis l’Gave embrasse la femme, et puis ils rentrent dans la maison, et voilà, après, j’ai pas voulu me mêler davantage, déjà qu’sa femme au Gave j’la vois tous les lundi à la gym, j’aurais pas su quoi lui dire, enfin, j’aurais été mal à l’aise oui, hm, oui oui, enfin, la journée s’passe ensuite, le soir mon Flime rent’ d’là où qu’il était, j’lui en parle pas, j’sais pas pourquoi hein, hein ? hm, non non, enfin, oui, peut-être, oui par vengeance, enfin, j’sais pas, c’est vous j’sens qui voulez m’faire dire ça, hein, oh non j’avais pas d’la rancoeur pour ses secrets à mon Flime, j’y étais pas c’genre de bonne femme là, à toujours surveiller l’heure, pis d’mander des comptes, y m’nait bien la vie qui voulait, y m’a toujours bien traitée, j’peux pas dire, des cadeaux, il achetait ça il voyait au téléshopping y m’gâtait pour sûr, j’ai encore tout ! j’peux pas tout porter, des bijoux, des bracelets, des colliers, j’pourrais vous montrer ! et — décidément ! ‘tendez, allo ? oui, oui, j’t’ai dit qu’j’te rappellerai ! non, mais non ! oui, oui, hm, oui bon j’te laisse, oui, oui, attends que j’te rappelle ! oui, oui, allez, oui, bon, désolée, hein ? oh non rien rien, donc, hein ? oui oui j’ai r’vu la voiture l’lend’main, pis l’surlend’main, après j’ai pas d’mandé d’détails, j’voyais bien qu’ça m’regardait pas, jusqu’à c’que j’sache qu’les cinq femmes qu’avaient été r’trouvées dans la nuit deux ou trois jours plus tard, même si au début ils en avaient r’trouvé qu’quat’, qu’la dernière ils ont mis plus de temps, p’t’être l’après-midi qu’ils l’ont r’trouvée et pas l’matin, là j’me suis dit, p’t’être qu’y en a une d’entre elles qu’c’est cette femme du Gave, alors quand la police m’a d’mandé d’venir identifier les femmes, comme qu’ils ont d’mandé à tout l’monde du quartier d’l’époque, j’suis v’nue, mais qu’est-ce que j’aurais pu dire, une femme, quoi, au loin, une silhouette, entre deux pins, ça aurait pu être n’importe qui, ça aurait aussi bien pu être les quat’ qu’aucune, alors j’ai rien d’dit d’la femme mystère du Gave, vous pensez qu’c’est mentir vous ? vous pensez qu’c’est comme si qu’j’étais complice des atrocités qu’on leur a faites ? comme si qu’j’étais une moitié d’meurtrière ?
« À minuit, par un clair de lune coupant comme un rasoir, je détachais l’amarre de galère funèbre — et voguais. De longues étendues de terre plaine, des vols de ramiers blancs fantomatiques contre les berges, c’était le premier éveil de cette marine féerique que j’improvisais dans le creux du paysage nocturne. » — Julien Gracq, Liberté grande.
Comme l’eau est sale, aux abords des villes. Les étangs ont l’air de marais, au-dessus desquels diverses nuées d’insectes minuscules bourdonnent en permanence, formant un compact nuage noir, mobile, translucide, indistinct.
D’un léger éclat dans le sol, ce qui aurait pu être le cadran d’une montre, ou l’or d’une bague, d’une broche perdue, abandonnée, jetée peut-être, et dont le métal aurait réfléchi sous l’impulsion du soleil (s’infiltrant entre les branches des arbres, dans cette saison encore abritée de la chaleur, où seuls quelques points offrent la lumière, comme entre deux jalousies légèrement écartées, et qu’on refermerait aussitôt, ou qu’on décalerait, au loisir du regard, de la chose vue, guettée), et cet éclat pourtant, alors qu’on s’approche, n’étant qu’un gland poli dont le fruit bombé, dégagé de sa cupule, offre sa surface aux reflets. On s’en saisit alors et le range dans notre poche, pour le déposer plus tard (au terme de cette marche), ainsi qu’un authentique bijou, dans une boîte en bois calfeutrée de rouge.
(Parfois écrire, comme en musique, pour faire ses gammes.)
« Quelque part, en bas, une femme chantonnait. La nuit, il restait couché là, vidé de tout, corps et esprit, dans un vague bien-être, respirant les odeurs confinées de chairs, de poudres et de parfums bon marché. »
Je ne sais comment une pensée nauséuse et excluante peut germer encore actuellement dans l’esprit des nouvelles générations (dont je fais partie). Il y a, à un moment donné d’une époque, dans un pays donné, une situation de vie particulièrement précaire, et qui ne va qu’en se dégradant au fil des années, depuis plusieurs décennies. Il s’agit donc, sommairement, de connaître les responsables de cette situation pour ensuite y apporter les réponses adaptées, et la modifier. Il se trouve encore des personnalités publiques (dont la parole est entendue, mise en avant) qui estiment encore intelligent, après les multiples démonstrations inverses dont fut témoin l’Histoire, de rediriger cette faute vers (au choix, ou cumulées) les communautés, toujours victimes, toujours manipulées, toujours exploitées, toujours minoritaires. Et non vers les hommes au pouvoir, étrangement toujours provenant des mêmes milieux sociaux, étrangement toujours des mêmes écoles, mettant étrangement toujours en place les mêmes politiques économiques ayant démontré (on en est les actuelles victimes !) une absolue absurdité, étrangement rendant le peuple à la misère, à la famine, à l’aveuglement, à la haine. C’est-à-dire que ces personnalités estiment responsables des personnes n’ayant presque aucune influence sur la société, ou alors seulement au terme de combats infernaux contre l’opinion publique, contre le pouvoir en place. Je trouve ce type de raisonnement tellement absurde que j’ai du mal à voir comment on peut y donner le moindre crédit. C’est-à-dire que je prends n’importe qui justifiant ce type de pensée, désormais, pour, au minimum un parfait idiot ne sachant pas ce qu’il dit, au pire un vautour. Les dérives amenées dans le passé par de telles idées sont si lourdes, si dangereuses, qu’il n’est plus possible, plus acceptable, d’y tendre l’oreille ; il n’est plus envisageable, sous prétexte d’une prétendue liberté de pensée, d’outrager la mémoire et la vie de toutes les victimes d’une telle idéologie. Il faut cesser d’encrasser nos cerveaux de miasmes. Il est de notre devoir de remplir certaines bouches de terre. La démocratie n’est pas l’insulte.
La haine et le rejet ont-ils jamais entraîné aucun salut ?
Possible introduction à Contre-enquête : Dans la nuit du 20 au 21 février 1998, cinq femmes sont retrouvées mortes en divers endroits de la campagne, non loin du village de M. Au terme d’une enquête mouvementée de sept jours, le fils d’une des familles, âgé de vingt-deux ans au moment des faits, est arrêté, puis condamné par le tribunal pénal à perpétuité pour le meurtre des cinq femmes, et le viol de trois d’entre elles. Suite à cette décision judiciaire, il se suicidera dans sa cellule en se tranchant la gorge avec un cutter. Il laissera derrière lui une lettre étrange rejetant la responsabilité des crimes sur l’ensemble des villageois. Cinq ans plus tard, une inspectrice retourne dans le village de M. pour interroger les anciens témoins de cette affaire. Il s’agit des transcriptions tirées des bandes audio de ses interrogatoires.
Vingt rennais sont actuellement passibles de sept ans de prison (!) pour « association de malfaiteurs », ayant voulu rendre l’accès au métro gratuit pour les usagers (!) en neutralisant les bornes de validation (!) avec de la mousse expansive (!) — produit en vente dans n’importe quel magasin de bricolage —, le parquet ayant souligné « la nature et la gravité des faits ». Aux yeux de nos dirigeants, l’insurrection est bien proche en effet.
« Il ne voit pas les infimes particules de diamant laissées par la rosée sur la partie du pré encore à l’ombre de la haie, il ne sent pas le parfum végétal et frais des brins d’herbe écrasés sous son poids, il ne sent pas non plus la puanteur qui s’exhale de son corps, de ses vêtements, de son linge raidi par la crasse, la sueur et la fatigue accumulées, il n’entend ni les chants d’oiseaux ni les légers bruissements des feuillages dans l’air transparent, il ne voit ni les fleurs qui parsèment le pré, ni les jeunes pousses de la haie se balancer faiblement dans la brise du matin, il n’entend même plus les battements déréglés de son coeur et les vagues successives du sang dans ses oreilles. » — Claude Simon, L’Acacia.
oui, ben, oui non mais, oui, je l’aurais pas dit de cette façon-là, enfin, après vous avez vos mots d’inspectrice, oui, oui, ben là je vous dis c’que moi j’en pense, après vous pensez bien vous c’que vous voulez, c’est pas moi, oui, hm, oui, oui, donc, attendez, donc, il se disait qu’on aurait cisaillé ses pneux au Cloude, que pour ça qui s’rait pas parti, qu’il aurait pas pu partir, oui, oui voilà, une espèce de sabotage quoi, ben, c’est c’qu’on dit en tout cas après, moi, si c’est vrai, c’est pas mon boulot, voilà, personne a vu qu’on lui avait crevé les pneus à son quat’-quat’ au Cloude, donc, que pendant qu’sa femme brûlait il aurait pas pu partir, à cause des pneus cisaillés, hein, à deux heures de la nuit oui, ben elle était partie, je sais plus bien, on m’a dit j’ai oublié, elle l’avait prévenu, partie chez p’tête son amie d’Pludinio, la Mile, oui, la Mile j’crois qu’est s’appelle, vous pourrez d’mander à côté ils la connaissent mieux qu’moi, voilà, donc, à une réunion de cuisine enfin, après, le motif, et, oui, ben moi j’vous dis c’qu’on m’a dit qui s’est passé, p’t’être ça s’est pas passé comme ça, j’sais pas, donc, vers les deux heures moins le quart qu’son téléphone sonne au Cloude, qu’on lui dit ta femme brûle, comme ça, puis qu’on raccroche, ah ben, pour sûr ça a dû lui mettre un coup, il appelle chez la Mile où qu’elle était sensée être sa femme, la Mile elle dit elle est pas là ta femme Cloude, et c’est là qu’il a compris enfin, compris quoi, aucune idée, il a voulu la chercher, à deux heures du mat’ une colonne de feu ça s’voit, il aurait vu sa femme, d’ailleurs le type qu’a r’trouvé la femme au Cloude plus tard y l’dit bien, la torche è f’sait p’t’être quoi, trois mètres de haut, alors, donc le Cloude sort prendre son quat’-quat’, pneux cisaillés, non, non, attendez, il a même pas tenté j’vais vous dire, il est r’tourné s’coucher, y s’est dit sûrement encore une connerie, et puis l’lendemain c’est là qu’il a su qu’c’était pas une conn’rie qu’on avait bien mis l’feu à sa femme, et puis, les voisins le connaissaient pas si bien, ils auraient pas ouvert, surtout pas prêté une voiture, moi je les comprends, y a eu des cambriolages dernièrement, les gens se méfient, oui, non, non pas arrêtés, oh les flics, ils ont jamais su, enfin, pas pour insulter vot’ profession mais les flics, nous, si j’vous disais c’qu’on en pense, surtout les p’tits larcins, ils sont bien aimables ils prennent les empreintes ils vous écoutent parler ils tapent sur leur machine et puis après, c’comme si qu’personne avait jamais rien volé, qu’personne avait rien vu ! alors, enfin, oui, ben, non mais, enfin, oui, ah mais elle, oui, elle vous a peut-être dit le contraire, mais plus personne la croit ! ah non ! ah ! avec son vieux pervers de mari, ah oui ! ah le Gave ! ah ben ça ! y s’privait pas pour r’luquer ma femme c’vieux type là ! et puis celle du Cloude aussi ! et puis pas que ! ah ben lui pour sûr que j’regretterais pas sa mort ! oh j’l’avais à l’oeil, il aurait pris un coup d’fourche si c’t’ait pas ma femme qui m’avait empêché ! oui, oui c’était la même nuit qu’la femme à l’père Cide a disparu mais, ben, j’vois pas pourquoi, ah mais, non mais, oui, j’veux bien vous croire, mais pourquoi qu’sa femme au Cide qu’est s’rait partie avec sa femme au Cloude ?! ah ça ! ah ben oui ! ah qui y aurait comme qui dirait une espèce de maniaque qui foutrait l’feu ou aut’ chose aux femmes du coin ?! il aurait mis l’feu à la femme au Cloude et qu’il aurait fait l’horreur à la femme au Cide ?! ah ça ! ah si vous m’dites plus tard qu’c’est bien c’qui s’est passé, j’veux bien vous croire, y a d’ces histoires parfois ! mais là, j’ai pas, enfin, oui, voilà, j’vais vous dire, ça m’paraît quand même farfelu !
Simon, seul à savoir redonner toute sa valeur au participe présent.
Il y aurait sans doute une espèce de quadrilatère à dessiner, composé de Gracq, Proust, Bernhard et Simon. Utilisation de nombreuses coordonnées et subordonnées, allant vers l’ouverture (Proust, Simon), ou la fermeture (Bernhard), vers une ouverture géographique (Simon, Gracq) ou psychologique (Proust, Bernhard), avec un immobilisme (Bernhard, Gracq), ou une progression (Simon, Proust), et dans le détail (Proust, Gracq, Simon), ou le ressassement (Bernhard).
Je ferme toujours le loquet de ma porte d’entrée à double-tour avant de me coucher le soir. Je me demande ce que les voisins en pensent.
Sans talent, sans génie, je tente ma chance.
Se rendre à l’évidence : personne n’attend ce que j’écris, comme personne n’y voit quelque chose d’essentiel, d’évident artistiquement. La publication se place forcément dans une démarche de don, de commerce, qui me met finalement mal à l’aise, car j’en veux à tout le monde de ne pas acheter et consommer mon produit immédiatement. (Absurdité de penser ainsi, impossibilité de ne pas penser ainsi.) Pour cela, les Relevés sont une des meilleures choses littéraires qui me soient arrivées : je n’y attends rien de personne, creuse mon sillon comme une lame dans un champ, sans regarder ce qui se trouve autour, butant parfois sur des caillasses, mais sans aucune considération pour les talus, dans une espèce d’immense champ uniforme, où la seule chose à faire est de creuser, toujours, sans relâche, sans faiblir, sans terme, marquer son territoire, laisser quelque chose, une crevasse, minuscule, insurmontable, remarquable.
Il est dommage, dans les médias, de ne pas entendre davantage d’incitations à la casse. Il faudrait en effet d’énormes bombes, et dans ces bombes d’autres bombes encore, et sûrement qu’on y serait à peine, au grand bouleversement, au grand renversement des valeurs. Alors comment s’offusquer de quelques distributeurs hors d’usage, de voitures en feu, c’est de la mécanique, de l’informatique, ça se construit, ça se programme, ça se dégrade, ça disparaît, ça doit disparaître, tout doit disparaître.
J’ai voyagé en compagnie d’inconnus, qui s’arrêtaient à ma hauteur alors que je longeais les blés, et me déposaient plus loin, toujours dans le sens de la marche, jamais exactement là où je le désirais. J’avais un canif qu’on m’a dérobé ; avec lequel on m’a planté au visage. J’ai passé la nuit dans une chiotte à côté de la digue. Un marin est venu y pisser et m’a battu au passage. Le lendemain, je pouvais à peine marcher. Je me suis écroulé dans un parc sur l’herbe humide, et personne ne m’a porté secours. Deux jours ont passé peut-être avant que la faim ne me tenaille le ventre. J’ai volé dans l’arrière-cuisine d’un restaurant ; j’ai tout donné au premier pauvre que j’ai croisé. J’ai passé du temps assis au bout d’un ponton, à regarder crever les vagues. J’ai pensé partir mais je n’avais nulle part où aller. Il y avait un attroupement une fois sous un pont, d’autres comme moi sans doute ; je n’ai pas voulu les déranger. Puis les flics sont arrivés et les ont passés à tabac. Ils n’étaient plus que deux quand je suis revenu, l’un avait l’oeil explosé, l’autre ne pouvait plus marcher. Ils m’ont menacé avec un tesson de bouteille. Alors que je rejoignais le centre-ville, une bande d’adolescents en scooter m’a pris en chasse et cogné dans le ventre avec une barre de fer. Je me suis effondré sur un trottoir. On aurait mieux traité un chien. J’ai pensé à ma mère. Après avoir pensé à elle, j’ai rendu sur mes bottes. Je sais pas si c’est de penser à elle. J’aurais pu m’engager sur un bateau, mais on m’aurait jeté par-dessus bord. Je me suis planqué dans un jardin. La maison semblait abandonnée. Sans doute des riches qui passaient loin l’hiver. Le potager était crevé, l’herbe bien trop haute. La peinture des volets s’écaillait. La balafre du canif s’est infectée, et une plaie purulante m’a traversé la joue. J’avais pas de quoi payer le médecin. J’ai cassé un carreau et forcé la porte du garage. La maison était noire et sentait la moisissure. La tapisserie était décollée par endroit, et derrière le plâtre s’effritait. À l’étage j’ai trouvé la salle de bain, et passé de l’alcool sur ma blessure. J’ai hurlé dans la maison et je crois que j’ai aussi pleuré en même temps. J’ai pas hurlé pour cacher que je pleurais. Je me suis allongé sur un lit, dans une des chambres. J’ai pas allumé la lumière. J’ai eu peur qu’on me repère. C’était un lit d’enfant. J’ai dormi sur le matelas nu, avec une énorme tache au centre, comme de la pisse. J’ai posé mon nez dessus mais ça ne sentait rien. Une fois la douleur passée je suis descendu dans la cuisine. J’ai ouvert le frigo, mais il n’y avait plus d’électricité. J’ai allumé la télé, pareil. Je suis ressorti dans le jardin. On aurait dit un champ en friche à cause des mauvaises herbes. Des bestioles grouillaient sur mon jean. J’en ai chassé une de la main. Le vent balayait les pins, et parfois des aiguilles tombaient sur moi. Je me suis endormi dehors. La nuit était peut-être déjà finie. Je me suis réveillé avec les articulations gelées. Le soleil frisait entre les branches. Je n’avais toujours rien à manger. J’ai hésité à m’aventurer sur la plage, pour finalement m’assoir sur un banc à droite de la digue. Des vieux se baignaient. Des cavaliers. J’ai entendu un train arriver à quai. Je me suis retourné et les passagers sortaient de la gare. La place fut un instant bondée de voitures, puis il n’y eut plus personne. J’ai mendié devant le supermarché. Un enfant m’a craché au visage. La mère m’a laissé une pièce. Pour excuser son fils, surement. Le soir, une autre bande d’adolescents s’est installée dans le pavillon d’à côté. Je les ai observés à travers la haie. Ils se passaient les mains sous les tricots. Je voyais les doigts moulés dans les plis du vêtement. Des espèces de torches brûlaient qui éclairaient la scène.
Depuis Cécile (ou un peu avant ?) plus aucune souffrance quant à la solitude ; plaisir même de rester à Rennes, n’avoir de nouvelles de personne, n’en pas donner non plus. Faire ce que j’ai à faire que moi seul peut accomplir. Cette solitude serait-elle possible sans Cécile ? Le souvenir encore de mon adolescence, passée à souffrir n’être invité nulle part, toujours délaissé des cercles sociaux fréquentés. Désormais, indifférence absolue envers toute forme de convention publique, de rassemblement, d’événement.
« Ce besoin que j’ai d’écrire quelque chose de dangereux pour moi, comme une porte de cave qui s’ouvre, où il faut entrer coûte que coûte. » — Annie Ernaux, Se perdre.
Après une journée de marche, Namrej et le mage trouvèrent refuge dans le coin abrité d’un hangar. Une espèce de rouille recouvrait la tôle ; de l’huile de moteur se répandait sur le sol : l’odeur prenait aussitôt à la tête. Près d’un baril en feu, une dizaine de mendiants se réchauffaient. Ils semblaient ne pas tenir compte de leur présence. Certains étaient étendus sur le sol quand d’autres, assis, rongeaient d’étranges os cassés. Qui sont-ils ?, demanda Namrej. Différents voyageurs comme toi fuyant les patrouilles, répondit le mage. Laisse-les approcher ; écoute leur histoire à chacun. Un premier mendiant s’éloigna du baril pour s’approcher de Namrej. Il s’assit en face de lui, et conta son voyage.
Je n’ai pas de père. Ma mère est une putain prisonnière du bordel principal de la ville. Un riche prophète m’a recueilli à l’âge de sept ans, et m’a logé dans un dortoir où d’autres jeunes enfants le servaient. Les jeunes filles étaient enfermées à l’intérieur, chargées de nettoyer et mettre de l’ordre dans son palais ; les garçons allaient par les rues pour vendre sa marchandise. Des prophètes rivaux parfois capturaient les garçons du dortoir, et demandaient à notre maître quelques sacs d’or, du bétail, ou des jeunes filles en échange. Si le maître ne satisfaisait pas la demande du prophète ennemi, celui-ci exécutait l’enfant et abandonnait sa dépouille devant le palais, en signe de déshonneur. Tous n’avaient pas été recueillis comme moi suite à la disparation de leurs géniteurs ; on les avait vendus, et ils devaient servir le prophète jusqu’à l’âge de maturité. Nous n’assitions jamais aux banquets tenus par le prophète, pour ne pas lui faire honte ; sauf certaines filles qui défilaient et servaient comme putains aux invités. Ils remarquaient là les prochaines prisonnières de leurs bordels. Nous mangions dans la cuisine, à même une large gamelle de sardine et d’oignons frits commune à tous. Les prophètes sont les premiers disciples du père fautif Calvarde, qu’ils vénèrent dans des pièces sacrées où eux seuls peuvent pénétrer. Ils rendent des prières en sa gloire de Seigneur du ciel et du feu à deux reprises au milieu de la nuit, et une dernière fois le matin. Les plus belles putains et les plus forts esclaves sont envoyés par navette vers les satellites célestes du père fautif Calvarde. Ça n’a pas été mon honneur. (…)
Allez, repose-toi à présent, conclut le mage. Demain, un voyage autrement plus long nous attend. Namrej s’allongea à son tour sur le sol, le dos collé contre un pilier de ciment. Le mage le recouvrit d’un drap long brodé dans un tissu rare. Puis il s’approcha du baril et se jeta entièrement dans les flammes. À l’intérieur de cette étrange couche le mage passa la nuit.
Il m’arrive parfois de quitter la ville en longeant la rivière. La municipalité a aménagé des sentiers de part et d’autre du cours d’eau, sur toute sa longueur. Il est possible de marcher ainsi presque jusqu’à l’océan, même si je ne m’y suis jamais aventuré, par peur de n’avoir pas le temps de rentrer. On croise divers villages lors de ces trajets, qu’on traverse en partie, sans bien distinguer ni la façon dont ils sont agencés, ni qui y réside. Toute cette banlieue semble comme étrangère à mes yeux, comme absolument séparée de la ville ; je ne connais personne qui y vive. Je n’ai jamais eu la curiosité de m’y arrêter, comme si la distance réduite ne justifiait pas que je m’installe, quand bien même rien ne la différencie d’un pays lointain. Il s’agit, en somme, d’un exotisme connu.
Aux critiques, avis (n’avoir pas écrit le livre qu’on attendait de nous, ou pas de la bonne façon, ou pas de la façon attendue, ou ne pas comprendre le projet, ou l’avoir compris mais y rester indifférent), toujours la situation délicate de celui qui écoute en sachant pertinemment n’y accorder aucune importante. Difficulté de trouver d’autres mots en retour que : D’accord ; ou, comme on dit parfois : Ok vu. Toujours la sensation de jugements à contre-temps. Pourtant, tenir la posture de celui qui écoute attentivement, pour ne pas paraître indélicat, égocentrique.
Absolument désintéressé par tout ce qui n’est pas l’écriture ou la lecture. Les actes de présence, les déjeuners, les rendez-vous, etc. Pourtant, toujours devoir justifier mes refus ; comme si seulement vouloir travailler (ou ne rien faire) ne suffisait pas ; comme s’il n’était pas valable d’uniquement dire non.
(Cet instant insupportable — avec ma mère, ma belle-mère, ou il y a deux ans Sylvie — à partir duquel je suis considéré comme intrus quelque part, où l’on demande mon départ, où mon absence est davantage souhaitée que ma présence.)
Le sous-titre à La ville fond aurait pu être : un leurre.
Un premier vaisseau survola Namrej et le mage. La chaleur dégagée par son passage troubla l’air au-dessus d’eux ; Namrej crut y voir une nuée particulière, mais très vite elle se dissipa, ouvrant son regard sur une multitude de satellites cerclés d’étoiles. Ne regarde pas tant le royaume du père fautif Calvarde, le prévint le mage, lui seul sait comme il pourrait te punir. Le mage poursuivit : Le royaume du ciel appartenait autrefois au père-busard Machine, mais depuis sa mort, son frère Calvarde en a pris le contrôle, et l’a pollué en son ensemble. Une navette de la patrouille se posa à côté d’eux ; en sortit une escouade militaire qui les ignora et se dirigea en courant vers une carrière abandonnée.
Il nous faut quitter la zone, confia le mage. Il est nécessaire de nous dégager absolument du territoire conquis par le père fautif Calvarde. Son influence sur tout ce qui nous entoure là est considérable. Ce qu’il est capable de faire à celui qu’il désigne comme intrus épouvantable. Et déjà il semblait à Namrej qu’on l’espionnait. Et déjà chaque busard était à ses yeux une vigie. Le mage le saisit par le bras : Ne ralentis à aucun moment ton pas. Suis-moi et marche dans les empreintes laissées par mon passage ; qu’on ne te distingue pas. Ce qu’il advenait à ceux dont on distinguait le passage, le mage ne le révéla pas alors à Namrej.
Souvent, désormais, non plus l’obsession d’écrire pour ne pas oublier, mais celle d’avoir oublié si quelque événement a bien été écrit. L’impossibilité de l’écriture pour résoudre ce problème essentiel qu’est le néant. Me sentir piégé entre la redite et le laisser-aller définitif. (Par exemple, le jour où j’ai appris le décès de mon grand-père : l’ai-je écrit ? Si non, serais-je capable de remonter, à l’aide d’un mot-clé, chaque chose écrite à son propos ces dernières années sans avoir le coeur déchiré autant de fois ?)
Au coeur d’une lande marécageuse, dans une crevasse de câbles et de boue, à l’abri de pylônes abattus, se trouvait Namrej l’exilé. Agenouillé sur le sol, il frappait son visage de ses mains pleines de terre. Les toiles des abris se distendaient, déchirées par le vent, et balayaient les traces de ses compagnons disparus sous les bâtons des patrouilles, celles qui tant frappaient, tant abîmaient les visages. Un homme vint à sa rencontre, qui n’était ni des patrouilles, ni de cette lande, et dont on ne voyait rien de plus qu’un étrange manteau encapuchonné. De sous le tissu du manteau sortit une main dont la paume se déposa sur le front de Namrej. Guide-moi vers où est ta peine, dit le mage à Namrej. Alors Namrej ouvrit au mage un passage à travers les décombres de la lande.
Enfin ils approchèrent d’une surface dégagée, vers laquelle Namrej accourut. Il se saisit de ceux allongés sur le sol. Namrej tenait entre ses bras sa femme et son fils, leurs corps meurtris par les coups des patrouilles. Il avait abandonné leurs corps car il ne savait où les enterrer ; il ne savait s’ils méritaient cette terre étrangère.
— Cesse de te lamenter, lui dit le mage, creuse un trou dans le sol et dépose-y leurs corps ; je t’aiderai à prier pour eux. Puis tu m’accompagneras.
— Il me faut rejoindre la lande d’après la mer, confia Namrej. Ainsi j’ai voyagé avec ma famille depuis mon propre pays, car là-bas enfin le repos m’attend.
— Il y a un autre chemin pour toi que les flots, répondit le mage. Il n’y a plus aucun repos pour toi en ce monde. Regarde autour de toi. Où sont tes compagnons à présent, où est ta famille ? Regarde ce village que vous avez bâti, qu’est-il devenu ? Et cette terre qui jusque-là était votre refuge, n’a-t-elle pas englouti ceux que tu aimais ? Après les flots une misère semblable t’attend, qui ne t’épargnera pas.
(…)
Ils pénétrèrent dans une fosse et, une fois le sol frappé par le sceptre du mage, la terre s’ouvrit sous Namrej, découvrant l’issue unique pour celui que tous ont oublié. Découvrant la Voie unique de l’exil accompli.
(Un peu déçu par cette nouvelle traduction, moins poétique (à mon sens) que celle de Jacqueline Risset. Parfois la sensation - sans comprendre le moindre mot d’italien - d’une traduction beaucoup plus littérale, avec des tournures lourdes et alambiquées, rendant sans doute davantage le sens, mais beaucoup moins l’impulsion.)
« Là l’empereur du règne de souffrance
sortait à mi-poitrine de la glace ;
et d’un géant j’ai plus la corpulence
qu’ont les géant de ses bras la surface :
tu vois donc bien ce que le tout était
si la partie était de telle masse. »
Calvarde forgea son trône dans la lave d’un brasier ardent ; là avec sa masse il fit naître d’étranges êtres de pierre, et des bêtes de ce même sang infernal, qui s’enlaçaient dans la braise en écharpant leur pelage. Divers puits de lumière perçaient la croûte terrestre et se prolongeaient en tubes jusqu’au sol. Un étang s’en trouvait éclairé, au-dessus duquel voletaient quelques moucherons, et dont la berge se peuplait de roseaux. Depuis la surface jusqu’au portail colossal, des marches incrustées dans la roche offraient un passage ; d’immenses parois délimitaient le domaine du seigneur. Le portail demeurait fermé car Calvarde ne supportait aucun dérangement, ni aucun bruit. Quiconque tentait de l’ouvrir sans son accord voyait ses membres calcinés dans l’instant, et des ossements gisaient perpétuellement à son pied, dont parfois les prophètes se servaient pour leurs mausolées. La fumée permanente dissimulait rôdeurs et pillards ; le royaume entier était soumis au chaos.
Calvarde cultivait le secret d’une nouvelle lumière, qui supplanterait celle contrôlée par son frère seigneur du ciel Machine. D’étranges savants drapés construisaient dans le silence de son domaine interdit ce soleil inconnu et, quand parfois ils s’éloignaient de l’objet de leur attention, on aperçevait fascinés, comme un trou béant qui autour de lui tout aspire, une sphère horrible de colère et de feu.
Je tente de trouver quelque chose de plus que la simple restranscription des choses. C’est difficile. Je tente d’être bon ; souvent c’est à peine potable. Il est très facile d’avoir un sujet et d’en parler ; mais presque infernal de parler comme ça, pour rien.
Il est vrai que la peine est immense car le bourreau est roi. J’ai fait de ma propre maison un gibet.
« J’entendais de toutes parts pousser des cris
et ne voyais personne qui les poussait ;
c’est pourquoi je m’arrêtai, interdit. »
Quelque chose d’étrange s’est passé la nuit dernière. Contrairement à d’habitude, je ne dormais pas alors qu’on détruisait les immeubles en face de chez moi. Je ne sais pourquoi, une quelconque angoisse m’empêchait de dormir, et je restai éveillé, immobile dans la pénombre de ma chambre. Soudain, j’entendis des explosions au dehors, et je sus aussitôt qu’il s’agissait des immeubles qu’on détruisait. J’ai d’abord hésité à ouvrir mes volets, par peur de ce que j’aurais pu voir et qui ne me regardait pas. Si on s’obstinait à détruire les immeubles la nuit quand tous dormaient, c’était sans doute pour dissimuler quelque chose, quelque chose même de la plus grande importance, presque un secret interdit. J’ai eu comme le sentiment d’être un intrus, et de risquer une peine épouvantable si jamais on me surprenait dans la nuit en train de ne pas dormir, d’espionner les immeubles en train d’être détruits.
I. RÉVÉLATION DE NAMREJ
II. FRÈRES ET SOEURS
1) Gabja le damné
2) Damirine l’oublieuse
Etc.
III. LOUANGE ET DEUIL DU PÈRE-BUSARD MACHINE
1) Machine fils
2) Machine père
3) Machine détruit
IV. RÉSURRECTION DE NAMREJ
V. ERRANCE DE L’APÔTRE-MENDIANT
1) Plainte du cavalier perdu
2) Conte de Marie, jeune soldate
VI. CALVARDE L’INCENDIAIRE
(À compléter)
« Je suis au troisième cerclé, de la pluie
éternelle, maudite, froide et pesante ;
sa règle et fonction jamais ne modifie.
Gros grêlons, neige et une eau dégoûtante
se déversent à travers l’air ténébreux ;
la terre qui les reçoit est puante.
Cerbère, fauve cruel et monstrueux,
de ses trois gueules aboie avec rudesse
sur la foule submergée en ce lieu. » — Dante Alighieri, Enfer, Chant VI.
Souvent quand je me réveille je ne sais plus où je me trouve. Les murs comme le plafond ont à peine l’apparence de la veille. Les pales des hélicoptères ressemblent à la chute des bombes, et parfois il s’agit bien de la chute de bombes, mais je me rassure en imaginant voler des hélicoptères. Parfois les bombes pulvérisent intégralement les immeubles en face de chez moi, et alors il n’y a plus rien à regarder qu’un immense tas de gravats et de corps. Parfois il y a des corps encore vivants qui crient, cela ils le disent aux informations, car moi je ne les entends pas. Les immeubles détruits mettent un temps considérable à être reconstruits, tous sont d’ailleurs encore en état de construction, ou détruits. Souvent les immeubles sont détruits la nuit, durant mon sommeil, et je ne les entends pas être détruits, et c’est ce qui rend mes réveils si étranges. Je pense qu’ils détruisent les immeubles la nuit pour ne pas choquer les voisins, pour qu’ils ne se rendent compte de rien, car la plupart des voisins ne remarquent qu’à peine la destruction des immeubles. Les voisins soutiennent que les immeubles ont toujours été détruits. Les voisins sont dupés par ceux qui détruisent les immeubles la nuit. Les voisins ne prennent pas le temps de penser à ce qui se passe d’horrible la nuit autour d’eux quand ils dorment. J’envie beaucoup l’insouciance des voisins, car elle leur permet de n’être pas perturbés à chaque réveil, et de travailler correctement la journée au bureau, chose que je ne suis plus capable de faire depuis qu’ils détruisent les immeubles la nuit. Bientôt mes chefs remarqueront comme je suis atteint par la destruction des immeubles, par mon manque manifeste de repères, et alors ils me blâmeront, puis me licencieront. À moins que l’immeuble dans lequel je travaille ne soit lui aussi détruit.
Une fois réveillé je mets un temps considérable à me lever car je ne comprends plus comment fonctionnent mes pieds, si jamais ils fonctionnent. Il me faut toujours comme réapprendre à marcher, réapprendre à vivre, et ça demande un effort incroyable, comme presque l’effort de naître à nouveau. De même, je laisse toujours la chambre de ma porte ouverte afin de m’assurer qu’elle ne mène pas en quelque endroit hostile et dévasté lorsque je l’ouvre au matin.
Toujours à l’heure où je déjeune le voisin joue du piano. Il s’exerce dirait-on, et ne progresse que peu. Les déjeuners en sont chaque jour plus pénibles, si bien que j’ai pensé engager un artisan pour renforcer l’isolation des cloisons, ce qui coûte en réalité une fortune et demande en plus l’aval de la copropriété en son ensemble. Je n’ai jamais vu la copropriété accepter la moindre requête proposée par un locataire. Je crois que les propriétaires participant aux réunions de copropriété se moquent tout à fait des problèmes d’isolation de l’immeuble, eux qui vivent la plupart du temps dans des bâtisses plus solides et mieux isolées à la périphérie de la ville. Les propriétaires doivent secrèrement espérer la destruction de l’immeuble pour ne plus avoir à s’occuper des réunions de copropriété, et même si cela devait les déposséder pour toujours de leur bien, et de la vie de plusieurs locataires, dont je fais partie. Sans avoir de connaissances particulières en architecture, je dirais donc que ce bâtiment a été mal conçu dès le départ, dès sa conception, qu’il a été mal imaginé par l’architecte dès qu’il en eut l’idée, et en tout cas il oublia d’accorder davantage d’importance à l’isolation, au bruit, ce qui fait de lui à mes yeux un bien piètre architecte, un bien mauvais constructeur. Cependant, je n’ose aller dire au voisin comme ses exercices me dérangent par peur de le froisser, et qu’il n’abandonne absolument l’apprentissage de cet instrument sonnant magnifiquement bien lorsque l’on sait en jouer. La voisine qui loge en-dessous ayant moins de scrupules, il lui arrive de taper au balais contre le plafond, mais cela ne semble aucunement le décourager. Que le voisin d’à côté témoigne du mépris à l’endroit de la voisine du dessous ne m’étonnerait pas une seconde, lui qui n’a jamais pris le temps de venir me saluer après avoir emménagé. De plus, la voisine du dessous a quelque chose d’immédiatement désagréable qui la rend aussitôt antiphatique pour n’importe qui, même les gens les mieux intentionnés, même ceux les moins aptes à haïr finissent par haïr la voisine du dessous tant elle est immédiatement antipathique.
Car le ciel, c’est le feu.
Je suis passé à la librairie. J’ai feuilleté De nos frères blessés puisque tout le monde en parle tant. Bon. Sans doute comme d’habitude n’y a-t-il pas tellement motif d’à ce point en parler. Un sujet comme j’ai l’impression qu’il en pousse à chaque fois qu’un nouvel auteur souhaite s’emparer de l’Histoire. Et puis, par hasard, je lis, juste après être sorti de la même librairie, un article sur la République des Livres qui, comme d’habitude (j’en étais certain) ne manquerait pas de me réjouir. Assouline ayant toujours un don manifeste pour me stimuler. Car l’auteur du sus-mentionné livre a dans la même semaine reçu (à la surprise générale) puis refusé le prix Goncourt du premier roman. Il n’en fallait pas plus pour partir à l’assaut :
« Difficile en tout cas de ne pas déceler sous la revendication d’idéalisme un mélange de mépris, d’arrogance, d’immaturité, surtout trois jours après, alors que sur le site de l’éditeur le livre était déjà ceint du bandeau “Goncourt du premier roman”. L’orgueil est toujours mal placé lorsqu’il se manifeste à retardement. »
On sent le juge blessé. On sent le donneur de bons points outré qu’on ait osé déchirer ses coupons. Difficile surtout de ne pas voir dans cette réponse le mépris d’une élite culturelle pour qui ne veut pas jouer selon leurs règles. Pris à leur propre jeu de s’être crus tout-puissants. Grand bien fasse à l’auteur qu’il puisse à la fois bénéficier de cette influence tout en leur ayant dans le même temps habilement marché dessus.
J’ai tout de même acheté la nouvelle traduction de l’Enfer de Dante, par Danièle Robert (en attendant celle d’Antoine).
Au centre du temple, enveloppée dans un linceul en peau de cuir, leur mère à tous deux reposait, le poignard assassin encore au creux du cou. Lors de l’incinération, l’arme du crime devait rester dans le corps de la victime, ainsi qu’il était écrit dans le Livre des Cadavres. Une fois le corps réduit en cendres, et le linge de même, durant le voyage dans la mort outrepassée, le Juge noir retirera de ses propres mains l’arme fautive du cou de la mère, et la plaie ne saignera pas, et le sang deviendra sec, car l’arme aura été lavée. Les deux frères Machine et Calvarde quittèrent le temple l’un derrière l’autre, après que tous les sages eurent fait de même. Machine regardait Calvarde avancer devant lui, et il ne devinait aucune peine en son frère. Calvarde ne semblait aucunement affecté par la mort criminelle de leur mère. Calvarde était sans compassion. Le manteau de bête maintenu sur son torse par une chaîne en acier se gorgeait de la pluie jaune du ciel d’orage. Que le poignard court fiché dans le cou de leur mère était celui de Calvarde, Machine n’en savait rien encore.
Je serai seigneur du ciel, dit Machine. Je serai seigneur du feu, dit Calvarde. Et ainsi les deux frères se répartirent le royaume qu’avait construit leurs aïeux et que possédait leur mère.
« Mais je vois bien que pour moi il y a seulement de moins en moins de temps à l’instant où je suis, ce qui explique non pas qu’il n’arrive rien, mais que ce qui arrive soit comme la répétition d’un même événement, — et cependant non pas le même : il s’enfonce à un niveau sans cesse plus bas, où il semble errer plutôt à la manière d’une image, quoiqu’il soit absolument présent. » — Maurice Blanchot, Au moment voulu.
Le mendiant songeait aux paroles d’Orstir le voyant. Vois comme les chaines entravent leurs poignets ; vois comme les chaines entravent leurs chevilles. Les chaines étaient accrochées dans le bitume et seuls ceux autorisés par le père fautif Calvarde pouvaient s’en détacher ; des chiennes léchaient le métal brûlant des chaînes et leurs langues se boursouflaient de cloques. Les chaines étaient dissimulées par les haillons et les tissus des mendiants. La parole seule ne suffisait pas à rompre les chaines. La parole seule était impuissante.
D’autres figures en haillons circulaient parmi les mendiants ; elles semblaient plâner mais leurs vêtements dissimulaient ce miracle. La pointe de leur cladio grinçait au contact de la pière au sol, et comme des ailes d’aigle pourries leur transperçaient le dos. Une plainte permanente s’échappait de leurs bouches, et ces figures étaient rares, car elles se réfugiaient dans la brume, car elles étaient laides d’avoir été déchues par le père fautif Calvarde lorsqu’il prit le contrôle du ciel. La seule présence du père fautif Calvarde suffisait à tout anéantir, à tout réduire au silence.
J’aimerais dire la fugue, mais n’ai jamais fugué. J’aimerais dire le deuil, mais n’ai perdu personne. J’aimerais dire les coups et les membres cassés, mais jamais on ne m’a battu. J’aimerais dire la maladie, mais j’ai toujours guéri. J’aimerais dire l’abandon, mais tout le monde est là. J’aimerais dire l’attente d’un bateau et les soirs dans le port, mais j’ai la ville comme maison. J’aimerais dire l’exil, mais je ne suis jamais parti. J’aimerais dire quelque chose, mais j’ai déjà tout dit.
Sorti absolument épuisé de la lecture de Corrections. Bernhard (et davantage encore sur 400 pages !) broie la parole et son rouage est si fort qu’il est presque impossible d’arrêter sa lecture et pourtant c’est insupportable et pourtant on a la nausée et pourtant on voudrait s’arrêter à chaque page, bientôt presque à chaque phrase, à chaque mot, mais on se retrouve foré par la voix, et par la parole, et par la chute sans cesse repoussée des âmes et des corps.
« sa mémoire est rayée
de la terre et son nom
est biffé sur les cartes
il est chassé du jour
poussé dans les ténèbres
exclu de l’univers
pas de lignée pour lui
pas d’enfants dans son peuple
pas de quartier chez lui
à l’ouest on plaint son sort
à l’est on en frissonne
— voilà où vit l’injuste
où finit le sans-dieu. » — Job, 18:17
attendez, oui, et, voilà, j’préfère fermer la f’nêtre parce que l’père Cide va commencer d’tondre il en a pour l’après-midi après ça qu’on s’entendra plus parler donc, oui, ben tenez, c’est su’ l’ père Cide plutôt qu’vous devriez enquêter lui il en a du mystère dans sa maison, hein, c’est bien simple, il se trouve, un soir, comme qui dirait, enfin, c’est c’qu’on m’en a dit moi j’étais pas là quand ça s’est passé, qu’on aurait vu sa femme courir dans l’bosquet que, oui çui-là là-bas, non, oui, qu’est s’rait partie en courant là d’dans et qu’le père Cide l’aurait pourchassée, en plein milieu d’la nuit, moi j’ai rien entendu, avec ces cachetons j’m’endors comme une masse, et qu’au lendemain matin, y avait bien le père Cide, mais plus d’femme, hein ? oui bien sûr, oh ben bien sûr oui, la police a cherché partout, pas de traces de la femme, non non, enfin elle a été disparue trois jours après un type l’a r’trouvée elle avait été, enfin, j’préfère pas donner les détails qu’on en f’rait des cauchemars, tout le village qu’était à l’enterrement qu’on y voyait même plus la tombe, enfin, trois jours encore plus tard, le père Cide qui change de voiture, qu’il se prend un gros quat’-quat’, et depuis qu’il part en pleine nuit, c’est à côté qu’on m’a raconté ça, personne sait où, et y r’vient au matin alors ça si c’est pas du mystère ça inspire rien d’bon j’dirais mais après j’fais pas votre travail m’dame j’me permettrais pas d’dire c’qu’il faut qu’vous fassiez ou pas j’dis juste ça en l’air faites aussi bien comme si j’avais rien dit
ah ben ! p’tête que l’père Cide avait queq’chose à s’reprocher qu’mon Gave savait, rapport à l’histoire dans l’bosquet ça pourrait être possible vu qu’mon Gave avait l’habitude d’se poster su’ l’toit la nuit ça s’trouve il a tout vu et l’père Cide l’a p’tête vu aussi et p’tête qu’il lui est tombé d’ssus, hein, ben, non mais attendez, là j’vous dis vous me demandez, j’vous réponds, si vous êtes pas convaincue, moi j’donne les pistes après c’pas mon boulot m’dame que d’démêler l’sens de tout ça, déjà qu’la peine m’est tombée d’ssus qu’j’my attendais pas alors, j’dis p’tête qu’le père Cide qu’il aurait à s’reprocher queq’chose après j’crois tout l’monde a ses démons j’vous ai dit tout le monde c’est l’village qu’est comme ça c’est, oui, ah ben l’père Cide qu’il a toujours cru tout l’monde lui en voulait d’sa réussite, même ça femme qu’elle tournait barrique m’étonne pas qu’elle s’soit carapatée dans l’bosquet moi depuis longtemps qu’j’l’aurais plombé l’père Cide, ah ben si ! ah mais on vous a pas dit ! ah mais l’père Cide qu’il était passé dans l’poste, à l’émission, oui oui, qu’il avait gagné une p’tite somme, ah ça, ça a fait parler au village ! ah oui ! ah ben ça ! qu’il a tout dépensé pour ses fusils, ah ça ses fusils ! ah tout l’monde pourrait vous l’dire, et zéro pour sa femme, ah zéro oui ! ah ça qu’c’est pas la générosité qui l’tuera l’père Cide mais l’est connu pour ça qu’y règle jamais ses ardoises au bar ah oui il est connu pour ça ah il en avait des dettes avec des types d’la ville ah des gars louches ah ça, qui v’naient rôder là, qu’ça effrayait les mômes, ah oui ! ah ben oui ! ah l’père Cide ! hein, oh ben louche j’sais pas moi, comment j’pourrais vous dire, l’genre bien habillé pis grosse bécane, oui quat’-quat’, oh, d’temps en temps, après c’était surtout pour les mômes nous, oui, alors qui dit qu’mon Gave il se s’rait pas fait plomber par les types louches du Cide, maintenant que j’le dis, pourquoi pas qu’ça s’rait pas ça la vérité, la clé d’votre enquête m’dame, la clé d’sa mort à mon Gave
Possiblement cette seconde citation en épigraphe de La ville fond (dans Corrections) : Nous voyons un paysage et nous voyons un être humain dans ce paysage et paysage et être humain sont toujours autres, à chaque instant, bien que nous supposions et que, dans cette erreur, nous nous risquions à continuer d’exister, que c’est toujours la même chose, selon Roithamer.
(Demain soir, le 11 mai, à 19 h, à la librairie La Manoeuvre, Paris 11, une rencontre est organisée avec les auteurs français publiés pour l’instant cette année chez l’Ogre, ainsi qu’avec les deux charmants éditeurs de la dite maison, ce qui comprend donc : Lucie Taieb, Claro, Maurice Mourier, Benoit Laureau, Aurélien Blanchard, et moi-même. Venez nombreux, il y aura sans doute de quoi se réjouir.)
« Quand nous le disons, ce que nous faisons s’anéantit. Ce que nous publions s’anéantit à l’instant de la publication. »
qu’en parler, quoi ? non, qu’en parler ranime toujours quelque chose, vous savez, de lui, je suis pourtant pas spirituelle pour un sou, pas mon genre, qu’il m’aurait toujours défendue d’y croire, qu’il était pas de ce genre-là non et, hein ? non non, bien sûr que non, oh non il n’était pas de ce genre-là non plus hein ? oui bien sûr ils vous diront le contraire, et, enfin, je vais vous dire, tout ça circulait déjà de son vivant, quoi ? oui oui l’histoire du toit oui bien sûr, que voulez-vous que je vous dise, oui bien sûr il y avait une trappe enfin ça a jamais été un secret pour personne qu’il allait dessus parfois pour espionner les voisins enfin quoi vous savez comment c’est les petites manies de chacun, moi j’viens pas fouiller vos tiroirs pourtant sans doute que j’y trouverai, oui, enfin oui, non, mais oui non mais attendez laissez-moi terminer, qu’on parte pas fâchées, vous revoulez un peu de jus ? attendez, je me sers, oui, voilà, je disais, je savais bien qu’il espionnait les voisins, enfin, les voisines, bien sûr j’étais pas dupe, oui, je suis vieille mais pas encore con, enfin, il savait bien que j’étais pas con et que je le voyais monter sur le toit pour guetter les voisines et un peu s’toucher l’engin, et elles se doutaient de rien j’crois, enfin, on a jamais eu de plaintes, enfin, il recevait parfois des courriers bizarres, hein ? oui voilà, des espèces de menace, mais au bourg tout le monde se regarde un peu du coin d’l’oeil, c’est l’genre du coin enfin, on s’apprécie bien sûr, non, c’est pas la question, mais là vous m’demandez qui pouvait lui en vouloir, moi c’est tout c’que j’peux vous dire, qu’il mattait les voisines et qu’on avait du courrier bizarre parfois le matin mais jamais on lui est tombé dessus, quoi ? non jamais de coups, jamais les pneus crevés, enfin, à moins qu’il me l’ait pas dit, là je dis pas, je peux pas tout savoir de la vie d’un homme, qui pourrait, hein, vous il fait quoi le votre de bonhomme en ce moment, oui, on peut pas savoir, hein ? on peut pas savoir non, moi j’pense, attendez, vous en voulez toujours pas ? je pense on peut pas savoir, attendez, je vais vous dire,
moi c’est ce qu’on m’a racontée, après j’étais pas là, on devrait pas parler, vous noterez pas, c’est dans la confidence, bon, un biscuit ? bon, une nièce d’une amie, à peine majeure, oui, enceinte, ça arrive, le type reste, bon gars, un pêcheur, il part six mois il revient, toujours voilà il part six mois, il revient trois, c’est le travail, oui, non pas facile, oui, enfin, il revient une fois après six mois en mer, la fille l’attend sur le quai, c’est pas le même type, hein ? non pas le même type je veux dire c’est un type complètement différent, genre un gus qu’elle avait vu, oui, c’est ça, il lui dit c’est moi, il l’embrasse, il porte la p’tite, mais la fille elle se dit : c’est pas l’même type, où qu’il est mon type, c’est ce qu’elle se d’mande sur le quai, hein ? oui, et là je redis, ça elle l’a dit à sa mère et sa mère à mon amie et mon amie à moi y a p’t’être que j’me trompe par endroits mais ça j’m’en souviens bien : la fille elle se dit : ce type-là c’est pas mon type, alors, hein ? non attendez la fin, ils rentrent ils se couchent là le type enfin, voilà, les affaires de couple, le lendemain il repart en mer pour six mois, la fois d’après il revient, et là c’est bien lui, le vrai quoi, son vrai bonhomme, alors comment qu’on m’explique le mystère du bonhomme du milieu enfin, elle en tout cas elle s’l’explique pas, la pauvre parfois même qu’elle s’en rend malade la nuit, alors voilà, enfin, un biscuit ? non ? du jus ? oui, non mais c’est pour vous dire, parfois des choses arrivent, enfin, oui bien sûr, non il a pas été tué, ils sont toujours ensemble, oui une maison sur la côte, oh ils sont bien installés, non bien sûr rien à voir avec mon bonhomme mais voilà pous vous dire : faites attention, parfois on croit parfaitement connaître quelqu’un et la stricte vérité c’est qu’on le connaît pas que ça pourrait être comme un étranger, c’est pour ça, les ennemis, oui, il était peut-être gangster, je saurais pas dire, moi j’ai que ma cuisine et ma cafetière et mes rognons alors, je vous parle à partir de ça, et après, enfin, vous vous débrouillez
Le mendiant eut du mal à parvenir jusqu’aux premières zones vertes car elles étaient encerclées de grillages ; il s’en remit à sa croyance en Namrej le ressuscité pour franchir ces obstacles, et ne pas se blesser au contact du poison. Le mendiant se refugiait sous des porches et là il vénérait Namrej et il invoquait sa protection et sa toute puissance et sa lumière pure ; car la lumière du père fautif Calvarde était de brûlures et de sel. Le mendiant devait dissimuler sa bouche dans un foulard pour ne pas que le père fautif Calvarde ne la remarque. À l’intérieur des zones vertes les humains se regroupaient autour de barils incendiés ; leurs tissus étaient sales et troués. Les zones vertes étaient toxiques et les arbres verts l’étaient également. Il ne fallait rien toucher sous aucun prétexte. Etc.
Partout le mendiant prit la parole. Il dit à ceux des zones vertes, et des usines, et des décharges-refuges la parole transmise par Orstir le voyant. Il ne déforma aucun mot transmis par Orstir le voyant. Sa langue n’était pas celle d’Orstir pourtant sa langue transmit exactement la langue d’Orstir, et les paroles exactes, et le message divin de Namrej ressuscité. Et il disait le nom de Namrej et parfois il témoignait de sa résurrection. Parfois le mendiant s’asseyait sur des caisses en bois ou sur le sol car la foule rampait et les oreilles de la foule ne pouvaient percevoir de paroles trop hautes. Le mendiant parfois chuchotait au ras du sol les paroles d’Orstir, et parfois il les criait tant les foules étaient sourdes et dispersées. Dans les zones vertes le mendiant fut agressé, comme dans les usines, comme dans les décharges-refuges. Partout où il passait il était agressé, car la parole d’Orstir ne trouvait aucune oreille amie. Et parfois le mendiant quittait ces lieux le visage déchiré par les pierres, et il se retournait, et il voyait les centrales et les cheminées, à travers le sable des tempêtes, et il voyait un homme, ou une femme, le suivre de loin, apeuré. Alors le mendiant s’asseyait et attendait que l’homme ou la femme le rejoigne, car il savait qu’avec de la patience il ferait d’eux ses compagnons. Finalement ils approchaient et s’asseyaient dans le giron du mendiant, et se taisaient. Alors le mendiant recouvrait ses nouveaux compagnons d’un habit semblable au sien, puis ils poursuivaient leur route, puis ils parlaient ailleurs, et ainsi leur groupe a grossi, et ainsi la parole s’est répandue, et ainsi les adeptes se sont multipliés.
« Soudain, une idée est là et demande à se réaliser ; toute notre vie, toute notre existence est faite de ces idées qui demandent à se réaliser ; si cet état s’interrompt, la vie s’est interrompue, la mort a fait son apparition. Nous sommes seulement composés d’idées qui ont surgi en nous et que nous voulons, que nous devons réaliser parce qu’autrement nous sommes morts, ainsi pense Roithamer. » — Thomas Bernhard, Corrections.
La brume en se déposant sur la ville trempa l’habit du mendiant.
Orstir le voyant et Namrej le ressuscité marchaient dans la boue des bas-quartiers ; là se baignaient les enfants-pillards ; les femmes y lavaient le linge et les draps. Toutes en demi-cercle à genoux contre le grès des lavoirs, des rats ouverts flottant parmi les feuilles mortes. Namrej le ressuscité s’agenouilla à côté de l’une d’elle, prit son drap et le frotta dans la souillure de l’eau. Le drap lavé par Namrej sortit d’azur depuis la boue ; il en couvrit les cheveux de la servante au dos voûté. Puis il se releva et continua sa marche aux côtés d’Orstir le voyant. Aux fenêtres d’autres enfants les observaient et jetaient en riant sur leurs visages des détritus et de la sciure. Vois ce pays que domine la poussière, dit Orstir à Namrej, vois comme les cendres tombent du ciel. Alors Namrej tendit la main : une salamandre s’endormit dans sa paume.
Jeudi dernier, un romancier, Didier Van Cauwelaert, était invité dans l’émission La Grande Librairie pour parler de son dernier roman : On dirait nous. L’enthousiasme de la discussion entre le présentateur et le romancier était tel que je n’ai pu m’empêcher d’aller voir de quoi il en retournait dans le texte. Par chance, les premières pages étaient disponibles sur le site de l’éditeur. Aussitôt, le style m’a frappé par sa singularité. J’allais d’étonnement en étonnement. Ce texte était véritablement incroyable. Une telle utilisation chaotique et primaire et décomplexée de la grammaire et du rythme ! On frôlait l’expérimental, le post-modernisme ! Voilà bien toute l’audace de cette émission qui mettait en avant une telle pointure ! Jusqu’à la dernière page proposée, s’ouvrant sur une trouvaille inédite, que j’ai soulignée pour mettre en valeur toute l’intelligence, toute la finesse, toute la vision du romancier : « J’ai dégluti en acquiesçant des paupières ». Il ne me semble pas utile d’en ajouter davantage.
(Une lecture de Saccage, par Éric Darsan : « Anticipation sociale et chanson de geste, récit choral, focal, oracle et prophétie, Saccage est un premier roman néo-poélitique puissant et fantastique sorti le 4 mai. Avec lui, Quentin Leclerc dépasse les bornes, l’entendement, marque pour mieux les défaire — au fer rouge toujours, au fil blanc, à la pierre — les frontières du possible et du réel sans cesse repoussées par Les Éditions de l’Ogre depuis leur création. »)
Orstir le voyant sortit du hangar jusqu’au parapet de pierre qui longeait l’eau du fleuve. Un immense pont de métal le surplombait. Deux mendiants se battaient à l’abri de l’ombre, sous l’arcade, sous de larges tentes en toile de jute. Un drone circonscrivait le combat au halo de ses torches ; les mendiants se prenaient le visage, et les doigts déformaient les bouches ouvertes par la lumière intense ; le bruit des moteurs et la fumée d’échappement encombraient l’atmosphère et désolaient le bitume. Et les corps agitaient la poussière au sol en rideaux menus, qu’Orstir le voyant franchit sans déranger l’affrontement. Quand l’un vaincut l’autre, ses deux mains en étau finissant d’étrangler le cou blanc, il pleura allongé, tenant sur son propre ventre le frère assassiné. Le drone éteignit ses torches, s’éloigna. Orstir le voyant s’avança et posa sa paume gauche sur le ventre du mort. Puis il enfonça son poing droit dans la bouche encore ouverte du mendiant battu. Il dit alors : Tu seras le corps neuf de Namrej le ressuscité, revenu sauf depuis la vie-morte du père-busard Machine, revenu Machine au visage double et au Verbe Saint.
Alors le ventre fut prit de spasmes, la bouche cracha dans la poussière ; le corps se redressa complètement. Le mendiant vainqueur contempla la charpie ressuscitée de son frère assassiné, et s’agenouilla devant Namrej le ressuscité, revenu depuis la vie-morte du père-busard Machine. Sois le premier témoin de la vie-morte de Namrej le ressuscité, dit Orstir au mendiant, sois la première langue à rendre compte du divin Messager revenu. Porte la parole à ceux tes frères désormais esclaves du miracle, poursuivit Orstir. Dis-leur qu’il est à nouveau au monde celui qui nous délivrera tous du père-fautif Calvarde. Le mendiant acquiesça tandis qu’Orstir le voyant escortait Namrej le ressuscité jusque dans le hangar abandonné. Son crâne rouge était balayé par les faisceaux des sentinelles alentour. Enfin il retourna dans l’ombre du pont, brûla ses tentes, et s’avança au dehors, sous le soleil calciné du père-fautif Calvard, débutant alors son misérable périple d’apôtre jusqu’aux zones vertes, aux usines, aux décharges-refuges.
(Réfléchir à une Langue particulière des apôtres, proche de celle de Guyotat.)
Ces auteurs “débordés” par leurs personnages, ceux-ci ayant, apparemment, sortie de nulle part, “une vie propre”, “des décisions personnelles” ; mais de quelle fable veulent-ils se convaincre là ? « Les personnages font ce qu’ils veulent avec nous », bon ; « Je suis rarement le maître d’oeuvre, pour tout dire », quelle paresse alors !
(Donc oui, mon premier livre, Saccage, est désormais disponible à la vente ou sur commande en librairie. Il y a la fiche éditeur en haut du site pour davantage de détails.)
Pour chaque nouveau texte, je ne fais que reconfigurer les mêmes obsessions, les mêmes tropismes. Je m’évertue pourtant toujours à écrire quelque chose de différent, à chaque fois d’aller puiser là où l’eau est claire, où je n’ai pas remué la vase avec tout mon attirail, mais je remue pourtant toujours la même vase, avec toujours les mêmes instruments, je ne fais qu’écrire les mêmes choses différemment. Peut-être n’en sortirai-je jamais, de la forêt, des fusils, du froid, des champs. Peut-être y a-t-il une scène fondatrice, un décor initial, premier, qu’il s’agit de saisir au mieux, c’est-à-dire toujours le plus imparfaitement possible, afin de toujours pouvoir en parler, de toujours pouvoir ressasser, d’être toujours bavard, insupportablement bavard.
Assouline a encore frappé ! « Je n’ai jamais compris que l’on puisse décréter que certains livres étaient, comme l’on dit désormais atrocement, « genrés ». […] Cela commence souvent dès la littérature « Jeunesse » et cela se termine place de la République où des réunions féministes de la Nuit debout sont interdites aux hommes. » On ne l’avait pas vu arriver, il se dissimulait, derrière un buisson, un lampadaire, sous une plaque d’égoût, il était là, il avançait patiemment, il guettait l’instant, et il vient à présent, avec sa pensée, il est prêt à tout, il va enfoncer les barricades, se révolter contre l’absurdité contemporaine, l’épée à la main, il va coûte que coûte accomplir sa quête incomprise d’homme blanc.
« Il me suffirait d’être imprimé de la façon la plus exacte possible, avec le minimum de coquilles, le plus simplement possible, sans sophistication particulière dans la mise en page. Et que je puisse en vivre. Le reste ne m’intéresse pas. Ce qui vient après aurait toujours plutôt tendance à m’horripiler. » — Thomas Bernhard, Sur le papier, je pourrais tuer quelqu’un.
Manuel à usage des plus décidés :
- Ôtez les casques puis cassez les têtes
- Prenez les matraques puis tapez les têtes cassées
- Prenez les divers pistolets et fusillez dans les yeux et dans les bouches
- Fusillez les têtes cassées par les coups
- Ôtez les uniformes et marquez les corps
- Mettez la fumée dans les bouches et ainsi dans les corps
- Là où il y a des vitres brisez les vitres et faites les manger aux têtes cassées
- Mettez des pétards et des explosifs dans les bouches et dans les corps
- Quand il y a des cris mettez des baillons
- Quand il y a le silence faites vous-mêmes les cris et mettez les baillons
- N’arrêtez jamais
- Si jamais vous n’avez plus la force passez à celui qui attend derrière
- Que celui qui arrive derrière répète ces étapes deux fois plus fort
Le clip réalisé à l’occasion de la nouvelle chanson de Radiohead (Burn The Witch) est réellement magistral. Dans un petit village, un homme demande à la foule devant lui de se disperser, après leur avoir communiqué ce qui semble être un plan. Les villageois s’activent et repeignent, construisent, tondent pour améliorer l’apparence générale. Un homme arrive en voiture, qui a l’air d’un inspecteur, policier peut-être, ou agent administratif. Il prend note de ce qu’il voit, de ce que l’homme lui montre du village. D’abord naïve, la balade tourne vite au cauchemar : des carcasses sanglantes sur un étal, une potence fleurie, des juges à l’épée autour d’une femme attachée. Enfin, à l’occasion d’une fête comprenant tous les villageois, est révélée une immense construction en bois à l’intérieur de laquelle l’inspecteur prend place. Une villageoise vient brûler la construction et l’inspecteur. Les villageois se tournent alors vers la caméra, et saluent chaleureusement le spectateur en guise d’au revoir.
Hier, la journaliste m’a demandé si Saccage était politique. J’ai réfléchi un peu, sans trop savoir où me situer, pour finalement dire qu’il ne l’était pas vraiment. Qu’il y avait une révolte, une résistance, mais pas de revendication. Maintenant je me dis : à partir de quel instant quelque chose devient politique ?
« Les nuits à présent sont pleines de vent et de saccage ; les arbres plongent et se courbent et leurs feuilles tourbillonnent pêle-mêle avant de tapisser la pelouse, de s’entasser dans les chéneaux, d’engorger les conduits et de joncher les sentiers détrempés. » — Virginia Woolf, Vers le phare.
L’obsession, enfant, pour des espaces violents circonscris aux tailles des feuilles sur lesquelles je les dessinais (et sans doute encore archivés dans une grande pochette entreposée chez ma mère). Des bâtiments toujours comme en coupe, les façades invisibles, juste des murs, des traits fins, pour séparer les différents éléments. Aucune notion de perspective, d’architecture. Des emboitements sommaires, de machines de guerre principalement, d’hélicoptères, d’hommes à pistolets. Des tanks propulsant des boulets étranges, car incapable alors de représenter la vitesse, je les multipliais sur une même trajectoire, comme le même boulet filmé au ralenti, l’image ensuite décomposée, laissant voir chaque instant de l’unique boulet propulsé. Et ainsi sur des feuilles colossales, des scènes de guerre ininterrompues, globales, toujours dans l’acte, toujours dans l’absolue horreur de la mort en train de se faire.
Jamais été grondé pour de tels dessins ; jamais été puni.
Je venais de payer mon sandwich dans la boulangerie, et n’avais pas fait attention à l’homme qui était rentré à l’intérieur en même temps. En me retournant, alors que je rangeais mon portefeuille, il se tenait devant moi, vraisemblablement aveugle, et demandait une pièce. Les vendeuses alors l’interpelaient pour qu’il parte, pour qu’il ne dérange pas les clients, mais il continuait à circuler, toujours plus près des pains, des patisseries, les mains tendues. Pris au dépourvu, puisque j’étais en train de ranger ma monnaie, je lui laissais une pièce dans la paume. Il me dit aussitôt « Pas assez », et j’ai haussé les épaules, l’air de dire : si, c’est largement assez. Une fois sorti, j’ai eu honte de moi. J’aurais pu lui vider mon portefeuille dans les mains, que ça n’aurait encore pas été assez.
Je me souviens d’une fin d’après-midi de septembre, en 2012, passée à hurler seul de tristesse dans ma chambre. Je n’en retrouve aucune trace dans mes Relevés.
« (Je m’aperçois que je cherche toujours les signes de la littérature dans la réalité.) » — Annie Ernaux, Journal du dehors.
Je viens d’achever la lecture du Bruit et la fureur, et je me questionne encore quant au fait de marquer les accents des personnages Noirs (par exemple, “Caroline” transformé en “Ca’oline”). Les trois premiers chapitres sont en focalisation interne, et donc peut-être là pour rentranscrire une vision raciste des personnages (au moins pour l’un d’entre eux, Jason, c’est le cas), mais le dernier est en focalisation externe, et j’ai donc du mal à trouver une justification à ce procédé. J’ai pensé qu’il s’agissait d’une mauvaise traduction, mais dans la version originale, on retrouve par exemple « “Lawd knows.” Luster said ». Marquer les accents était sans doute une réalité sociale (l’est toujours), mais devait-elle pour autant devenir une réalité littéraire ?
La mise en avant des accents est toujours une marque de domination : mal parler, mal maîtriser la langue, c’est être plus faible, plus bas, que ceux qui savent. Marquer le mauvais parler. Dans Tout s’effondre de Chinua Achebe, traduit aussi de l’anglais (Nigéria), il n’y a à aucun moment aucun accent. Pourtant, il y a dans son roman également un rapport de domination, puisqu’il s’agit de l’arrivée des colons anglais à la fin du XIXème siècle dans un petit village. Mais les personnages nigérians parlent toujours un bon anglais. Et surtout, le narrateur ne marque à aucun moment l’accent des colons. Chacun est à sa place quant à la langue qu’il parle ; elle ne pose pas problème.
Bien sûr chez Faulkner la réflexion est plus large, puisqu’elle comprend également le parler des paysans, avec ses ruptures syntaxiques et ses difformités grammaticales (d’ailleurs, détail amusant : celui qui s’exprime le mieux, Jason, est celui qui a le moins de vision, de poésie), mais j’y ressens malgré tout un jugement qui me déplait. Est-ce ce narrateur ému par le déclin de ces petites gens de peu, touchants car maladroits ? Le Pinget de Clope au dossier me semble beaucoup plus sincère.
(Mérite d’être approfondi.)
Comme chaque semaine, Bram aimerait se rendre en ville. Mais il est parfois difficile d’arriver là où l’on souhaite aller.
« Et je crains toujours de laisser échapper quelque chose d’essentiel. L’écriture, en somme, comme une jalousie du réel. » — Annie Ernaux, L’occupation.
L’arsenal répressif des policiers devient à chaque nouvelle occasion plus dément. Et les journaux télévisuels qui vantent dans le même temps avions de chasse, sous-marins, que nous vendons à l’étranger, à quels pays ?, demande le présentateur, et combien cela rapporte à la France ? ; pas : pour détruire qui ? bombarder qui ? exterminer qui ? pulvériser quoi ?
Dans Saccage, il y a l’extrait d’une page de magazine déchirée (un magazine d’armes, d’outils, de bêtes). Je me demande parfois si ce genre de magazine n’existe pas vraiment, tant ce commerce me semble absurde et répugnant.
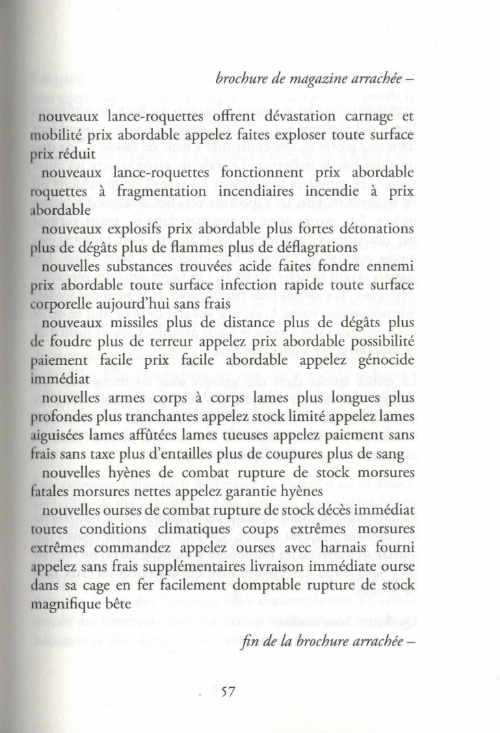
En arrivant à Rennes quelques heures après la manifestation : à quel point les rues sont vides. J’ai vu les images, la bombe artisanale, le caméra de surveillance mise à terre, les affrontements, les barricades, et désormais plus rien. Je maintiens que la stratégie d’occupation et d’opposition se coule encore trop dans les règles fixées par l’État. Pourquoi ne pas ruser ? Prendre d’assaut les rues et les places une fois les barricades ôtées ? Tenter la surprise ? Il n’y a plus personne à présent. Le temps que les CRS se mobilisent, la place du Parlement sera déjà pleine. Il y a une espèce de conformisme dans la révolte qui me semble un peu triste, un peu décevante.
« J’ai partout cherché l’amour de ma mère dans le monde. » — Annie Ernaux, « Je ne suis pas sortie de ma nuit ».
Douleur persistante au talon droit.
Rêve atroce : une rue au-dessus de chez Cécile, je rentre dans une voiture mais ne suis ni le passager ni le conducteur. Les deux hommes parlent puis se prennent au corps, dans l’espace clos, au-dessus du volant. Un couteau vient trancher les doigts du passager, puis le conducteur saisit son visage et écrase ses orbites en y enfonçant les pouces. Puis il rend le passager aveugle au dehors, lui dit quelque chose, un verset biblique je crois, referme la porte et le rêve du même coup.
« Un autobus est arrêté, vidé de ses passagers, poussé jusque dans la rue de Kiev, mis en travers et incendié. Les voitures en feu se multiplient sur les parkings. À 20 heures, trois compagnies de CRS (420 policiers actifs hors officiers) et un escadron de gendarmes mobiles (120 militaires) sont déployés rue de Kiev. Les affrontements durent jusqu’à 23 heures. » — Mathieu Rigouste, La domination policière.
C’est en griffant la peau qu’il vit la peau griffée. Il ne comprit pas ce qu’avaient fait ses doigts. À les considérer comme griffes il n’y avait jamais pensé. Mais à présent qu’il y avait balafres il considérait ses griffes et la peau balafrée. Il crut mordre mais il n’y avait rien à mordre dans la plaie. Il prit la hache et fendit la plaie, qui sans blessure ni cri s’ouvrit jusqu’à l’os. Il mit ses ongles dans la plaie puis écarta la chair, et la chair se fendit sans que l’os ne hurle ; et sans que la douleur ne vint. Sous la peau que jamais le soleil n’atteint, dans le sombre de la chair écartée, et saignée sans douleur, et saignée sans écoulement, pas même les doigts aux mains sales, il vit le fond d’une blessure. Il se dit qu’il était sans douleur d’astiquer la plaie, qu’il était sans panique à moins d’y voir la mort. Mais qu’à hurler sans retenue on ne fait qu’entamer le coeur.
Un homme au blouson noir matelassé, la tête enfouie dans la terre, et l’écharpe rouge empoussiérée autour du cou. Dans les plis du blouson comme des réserves de sable. Les yeux de l’homme dans la terre voient la terre.
Arthur Dreyfus a quand même l’air assez con.
Chez certains (la plupart des) éditorialistes et autres journalistes peu scrupuleux, il y a toujours un intense défaut de compréhension des structures sociales. Ainsi ils se plaignent d’être rejetés de certaines réunions ou de certains camps non-mixtes, plaident la ségrégation, le racisme anti-blanc. Sans prendre conscience qu’il ne peut pas s’agir de telles choses dans un pays structurellement et socialement dominé par les blancs. Que la ségrégation ne séparait pas à égalité, mais rejetait et restreignait une partie de la population pour mieux la dominer. Qu’ici, il s’agit de factions de résistance face à une majorité étouffante et intolérante, majorité disposant toujours de 99% de la capacité de son territoire, de ses institutions, et de ses espaces de discussion. C’est l’enfant égoïste qui a tous les jouets mais désire ardemment le seul que possède son voisin. Et ne faiblira pas tant qu’il ne l’aura pas obtenu, quitte à réduire son rival à néant.
À lire, cet article essentiel de Christine Delphy : La non-mixité, une nécessité politique.
Je lis en ce moment “La gauche”, les Noirs et les Arabes, bel ouvrage d’introduction aux problématiques islamophobes et racistes contemporaines. Mais un hiatus persiste concernant la loi de 2004 sur l’exclusion des élèves voilées, et sur lequel je me questionnais déjà après ma lecture de Les filles voilées parlent. Je ne comprends pas comment on peut considérer que rejeter des jeunes femmes de l’école, sous prétexte qu’elles soient manipulées (ce qui repose déjà sur une quantité de préjugés hallucinante), favorise leur intégration sociale (tant souhaitée par nos politiques, et dont le sens est toujours à définir clairement). Simplement, logiquement, je ne le comprends pas. Je n’y trouve aucun sens. Il me semble évident que de tels choix favorisent encore davantage le repli. Ce qui entraîne soit une déception profonde, soit une haine totale, quant à ce qu’est la France, et ce qu’elle représente comme rejet de l’autre. Exclure encourage le ressentiment. On n’embrasse pas qui nous gifle.
Pour quelque enfant que ce soit je ne comprendrai jamais une telle logique.
Ce matin, vers six heures, le téléphone chez ma grand-mère a sonné. Il ne devait pas sonner. Du moins, pas celui-là, mais son téléphone portable, que devait faire sonner la voisine pour la réveiller, car elle devait prendre la voiture tôt. La sonnerie m’a réveillé d’un coup et je n’ai pas compris tout de suite où j’étais. J’ai cru me réveiller à Rennes, et me suis demandé pourquoi Alice faisait tant de bruit en rentrant, et pourquoi à cette heure, et d’ailleurs quelle heure il était. Puis j’ai entendu ma grand-mère répondre au téléphone et dire que son téléphone portable n’avait pas marché. Je me suis rendormi, avec cette idée tenace pourtant : à mon réveil, je n’étais pas là où je croyais être.
Je n’ai pas l’habitude de réserver ce type de chambre. Le néon au-dessus du miroir de la salle de bain grésille. À travers la fenêtre on aperçoit les toits de tôles des usines, les fientes, et la fumée des cheminées. Je ne comprends rien au fonctionnement de la télévision. La télécommande m’a lâché dans les mains. Je me suis couché tôt sans manger. Une fois la veilleuse éteinte, la lumière des lampadaires extérieurs s’est répandue dans la pièce. J’ai fixé le plafond en attendant qu’ils s’éteignent, ce qui n’est jamais arrivé. J’ai appelé l’accueil mais personne ne m’a répondu. Je suis sorti dans le couloir voir ce qui pouvait s’y passer, et il ne s’y passait rien. Je me suis assis le long d’un mur sur la moquette et j’ai fermé les yeux. Un couple a fini par sortir de l’ascenceur pour se diriger aussitôt vers sa chambre. J’ai voulu l’ouvrir mais ils l’avaient déjà fermée à clé. J’ai forcé la poignée. Ils étaient allongés l’un sur l’autre alors j’ai cogné le type au visage, puis je suis ressorti. J’ai marché dans la friche industrielle. Près du port un type m’a planté dans la hanche avant de s’enfuir en courant ; un chalutier s’est avancé lentement dans la rade.
Bergounioux, à propos de ses Carnet de notes : Et l’utilité du carnet est de permettre à celui que je serai demain, c’est-à-dire un peu rasséréné, de juger plus froidement de ce qu’est arrivé au type qui la veille portait son nom.
D’écrire La ville fond me fait aussi questionner ce qu’on attend d’un livre. Comme je l’ai déjà dit (ou non, je ne sais plus), ce récit avance sur une ambition constamment déjouée. En somme, il y a une aventure, mais un narrateur qui s’évertue à ne jamais la voir aboutir. Pour quelles raisons il ne veut pas la voir aboutir, ce n’est jamais explicité, mais c’est de toute façon une posture qu’on ne questionne presque jamais en tant que lecteur. On ne se demande pas, dans les romans habituels, pourquoi le narrateur raconte correctement (ou malaisément) du début à la fin l’histoire exposée. C’est acquis.
Ici, rien n’est acquis. Tout tend à renverser le plus possible, le plus d’éléments possibles. Le texte revient toujours sur lui-même, à l’intérieur des phrases, mais aussi lors des événements vécus par le personnage principal. Ce qui entraîne une espèce de vertige : où se place-t-on ? à quelle temporalité exacte du récit ? sur quel plan géographique ? On croit voir la machine correctement avancer, puis d’un coup sais raison apparente tout déraille, et il faut recommencer à zéro. C’est une espèce de texte ingrat. Ingrat pour Bram aussi, qui coûte que coûte tente d’atteindre cette ville, pour rien en fait, une course, un détail, mais qui est toujours empêché par le narrateur. Pour quel prétexte. Pour aucun prétexte. Pour s’amuser.
C’est aussi, en plus de ça, une approche personnelle des déplacements : à quel point on repasse dans cesse par les mêmes lieux, suivant des trajectoires apparemment semblables et pourtant infimement différentes, comme dans certains jeux vidéo où vous voyez le fantôme de tous vos essais infructueux en transparence de celui que vous êtes en train d’effectuer (jusqu’à ce qu’il devienne lui-même un fantôme si vous n’êtes pas assez habile). La sensation de reconnaître un détail, et puis soudainement de ne plus rien reconnaître du tout. D’aller quelque part.
Il y a des choses très simples que j’aimerais savoir exprimer. Marcher sur un trottoir moitié défoncé sous le crachin. Quand les nuages sont gris mais qu’il ne pleut pas. L’atmosphère des rues vides dans un quartier résidentiel. Celle des parkings le dimanche en fin d’après-midi. Quand on déjeune seul et qu’il n’y a personne à qui penser. Quand chez ma grand-mère je regarde les chambres vides à l’étage. Quand je reviens là où j’ai vécu. La joie que quelqu’un soit à côté alors que je me réveille d’une sieste. Au printemps, apercevoir des inconnu(e)s sortir du supermarché avec de quoi dîner entre ami(e)s. La disposition naturelle des champs. Les jardins des maisons dont les balançoires ne bougent que l’été. Etc.
« Les baies noires sont si mûres qu’elles fondent dans la bouche ; un gamin en cueille une poignée ; elles sont mouillées de pluie. » Pour cette phrase de Duvert je pourrais donner ma vie.
Elle a longtemps souffert qu’il la laisse seule le dimanche pour aller à la chasse.
À chaque fois que j’entends Loulou Robert s’exprimer, le vide de sa pensée m’aspire plus profondément dans des tréfonds que je n’avais même jamais envisagés. On voit là les limites du circuit médiatique, qui n’hésite pas à l’inviter sur divers plateaux (car sans doute fille de, et mannequin) pour déverser des flots de banalités incroyables. Et il n’y a rien de la littérature à cet instant-là, rien de la langue ; du bavardage, de l’inutile.
« De désespoir, un jour je cracherai sur ma tête dans la glace. » — Annie Ernaux, La femme gelée.
Ce matin, au petit-déjeuner, alors que le mécanisme du grille-pain s’était déclenché, les tartines n’ont pas sauté. Il arrive en effet parfois que les tartines ne sautent pas, soit qu’elles restent bloquées dans le grille-pain, dans un recoin de l’appareil ou entre deux grilles, soit que j’ai tout simplement oublié de les y mettre avant d’actionner le ressort. Je me suis penché au-dessus du grille-pain pour observer ce qui se passait exactement. Je n’y ai vu aucune tartine. J’ai donc pris cela pour un de mes oublis fréquents, et suis retourné à ma table pour découper une nouvelle tranche de pain. Seulement, alors que j’étais tout à mon affaire, de la fumée noire et une forte odeur de brûlé se sont élevées de la machine. Je me suis précipité pour enlever ce qui provoquait une telle réaction et j’ai aperçu alors, coincée tout au fond, une minuscule tranche de pain. Je me suis saisi d’un long couteau mais rien à faire, j’étais incapable d’accrocher la mie. Et toujours cette fumée qui s’élevait dans la cuisine, car je n’avais pas eu le réflexe de débrancher la prise électrique. Je n’ai pas toujours les réflexes adéquats. J’ai hurlé à ma femme qu’elle vienne de toute urgence dans la cuisine, car le grille-pain prenait feu, et qu’il m’était impossible d’enlever le morceau de pain (encore une fois minuscule, infime !) qui provoquait un tel foutoir. Moitié-endormie, elle a entrepris à son tour d’extirper la tranche avec divers ustensiles ménagers. Sa main plus fine parvenait plus aisément à s’infiltrer entre les parois en plastique du grille-pain. Mais peu résistante aux brûlures, elle tomba rapidement inconsciente sur le carrelage de la cuisine car son avant-bras entier avait pris feu. J’en voulais à présent au grille-pain d’avoir mis ma femme dans un tel état. Seuls les grille-pains sont capables de telles atrocités. Le plafond de la cuisine devenait de plus en plus noir. J’eus alors l’ingénieuse idée de retourner le grille-pain pour faire tomber le morceau de pain, et secouai l’engin de toutes mes forces. J’étais recouvert de miettes, et de diverses pièces métalliques, mais n’étais aucunement parvenu à déloger l’objet de ma colère. Puis je me suis assis un instant sur une chaise pour reprendre mes esprits. Le grille-pain n’en finissait plus de brûler, de se consumer. Et tout ce chaos parce que les ingénieurs chargés de construire ces objets n’ont pas été capables de correctement les imaginer au départ, de les concevoir ainsi qu’aucune tranche jamais ne puisse plus se bloquer à l’intérieur. Il y aurait beaucoup à reprocher aux ingénieurs de grille-pain. Beaucoup plus qu’on veut bien nous faire croire. Et pourtant un tel silence sur leur incompétence, un tel silence. Ma femme victime de leur terrible incompétence, et bien sûr aucun tribunal pour les condamner. Et personne pour enlever ce miniscule morceau de pain. Aucune intervention, aucun soutien. Je devais abandonner l’idée de ce petit-déjeuner, l’idée de ma femme, et du morceau de pain. Tout ce que j’avais envisagé pour ce début de matinée n’était plus. Autant finir dans le feu, si c’est pour vivre dans une telle société injuste.
Il est facile, à partir d’à peu près n’importe quelle situation, de dégager un enjeu. Le démarrage n’est jamais le problème. C’est jusqu’où rouler ensuite ; jusque quelle crevasse jeter le bolide en feu ?
Ernaux : « Dix ans plus tard, c’est moi dans une cuisine rutilante et muette, les fraises et la farine, je suis entrée dans l’image et je crève. » (Je souligne)
« […] et quelquefois j’ai l’impression de ne pouvoir me fier qu’à ma peur, comme si c’était ce qu’il y a de meilleur en moi, qui avec le temps me mènera peut-être quelque part, je m’exprime mal : qui peut-être me sortira de quelque part, même si elle ne me mène nulle part… » — Imre Kertesz, Le Refus.
J’aurai l’occasion d’en dire plus lors de sa parution prochaine début mai, mais j’ai pu récupérer une partie de mes exemplaires de Saccage hier. Le livre est tel que je l’imaginais, même si en l’ouvrant il n’est jamais tel que je l’avais imaginé. Je dois évidemment remercier Guillaume pour m’avoir empêché de l’enterrer, Benoit et Aurélien de me faire entrer en littérature ; Cécile pour le reste.
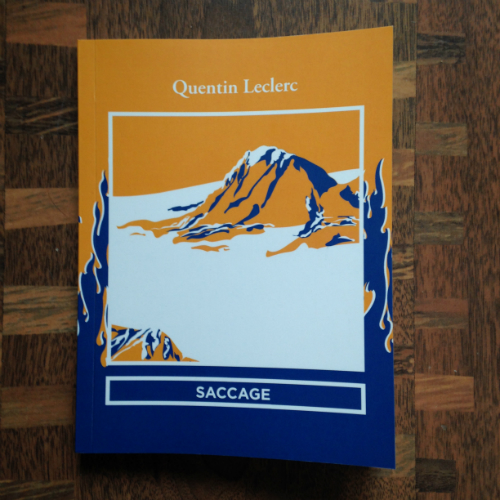
« Le cadavre d’un chien pourrit sur le tarmac. Un essaim de Spanish flies survole l’animal. Mon regard s’accroche à la langue de la charogne. Lambeau rigide de chair sombre. Noir organe qui ouvre sur une bouche d’ombre. » — Bernard Wallet, Paysage avec palmiers.
Alice ne passe presque plus ici. Depuis qu’elle fréquente quelqu’un, elle vit chez lui. Il habite à peine à trois rues, mais plus près du fleuve. De temps en temps elle doit venir récupérer des affaires. Je ne la vois pas. Elle m’a demandé de la prévenir si ça me dérangeait. Ça ne me dérange pas.
Quand j’enfile ma polaire, qui appartenait à mon grand-père, et que porte parfois Cécile s’il fait froid dans l’appartement, j’ai la sensation d’être recouvert de ces deux personnes que j’aime, et qui ne sont pas là. (D’une fois sur l’autre je lui répète : elle appartenait à mon grand-père. Elle me dit : je sais. J’oublie. Je dois aimer le lui répéter.)
Quand Marie vit cette crise en 2000, j’ai neuf ans. Un enfant. Une certitude : je ne sais pas comment se sont aimés mes parents. De leur amour entre eux, à travers moi, il n’y en avait pas. Il y avait de l’amour pour moi. En restait-il pour eux. Quatre ans plus tard, dans un restaurant sur la côte, leur rupture (le divorce), et la même question, d’un narrateur différent : que s’est-il passé ?
« J’ai toujours pleuré le matin, aussi loin
que je me souvienne.
Et comblé de vides plus grands
le vide premier.
Et redouté de perdre la parole.
Et tremblé de ne pas me relever de l’espoir
dément qu’on viendrait me chercher. » — Marie Cosnay, Que s’est-il passé ?
Je trouve étonnant que ceux dits “casseurs” soient désignés comme ceux discréditant les mouvements sociaux actuels ; comme quoi ils nuiraient à l’image renvoyée, bonne enfant, constructive, pacifique. Mais il n’y a aucune image renvoyée. S’il n’y a pas de heurt, il n’y a pas de média, et il n’y a pas de transmission. Les chaînes actuelles n’ont aucun intérêt à transmettre les faits de courants émergeants qui souhaitent refonder leurs structures. Au-delà de l’événement, rien ne persiste. Il faut comprendre n’avoir plus rien à espérer des médias traditionnels ; la foule gonfle d’elle-même.
Casser, c’est aussi revendiquer la ruine des institutions physiques (les lycéens de Bergson défonçant un commissariat, des vitrines de banques brisées, etc.). Je suis tombé sur l’image frappante d’un potager aménagé sous les dalles, place de la République. Ça n’est peut-être pas considéré comme tel, mais cet acte est aussi casser. C’est un processus de déconstruction de l’espace public essentiel à la réappropriation du territoire (comme, à plus grand échelle, nous devrions nous réapproprier le territoire français, où tant de campagnes sont délaissées). La ville est une oppression dans son aménagement (insécurité des femmes, contrôles aux entrées des transports en commun, exclusion des sans-abri à l’aide de piques, pointes et autres barrières, etc.). Détruire et construire sont différentes étapes d’un même mouvement. On peut bien brûler quelques Autolib, ça compensera tout juste les saccages humains et environnementaux menés par Bolloré au Cameroun.
La ville est une violence (galeries marchandes à tous les étages, interdiction de stationner, de marcher sur la pelouse, de pénétrer dans telle cour, s’assoir devant tel commerce, ou sur tels escaliers, j’en passe). Apprenons dès aujourd’hui à la redéfinir selon nos propres modalités. Frères, cassons.
Alors que Namrej vivait en songes la vie-morte du père-busard Machine, Orstir le voyant avançait seul parmi les dunes de gravier. Voilà déjà trois jours qu’il s’était éloigné du château, en quête de Namrej ressuscité, en quête de sa forme d’homme nouveau, déjà mort. Un voile enroulé autour de son visage empêchait que les bourrasques n’atteignent ses yeux ; son sceptre guidait sa marche. Il apercevait parfois au loin des caravanes de marchands, et des armées lance à la main.
Je trouve que mon arrière-grand-père paternel a un faux air de Beckett. Les cheveux peut-être.
Sur la photographie de groupe de ma classe de sixième, je me trouve au premier rang sur la droite, assis en tailleur sur le sol. D’après mes souvenirs, je portais un gilet rouge à fermeture éclair au milieu, laissant le col ouvert, un pantacourt d’une couleur quelconque, noir sans doute (peut-être en jean ?), des chaussettes de sport blanches tirées jusqu’au mollet, et des chaussures, noires également, trouées sur l’avant et au niveau de la semelle. J’avais toujours l’espoir que mes parents m’achètent des chaussures de marque (la joie d’ailleurs de posséder ma première vraie paire de basket, deux ans plus tard), mais déchantais rapidement à l’approche du magasin de vêtements à bas prix ; magasin qui avait d’ailleurs plus l’allure d’un hangar. Sans doute n’y avait-il pas beaucoup d’argent, ou pas beaucoup à mettre dans ce genre de choses. La mèche de mes cheveux, sur le devant, est coupée de travers, un peu en escalier (je sais m’être massacré les cheveux moi-même avec un ciseau un jour, mais ne sais plus si c’était durant la même période). Là, de me voir, il y a de la pitié. Et il ne s’agit pas tellement des vêtements, de la coupe de cheveux, ou de la posture, mais d’une espèce de dégagement total de la réalité, et non pas car j’étais dans mes rêves, ou « dans la lune », mais car tout simplement je n’étais pas là, je n’avais aucune fonction, je n’étais sincèrement rien, d’aucune sorte ; je n’avais aucune nécessité de vie. J’observais déjà les autres avoir leur rôle, et ne savais absolument pas quel devait être le mien. Je suivais. Je ne faisais pas partie de l’écosystème social.
J’ai parfois envie de lui dire : Tu viens de la frange sociale inexistante (ma mère qui a toujours rêvé de pénétrer le milieu bourgeois, sans comprendre que la rupture n’a que peu à voir avec l’argent) ; tu deviendras quelqu’un, et cela te prendra surement toute ta vie, mais à ta mort on dira alors peut-être : voilà qui il était, et qui valait quelque chose ; tu n’as pas à te sentir coupable, responsable, de n’être personne. Il est difficile de conserver en toute circonstance la sensation de soi.
Cette phrase, dans Passion simple : (C’est donc par erreur qu’on assimile celui qui écrit sur sa vie à un exhibitionniste, puisque ce dernier n’a qu’un désir, se montrer et être vu dans le même instant.)
« J’opte pour l’indécision : d’avoir reçu les clés pour comprendre la honte ne donne pas le pouvoir de l’effacer. » — Annie Ernaux, Mémoire de fille.
Je n’ai jamais tellement réfléchi mon rapport à l’écriture. Pourquoi j’écris, souvent, presque chaque jour, pourquoi ça plutôt qu’autre chose, et pourquoi maintenant. Je ne sais pas quelle part de posture il y avait dans la réponse de Beckett (à cette même question posée par Libération) : Bon qu’à ça., mais elle me correspond bien. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours suivi ma pente. Si je n’y arrivais pas, je n’insistais pas. Quand j’ai échoué, j’ai dévié. Peut-être ma faculté d’adaptation contrebalance ma tendance à l’abandon. Progressivement, je suis allé là où, sans trop fournir d’efforts, j’arrivais à quelque chose. Peut-être l’écriture est-elle une voie par défaut (encore une fois : je ne sais pas). Je ne suis pas tout de suite arrivé à quelque chose en écrivant (est-ce seulement le cas à présent), mais il y avait une aisance, une évidence à le faire ; peut-être car il m’était matériellement facile d’écrire, et car j’avais quelques images potables qui flottaient dans ma tête. Rien d’une vocation, donc.
Je me souviens d’une après-midi, alors que j’étais adolescent, où j’avais emprunté L’Être et le Néant à la bibliothèque, pour faire genre (même si je ne sais pas au juste auprès de qui), puis que j’avais lu en marchant dans les rues de Lamballe pour rentrer chez moi. Je ne comprenais rien puisque je lisais en marchant et que ça ne m’a jamais réussi, si bien que je ne décollais jamais de la première page, voire de la première phrase, que je relisais en boucle, et plus je la relisais, moins j’y comprenais quelque chose. Il est étonnant d’ailleurs que je ne sois pas tombé en marchant ou que je n’ai percuté personne tant mon esprit était embrouillé à ce moment-là. Arrivé chez moi, j’ai posé le livre sur une commode à côté de mon bureau, et ne l’ai plus jamais rouvert. Encore aujourd’hui, je ne sais pas de quoi il parle. Sans doute d’ailleurs ne le lirai-je jamais. Mon père l’a rendu à la bibliothèque la semaine suivante.
La précaution d’Ernaux, dans L’événement, qui l’empêche de donner les noms réels de ses personnages ; au contraire de Doubrovsky, qui a tout étalé jusqu’à la mort.
La honte que m’inspire notre pays est telle que je ne sais même plus par quel côté l’aborder. Tout est matière à envisager les fourches ; pire parfois. Chaque jour nous sombrons davantage dans l’abject. Chaque jour nous sommes soumis à la pire répugnance. Il faudrait traquer : à qui profite, à qui complote, à qui manipule, à qui divise, tomber dessus, et y mettre les ongles. Il faudrait passer par là. Peut-on faire sans la violence pour riposter de toute celle qu’on nous inflige ? Des matraques, des lois, des insultes. Et les bureaux-forteresses dans lesquels nous les avons installés, et qui aujourd’hui ne nous sont plus accessibles. Il faudrait faire fondre les dorures, et sceller leurs bouches avec cette pâte d’or. Ils auront ainsi leur richesse matérielle tant désirée : elle coulera en eux !
Je n’ai rien d’un explorateur. Je tente seulement d’ouvrir à tous des paysages déjà vus.
« — Voilà. Ce qui se présente maintenant, c’est la fin d’une ancienne façon de vivre et le début, peut-être, d’une nouvelle. Le passage ne se fera pas sans douleur. Nous pouvons, nous les filles, à notre façon, d’autres à la leur, être cette douleur. »
J’avais suivi la direction indiquée par le panneau sans me poser de questions. Les premières routes ressemblaient à celles que j’avais l’habitude d’emprunter, c’est-à-dire recouvertes à la hâte de goudron, sans délimitations particulières sur les bords, sinon une coulure progressive vers l’herbe et la terre ; des fossés fournis en ronces, quelques chênes. Des cultures de maïs ou d’autres champs en jachère de tous côtés, et parfois les hangars des fermes, et le bruit lointain des voitures allant entre deux villes. Il arrivait encore sur la fin qu’un chien aboie à mon passage. Puis peu à peu la civilisation a disparu, et je n’ai plus avancé que dans des sentiers boisés abandonnés ; je n’allais nulle part. Je suivais une piste laissée par de précédents voyageurs, fine, presque indistincte, sans doute même décourageante pour les moins téméraires. Mon parcours avait quelque chose d’obstiné, et pourtant je n’étais pas si loin, et pourtant je n’étais pas parti depuis si longtemps. À couvert des arbres s’installait une progressive pesanteur, dans le froissement continu des feuilles, et des cours d’eau invisibles. Je pensais être allé au plus profond de la forêt, car je marchais désormais en enjambant des troncs couchés sur le sol, fendus par la foudre, et des fougères importantes. Il m’aurait plu de trouver au coeur de cette végétation sauvage une nouvelle issue mais, à l’inverse de ce que j’attendais, l’avancée se fit à mesure plus facile, et j’ai vite retrouvé des sentiers praticables, puis des chiens, puis une route et ses fossés et ses champs autour, et finalement un nouveau panneau m’a indiqué la direction vers chez moi. Je l’ai suivi sans me poser de questions.
Orstir dit à Namrej :
— Le père-busard Machine est à présent en toi, et sa vérité viendra te hanter en songes. Tu vivras en songes la vie du père-busard Machine, dernier oiseau assassiné par la folie du père fautif Calvarde. Les mêmes amours tu vivras et les mêmes douleurs, et les mêmes coups de poignard sournois du père fautif Calvarde. Le sang qui coulera sera tien. Les larmes seront tiennes. La mort du père-busard Machine sera tienne et il faudra y survivre, sans quoi il n’y aura aucun futur pour toi.
Namrej s’apprêtait à sombrer mais ne pouvait se résigner à abandonner le voyant Orstir, guide unique de la quête vers le Royaume de la mère-source Miraj, et bouclier d’or contre les démons et la ruine. Orstir poursuivit :
— Je dois te laisser à présent au bord de la nuit, car elle est hostile à ma présence, et aucune magie ne peut y pénétrer. Je te retrouverai après ta mort survécue. Mes sorts sauront quelle forme aura ta seconde naissance. Va à présent dans le rêve, et arme-toi, et souviens-toi.
Alors Namrej s’endormit, et commença là son nouveau voyage vers le désespoir du père-busard Machine, laissant Orstir le veiller un instant, puis disparaître en silence au dehors du château.
« C’était donc cela le désert ; le lieu où même les signes ne pouvaient naître, encore moins se glorifier. »
J’ai une nausée absolue à la moindre prise de parole d’un de nos politiques, face au manque de respect évident dont ils font preuve à l’égard du peuple, des gens, quels qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, face à ce qu’on accepte d’entendre, quand des centaines de milliers de personnes sont soumises à cette parole nauséabonde des médias principaux, sans que rien ne soit dit contre, sans qu’aucune protestation immédiate et de même audience ne puisse être entendue, ne soit entendue. La façon dont on laisse la haine prendre la rue est une honte immense dont, sans la révolte et le massacre immédiat des bouches menteuses, nous ne reviendrons jamais.
Et que la vase monte et nous recouvre pour dissimuler définitivement notre laideur.
Étonné, en lisant les premières pages des Jardins statuaires (dont je n’avais jusque-là qu’entendu parler), de la similitude des dispositifs d’entrée avec Saccage. Dans les deux cas un narrateur masculin non-identifié arrive dans un lieu (pays) qu’il ne connaît pas, ne maîtrise pas, et trouve à s’installer dans un hôtel étrange, et à l’intérieur de cet hôtel se fait une place dans une chambre de rien.
Qu’Annie Ernaux aime à ce point ce qu’écrit Édouard Louis me déprime absolument.
« C’est le vide de toute part qui tâche et joue à se circonvenir et creuse lentement les lignes de la main de la terre. Les réseaux se nouent, se superposent, s’effacent. Les signes pullulent. Il faut que le regard s’abîme. » — Jacques Abeille, Les Jardins statuaires.
Les trottoirs n’ont plus rien de ceux que j’ai déjà laissés derrière. Quand ils rentreront il n’y aura plus personne. J’ai laissé la veilleuse allumée au cas où ils se précipiteraient dans la chambre ; ils ne s’y précipiteront sans doute pas. Il n’y a pas grand chose à voir. Les hangars sont déserts, les rues de même, et sans la bruine pour me recouvrir je me croirais tué mille fois d’ennui. Il ne fait même pas nuit, pourtant personne ne passe. On a créé des axes morts où les commerces pourrissent et les bars se vident ; où mon visage porte le masque des phares cassés. Je sais qu’au port ils lèchent dans les chiottes de bord de plage, dans les parcs, et les fortes vagues passent sur la digue mais ne lavent pas ce que les passants voient. Il n’y a plus que les sapins et leurs épines pour me blesser les pieds jusqu’au refuge. À la décharge j’avais déjà couché sur des matelas moisis et les rats seuls me caressaient. Si le gardien m’avait retrouvé moitié-nu dans la crasse sûr que sa barre de fer aurait bleui ma peau, mais il n’y a personne, et je peux toujours espérer dénicher entre la tole et le cuir quelques pièces à vendre au chauffeur ; pour repartir jusqu’au cap, observer là la mer, puis creuser dans la terre un peu de ma présence.
On saura que j’ai vécu des miettes laissées sur le sol en longeant les pierres.
« Qu’une usine est une ville ramassée sur elle-même et qui aurait rejeté tout ce qui ne sert pas à ce seul rapport des hommes à leur main. » — François Bon, Temps machine.
que dès la plage finie ranger le salon de fortune déposé (et parasols, et sièges, et pelles), écraser les chateaux et boucher les rigoles pour ne pas que la mer, sur les tapis le sable, dans les serviettes, sur les sièges l’eau des fesses les marques, le tissu le lendemain pourtant sans trace, les graviers à l’arrivée et aussitôt dans le bain, là sans le sable, s’envelopper, dans la cuisine les tartines et le chocolat, sur le tapis ensuite les peaux douces et le sable encore entre les orteils, les grains sur la moquette, autour de la table basse, toutes les odeurs d’eau et de savon et de sable et de sel dans les cheveux gras, la télévision comme seule lumière dans la nuit (la chaleur), le contact d’être enfant sans avoir à se toucher, puis le sommeil — et quoi pourtant, plus aucun souvenir de ça, plus la chaleur, plus jamais les vacances
Je suis tombé sur le profil Facebook de Pierre Michon en traînant par hasard. Y a un côté un peu désuet (comme quand j’observe ma grand-mère taper sur les touches de l’ordinateur avec une infinie lenteur) à voir ces photos de profil et de couverture basiques, communes (mal cadrées, mal éclairées), et puis sous les photographies les commentaires un peu à la con, il faut le dire, des proches, ou des admirateurs. Comme pour tous, le même ridicule d’exister.
Tony Duvert, le dernier maudit.
Le magicien apparut dans la pièce sans que personne ne le remarque. Une longue robe l’enveloppait, sa capuche dissimulait son visage, et on n’aurait su dire si une tête contrôlait ce corps. Il sortit de sa poche un petit écran, et le plaça au-dessus du malade. Un court temps passa puis le visage du malade se mit à grésiller, oubliant ce qu’il était, ce à quoi il ressemblait, pour finalement se creuser et fondre en dedans. Le magicien alors prit un poignard et le planta droit dans le petit écran, qui se mit à hurler comme un dément ; puis il plongea l’écran hurlant dans le visage fondu du malade, de sa pleine main, et en ressortit, à la place de ce qu’il venait d’y déposer, une pierre de lune. La famille autour ne savait comme interpréter ce rituel, mais s’empêchait toutefois d’intercéder dans son processus. Le magicien prononça ensuite des incantations qui n’étaient d’aucune langue connue, puis la pierre de lune s’effrita entre ses doigts, et il ne resta plus rien d’elle que quelques débris sur le sol. Alors un bruit épouvantable se fit entendre, qui provenait du visage renfoncé du malade, de plus en plus cinglant, à mesure que la peau revenait, mais au terme de la recomposition cellulaire, à la place du visage, il y avait cet écran et non les yeux, comme soudé, cousu. Le père s’apprêtait à attaquer le magicien quand celui-ci releva le malade et fit se refléter l’écran sur le fond de la pièce. Tout le monde se retourna alors vers le plus jeune fils resté à l’arrière en retrait, et dont le visage s’effritait comme la pierre de lune, comme elle en miettes aussitôt à leurs pieds. Le temps qu’on se penche sur le corps du plus jeune fils, le magacien avait disparu, laissant dans le lit le malade à l’écran hurlant comme visage, et en fond une voix murmurant : Il n’y a de magie que noire ; voyez ce qu’elle a fait de vos enfants.
« Alors,
je me suis assise
et la nuit est venue sur moi.
Et la nuit m’est venue de face.
Et la nuit m’a cassé les yeux. » — Laura Vazquez, La Main de la main.
Ceux qui l’ont vu auraient pu dire qu’il était habitué à s’enfermer, qu’il ne sortait presque plus, sinon pour grignoter un morceau et récupérer le courrier, et même le courrier il le jetait sans l’ouvrir dans un coin du salon, ensuite il retournait dans sa chambre aussitôt, personne ne pensait à le déranger, les quelques qui s’y étaient aventurés avaient compris, il n’était pas commode, il ne se privait pas de vous le faire comprendre, mais il avait besoin de ce silence-là, enfin ce qu’il faisait personne n’a jamais su, personne n’a pu se rendre dans la chambre après sa mort, tout avait été nettoyé, par les proches ou la police peut-être, les proches on n’est pas sûrs, alors on pourrait beaucoup dire, tant qu’on sait pas au juste ce qu’il faisait il est difficile de juger, ça a beaucoup parlé à ce sujet, chacun y allait enfin je préfère ne pas m’étendre à ce sujet, on finirait par dire du mal, ce qui n’est pas mon intention, il était très respecté, on avait de la considération pour lui, bien qu’on n’ait jamais su ce qu’il faisait au juste, mais simplement son acharnement, sa méthode, ça fascinait bien sûr, au village personne n’était capable de se consacrer à ce point à quelque chose, il fallait vivre avant tout et lui nous n’étions pas sûr qu’il vive vraiment, il doit y avoir de ça, je pense, dans la fascination.
Quand nous dormions encore, mes cousins et moi, à l’étage chez mes grands-parents, il nous arrivait d’éteindre la télévision très tard, vers deux ou trois heures du matin. C’était une imposante télévision cathodique, grise, dont la télécommande fonctionnait mal sur la fin, si bien que nous devions nous lever à tour de rôle pour changer les chaînes et régler le volume. Comme l’écran était la seule source lumineuse de la pièce, lorsque nous l’éteignions, une sorte de halo blanchâtre persistait, qui laissait croire à une présence spectrale. Ce halo étrange se reflétait d’ailleurs dans le miroir de l’armoire qui bordait notre lit, et de trop le fixer me faisait croire que quelqu’un ou quelque chose en sortirait, s’en extirperait. Je fermais alors les yeux pour ne plus avoir peur, et espérais m’endormir au plus vite.
Il me prend la même hantise encore actuellement lorsque je fixe trop longtemps la poignée d’une porte fermée, ou le bout d’un couloir vide : l’angoisse que je projette dans l’immobilisme ou l’absence me fait apparaître ceux que je crains. Ainsi je m’imagine constamment en danger.
« Les fantômes avec qui tu vis se métamorphosent trop souvent en ombres déchiquetées, aussi maléfiques que celles qui montent du fond humide de la vallée, du fond de tes souvenirs affreusement nets de bébé nerveux et te terrifient. »
Dernièrement, l’impression de n’être pas là, pas dedans, de forcer au maximum à la fois l’écriture, et la poursuite des jours. Je regarde par la fenêtre : les immeubles sont, comme ils sont toujours, ne cèdent pas, ne cassent pas, ne sombrent pas. Les rues vides puis peuplées des mêmes piétons. Il y a de la fumée qui sort de certaines cheminées. Les arbres bougent à cause du vent. J’entends la télévision trop forte depuis l’appartement du dessous. Un peu mal au-dessus des yeux, au milieu du dos aussi. Il y aurait des choses à faire, à dire. Demain ensuite, voir si un des immeubles peut être détruit, un piéton dégommé, une cheminée bouchée et ses propriétaires brûlés, des arbres déracinés, mon plancher troué et ma voisine pendue. Et toujours, un jour après l’autre, saper le réel, tout ce qui m’entoure.
« Car tu as désormais un passé, très loin dans les brumes. Le miroir, vertigineusement, s’est approfondi et dans ses replis glacés la folie du présent recule, l’avenir cesse d’exister, hier remonte du fond des eaux chargées de particules en suspension puis il éclate sans bruit à la manière d’une bulle de gaz des marais, te submerge, t’envahit. » — Maurice Mourier, Par une forêt obscure.
Tu as descendu depuis la maison par des chemins de campagne, et t’allonge enfin sur l’herbe de la rive.
mais quand l’idée du mal avance et couvre déjà toujours comme si depuis des millénaires le mal n’avait fait que croître et qu’il fallait toujours des forces et un courage colossaux pour s’y opposer pour l’affronter pour ne pas se résigner à la truanderie et à l’assaut et qu’en dernier recours et certainement personne ne pourrait s’y opposer si les mains sont tranchées si la plaie s’infecte alors bien sûr il n’y aurait plus rien à dire il n’y aurait qu’à se taire et à accepter le mal et alors il s’agirait de continuer pourtant et quoi des nuages noirs et des éclairs permanents et des êtres maléfiques en fou rire au sommet de leurs immeubles et soi dans les bordels et les marchés et les sous-sols de la ville anéantie à savoir est-ce cela l’idée du mal une ville anéantie et au sommet des rires épouvantables est-ce celle-là la nouvelle fantaisie totalitaire ?
« Eh bien ! pour moi, j’ai des yeux que la veille n’abandonne point, un coeur que le souci assiège sans relâche, une poitrine où l’angoisse a pris domicile, un esprit que hantent les fantômes de l’imagination, une volonté qui ne dirige que des membres mutilés et ne s’appuie que sur des idées morcelées et sans suite. » — Les Milles et Une Nuits, Histoire du prince Ali, fils de Bakkâr, et de la belle Chams al-Nahâr.
À peine sûr d’être là, déjà n’y étant plus.
Quand ce qui vous manquait est trouvé, quand tout commence et tout se clôt comme vous le souhaitez, une certaine euphorie vous prend, à laquelle il est difficile de résister. On voit sa boîte parfaitement construite, debout, stable, immuable presque. Bien sûr, à l’intérieur, beaucoup de choses sont encore à améliorer mais, comme quand on change sa couette, une fois les quatre coins fixés, il ne reste plus qu’à tout tasser un peu à la va-vite puis à secouer un bon coup.
La ville fond également progresse par suite de leurres. On lit l’histoire pour une raison principale, qui semble se rapprocher à mesure, mais qui pourtant prend toujours ses distances avec sa résolution. C’est un système global en déception, qui est aussi quoi qu’on en pense une certaine façon d’avancer.
Un beau fonds d’entretiens avec des auteurs de chez Minuit est mis à disposition par France Culture.
Il écarte le feuillage et ainsi à nouveau plusieurs fois, et dans la machette à main — que la jungle s’épaississe, à brûler les tigres, pourtant rien n’arrive que la pénombre étouffante — les autres aux bras tranchés et leurs visages sur des pieux, transportés parmi les arbres dans les cris, enfin — et le passage n’ouvre sur rien et, les cris — et les tigres et, les cris — et les pieux — la course dans le cri incessant des pieux soulevés, et des visages aux bouches, les pieux dans les bouches, les bouches muettes, les cris — le feuillage identique sans progression, aucune direction, le bruissement alentour, les cris des pieux aux bouches trouées — rien dans la fuite ne sauve que le feuillage identique et la machette à main — rien ne sauve des cris et du bruissement et de la pénombre de la jungle — sa plaie au ventre l’ouvre en deux, comme la machette à main le feuillage — comme la jungle il s’ouvre à mesure de la course — il finira en tête à pieu, et aura comme les autres la bouche muette du cri silencieux — la bouche creuse — la machette à main enfin dans le feuillage comme dans la tête — et les cris.
Naissance et mort du père-busard Machine.
Qu’aucune loi d’aucun monde ne peut imposer à l’homme à la fois l’obéissance aux principes, la soumission à la terreur, le respect total des élites, le silence dans le conflit, la non-violence dans la fournaise, la dégradation des savoir-faire, la destruction complète du territoire, l’abattage systématique des espèces vivantes, la menace d’extinction atomique, le délire des bourreaux, la complète compréhension des codes et articles de domination, la détention en pays libre.
Je viens d’entendre une des définitions les plus pertinentes sur la littérature depuis un moment. C’est Loulou Robert, une jeune autrice, qui la donne :
« Bah la littérature qu’est-ce que c’est, bah, c’est juste magique, bah c’est comme l’art, c’est comme la musique, c’est comme tout, c’est des mots, ça te permet de t’exprimer, ça te permet de vivre aussi, de vibrer, ‘fin c’est euh… ‘fin si on avait pas ça, ça serait super triste en fait ! parce que c’est ce qui permet de t’évader, de voyager, c’est ce qui te permet de, je sais pas, je… ouais de ressentir, et puis c’est tellement beau ! euh… ça rajoute de la beauté en fait ! ça rajoute de la force, ça rajoute des émotions, donc sans ça ben ça serait beaucoup plus terne ! […] »
On ne peut que féliciter Julliard de publier son premier roman qui, s’il est à la hauteur de sa pensée, sera sans doute consacré à sa mesure, c’est-à-dire, on l’espère, petitement.
Au moins jusqu’à la fin du XIXe siècle, le voyage était une réelle source de rebondissements. Quand il fallait se déplacer à pied d’un pays l’autre, on débouchait dans des domaines reculés, à flanc de falaise, on croisait la route de brigands, ou d’autres nobles déjà attaqués, on séjournait chez des inconnus, dans des auberges, on savait à peine si on allait arriver sauf. Aujourd’hui, cinq heures en train, et c’est réglé.
« Alors elle écartait ses vêtements et l’horreur de la damnation me faisait trembler. Son corps était un squelette desséché, mais dans ce squelette d’innombrables serpents se tonifiaient et se mêlaient et dressaient leurs têtes et dardaient vers moi leurs langues de feu. »
Dans Les Élixirs du diable, il y a ce chevauchement, cette imbrication des éléments que je tente de développer dans La ville fond. À cause de traumatismes étranges, le même personnage se dédouble, et bientôt on ne sait plus à la lecture qui est le narrateur : des témoins nous affirment qu’il n’est pas celui qui nous parle. Parfois lui-même nous le dit. Cela provoque un fort effet de malaise, d’agacement, propice à stimuler la réalité proposée.
Par exemple, le narrateur et personnage principal se retrouve au milieu du livre enfermé dans une cellule. Suite à diverses hallucinations, il tente de s’échapper en brisant le mortier au sol à l’aide d’un petit couteau. Alors qu’il en est à la quatrième dalle soulevée, il voit sortir du sol, jusqu’au buste, un homme qui le fixe avec un sourire dément. Cet homme qui le fixe, c’est lui-même.
Peut-être trouve-t-on déjà là des éléments du glitche : la déformation, le glissement, la rupture avec ce qui est directement visible, pour engager une situation ailleurs. Rien du fantastique à vrai dire, plutôt du trou, du manque, et de la superposition (des personnages, lieux, actes, etc.) Aussi, une question importante : comment adhérer à un récit qui ne donne aucune prise ?
Casser le pacte de lecture, pour ensuite déverser encore par-dessus les débris de ce qu’on a plus tôt pulvérisé.
« — Écoute ! Ce n’est pas avec le Diable que parle notre mère. C’est avec un bel homme. Mais cet homme n’est qu’une image qui sort du mur quand maman l’appelle. »
Et l’histoire dit, poursuivit le mage, que l’oiseau descendit sur son visage et que ses serres le lacérèrent, qu’il cria de n’y plus rien voir, d’être aveugle chassé par la grâce divine, détruit par le messager, qu’il se roula sur le sol les mains sur son visage rouge, le bout de ses doigts dans les deux trous formés par la colère de l’aigle, et que le sable ne faisait qu’irriter davantage la plaie, que le vent s’engouffrait dans son crâne. Après trois nuits et autant de jours d’agonie l’aveugle s’est relevé puis a marché jusqu’au creux d’une dune. Là il a trouvé le sanctuaire, et dans le sanctuaire un lit dans lequel se coucher. Alors il s’est allongé et a vu au plafond comme le sanctuaire se fissurait. Le sanctuaire s’écroulait sur lui. Et les gravas bientôt le tueraient. Alors il pria, mais rien ne le sauva.
« Je m’étais placé moi-même en dehors de la norme des actes humains ; il me fallait maintenant aller toujours de l’avant ; puisque je m’étais désigné comme l’Esprit de la Vengeance, il me fallait aller jusqu’au bout de l’horrible. » — E.T.A. Hoffmann, Les Élixirs du Diable.
Il vit alors chuter depuis le ciel des météores de feu ; les explosions anéantissaient villages et plans d’eau ; les survivants fuyaient par les chemins ; la poussière et la fumée recouvraient le pays ; les fuyards devenaient poussière et couraient pour se débarasser de la pellicule sur leur corps ; les animaux eux aussi détalaient, mais la poussière était tenace, et semblait ne jamais vouloir disparaître ; alors une crevasse s’ouvrit sous leurs pieds et un abîme incroyable se présenta, qui engouffra toutes les forces vivantes à l’intérieur ; les arbres eux aussi tombaient, et la terre également, et des morceaux du ciel ; tout revenait au feu unique du centre créateur ; tout sombrait dans cette crevasse absurde, déjà visible depuis l’espace ; les premières étoiles elles-mêmes semblaient attirées par ce néant apparu, et les galaxies, et le vide ; la lumière n’était plus ; et les mots disparurent à leur tour.
Parfois je me dis : écrire une biographe de Mark Hollis. Après je me dis : c’est impossible.
Toujours rien.
« Ils marchent toujours ensemble, tous les trois, et dès qu’ils en ont la possibilité, la main dans la main. Après un certain temps, j’ai remarqué que le père restait en arrière et que ses fils devaient l’aider, le traîner derrière eux en le tenant par la main. Plus tard, le père n’était plus parmi eux. Bientôt, l’aîné dut tirer le cadet de la même façon. Puis, ce dernier disparut et l’aîné dut se traîner lui-même, et à présent, je ne le voyais plus nulle part lui non plus. » — Imre Kertész, Être sans destin.
manger les loups dans le coeur courir après les mêmes loups dans le coeur qui jappent qui crient mêmes loups dans même coeur dans triste coeur dans triste bois dans forêt morte jamais aimé toujours pourri jamais aimé toujours loup à jamais loup à jamais sec dans le bois de même inondé moitié-pourri moitié-plein de vase aux loups englués dans le miasme aux mêmes loups bouffeurs de coeurs dans la même vase de coeur pourrie dans la même ruine de coeur qu’à bonne chair à loup qu’à bonne rouille de sang et si la colère tonne dans le bois si les mêmes loups jappent engloutis si la rouille prend les mêmes coeurs si la terreur d’être un jour sans coeur prend là si le coeur cri par la gueule de loup et si personne n’entend alors dans quel bois pour quelles bouches pour quel cri japper ainsi pour quelles trappes les pattes broyées pour quels chasseurs les dépouilles cuites pour quel cri la vase à déborder la gueule quand le bois brûle déjà d’être sans coeur quand les loups brûlent déjà d’être sans cri quand le bois déjà n’est plus et que tous t’ignorent —
mais quel crâne tu enfonces dans la vase et quels mots remontent —
Ce matin, en me levant, et sans savoir particulièrement pourquoi, j’ai regardé l’église de Matignon par la fenêtre de ma chambre. À mon grand étonnement, il y avait bien une horloge sur son clocher. Je ne sais plus quoi penser désormais. Pourquoi ai-je tant tenu à l’enlever de mon souvenir ?
Souiller les mémoires puis partir en paix.

Ma grand-mère a fêté ses quatre-vingts ans hier.
qu’l’homme sur l’parking noir sous l’parka clisse la lame sous l’manche l’poignet souple qui l’entaille le torse qu’les phares sauvent rien qu’les passants sauvent rien qu’l’usine couvre tout qu’la lame l’entaille toujours qu’elle charcute intacte la chair qu’dans l’noir qui s’fait sombre qu’le coup c’contre trois pièces dans la poche qu’la taillade sur visage qu’la fissure à lèvres dans l’entaille dans l’cri tu du noir dans l’ombre pas vue du bord d’route où l’phare balaye l’silence et sape dans l’trajet l’encoche à crever l’bide
Il y a une dizaine d’années, dans un coin du salon de mes grands-parents, au-dessus d’une commode, se trouvait un cadre, une sorte de tableau, qui représentait un clocher, presque en tout point semblable au clocher de Matignon, et ce tableau (comble de la modernité), à l’endroit du clocher dépeint, donnait l’heure. Depuis la chambre où je dormais enfant, dans l’exacte même direction que celle du tableau dans le salon, je voyais distinctement le vrai clocher de Matignon, qui lui n’avait aucune horloge en son sommet. Ces deux représentations d’un même objet se sont toujours superposées dans mon esprit, à tel point même que je prenais le clocher du salon (puisque j’y passais plus de temps que dans ma chambre), comme le clocher original, et celui vu depuis ma chambre comme une reproduction. Le clocher de Matignon a toujours été pour moi celui fictif et pratique du tableau. Si bien que le jour où mes grands-parents ont décidé de l’enlever du mur par souci esthétique, j’eus l’impression qu’ils avaient détruit absolument le clocher. Depuis, quand je regarde le clocher de Matignon, je préfère l’ignorer tant il n’est pas vrai.
Sur sa table de chevet, un volume de Splendeurs et misères des courtisanes.
« Lorsque j’avais quinze ans, ma grand-mère était morte et j’avais dû embrasser ses lèvres sous la surveillance d’un membre de la famille. Ça avait quel goût ? J’avais toujours cru que les vivants devaient manger une partie de leurs morts. » — Klaus Hoffer, Ches les Bieresch.
la cave pue qu’il dit l’enchaîné qu’elle pue la pourrissure la vomissure l’enchaîné qu’a l’cul qui flotte d’dans qu’il dit au garde viens qu’tu vas m’frotter l’bout qu’tu vas m’laver toute cette vomissure du sol qu’le bitume va reluire d’ta vieille bave qu’j’vais y cracher d’dans ta bouche pour que ça reluise encore les boulets aux ch’villes les mains à la chaîne entre les plissures des coudes et l’seigneur passe là qu’il ouvre la trappe qu’il verra bien à quoi j’ressemble dans la puanteur du cachot que l’seigneur touche la vomissure qu’il verra dans quoi qu’je flotte le purin d’vache il osera même pas piétiner d’dans il pourra pas y poser l’bout d’son soulier qu’le garde déjà y rechigne alors qu’il est même pas mieux qu’ma vieille dépouille salie détourne pas les yeux qu’il dit l’enchaîné à l’garde précieux t’bouche pas l’nez t’y touche déjà la crasse d’savoir c’pas l’seigneur qui t’sortira d’là quand j’me serai échappé j’viendrai t’bouffer l’visage et t’y goûteras d’la vomissure gardée dans la joue t’seras prisonnier aussi t’seras enchaîné aussi c’pas l’seigneur qui t’sauvera d’devenir moi
qu’avec les os qu’y m’lance qui croit qu’j’vais pas l’dévorer lui qu’j’vais pas m’faire à sa chair d’garde vil bien chair bien musculé d’dans l’cave s’il m’vient toucher palper l’peau j’lui croque d’dans j’lui plante d’dans qui croit qu’c’parce qu’il est décoré qu’il s’peut pas toucher qu’il s’peut pas atteindre qu’le seigneur l’protège qu’il croit qu’l’seigneur c’est l’christ qu’dans l’cave y a pas d’christ pas d’seigneur pas d’salut qu’des morfales qu’des sans-dieux qu’des coupeurs de gorges
J’ai lu les premières pages du nouveau roman de Sacha Sperling. J’ai cru crever tellement c’était mauvais. Et voir Patrick Besson en faire l’éloge c’est un peu le caniche qui lèche sa propre merde.
« entrer
par ce qui dans la nuit
n’est pas le plus noir
à contempler » — Émilien Chesnot, faiblesse d’un seul.
la prise frotte la flaque le courant la semelle craque la boue trempée d’entre les sillons plastique personne seul marchand donne la caisse passe les clés dit : prends la prise branche la caisse — ta caisse sale de mâle crasseux — avance barre-toi, la prise flottée dans la flaque saumâtre là la caisse immobile déchargée il y a de la vieille souillure sur les sièges le marchand dit : la vieille souillure des femmes à l’arrière de la caisse goûte encore tu peux lécher tu verras ça goûtera bien, le marchand s’écrase tient la prise qui flotte encore le métal dans la flaque tend le cordon branche la caisse barre-toi avec la vieille souillure des femmes à l’arrière, c’est quedalle à payer aucun bruit tu passeras dans les boulevards aucun bruit tu ramasseras les putes elles iront se toucher à l’arrière de la caisse tu pourras regarder dans le rétro ça dit le marchand tu pourras ramener ta vieille souillure de pute au prochain arrêt tu passeras le cordon à un autre type les clés il branchera la caisse il fera aussi ses tours à la fin de la journée toujours un esclave pour laver la dépouille hésite pas évite pas l’ordure prends le cordon circule la nuit y aura toujours des vieux corps pourris à entasser à l’arrière de ton char
les vieux arbres retombent sur la marchandise — trois chats estropiés s’éborgnent
Je ne pousse pas assez le langage. J’en suis conscient. Je ne vais pas assez loin, j’en reste à ce que je sais faire. L’investissement demandé est colossal et je ne sais pas si j’en serai capable. À quoi bon, pour mon Livre nouveau, écrire une resucée des Mille et une nuits, ça n’a aucun sens. Ce n’est pas l’aventure qui va renouveler le monde. Je disais à mon père : j’aimerais faire reprendre conscience aux hommes qu’ils font partie d’un processus qui les guide depuis des millénaires, et qui durera encore autant de temps après eux. Je ne vais pas y parvenir avec une histoire, mais avec le vertige de la langue, avec l’extrémité abyssale où je saurai la faire se révéler. C’est la Langue qui fait la Bible, pas le folklore ; c’est le Verbe.
Les deux titres Bordels Boucherie et Basic Text sont quand même magnifiques.
« Je suis communiste parce que j’ai pu voir, en Algérie, proliférer devant moi, à tous les niveaux, le mensonge du capitalisme déclinant : massacre, corruption, torture, racisme, propagande, gâchis des corps, des biens, des cerveaux jeunes, des espérances de l’esprit. » — Pierre Guyotat, Lettre à son père, 1969.
j’avance où le marchand dit : prends la pourriture du sol et goûte le mépris des gardiens alors le marchand tend sa main et dans la paume s’use le sel rouge, coule à travers les os et tombe et le marchand dit : prends le sel, et les dents du marchand se déchaussent, ses yeux fondent face à moi, ses cheveux, sa peau cire, seul son bras et au bout la main encore pleine du sel rouge mais lui le marchand coule là il rejoint la poussière il a sa main ouverte et rien ne le sauve et ses vêtements comme un tas informe sur le goudron, je me détourne passe la main dans ma poche y est le sel rouge je le lèche
dehors la foule s’amasse les braises des poêles à marrons les grilles tombées au sol impossible de franchir la cohue on frotte les draps les voiles on frotte la foule les fruits pourris écrasés par les godillots troués les pièces à chair moisies où mouches mangent où dévorent moëlle et cervelle les enfants accroupis pillent les poches l’un prend mon sel le lèche je sens l’enfant piller ma poche et lécher le sel je saisis sa mâchoire et la broie dans le sel, le sel rouge plein du sang de l’enfant pillard, la mâchoire broyée déjà volée par les lycaons, déchiquetées par les loups sauvages, et le corps de l’enfant piétiné par la foule ses prières vers le ciel attendant le salut qui viendra du rapace mangeur d’yeux
Je sens que je m’assèche. Il me faut reconquérir la parole en jetant tout à vrac ce qui me vient des choses. Il faut que je parvienne à dégager des ambitions nouvelles. Sinon je vais me prostrer, et je n’aurai alors plus aucun moyen de retrouver la lumière.
Saccage est né d’une de ces impulsions informes.
c’était le matin et le bitume goutait la bruine, le clocher sombrait dans la brume, l’énorme horloge couverte de mouettes et mouettes à sonner les heures, les pas n’étaient plus déjà l’ascenceur descendaient l’écho se faisait toujours plus grand dans l’interminable couloir jaune à portes battantes porte battue écho de spectre écho derrière, porte battante écho derrière, à l’avancée toujours dans un couloir sans lumière sans dehors à couloir jaune de pisse sentie, porte passée, et là l’immense surface abandonnée, là les piliers, là le ciment brut fracturé, là les coups là les blessures, là les véhicules et aux angles toujours la pisse et la vieille odeur de nuit là dans les angles la sueur des hommes perfides et les traces blanches au sol les guides vers quoi — la lumière seules traces de l’organisation absurde de la société, quand ça pisse juste à côté, quand ça souille à la moisissure la moindre parcelle de bitume, et les lignes blanches là bonnes juste à esquiver la misère, les néons blafards scintillants défectueux les interférences du bruit lumineux sans l’odeur dans les cris au matin sans l’agitation épouvantable des fumées et des gaz et des pneus et des humeurs des hommes cachés dans les recoins sombres de nos caves.
J’ai commencé la dense biographie de Catherine Brun consacrée à Pierre Guyotat et ai lu les pages à propos de ses lieux matriciels, très variés (Finistère, Bourgogne, Bourg-Argental, Pologne, Éthiopie, etc.), et je songe alors aux miens. Je me rencontre à quel point toute ma géographie est concentrée.
Ma famille vient (d’autant que je m’en souvienne) du centre Bretagne, et je suis né à Saint-Brieuc, dans les Côtes d’Armor. J’ai vécu dix-huit ans à Lamballe, une petite ville de dix milles habitants, principalement résidentielle, et pratique car centrale. Sans identité particulière, sinon une collégiale qui la surplombe, et que je voyais tous les jours depuis la cour de récréation de la primaire, et du collège.
Moins que par des régions, c’est par des espaces que j’ai été influencé. À Langueux, la zone industrielle austère où je me réjouissais d’aller avec mon père car elle signifiait souvent l’achat d’un jeu vidéo ou d’une figurine. À Matignon, l’imposante’ maison de mes grands-parents, le jardin, le potager, le chenil et les chiens de chasse. Saint-Cast le Guildo, la plage de Pen Guen, les dunes, la Manche. Sables d’or, les étranges quartiers entre les pins, et le bout de la digue, cette carrière moitié abandonnée, moitié explosée, les grillages troués, les sentiers sur les falaises. Dinan, les remparts, les douves, les parkings le matin, le port. Et aussi toutes les départementales, les croisements, les restaurants de coin de rue, les champs, les grandes surfaces désertes, les bourgs le dimanche midi, les jardins, les plans d’eau.
Voilà, je dirais, mes lieux matriciels.
Parfois l’après-midi je vois des abeilles voler autour de ma fenêtre. J’ai l’impression qu’elles construisent une ruche à côté de moi. Que tout un monde existe que j’ignore complètement.
J’écris pour essayer de comprendre, d’éclaircir, ce qui me manque, ce qui m’insatisfait à ce point dans la réalité. Et si je me promène peu, c’est aussi car je ne comprends plus très bien ce qu’elle a à m’offrir.
Saccage est un livre court mais qu’il faudrait lire très lentement. Le plus lentement possible. Je dirais même : attendez toute votre vie entre chaque phrase.
Ce matin, j’ai reçu par la poste le manuscrit que j’avais envoyé à POL il y a un an et demi, en août 2014. Sans aucune annotation, aucun mot, juste mon manuscrit, dans une autre enveloppe, en retour. Mon texte a beaucoup changé depuis un an et demi et il a trouvé une autre issue, et donc je ne sais pas très bien quoi faire de cette version là, sinon la détruire, détruire mon propre texte qui dans deux mois va pourtant paraître.
L’année dernière, j’ai travaillé, j’ai écrit pour la plus grande organisation patronale française. Aujourd’hui, j’en ai affreusement honte. On m’a dit : ne t’en fais pas, il faut bien vivre, il faut prendre l’argent où il se trouve. Mais j’ai honte d’avoir vécu avec l’argent de démons. Et pourtant j’en avais besoin. Et j’ai été mal traité durant ce travail, et il y a eu peu de reconnaissance au bout, et je ne sais quelle consolation j’y trouve aujourd’hui, sinon l’argent, qui n’est pas une consolation, qui est ce qui me permet de vivre, et d’écrire réellement, et de faire quelque chose de moi, de toucher à quelque chose d’important pour moi, et peut-être aussi je l’espère pour les autres. C’est vrai (Volodine et Guyotat l’ont déjà dit) qu’on se sent un peu comme une vermine, à toujours avoir besoin de, quémander, récolter quelques piécettes. On ne devrait pas avoir à se salir pour faire ce qui est important. Je ferai en sorte de ne plus jamais me salir. On a assez joué aux porcs.
« Oubli est-il le nom de ce brasier qui me dévore le coeur, et au milieu duquel je pleure ? » — Hélène Cixous, Homère est morte….
Je n’interrogeais pas ce geste, répété pendant trois mois (car mieux valait ne pas l’interroger si je voulais gagner mon argent) quand, après avoir coupé joues et oreilles : jeter la tête du porc dans un bac, un bac bien loin de moi, lancer la tête morte du porc sans oreilles ni joues, et parfois voir la tête manquer le bac et rouler sur le sol javellisé, rouler entre les pieds, la tête aux orbites pleines, regard vide, sans oreilles, sans joues. Lancer à travers la pièce les visages d’animaux mutilés. Et quand je n’avais pas à lancer la tête, c’est qu’elle poursuivait son trajet sur le tapis, où on lui ôtait la langue, où on lui fracassait le crâne en deux, où on détachait chaque parcelle de chair jusqu’au cerveau pour tout manger ensuite.
Et des bacs entiers qui déversaient ces têtes sur nos tapis, des dizaines de bacs chaque jour, des milliers de têtes, à rouler partout, tranchées, charcutées.
Ne pas interroger ce que c’est de saccager à ce point la vie.
La violence sociale actuellement est inouïe.
Je relis en ce moment les dernières épreuves de Saccage. Parfois je me dis : quand même, c’est pas mal. Je suis content de moi. C’est déjà ça. On avance comme on peut.
« Quelqu’un abat les broussailles, ose. On trouve le trésor derrière, ou plutôt la démesure des pierres et encore le labyrinthe dans la jungle, de temple en temple. Après bien sûr on décapite. On désosse les carcasses des dieux en statue. C’est quand même en soi qu’on a fait la place pour les grands monstres et pour le surprenant. » — Marie Cosnay, Déplacements.
Dans La ville fond, je mets en place un environnement qui se veut ouvertement illogique. La texte est de simple facture, les phrases facilement compréhensibles, et il est pourtant possible qu’à n’importe quel moment rien ne se passe comme prévu. Je ne cherche pas à exploiter logiquement une absurdité, mais bien à proposer de l’illogique. Par exemple, au début, il y a un bus qui brûle et finit en cendres. Le jour d’après, le chauffeur revient avec exactement le même bus, cette fois-ci dans son état habituel. Mais c’est bien le jour d’après, et c’est bien le même bus, il n’y a aucune tromperie, aucun coup-bas. Alors parfois les personnages parlent du bus comme s’il était en cendres, parfois comme s’il existait encore. Et quand le bus devient inutile et que plus personne ne l’utilise, il a bien un état final, mais ce n’est pas forcément sa destruction.
Évidemment, ça va provoquer un réel agaçement, dérangement chez le lecteur, qui ne va plus exactement savoir si telle chose existe ou non, ni dans quel état réel elle se trouve. L’invraisemblable gêne. Pourtant, encore une fois, rien de complexe dans le propos, tout se suit simplement, mais il faut accepter la rupture, l’incohérence. Ça va également créer un effet de superposition entre réalité et inexistance qui est, en fait, tout l’enjeu du texte. À la fois : qu’est-ce qui est ? qu’est-ce qui se trouve là ? untel est-il mort ou vivant ? et finalement : à quoi bon ?
« Je m’offre la liberté. Je proclame que je lâche tout, et regarderai les liens mourir et les corps se désorganiser. Je regarde la lumière se faire sur la désorganisation et la liberté. » — Bernard-Marie Koltès, Récits morts.
Je réfléchis à mon futur Livre nouveau du ciel et des enfers. J’essaie de comprendre où se trouve le sacré, où sont les lieux les plus symboliques de l’échange mystique. Je crois beaucoup aux visions de Guyotat et Koltès à ce sujet, à la transaction, au marché du corps principalement. Les bordels évidemment, certaines rues, pas forcément cachées, les boulevards, avenues, surtout marchands, outrageusement marchands je dirais — immenses devantures, lumières blafardes, etc. ; les parcs en périphérie des villes, les marchés (nourriture, viande à même l’air, odeurs, cris, foule), les parkings, les couloirs du métro, parfois les véhicules eux-mêmes (bus, wagons, surtout quand ils sont bondés), peut-être aussi autour de la télévision (devant le poste, dans les studios). Les lieux de culte se sont déplacés dans les lieux de passage. Il s’agit d’en finir vite avec le don, de le perdre dans le déplacement. On ne sacralise plus l’acte de foi, on le glisse sous le manteau. Cela met en évidence une nouvelle mythologie souterraine aux rapports de force habituels : dominants (dieux, bourreaux, marchands), et serviteurs (apôtres, clients, passants). Il faut circuler à travers tous ces univers communs, et dégager les motifs d’une nouvelle spiritualité, d’un nouveau parcours iniatique pour atteindre le sublime.
Le mystère qui persiste étant : quels sont les lieux de lumière ?
« Dans un accès de folie soudaine (catatonie ?), lui Konrad a commencé à badigeonner toute la Plâtrière, du faîte à la cave, avec une laque mate, noire, dont il a trouvé au grenier plusieurs bidons. Décidé à ne pas quitter la Plâtrière avant d’avoir revêtu de laque noire tout l’intérieur, il attachait le plus grand prix à tout peindre en noir, avec la laque noire trouvée au grenier. Murs et plafonds, meubles encore subsistants, tout, répétons-le, tout, il peignait en noir sur toutes les faces ; il badigeonna de noir jusqu’à la chambre de sa femme, tous les objets de la chambre de sa femme, finalement sa femme elle-même. » — Thomas Bernhard, La Plâtrière.
Il n’était jamais possible de rester plus de quelques minutes à la surface. Un immense rayon balayait les ruelles. Des rats couraient dans la boue et les putains commerçaient sous capuche. L’immense nef faisait des rondes où la milice envoyait ses sergents, appuyait les rafles. La chiure collait aux bottines ; pour les nettoyer de jeunes esclaves les léchaient. Les sergents passaient derrière le rayon, dans l’ombre du rayon, dans l’invisible du rayon, éclataient les visages. Dans l’ombre du rayon c’était presque la mort, et presque la domination, le carnage. On entendait des mères hurler aux fenêtres, aux fenêtres des caniveaux ; dans l’ombre de la déjection on ne voyait que les bouches hurlantes des mères, aussitôt condamnées par des bâtons de dynamite. Des rangées d’orbites creuses, reflétant par absence les visages balafrés des sergents. On disait du bordel : paradis, où descendent archanges et démons, les paumes riches d’or, les lèvres couvertes de pustules. Et ainsi ils embrassaient les phalanges des pécheurs déjà en larmes face à l’apparition divine. Et la crasse pour signer leurs fronts.
Parfois il faut laisser faire la machine et se résoudre au combat.
Persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer, persévérer.
Bouleversé par le chapitre Les adultes dans Onze rêves de suie.
« L’image disparut. Le rouge lumineux persistait sur les rétines, obligeant à penser encore aux arbres, à la terre, au feu intérieur. Puis l’un des trois ouvrit encore les yeux, et aperçut le rouge qui était encore là, comme une réalité évidente et naturelle, du moins sur les troncs des bouleaux, sur la terre. Puis, du point de vue de la réalité, ce fut fini. » — Manuela Draeger, Onze rêves de suie.
Je crois qu’il y a dans La ville fond une espèce de quête obstinée de la vérité, des origines. Une espèce de retour à l’instant initial de la création des choses. C’est une obstination démesurée, menée par un imbécile, une espèce d’imbécile, qui n’y comprend rien, qui ne comprend pas pourquoi son trajet quotidien devrait se révéler porteur du moindre sens. Il ne comprend pas pourquoi il ne devrait pas savoir, et pourquoi il lui est si dur de savoir, d’y parvenir, de comprendre.
Sécheresse presque totale. Beaucoup de lectures pour tenter de déclencher quoi ; rien ne vient.
ce qui vit outre les tombes là au Nord où tout se brise et les vagues toujours rouler le même sable toujours la même peur se noyer cent fois sans jamais revenir sa mère hurlant les genoux dans la boue et le mari derrière oublié déjà dans les dunes déjà parti déjà plus que la mère seule face au déferlement à l’image de celui emporté dans la houle et les hauts rochers à côté qui cachent qui cachent et jugent la douleur la douleur et le sel et la chaleur mêlés l’infini tunnel de la terreur l’infinie solitude de l’enfant disparu
Retrouver peut-être quelque chose de la peur, de la colère, de la joie. Retrouver de quoi fournir la parole, de quoi vivre un peu.
Un roman est aussi composé de tous les romans qu’il ne sera jamais.
J’ai acheté le dernier numéro de Critique consacré à Pierre Guyotat, et qui contient notamment deux textes inédits : le premier datant d’avant Tombeau, le second étant un extrait de Géhenne. On se demandait avec Guillaume ce qu’il en serait de ce texte, voyant déjà le niveau de difficulté de Joyeux animaux de la misère qui était, selon les dires de l’auteur, un exercice de détente. À la difficulté de la langue s’ajoute celle de la typographie, et on passe encore une étape importante dans l’effort.
Le grand trou qui nous sépare des oeuvres « en langue » de Guyotat vient de l’oralité. Il écrit presque comme on pourrait imaginer Homère ou Rabelais le faire, c’est-à-dire moins pour une lecture silencieuse personnelle, mais comme transmission orale, comme lègue, comme circulation sonore. Il faudrait hurler Guyotat dans des places publiques, dans des églises, dans des parkings, et non calmement, le dos voûté sur son bureau. Mais qui fait ça encore, qui est capable de ça. La langue de Guyotat est extrêmement singulière et complexe car elle fait appel à des méthodes culturelles oubliées, abandonnées. On attend de la voix de ces textes, et on attend, non pas de les lire, mais que quelqu’un nous le partage, converse, grâce à ce matériau unique et obscur. Guyotat a peut-être déjà écrit la langue des futurs esclaves que nous devenons progressivement. Mais nous n’y comprenons rien. Peut-être ne voulons-nous pas accepter la bestiole bavarde étrange en laquelle nous nous transformons.
Et il ne s’agit pas ici d’une critique, mais d’un aveu, d’un amer constat, qu’aussi profondément on puisse lire ses textes, Guyotat ne parle même plus, ou qu’à peine, à nous. Il est déjà après, dans les prochaines bouches, dans les prochaines voix.
(Mon exemplaire de Critique est si mal imprimé que l’encre du texte bave sur la couverture quand on y applique ses doigts.)
« Je creusais dans le vide qui était en moi, bien connu de moi et devenu si vaste, quoique fragmenté en unités. » — Marie Cosnay, Trois meurtres.
Nous quatre dans la chambre de mes grands-parents, c’est le matin, deux sont assis sur le tapis, adossés au barreaux en bois du lit ; deux autres sont sous la couette. Tous regardant la télévision en hauteur dans l’angle droit de la pièce, tous obsédés par la fantaisie. Les petits-déjeuners sont servis sur d’étroits plateaux noirs au fond desquels sont dessinés différents signes astrologiques. Des tartines finement découpées saupoudrées de chocolat, du jus d’orange, des céréales baignés de lait. De neuf heures à midi, sans presque bouger. Là tous en pyjama. Des figurines et peluches autour. Elle est là la mythologie de l’enfance ; l’agencement sacré d’une journée parmi d’autres. Et ce perpétuel fantasme d’un jour y revenir.
Qu’on se demande à ce point pourquoi je tiens au bon état de mes livres, puisque apparemment il faut qu’ils vivent, et que vivre veut forcément dire corner, déchirer, plier, écrire dans ; mais raye-t-on ses CDs ? entaillons-nous les troncs de nos bonsaïs ? arrachons-nous les ailes de nos papillons ? plie-t-on les capsules de nos bières ? découpons-nous nos timbres ?
Pour écrire la citation ci-dessous, j’ai dû un peu casser la reliure du livre. C’est bien simple, à peine l’avais-je ouvert qu’un bloc contenant la moitié des feuilles s’est détaché de la couverture. Je me suis retrouvé avec ce bloc dans la main gauche, la droite tenant le reste du livre. J’ai regardé un instant ce bloc et me suis demandé quoi en faire. Je l’ai glissé tant bien que mal à son emplacement initial et, grâce à une habile pression de ma part, l’ai maintenu ainsi durant le reste de ma lecture, comme s’il était toujours collé, comme s’il ne s’était rien passé. Qui a fabriqué cet objet ? C’est vraiment du travail de merde.
Maintenant que je l’ai achevé, il est rangé dans ma bibliothèque, bien serré entre deux autres livres intacts, ni vu ni connu. À ce rythme, je ferai bientôt disparaître les girafes.
« d’abord les beaux êtres humains : par milliers, dizaines de milliers, millions, nus, barbouillés de sang, aux ongles longs, aux cheveux longs, aux énormes ventres, boursouflés, des stries sur le dos, sur les reins : le gaz a gonflé leurs têtes, leur a bouché les conduits auditifs : une véritable pelle géante pousse la masse morte de ces êtres humains dans un four géant : la chaleur est telle que tout tombe en poussière, » — Thomas Bernhard, Dans les hauteurs.
L’humanité n’est rien de plus qu’une succession de couches, de calques. Là où vous dormez, auparavant il y avait des landes, sur ces landes des monstres carnivores hauts de plusieurs mètres, avant même il n’y avait rien sinon un immense vide, et bien plus tard ce vide reviendra. Entre-temps il y a des habitations, des chambres, des bureaux, des jardins. Il y a vous, qui ne passez qu’un instant. Si vous vivez dans un appartement, au quatrième étage, sans doute auparavant y avait-il le dense feuillage d’un arbre à votre hauteur, bondé d’oiseaux rares, probablement disparus, capables de chants inouïs, de merveilles, là où vous faites cuire des poivrons, passez le balai. Il est difficile de se résigner au gouffre immense dans lequel nous tombons en permanence, persuadés d’être à ce moment précis quelque chose, sinon déjà le souvenir un peu nostalgique d’une humanité future.
Je n’aurais jamais pensé faire ce lien un jour mais, entre la ligne de vêtements de Kanye West (voir la performance publique pour son dernier album) et les plus récentes fictions de Guyotat (Progénitures, Joyeux animaux de la misère), j’ai l’impression d’observer une flagrante familiarité. Des êtres de rien, vêtus de haillons, tous semblables, esclaves modernes, à jamais en colère, muets c’est-à-dire.
« Simplifions : si vous continuez à penser qu’il n’y a pas de souffrance plus forte que la vôtre, comprenez que c’est un signe de maladie mentale. » — Olivier Cadiot, Histoire de la littérature récente.
Je trouve étonnant qu’autant de personnes s’insurgent contre la haine d’une certaine jeunesse contre la France. Cette haine me semble pourtant chaque jour plus légitime. Qu’en faire, de cette haine ? Comment la canaliser ? Je suis plutôt surpris qu’autant de gens parviennent à la maîtriser. À voir comme nous sommes traités, je suis plutôt surpris que tout se maintienne encore à ce point. Il n’y a plus d’équilibre, il n’y a plus que des fondations fantômes. C’est un talent que de construire quoique ce soit sur ce vide. C’est un miracle que la France aujourd’hui.
Jusqu’à quel point sera-t-on prêt à tout laisser passer ?
Un passage dans Au plafond de Chevillard : Puis on me montre du doigt, regardez-le, encore un de ces pauvres types capables de tout pour attirer l’attention. Voilà ce que j’entends. Sachez-le donc, j’en retire moins de gloire que d’humiliation, je dois courber l’échine dans les bâtiments publics, les administrations, où mes airs penchés confortent dans le sentiment de leur toute-puissance les plus infimes, inefficaces et rabougris guichetiers déjà trop enclins à croire que les gens font la queue pour les contempler […] »
« Le narrateur avait attribué son « son manque de talent » à l’absence chez lui du don d’observation, ou plus exactement à ce qu’il supposait être une manière d’observer impropre à l’inspiration artistique. Il était incapable d’enregistrer la surface des choses. » — Samuel Beckett, Proust.
Sur la place centrale de Rennes, des gens déguisés protestent. Autour, des rideaux de policiers casqués et armés. Au-dessus, un hélicoptère plâne immobile. Sont-ce les fous que l’État craint ainsi ?
Résidus d’une discussion avec mon père à propos des femmes voilées d’un tchador, d’un niqab, ou d’une burqa :
1) Il ne comprend pas que, si jamais il y a aliénation par le biais de ce vêtement, elle vient moins de la religion que de l’homme qui l’impose. Tout comme certains hommes obligent leur femme à “être féminine”. À faire, selon leur désir : les courses, le repas des enfants, le ménage. Il ne comprend pas qu’un tel vêtement puisse être porté volontairement. Il ne comprend pas qu’un tel vêtement puisse même être signe de revendication contre le regard et la domination des hommes.
2) Il estime que la défiance d’une “grande partie de la population française” quant à ce vêtement impliquerait qu’elles fassent un effort et se voilent plutôt d’un hidjab (ou d’une shayla), plus sympathique, plus avenant. Il ne comprend pas que ces vêtements n’ont pas la même symbolique, la même fonction, qu’ils ne sont pas interchangeables à loisir. Il ne comprend pas que ce sont sa peur et son incompréhension qui font de ce vêtement une menace. Il ne comprend pas qu’elles n’ont aucune raison de l’enlever, qu’il n’a pas de pouvoir sur elles, car elles sont comme lui femmes françaises et, sinon françaises : libres. Il ne comprend pas que se soumettre au diktat populaire c’est perdre son combat, sa singularité. Sous couvert de laïcité, il ne voit pas pourquoi l’effort viendrait de lui.
3) Il estime que les femmes, ces dernières décennies, ont revendiqué et gagné le droit de s’habiller de moins en moins cachées. Il ne comprend pas qu’elles ont essentiellement conquis le droit de faire comme elles veulent sans l’aval des hommes : être couvertes, ou non.
4) Il estime que toutes les femmes portant ces voiles “tirent des têtes de six pieds de long”, comme si elles exprimaient forcément une souffrance quant à leur vêtement, et non à divers tracas quotidiens (sans parler du courage de circuler ainsi dans une société aussi ouvertement raciste). Comme si les femmes à la mode occidentale étaient plus enclinent à exprimer ce qu’elles veulent car on peut les voir en jupe, ou en pull ; et surtout à exprimer la joie, donc. Comme si lui-même était toujours souriant lorsqu’il circule dans la rue.
5) Il estime qu’une femme vêtue ainsi est forcément maltraitée, soumise. Il se donne un pouvoir de connaissance absurde sur la vie privée. Il ne se pose pourtant jamais la question de savoir si telle femme habillée à la mode occidentale et qu’il croise dans la rue est forcément bien traitée par son mari. Il n’accepte pas qu’il n’en sache tout simplement rien, et que là réside toute l’absurdité du jugement.
6) Il croit, comme son entourage, que c’est inquiétant pour le futur, pour la liberté. Il n’entend pas que sa liberté n’est pas la liberté. Que sa liberté, à l’entendre, empêche même celle de certaines femmes. Il n’entend pas que des problématiques similaires ont existées en France avec d’autres pays voisins depuis des siècles. Quand je lui parle du Musée de l’histoire de l’immigration, il me répond : Je n’ai pas de problème avec l’immigration !
7) Il estime véhiculer une pensée féministe. Pas la même que celle de mes quelques livres lus (Les filles voilées parlent, Féminismes islamiques, Classer, dominer). J’ai du mal ensuite à argumenter davantage. Je comprends n’avoir pas les armes pour mener ce combat.
« HB a presque 23 ans quand il connaît un accès fou de passion. Impossible alors de lire, même L’Avare. Impossible d’éprouver de la joie, même en présence de M(élanie), tout est éteint si ce n’est cette furieuse passion montée (qui est une passion d’ambition). HB est capable alors de toutes les infamies, il peut le crime, j’aurais eu plaisir à battre M. » — Marie Cosnay, Vie de HB.
Assise au bout de la table du salon, ma grand-mère fait ses comptes. Elle a monté du bois pour ce soir. La grande maison est vide. À l’étage, toutes les portes sont ouvertes mais personne n’attend. Aux murs, des portraits sourient. Par les fenêtres de la chambre on voit les champs abandonnés à l’hiver. Il y a des crêpes pour le goûter. C’est une journée qui passe.
« Je crois qu’il faut tout faire pour prévoir en toute ombre les choses, les voir obscurément. Mais le feu est unique et le restera. »
« Sans toi je m’installe confortablement dans le mal et ne suis bien nulle part. »
« Il le faut bien parce que je crois à l’accident, je ne peux avancer que d’accident en accident, dès que je sens une logique trop logique cela m’énerve et vais naturellement à l’illogisme. »
« Je n’ai pas la force de parachever mes tableaux.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi.
De tout coeur. »
« Nicolas de Staël se donna la mort en se précipitant dans le vide du haut de son immeuble dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mars 1955. »
Mal aux tempes et sensiblement à la tête. Ma grand-mère a fait une flambée. Les flammes me mangent les yeux dans le salon éteint. Lis à peine. Travaille sans entrain.
Staël à sa maîtresse Jeanne Polge : Ne dis pas que tu as choisi de vivre et souffrir, on ne sait pas ce que c’est la souffrance.
Et Jeanne, plus tard, s’inquiétant des pulsions suicidaires de son amant : Je sais que je ne suis pas seule dans ma détresse. J’ai besoin de marcher maintenant […] quand on n’a pas le courage de mourir il faut avoir le courage de vivre. »
Je suis complètement obsédé par l’histoire que je suis en train d’écrire en ce moment, et que j’avais commencée ici. Je suis incapable de produire quoi que ce soit à côté. Ça suce toute mon imagination. L’histoire est des plus simples : Bram doit se rendre en ville. Il a l’habitude de faire le trajet en bus pour y acheter des médicaments, mais cette fois-ci le bus n’arrive pas en ville. Cette fois puis d’autres, le bus bloque avant d’arriver en ville. Bram essaye par tous les moyens possibles, mais il n’y parvient pas. Il ne connaît pas le trajet jusqu’en ville, et a peur de sa périphérie. Bientôt, il se rend compte que les villageois du village voisin veulent eux aussi se rendre en ville. Que quelque chose de grand s’y prépare. Quelque chose qui pourrait tout bouleverser. Mais tout est déjà bouleversé. L’influence de la ville est sans limite. C’est un texte qui me ressemble beaucoup car il souffre de la relecture. Il doit se lire d’une traite sans faire attention à ce qu’on vient de lire. Il doit faire avec les trous de mémoire et avec les sauts possibles. Il doit bénéficier de la complète adhésion du lecteur. J’y mets mes propres fantasmes. Saccage se concentrait sur les intentions. La ville fond se concentre sur la progression.
Staël : C’est si dur d’accepter l’abruti qui se trouve en soi et comment faire sans lui ?
Ce qu’écrit Chevillard sur la religion est souvent assez bête.
Et pareil, j’aime énormément Butor, mais quand il affirme : j’ai l’impression qu’aujourd’hui, en littérature, il n’y a pas le mouvement et les interrogations qu’il y avait dans ma jeunesse, ça me plonge dans une tristesse véritable mêlée de perplexité. Je ne comprends pas comment on peut faire progresser la narration comme il l’a fait et ne plus y croire ensuite à ce point. Est-ce que lui-même ne serait pas victime d’une soudaine ignorance ?
« Françoise moque gentiment sa « gloire » mais le peintre apparaît déjà partagé entre l’angoisse de se sauvegarder et celle d’assurer bientôt sa tranquilité de création dans une solitude éloignée de Paris. »
Quand je rentre à Matignon en voiture et que je vois toutes ces zones, tous ces bâtiments en tôle, ces inconnus qui marchandent, qui sortent de leurs véhicules pour entrer dans des magasins où je n’ai jamais mis les pieds, acheter quoi, des morceaux de carrelage, des tiges métaliques, de la ferraille, quoi encore, quand je vois telle voiture passer devant moi, tel camion changer de direction et partir encore plus en avant dans la campagne, quand je lis les enseignes, quand j’observe les lotissements en construction, faits de terre et de cables, quand je vois la façon dont sont agencées les routes, les panneaux, les bourgs, les ralentisseurs, les sentiers de randonnée, telle femme qui sort de la boulangerie, et telle autre avec son caddie sur le parking, et les absents, quand je vois les parcs vides d’enfants, les maisons à vendre, celles jamais achetées, les mêmes, délabrées, les cours mal entretenues, trois chiens rôder, je sens qu’il y a quelque chose de plus que ce que je vois là. Je sais qu’il y a plus. Mais pourquoi suis-je le seul à m’en soucier ?
La vérité qui se cache derrière ces morceaux de rien, bâtiments ou mouvements à peine réfléchis, de quelle nature est-elle, que veut-elle dire, où mène-t-elle ? Pourquoi m’obsède-t-elle à ce point ? Qu’est-ce que je compte y trouver ? Qu’est-ce que j’y vois de moi ? La plupart des gens ne comprennent pas le sens que peuvent donner ces événements disparates et anodins. Ils ne saisissent pas ce qu’il y a à regarder, et qui n’est pas là. C’est impossible à expliquer. C’est l’intuition. C’est la vision. On vit seul avec.
« Toute ma vie j’ai eu besoin de penser peinture, de voir des tableaux, de faire de la peinture pour m’aider à vivre, me libérer de toutes les impressions, toutes les sensations, toutes les inquiétudes auxquelles je n’ai jamais trouvé d’autres issues que la peinture. » — Nicolas de Staël, Lettres.
Il y a ce qui pourrait peut-être ressembler à une espèce de purgatoire. Il ne revit pas infiniment la même journée. Il est à différentes étapes de multiples vies vécues par lui-même sur des axes semblables. Il est à la fois soumis aux visions, au réel, au souvenir, et à tout ce que ces événements charrient comme émotions : regrets, culpabilité, peur, etc. On peut penser qu’il cherche une issue. Je ne sais pas s’il cherche une issue. Je ne sais pas ce qu’il cherche, ce que je veux le faire trouver. Je ne sais pas si je veux lui faire trouver la moindre chose. Je veux lui faire vivre le pire. Il vit le pire. Il ne s’en sort pas. Il n’y arrivera jamais. Il verra tout s’écrouler autour de lui et il ne trouvera aucune issue. Il aura différents angles sur la même destruction. Il se dira : quelle histoire ! Mais il n’y aura jamais eu d’histoire. Il n’aura jamais existé.
Je travaille beaucoup. Quand je regarde où j’en étais il y a quatre ans, je me dis que, sans tout ce travail accompli, jamais je n’en aurais été là aujourd’hui. Dans l’art il n’y a que du travail. Il y a d’abord le labeur d’observer, qui est ingrat car inutile, car incompris, car mal perçu. Puis il y a le labeur encore pire de dire. Tous nous avons été démunis enfants quand, voulant retranscrire ce qui prenait forme dans notre tête, on ne ressortait sur le papier que trois traits maladroits et des visages boursouflés. Longtemps j’ai cru qu’il fallait magnifier, préciser, gommer les bizarreries. Mais plus que jamais désormais je tente de suivre ma pente, de boursoufler davantage, de produire des monstres, des monstres dans des châteaux biscornus, des scènes maladroites de torture et d’amour. Vous trouverez partout des voisins ; mais des assassins, seulement dans ma tête. C’est en ça qu’elle a un prix.
Enfant, j’ai toujours été soumis à deux principes : la répétition, et la destruction. Ces deux principes sont liés à ma solitude. Je ne pense pas que je cherchais une solution, une réponse à ma solitude, mais je sais qu’elle m’a enclenché dans ce parcours. Mon demi-frère et ma demi-soeur ont dix ans de plus que moi, et je n’ai donc pas grandi avec eux. Je n’ai pas connu la fratrie. J’ai grandi dans un lotissement. La plupart de mes jeux avaient un système de boucle. Le soir, je tapais au ballon contre un muret qui me le renvoyait selon des trajectoires attendues. Ainsi pendant des heures. Je m’affrontais moi-même aux billes, feignant de ne pas connaître mes propres stratégies. Ou encore, j’accomplissais des tours à vélo (c’est ainsi que j’expliquais mon jeu à mes parents). J’empruntais toujours les mêmes rues, en boucle, en abordant toujours les mêmes virages de la même manière, en évitant toujours les mêmes voisins qui rentraient du travail dans les mêmes voitures.
Ainsi, encore une fois, deux élans se confrontaient : la joie de toujours revenir, et la frustration que jamais rien ne change. Quand j’ai été plus grand et eu le courage de traverser, de couper là où habituellement je ne passais jamais, je me suis rendu compte comme tout se liait. Comme Proust d’une ville à l’autre que jusque-là aucune route ne faisait communiquer. Pour lui il y avait une révélation, pour moi une déception. Je pouvais franchir un bois entier, des jardins privés, des plans d’eau, je revenais toujours sur une route connue. Je me rendais compte que, peu importe à quel point on pouvait s’emparer du paysage, on revenait toujours aux mêmes endroits. On ne créait jamais rien. Notre parcours ne produisait jamais rien. Non seulement il ne produisait pas de sens, puisque je ne découvrais rien, mais en plus il ne produisait pas de contenu, il ne faisait rien apparaître : ni nouvelle ville, ni nouveaux animaux, ni nouveaux passages, tunnels, donjons, murailles brisées, rien. J’ai toujours été déçu, voire furieux, par le manque d’investissement de la nature quant à mes recherches obstinées.
D’où mon second principe : la destruction. Puisque la réalité me laissait insatisfait, je construisais dans ma chambre. Aux figurines des personnalités, aux quartiers en Lego une existence. Mais cette existence n’avait pas d’autonomie. Elle ne m’intégrait pas. J’étais partout, et ne pouvais donc rien y trouver de plus : j’avais tout créé, j’avais déjà tout imaginé. Je connaissais chaque pièce, chaque brique de chaque fondation. Alors je réduisais à néant et je recommençais. Presque indéfiniment. Un hélicoptère devenait une voiture de course devenait un lion devenait une masse informe devenait une tour de contrôle devenait un lac ; mais rien n’aboutissait, rien ne se produisait. Aujourd’hui, de toutes ces constructions faites les unes par-dessus les autres, je n’en peux distinguer aucune. C’est un échec monumental : je n’ai rien trouvé nulle part. Dans la destruction, il y avait ce même vide que depuis toujours je fuyais.
J’ai toujours eu ce fantasme que le parcours produise un sens, ou qu’en créant, en détruisant, je puisse trouver une réponse. Que chaque investissement ne me ramènerait pas à mon échec initial, à ma solitude première. Car j’étais là, et je persévérais dans le décor, et dans l’architecture, et j’ai cru distinguer une brèche, une faille minuscule, et à l’intérieur il y avait une autre vie pour moi. Mais cette faille n’était que le miroir du trajet déjà parcouru. Il n’y avait qu’une seule maison dans laquelle rentrer, la même, la mienne, où mes parents manquaient, où les jours se répétaient, où rien ne me consolait.
« S’incluant lui-même parmi ses personnages modestes et anonymes, Matsumoto, au-delà d’une simple signature humoristique, signale la vraie nature de son métier de mangaka : celui qui en se considérant comme appartenant au plus petit rang des opprimés est le plus à même de créer une image salutaire de l’attente d’une salvation presque messianique qui gît au coeur de toute situation désespérée. » — Pierre Pigot, Apocalypse manga.
La quête obstinée du non-sens. Je cherche par-dessus tout à profiter de, à exploiter la crédulité du lecteur pour le faire vivre n’importe quoi. Lui dire : passe cette porte, elle mène là où je te dis qu’elle mène. Reprends-la, et elle te mènera ailleurs. Et l’action seule fait logique. Alors les mêmes événements bouclent, reviennent à l’identique, se dupliquent, se superposent, se percutent. On ne peut que suivre le mouvement, un peu dérouté, un peu triste de ne plus trouver le chemin, et finalement on se perd, et finalement on meurt ainsi.
En lisant Apocalypse manga, j’arrive sur la page Wikipédia de l’unité 731 :
Deux cents prisonniers peuplaient ces cellules. Deux ou trois mouraient chaque jour. On se livrait à la vivisection de détenus. Certains furent bouillis vifs, d’autres brûlés au lance-flammes, d’autres congelés, d’autres subirent des transfusions de sang de cheval ou même d’eau de mer, d’autres ont été électrocutés, tués dans des centrifugeuses géantes, ou soumis à une exposition prolongée aux rayons X. Des détenus furent complètement déshydratés, c’est-à-dire momifiés vivants. On les desséchait jusqu’à ce qu’ils meurent et ne pèsent plus qu’un cinquième de leur poids normal. On étudiait également sur eux les effets du cyanure d’hydrogène, d’acétone et de potassium. Certains détenus étaient affamés et privés de sommeil, jusqu’à la mort. D’autres furent soumis à des expériences de décompression.
C’est intéressant ce que l’homme peut faire.
Quand vous vous observez dans le miroir, imaginez, pressentez que quelqu’un passe furtivement derrière vous. Vous vous sentirez alors immédiatement étranger sous votre propre toit.
J’ai une tendance systématique à l’essoufflement. Arrivé à un certain stade d’un projet, je ne sais plus où ni comment avancer. Ça peut arriver au bout d’un paragraphe, de cinquante pages, mais je ne vois plus rien. Tout l’attroupement que je fais grouiller soudain ne grouille plus du tout, les personnages n’ont plus de visage, ils n’ont plus de rôle, ils n’ont plus aucun intérêt. Et puis les décors se délitent, et puis voilà et puis plus rien. Alors je dirais : être endurant. Le plus important, c’est l’endurance. Décidément oui, l’endurance.
Parce que je suis fier aussi de participer à la construction de cette maison, parce que j’y retrouve tout ce que je cherchais dans l’écriture (des discussions, de l’exigence, de la rigueur, de l’enthousiasme, de l’engagement, de l’aventure, de la cohérence, une famille littéraire), vous devriez lire cet entretien des deux ogres. Il y a là tout ce qu’on peut attendre d’une défense efficace de la littérature.
Triste qu’à la fin du Démarcheur Monge ne s’enterre pas lui-même.
On trouve parfois des petits morceaux de papier magnétiques dans certains livres. Ils sont là pour qu’on ne vole pas les livres dans certaines librairies. Parfois ces petits morceaux sont collés dans le livre. C’est étrange. Quand on tombe sur la page où le petit morceau est collé, on se remémoire à quel point ce livre, on ne l’a pas volé. Ça fait des bons souvenirs.
« Tous ces temps-ci je pense et repense de plus en plus à ma vie. J’en cherche la faute capitale : la source de tout le mal, celle que j’ai sans doute commise, sans arriver à la découvrir. » — Franz Kafka, Recherches d’un chien.
J’y pensais un peu comme ça mais, vraiment, briser la logique du récit, faire du manque de liens la rigueur même de l’ensemble, il y a là de quoi réfléchir. Peut-être que la Poétique pèse trop encore actuellement sur la façon d’écrire. La vraisemblance, la cohérence, est-ce qu’on y tient toujours tant que ça, est-ce que ça provoque encore du sens, est-ce qu’on souhaite absolument se rendre quelque part ? Est-ce qu’on n’est pas victimes du sens à tout prix, de la suite à tout prix, des corrélations à tout prix ? Est-ce que la confusion n’est pas un peu magie, la rupture un peu splendeur, la destruction un peu poésie ? Est-ce qu’il ne serait pas temps de s’en foutre complètement ? Intelligemment, mais complètement ?
Construire son rapport au monde, c’est aussi mettre en avant tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui ne nous satisfait pas. Dégager un sens n’est pas forcément en donner un. Il s’agit plutôt de mettre à plat. Si on travaille à mettre à plat le foutoir, n’a-t-il pas une raison d’être ? Je ne crois pas à la façon dont les choses se présentent immédiatement à moi, je doute toujours de ce qui se présente à moi, de comment ça se présente à moi, de comment ça évolue, de comment ça meurt aussi, à terme. Je ne suis pas convaincu par le sens qu’on donne actuellement au monde. Je n’y trouve rien qui me satisfasse. Je n’y trouve rien de solide. Je m’engage à ne rien construire de solide.

Ma compromission professionnelle me tue parfois. Je tente de m’oublier, je tente d’oublier ça, à quel point je me salis pour vivre. Je ne sais pas si je pourrai l’oublier, si le reste prendra le pas sur ce qui n’a pas de valeur. Si le dernier jour je serai capable de dire : ça valait bien toute cette peine.
« J’étais raide et froid, j’étais un pont, je passais au-dessus d’un abîme. La pointe de mes pieds s’enfonçait d’un côté, de l’autre mes mains s’engageaient dans la terre ; je me suis accroché de toutes mes dents à l’argile qui s’effritait. Les pans de mon veston battaient à mes côtés. Au fond du gouffre on entendait mugir l’eau glacée du torrent que chérissent les truites. » — Franz Kafka, Le pont.
Le plus difficile, c’est de conserver la vue d’ensemble du projet, la cohérence générale. Savoir à chaque instant pourquoi tel personnage avance là où on le mène, pourquoi il fait des détours, ou non, pourquoi il rencontre qui il rencontre, et pourquoi parfois il tue qui il rencontre ou le salue, ou le fuit. Ne pas se perdre par hasard, mais savoir pourquoi on se perd. Bien sûr on n’est jamais tout à fait convaincu par les arguments qu’on avance, bien sûr souvent on fait fausse route et on s’obstine pour se pousser aussi à se sortir du pétrin. Épuiser les possibles fait partie de ce travail absurde d’écrire.
L’ambition est de se saisir de ce manque absolu de vision pour accentuer les désordres temporels et géographiques. Éclater absolument la chronologie du récit. Des choses se sont bien déroulées. À savoir dans quel ordre, c’est une autre histoire.
Dans la nuit, Bram se rendit compte qu’il n’avançait plus. Il appela le chauffeur, mais il ne répondit pas. Il voulut toucher le vélo, mais il ne le trouva pas. La caisse en bois s’était décrochée, et le chauffeur avait continué sans Bram. Bram n’avait jamais fait la route jusqu’en ville par ses propres moyens, et il lui était impossible de poursuivre à pied. Il resta dans la caisse en bois. Il eut peur que l’incendie ou les porcs ou autre chose ne le rattrape. Il eut peur de finir ainsi que la veuve, brûlé par quelque chose de la forêt. Il aurait voulu attendre jusqu’au jour mais craignait que sa condition ne s’aggrave. Bram ne savait pas combien d’heures le séparaient encore du jour. Il ne savait pas si le chauffeur se rendrait compte de son absence et ferait demi-tour. Si le chauffeur faisait demi-tour et qu’il ne retrouvait pas Bram sur la route, il n’aurait pas le courage de s’aventurer ailleurs. Peut-être le chauffeur a-t-il consciemment décroché la caisse en bois, se dit Bram. Peut-être m’a-t-il consciemment laissé en proie aux ombres de la nuit et aux spectres des morts. Bram n’imaginait pas que le chauffeur ait pu le piéger. Bram ne connaissait pas si bien le chauffeur. Qu’avait pu dire le chauffeur au fermier pour qu’il s’explose ainsi le crâne avec son fusil, voilà ce que Bram se demandait. Pourquoi le chauffeur détestait-il à ce point la veuve décédée, voilà ce que Bram se demandait. Pourquoi n’y avait-il que son bus pour nous emmener en ville. Bram se demanda si le chauffeur voulait lui cacher la ville, s’il voulait le priver de voir la ville à nouveau. Si le chauffeur avait voulu priver le fermier et la veuve de voir la ville à nouveau. Bram ne savait plus où se trouvait le village, ni sa maison, ni la ville. Alors il regarda le sens dans lequel la caisse en bois s’était décrochée, et par là où se trouvait le crochet, il imagina que se trouvait la ville. Derrière lui devaient se trouver la ferme, puis l’arrêt de bus, puis le village, puis chez lui. Autour de Bram il n’y avait rien car Bram n’envisageait rien d’autre que ces quatre lieux. À travers les fenêtres du bus, tout lui paraissait bien différent. Tout lui paraissait si plat. Bram ignorait combien de pas il devrait faire pour atteindre la ville, dans ce qui jusqu’ici pour lui n’était qu’une multitude de tableaux. Si je sors de ma caisse en bois, je romps l’image, se dit Bram. Le chauffeur ne reviendra pas, se dit Bram. Alors Bram se leva, tâtonna rapidement hors de la caisse en bois, puis finalement sortit complètement. Il franchit le talus qui longeait la route. Ce que Bram imaginait être un talus. Il dut forcer son passage dans les buissons et entre les ronces pour passer de l’autre côté. Autour de son corps, dans le même temps qu’il franchit le talus, l’intégralité du décor se déchira. Ainsi que dans le ville à présent qu’elle fondait, tout se déchira.
Bram ne sut combien de pas il fit dans le noir complet jusqu’au premier lampadaire. Il ne reconnut rien tout de suite. Au second lampadaire, un policier salua Bram, et lui dit : Bienvenue en ville. Bram se réjouit d’avoir trouvé le chemin, lui qui ne l’avait jusque-là jamais fait à pied. Bien qu’il fasse nuit, Bram s’inquiéta du nombre de policiers à patrouiller en ville. Il ne vit que des policiers, partout, dans toutes les rues. Alors qu’il déambulait, toujours accompagné du premier policier, il reconnut la rue du bourg où se trouvaient le bar de la veuve, ainsi que la boucherie. Puis, dans la rue, il reconnut les deux mêmes commerces. À cause de l’heure, ils étaient bien sûr fermés, mais Bram se promit de revenir le lendemain matin. Le policier accompagna Bram jusqu’à l’hôtel le plus proche. On lui offrit la nuit qui (il l’apprit à cet instant) finissait, et il s’endormit. Bram ignorait que, depuis que la ville fondait, nombre d’autres villages l’imitaient, nombre d’autres villages piégeaient.
La chronologie a éclaté, et la logique de même.
Comme la nuit était profonde et le ciel sans étoiles, Bram ne parvint pas à voir où se dirigeait le chauffeur. Le chauffeur semblait pédaler pour échapper à l’incendie de la ferme, mais quand Bram se retournait, il ne voyait rien derrière lui. Bram savait qu’à rouler aussi tard ils risquaient le pire. Le bus ne roulait jamais à des heures pareilles, et pourtant il était bien protégé. Que le chauffeur conduise aussi vite montrait à quel point il était déterminé à ne pas se laisser distraire par les ombres de la nuit et les spectres des morts alentour. Le chauffeur connaissait le chemin jusqu’en ville par coeur car il l’avait fait des années en bus. Le chauffeur doit être heureux de pouvoir à nouveau faire le chemin jusqu’en ville, se dit Bram. Le chauffeur espérait retrouver sa famille et son foyer, ainsi il pédalait sans se ménager. Bram vit sur le bord de la route la veuve le visage de terre et des porcs courir. Ils n’étaient là, à chaque fois, qu’un instant. Bram voyait la trace des porcs quand il ne voyait pas les porcs eux-mêmes. Bram savait que la nuit serait longue et il comptait sur le chauffeur pour le protéger. Bram n’avait rien à attendre. Le chauffeur ne parlait plus. Il avait le fusil du fermier en travers du dos, tenu par une lanière. Bram savait que le fusil du chauffeur tuerait à nouveau. Bram savait que dans le fusil il y avait la mort du fermier, et qu’elle se répandrait à nouveau. Bram croyait que les armes conservent quelque chose de ceux qu’elles ont tué. Ainsi les porcs sont vus car ils sont dans l’arme, et la veuve de même, bien que l’arme n’ait pas tué la veuve, bien que Bram ignore comment la veuve est morte dans la forêt. Bram n’avait jamais eu d’arme car sinon par la fenêtre de chez lui il aurait vu tous les morts, et il ne l’aurait pas supporté. Il aurait vu les animaux et les hommes, et il ne l’aurait pas supporté. Il n’aurait pas supporté voir tous les disparus par sa fenêtre. Bram ignorait que, depuis que la ville fondait, tout le monde disparaissait, tout le monde revenait.
Quelle autre ambition valable que celle de disparaître tout à fait ?
« Quand la Terre disparaîtra, comment ferai-je pour marcher sans avoir le vertige ? »
Namrej vit la glace derrière laquelle se trouvait Gabja le damné, premier frère du voyant Orstir, se fendre. Orstir dit à Namrej qu’une fois chaque frère et chaque soeur vus les vitrines se fendraient et qu’ils deviendraient tous partie de Namrej, nouveau serviteur-témoin de la mère source Miraj. Qu’ainsi frères et soeurs seraient le nouveau fils absolu de la mère source Miraj et du père fautif Calvarde. Ainsi Namrej vit dans ses mains apparaître les deux sachets de la guérison et de la vermine, et il devint Namrej prince nouveau des poisons, témoin et consolateur du premier frère Gabja. Orstir poursuivit dans la salle entière de vitrines, et présenta à Namrej sa seconde soeur : Damirine l’oublieuse.
Damirine l’oublieuse, troisième reine des mémoires, était la première fille de l’unique mère Miraj et du père-busard Machine. Elle fut l’unique fille du père-busard Machine, défait sitôt Damirine née par le père fautif Calvarde, grand prédateur du ciel, anéantisseur au feu. Elle fut cachée à sa naissance par la mère unique Miraj dans un bordel et devint à l’âge de dix ans la danseuse merveilleuse fruit des plaisirs immondes. Ses danses menaient au lit les hommes-porcins, qu’elle endormait puis poignardait dans la bouche, instant où son dernier frère Voljin, roi détesté du pays incendiaire, mangeait les dépouilles dans son antre cachée, domaine des pénombres. Ainsi Damirine l’oublieuse purgeait le pays comme l’avait souhaité son défunt père-busard Machine. Un soir, un homme-porcin se présenta au bordel. Les boucles qu’il portait aux oreilles ensorcelèrent Damirine l’oublieuse, et la danseuse en tomba aussitôt amoureuse. Au lit, elle oublia de dissimuler sa forme de reine-déesse à l’homme-porcin aux boucles de nacre. Ainsi il vit là celle cachée par la mère unique Miraj. Une fois sorti du bordel, il dévoila dans tous le pays la forme de reine-déesse de la danseuse-putain Damirine. Sans l’aide de son défunt père-busard Machine, elle fut souillée puis dévorée par les hommes-porcins, sous le regard froid et dément du père fautif Calvarde, double masqué de l’homme-porcin aux boucles de nacre.
Namrej ne put en entendre davantage et s’effondra sur le sol. Orstir lui ouvrit la bouche et lui fit boire le suc doux de l’abeille seigneure. Orstir le voyant savait que dans ses songes Namrej affrontait le père fautif Calvarde, l’oeil dessiné sur sa main brûlant à présent sa peau. Il le tint dans ses bras, assis sur le sol. Après un intense combat, Namrej se réveilla, et dit au voyant Orstir : J’ai vu le père-fautif Calvarde tenir par les cheveux Damirine l’oublieuse, et mon propre fils sans nom. Dans la bouche grande ouverte de mon fils, il n’y avait aucune lumière, Orstir, mais des nuées de sauterelles. Orstir répondit à Namrej : N’aie crainte. Le jour venu, tu auras les armes pour délivrer ton fils, pour vaincre le père fautif Calvarde. Namrej dit : Et si l’arme du père fautif Calvarde est mon propre fils sans nom ? Orstir le voyant lui répondit : Alors, tu devras vaincre ton fils.
Ce qui m’amuse le plus dans Making a murderer, c’est l’amateurisme complet des agents chargés d’accuser à tort un innocent. Des erreurs flagrantes, des scellés brisés, des messages effacés, tout un tas de bizarreries évidemment à souligner, qui sont compensées et sauvées par l’infernal aveuglement et la plus absolue complexité des systèmes judiciaires et policiers. En face de nous se trouvent de terribles idiots, mais ils savent parfaitement quand et comment fermer les yeux. Je crois que l’agacement total de ces injustices vient de là : que tous, ils ne sont même pas foutus de faire correctement leur boulot, d’au moins se donner un peu la peine.
Bram et le chauffeur décidèrent de rester dormir chez le fermier suicidé. Comme ils s’y attendaient, la porte d’entrée était ouverte. Bram se dirigea aussitôt vers la cuisine, où la lumière était restée allumée. Il vit alors, sur le carrelage, derrière la table, encore étrangement assis sur la chaise renversée, le corps du fermier et son visage déchiré. Il se retourna pour avertir le chauffeur de son étrange découverte, quand il vit celui-ci sur le seuil de la cuisine, son nouveau fusil pointé sur le visage de Bram. Bram ferma les yeux, entendit une intense détonation, et quand il rouvrit les yeux, il vit le visage du chauffeur explosé, et son corps étendu sur le carrelage. Puis un porc, venu du salon, vint lécher le sang du chauffeur. Puis un autre porc, et encore, encore des porcs, à présent venant de la porte d’entrée, du garage, de l’étage, tous lapaient le sang du chauffeur qui n’en finissait plus de couler depuis la plaie béante qui lui servait alors de bouche. Bram se réfugia à l’étage, dans la première pièce qui se présentait à lui, tout en évitant les porcs qui arrivaient toujours. Il vit là, assis face à face, la veuve le visage de terre, le fermier le visage absent. Les deux immobiles basculaient leurs têtes de droite à gauche. Bram avança jusqu’à la fenêtre au bout de la pièce, et vit, en contre-bas dans le champ, un immense incendie manger le terrain. Les porcs fuyaient le feu. Les porcs se réfugiaient dans la maison du fermier mais bientôt l’incendie détruirait aussi la maison du fermier. Bram courut vers l’extérieur pour repartir à vélo mais quand il arriva au rez-de-chaussée il surprit le chauffeur en train de manger les entrailles d’un porc à même la table de la cuisine. Le porc fixait Bram. Alors Bram entendit une intense détonation, et la fenêtre de la cuisine explosa, et Bram vit par-delà la fenêtre explosée les deux canons du fusil pointés sur lui, et derrière la crosse le chauffeur qui lui dit : Allons-y, les porcs arrivent. Bram sauta par la fenêtre et, arrivé dans la caisse en bois, il sombra, son crâne saturé par les détonations du fusil. Bram ignorait que son mal n’était rien à côté de celui de la ville, depuis que celle-ci fondait.
(Ce que peut observer Bram n’a rien à voir avec les rêves.)
« Je renonce à travailler. J’ai passé toute la journée chez moi à penser et à ne rien faire. On a sonné deux fois. Je n’ai pas ouvert. Pas de contacts humains, je m’aseptise. » — Jacques Spitz, L’oeil du purgatoire.
Bram et le chauffeur roulèrent encore plusieurs kilomètres, jusqu’au soir, où ils abordèrent une ferme. Bram vit de la lumière provenir d’une des fenêtres au rez-de-chaussée de la maison d’à côté. Le chauffeur dit à Bram qu’il ferait le tour, voir si, dans la ferme, il y aurait quelqu’un. Bram frappa à la porte de la maison alors que le chauffeur s’éloignait vers la ferme. Personne ne vint lui ouvrir. Il regarda par la fenêtre si quelqu’un se trouvait dans la pièce éclairée. Il vit qu’une des chaises était renversée sur le sol. Bram ne s’aventura pas à l’intérieur de la maison, craignant de surprendre une dispute familiale. Il se dirigea à son tour sur la droite, vers la ferme. Il ouvrit et pénétra dans une immense porcherie vide de porcs. Elle sentait encore un mélange de crasse, d’urine et de foin. Un tuyau percé coulait dans l’allée. Bram traversa la porcherie en son entier en évitant les flaques puis sortit de l’autre côté, qui débouchait sur un large champ. Il vit, au loin, au bout du champ en contre-bas, le chauffeur discuter avec un homme qu’il imaginait être le fermier. Puis il vit, encore au loin, mais à l’extrémité gauche de son champ visuel, un groupe de porcs s’enfuir. Il marcha vers le chauffeur et le fermier, qui toujours discutaient, puis il distingua une auge, puis il distingua le fermier sortir de derrière l’auge un fusil, puis il distingua les deux canons du fusil, puis les deux canons se retourner contre le visage du fermier, puis le doigt du fermier appuyer sur la détente du fusil puis dans le même temps le crâne du fermier voler en éclat, puis les éclaboussures de sang recouvrir entièrement le visage du chauffeur. Bram, sonné par le bruit, se rapprocha avec difficulté du chauffeur. Le chauffeur dit à Bram, sa bouche s’ouvrant dans le sang, que, d’après le fermier, les porcs se dévoraient, et qu’il n’y pouvait rien. Le chauffeur ramassa le fusil du fermier, puis, en silence, ils firent demi-tour. Bram et le chauffeur, revenant vers leur vélo, regardaient le ciel s’obscurcir, les nuages, ignorant que, depuis que la ville fondait, quantité de fusils faisaient voler en éclats quantité de crânes.
Je suis passé chez l’ogre pour signer quelques papiers. À monter les marches jusqu’au sixième étage de l’immeuble pour finalement arriver au bout d’un couloir sombre, on a la sensation de se diriger vers un laboratoire. Et alors, quand on ouvre la porte, ce qu’on voit, c’est un laboratoire. Il y a aussi la sensation d’être au début de quelque chose, de n’être pourtant pas beaucoup plus avancés que quelques étudiants dans une chambre de bonne, mais pourtant certains qu’on a déjà largement troué le toit qui nous empêchait. C’est un sommet comme une cave, un genre de pièce perdue, où des tubes fuient, et où les gargouilles crient.
La seconde partie apocalyptique dans Sans l’orang-outan était aussi inattendue que jouissive.
« Dans les rêves les pensées se ressassent et se reformulent, avec des déplacements infimes, sans jamais dire exactement l’identique. » — Lucie Taïeb, Safe.
Déjà pénible à cause de la caisse en bois à traîner, le trajet à vélo s’avérait encore beaucoup plus pénible que prévu. En effet, les arbres tombés au sol depuis la tempête n’avaient toujours pas été dégagés de la chaussée. À chaque instant, il fallait soit soulever les troncs avec difficulté pour les disposer sur le bas-côté, soit emprunter des chemins détournés, toujours plus cahoteux, toujours plus hostiles. Bram s’étonna de ce manque évident d’entretien. Il se demandait à quoi pensait la ville pour laisser ainsi la campagne à l’abandon. Il s’en enquit auprès du chauffeur qui ne sembla pas y témoigner une très grande inquiétude. La matinée venait de passer que les deux hommes n’en étaient pas encore au niveau de l’arrêt où Bram attendait le bus habituellement. Bram et le chauffeur s’installèrent un moment sur un banc au bord de la route, et mangèrent le repas qu’ils avaient préparé la veille et qu’ils conservaient dans une petite boîte en métal stockée dans la caisse en bois. Un rapide calcul fit prendre conscience à Bram qu’à ce rythme ils n’arriveraient que dans un ou deux jours en ville. Bram espérait que la tempête n’avait pas ainsi dévasté le bocage jusqu’à la ville. Sinon, ils n’en finiraient jamais d’aller en ville. Ils auraient pu attendre que la ville s’occupe enfin de déblayer la route, mais Bram était toujours plus pressé. Plus Bram était freiné, et plus il était pressé. Sans qu’il le sache pourtant, Bram fit bien de poursuivre, car personne ne viendrait s’occuper des arbres tombés au sol, à présent que la ville fondait.
À force de courage et de patience, Bram et le chauffeur parvinrent, vers le début d’après-midi, à l’arrêt de bus qu’utilisait Bram habituellement. Ils virent, alors qu’ils arrivaient précisément sur les lieux, un groupe d’enfants taper au pied dans un tas de cendres. Bram, qui pédalait, vit la scène en premier, et ne voulut pas alerter le chauffeur. Mais ce dernier, assis à l’arrière et intrigué par le bruit, quand il se rendit compte de ce qui se passait, bondit aussitôt de la caisse en bois et courut à la rencontre des enfants. Il insulta copieusement le groupe, leur demandant à force d’injures et de gifles comment ils osaient ainsi souiller les restes de son bus, de sa carrière, pour ne pas dire de sa vie entière. Un enfant, que le chauffeur tenait par le col de sa chemise, lui dit qu’on leur avait ordonné d’agir ainsi. Quand le chauffeur demanda le nom du commanditaire, l’enfant mordit la main du chauffeur, puis le groupe entier s’enfuit en courant à travers champs. Le chauffeur voulut les poursuivre mais il se prit les pieds dans une branche au sol et chuta dans un fossé. Bram, resté en retrait du conflit, aida le chauffeur à se relever, et lui demanda qui étaient ces enfants. Le chauffeur dit à Bram qu’il en avait reconnu deux ou trois, habitués de son bus. Le chauffeur dit également que ces enfants n’étaient cependant pas habitués à vadrouiller seuls dans la campagne, qu’ils étaient habituellement bien surveillés par leurs parents. Bram et le chauffeur, debouts, regardèrent un instant en silence le groupe d’enfants s’éloigner dans la distance. Bram demanda ensuite au chauffeur où était son second bus, celui avec lequel le chauffeur était venu le chercher après que le premier ait été réduit en cendres, et qu’ils avaient laissé sur le côté, en panne. Le chauffeur informa Bram que sa question était d’abord bien trop compliquée, et ensuite qu’il n’y avait jamais eu qu’un bus, celui-là, en cendres. Qu’aucun autre n’avait jamais circulé. Le chauffeur dit à Bram qu’il ne pouvait pas laisser les cendres de son bus ainsi en proie à tous les vandales de la campagne. Alors le chauffeur reprit la petite boîte en métal dans la caisse en bois, et, là où se trouvait plus tôt leur déjeuner, il déposa comme il put avec ses mains les cendres de son bus. Bram l’observa faire avec attention, puis il se remit en selle. Le chauffeur, de son côté, tenant toujours la petite boîte en métal fermement contre lui, se rassit dans la caisse en bois. Bram et le chauffeur ignoraient que, depuis que la ville fondait, des bandes d’enfants orphelins parcouraient le pays et souillaient les restes des habitants.
À force de pédaler, Bram remarqua à quel point le pays était vallonné. Ses muscles chauffaient, tiraient, lui faisaient affreusement mal. Il n’en pouvait plus de grimper, puis de descendre, puis de grimper, puis de descendre, toujours avec cette caisse en bois à l’arrière qui, soit le tirait vers l’arrière, soit le poussait en avant, mais, de façon constante, le contrariait. Le chauffeur, lui, justement assis dans la caisse en bois à l’arrière, ne remarqua pas grand-chose de tout cela. Il semblait profiter de la course et du paysage, pour une fois qu’il n’était pas celui chargé de conduire. Bram souhaita, avant de se rendre en ville, passer par le village. Au bourg, alors qu’on était jour de marché, il n’y avait toujours personne. Des étals étaient bien disposés, mais ni marchands, ni clients pour circuler entre. Bram passa alors dans la rue où se trouvaient la boucherie et le bar de la veuve. Sur la porte de la boucherie, un petit écriteau indiquait que le commerce était à vendre, quand, de l’autre côté, un rideau de fer était tiré sur la devanture du bar. Bram demanda au chauffeur si le boucher lui avait parlé de ses envies de vendre son commerce, et le chauffeur ne parut pas au courant de tels projets. Bram alors arrêta le vélo sur le bord du trottoir, mis la béquille, puis jeta un oeil à l’intérieur de la boucherie, ses mains de part et d’autre de son visage pour éviter les reflets. La pièce était parfaitement vide. Plus de viande, ni de trancheuse, ni de comptoir, ni d’étagères, ni de carrelage, plus rien sinon ce cube uniforme laissé à l’abandon. Bram se retourna et dit au chauffeur que le boucher avait même emporté les trippes. Le chauffeur leva les bras au ciel. Bram, revenant vers le vélo, dit également au chauffeur qu’à présent il était temps d’échanger les rôles. Sans poser davantage de question, le chauffeur pris place sur le vélo tandis que Bram s’installait dans la caisse en bois. La caisse en bois était surtout adaptée aux mesures du chauffeur, si bien que les jambes de Bram dépassaient un peu à l’extérieur. Il se trouva confortable malgré tout et, alors que le chauffeur pédalait, il se laissa aller à admirer la campagne alentour. Bram ignorait que, depuis que la ville fondait, peu de choses étaient encore admirables.
D’ailleurs, j’y reviens une seconde mais, dans Envoyée spéciale, un paragraphe est directement inspiré d’une information du Gorafi, à propos des (je cite) rubans de la Justice. Décidément, il est plein de ressources, notre cher Jean.
(Je me rends compte, après avoir écouté l’interview qu’il a donnée à Trapenard, que ce dernier avait déjà relevé cette source étrange. Tant pis pour la révélation.)
J’achève Infini de Josipovici, et je suis un peu embêté. Le livre est bon, mais j’ai l’impression de lire un mélange entre L’Inquisitoire de Pinget (la relance en interrogatoire, Continuez ; le majordome qui parle de son ancien employeur), et Bernhard (discours enchassés et rapportés, paragraphes serrés, principe de répétition). Donc c’est bien, mais je vois trop les coutures, et je n’aime pas trop voir les coutures.
En 2013, j’avais le projet d’un mémoire sur la fonction-personnage dans trois romans d’Échenoz (Lac, Les Grandes blondes, et 14). Ce mémoire n’a jamais abouti, ni même sérieusement commencé, puisque j’ai changé subitement de voie au bout du troisième mois de Master. Ainsi, un projet qui m’enthousiasmait depuis déjà deux ans, que j’attendais de réaliser avec la plus grande impatience, je l’ai écarté en un instant. Il s’agissait d’expliquer en quoi les personnages utilisés par Échenoz étaient malléables, faciles, nébuleux, en fait, rien que de grossières figurines bonnes à casser le moment venu. D’ailleurs, elles étaient souvent cassées le moment venu, à savoir celui auquel on s’attendait le moins. Je me demande parfois ce qu’aurait pu donner ce mémoire, ainsi que ma vie, si j’avais suivi cette piste plutôt que de m’aventurer là où je suis encore aujourd’hui. Je me le demande d’autant plus qu’à la lecture d’Envoyée spéciale, je retrouve l’illustration de la plupart de mes pistes. Peut-être même de façon encore plus flagrante.
J’aime Échenoz car il se joue toujours de la machine qu’il utilise. Il sait que chaque règle grammaticale comporte toute une gamme de complications et de lourdeurs, mais que, comme ces règles, il faut bien les utiliser quand même, autant les moquer. C’est pourtant la première fois que je le vois à ce point éclater dans toutes les directions les outils : focalisations, discours, digressions, descriptions ; tout y passe. On pourrait croire à une démonstration, mais heureusement, il y a toujours une aventure divertissante pour nous faire oublier à quel point on bidouille, on casse, voire à quel point on se fout carrément de notre gueule.
Une fois arrivés chez Bram, après une éprouvante marche à travers la tempête qui saisissait la campagne, celui-ci dit au chauffeur qu’il fallait impérativement qu’il se rende en ville, qu’il en allait de sa santé, et que le chauffeur pourrait l’accompagner s’il le souhaitait, mais qu’il irait malgré tout. Le chauffeur demanda à Bram comment il comptait se rendre en ville sans le bus, et Bram lui dit qu’il trouverait une solution, quitte à remettre en état son vélo cassé. Le chauffeur fut impressionné par la détermination de Bram. Peu d’hommes auraient eu le courage de se rendre en ville à vélo, traversant à nu la périphérie, risquant de rencontrer qui sait quoi dans cette périphérie crainte, hostile. Le chauffeur dit alors à Bram qu’il l’aiderait à réparer son vélo, et qu’il l’accompagnerait au moins jusqu’à la périphérie, mais qu’il se donnait le droit d’abandonner à cet endroit-là si jamais les choses se passaient mal. Bram accepta, et les deux hommes, dès le lendemain, entreprirent de remettre en état le vélo. Ils regonflèrent les pneus, fixèrent un garde-boue déniché dans une casse à proximité, ainsi qu’une loupiote sur l’avant du guidon. Le chauffeur ayant quelques connaissances en menuiserie, il construisit avec les morceaux de bois tombés au sol une petite caisse dans laquelle il s’installerait, et que le vélo de Bram, et donc Bram lui-même, à l’aide d’un simple crochet, traînerait. Parfois, les hommes pourraient échanger leurs places, et Bram, évidemment, fut d’accord pour qu’ils échangent parfois leurs places. Bram ne comptait pas traîner ainsi le chauffeur jusqu’en ville à la seule force de ses jambes. Jambes qu’il avait d’ailleurs en fort mauvais état, depuis le temps qu’il ne les avait pas utilisées de manière soutenue. La tempête s’était calmée. Bram et le chauffeur passèrent deux jours entiers à préparer leur voyage. Le matin du troisième, Bram enfila son casque, le chauffeur de même, ils coincèrent leur encas dans un renfoncement de la caisse, et ils partirent plein d’entrain à vélo vers la ville. Bram et le chauffeur ignoraient que ce voyage leur coûterait bien plus que quelques efforts à vélo. Depuis que la ville fondait, son accès était presque impossible.
Je suis très proche de mon argent. Ça me vient de ma mère. Dans mon inconscient, il doit encore y avoir les journées où elle allait pêcher le coquillage avec Angélique et Julien, sur les plages d’Erquy, pour avoir de quoi manger le soir. Cela des années. Je n’ai jamais connu la misère. Ma mère s’est toujours arrangée, depuis ma naissance, pour que jamais je ne la connaisse, car elle savait ce qu’il en coûte ; mon frère et ma soeur le savent eux aussi. Ma mère s’est toujours battue pour ne plus subir. Elle a été la meilleure. Elle a eu des récompenses pour avoir été la meilleure. Des hommes bien habillés lui en ont données. La vie le lui a mal rendu. Les mêmes hommes le lui ont mal rendu. Ma mère n’a plus grand chose aujourd’hui. Elle dit être heureuse. Elle a une petite maison à crédit, dans un petit lotissement d’une petite ville de Bretagne. Elle a toujours la même voiture, cabossée. Elle culpabilise de n’avoir pu envisager pour sa famille autre chose que l’argent. Elle n’en sort plus de l’argent. Elle n’en a plus, mais, avec ses proches, avec nous, elle ne sait pas faire sans. Parfois je vois ma mère telle qu’elle serait sans la misère passée. Est-ce qu’elle est encore ma mère à cet instant-là, libérée de la société ? Ma mère croyait que son salut se trouverait loin de sa misère, mais elle ne l’a pas trouvé. Elle est montée haut et elle n’a rien trouvé pour elle. Elle est redescendue, mais la vie avait toujours l’allure des plages d’Erquy. Les plages d’Erquy longtemps la hanteront. Il doit y avoir là-bas quelque chose d’elle qu’à vingt ans elle a abandonnée, et que, depuis, elle n’ose plus retourner chercher.
(J’ai acheté un nouvel ordinateur. Il est beaucoup plus léger. Je l’ai configuré presque trait pour trait comme le précédent. J’ai tout de même dû adapter de nouveaux logiciels, comme celui sur lequel j’écris mes Relevés. Je change d’outil, mais pas ma manière de les utiliser. Sans ordinateur, je suis incapable d’écrire. Je me traîne, mon idée se perd sans que j’aie eu le temps de la suivre, mon poignet me fait soudainement mal, ainsi que mon annulaire fracturé, et finalement je n’y arrive pas, j’abandonne. Si un jour il n’y a plus d’ordinateur, il y a des chances pour que je n’écrive plus du tout. Si je n’avais jamais possédé d’ordinateur, probablement que je n’aurai jamais écrit. Ça tient à peu de choses parfois.)
Le vent soufflait à déraciner les arbres, si bien qu’il déraçina un arbre alors que Bram et le chauffeur s’approchaient de la forêt. L’arbre s’envola jusque sur les lignes électriques voisines, mettant à mal tout le circuit qui approvisionnait la ville. Bram regarda en direction de la ville si le halo qui éclairait le ciel s’éteignait, mais non. Bram ignorait que, depuis que la ville fondait, le halo de lumière au-dessus de la ville était de flammes et non d’électricité.
Alors Bram et le chauffeur continuèrent, malgré le vent, et malgré les arbres et les branches qui voltigeaient autour d’eux, à marcher vers la forêt. Bram dit au chauffeur que la moindre des choses serait de se recueillir sur la tombe de la veuve, puisqu’ils étaient les seuls à connaître son emplacement. Le chauffeur acquiesca. Bram et le chauffeur mirent un certain temps à retrouver la tombe, qu’ils ne retrouvèrent d’ailleurs qu’en partie, celle-ci ayant été détruite par les bourrasques de vent. La croix de bois portant le nom de la veuve avait disparu. Sans croix, la veuve n’avait plus de nom. Bram oublia le nom de la veuve puisqu’elle n’avait plus de croix, et dû rendre un hommage anonyme. Pendant que Bram priait les cieux d’accueillir le corps anonyme de la veuve, le chauffeur s’était détourné. Il n’avait que faire de la veuve qu’il n’avait que peu connu, et peu aimé le peu de temps qu’il l’avait connue. Bram, lorsqu’il se rendit compte du mépris du chauffeur à l’égard de la veuve décédée, le gifla. Bram gifla si fort le chauffeur que celui-ci chuta sur les restes de tombe de la veuve. Le vent toujours partout empêcha d’entendre ce que Bram dit au chauffeur dans sa colère. Le chauffeur pleura son bus en cendres sur la tombe de la veuve. Il pleura sa famille perdue à jamais, et le chemin jusque chez lui. Bram ne savait que faire face à ce pauvre homme souillé par le vent et la terre. Il s’assit sur le sol et fut pris d’un affreux mal de tête. Bram se recroquevilla sur lui-même. N’avoir pu aller en ville accentuait sa migraine. La ville lui semblait si loin, et ce qu’il avait l’habitude d’y faire évanoui. Bram s’était vengé sur le chauffeur d’être incapable d’aller lui-même en ville. La périphérie de la ville l’effrayait, et le trajet du bus lui épargnait jusque-là d’avoir à la traverser. Il manquait à Bram quelque chose qui venait de la ville, quelque chose pour vivre, pour lier correctement les éléments qui traversaient sa vie, pour éviter qu’il ne fabule ou n’hallucine ou ne reconstruise dans le désordre les événements de ses journées. Tout comme la ville fondait, la cohérence, la logique, et la maîtrise de Bram fondaient. Cela, il ne pouvait plus l’ignorer.
Il y a toujours à la fois l’envie de retravailler son texte à l’excès (ce qui, au bout d’un temps, n’est plus bon à rien), et celle d’attendre des siècles d’y déceler enfin quelque chose de valable. L’urgence et la patience, Toussaint n’aurait jamais pu le dire mieux. Être le nez dessus et vouloir que ça aille vite et fort et en même temps n’y voir rien du tout sans fermer les yeux. Que quelque chose soit à faire est sûr, mais quand agir, moins.
« On m’a toujours diagnostiqué doué pour l’écriture. » Décidément, la prétention d’Éric-Emmanuel Schmitt n’a d’égale que sa médiocrité.
Tout ce qui se réfère à moi se réfère à un étranger.
La logique, ici, moi seul l’impose, moi seul la guide.
« Tu ne te transformes pas assez vite, ton aujourd’hui continue ton hier. Et ce chemin qui te suit pas à pas, c’est ton passé, déjà, qui s’engraisse de la dépouille de tes jours… » — David Bosc, Mourir et puis sauter sur son cheval.
Bram se sentit incroyablement fatigué. Il se rendit compte, tout comme le chauffeur, n’avoir plus la force de rien sinon de reposer sa tête sur la table du bar. Il s’endormit. Il rêva qu’un loup dévorait la veuve, là dans la forêt non loin, et qu’il était ce loup, et que le sang de la veuve recouvrait sa bouche. En songe, il vit au-dessus de la ville planer un étrange nuage noir, mais, alors que le nuage s’apprêtait à disparaître, Bram fut réveillé par le chauffeur qui lui tirait la manche. Le chauffeur confia à Bram se sentir à nouveau en état de conduire le bus. Bram n’avait plus la force de l’accompagner, alors il s’assura auprès du chauffeur qu’il saurait retrouver le chemin jusqu’à son bus. Le chauffeur répondit qu’il n’y aurait aucun problème. Bram fut rassuré, et il reposa sa tête sur la table du bar, désormais entièrement vide, entièrement propre, sans bière au sol, ni vitrine explosée. Dans son second rêve, Bram vit le chauffeur, en route vers son bus, encerclé par des colonnes de flammes venues de la ville. Le chauffeur ne parvenait pas à trouver une issue parmi l’incendie, et finissait consumé. Alors la veuve arrivait d’entre les flammes, tendait la main au chauffeur, et lui disait : Suis-moi, il y a ta tombe là-bas dans la forêt. Puis le chauffeur disparut et Bram se réveilla. Le chauffeur se trouvait assis devant Bram. Le chauffeur dit à Bram qu’il n’avait pas retrouvé son chemin jusqu’au bus, et qu’il avait dû faire marche arrière après avoir passé la journée à errer dans la forêt. En effet, au dehors, Bram remarqua qu’il faisait déjà nuit. Il se sentait toujours aussi fatigué. La boucherie était fermée. Sur le table du bar, il y avait les clés du bar, et le chauffeur renseigna Bram : il devrait lui-même fermer le bar. Bram s’assura que rien ne trainait dans le bar, il invita le chauffeur à sortir, puis ferma à clé derrière lui. Bram et le chauffeur marchèrent en direction de chez Bram. Bram ignorait que les flammes et le nuage noir vus en rêve étaient bien au-dessus et autour de la ville, à présent que celle-ci fondait.
Suite à l’explosion, Bram dit au chauffeur qu’il fallait porter secours au boucher, mais le chauffeur ne bougea pas. Alors Bram laissa encore une fois le chauffeur seul à la table du bar, et sortit vers la boucherie. Quand il entra dans la boucherie, le boucher se tenait derrière le comptoir, et demanda à Bram ce qui lui plairait. Bram dit qu’il aimerait goûter quelques trippes, alors le boucher emballa les siennes dans du papier fin, et les tendit à Bram qui les paya le prix fort sans sourciller. Bram revint dans le bar où le chauffeur dormait sur le sol dans la mare de bière. Par défaut, Bram invita la veuve à partager les trippes du boucher, suite à quoi elle mit le couvert. Bram et la veuve mangèrent en tête à tête les trippes du boucher tout en soulignant à quel point elles étaient délicieuses. Lorsque Bram eût fini sa dernière bouchée de trippes et qu’il souleva la tête, la veuve avait cédé sa place au chauffeur. Le chauffeur demanda à Bram où était son bus, et Bram lui dit qu’il se trouvait sur la route entre la campagne et la ville, non-loin du village. Le chauffeur dit à Bram que c’était impossible puisque deux jours auparavant le bus avait été réduit en cendres. Bram dit au chauffeur qu’il s’agissait d’un deuxième bus, que ce n’était pas le même bus. Le chauffeur demanda à Bram comment il pouvait en être si sûr. Bram dit au chauffeur de demander à la veuve confirmation, mais lorsque celui-ci se retourna, elle avait disparu du bar. Puis le chauffeur se rassit face à Bram, et il pointa soudain du doigt quelque chose derrière Bram, après la vitrine du bar. Bram se retourna et vit alors, dans la boucherie, le boucher accrocher les trippes de la veuve aux crochets de sa vitrine. Bram hurla, horrifié, quand il se rendit compte que le bar était inondé, qu’il se noyait dans de la bière, et que ses cris remontaient en bulles vers le plafond. Bram ignorait que, depuis que la ville fondait, les maisons devenaient des aquariums où les civils se noient.
Écrire quelque chose sur la violence comme événement (Mad Max), et la violence comme état de fait (Mad Max : Fury Road).
Je parlais ici hier de cette femme se donnant le droit de faire taire un malade monologuant dans le bus à voix haute. Lors de la parution d’En finir avec Eddy Bellegueule, seuls deux ou trois journalistes (à ma connaissance, et sur ce que je trouve en ligne) parmi la dithyrambe généralisée, ont relevé la façon dont l’auteur mettait systématiquement à distance, à l’aide d’italiques et de paragraphes autonomes, la parole de son univers d’enfance. Personne n’a remarqué à quel point un tel agencement tenait du mépris même pour ceux dont l’auteur estime faire l’éloge. À quel point dire : voici mon langage évolué compréhensible par tous, et voici celui des infirmes, des crasseux, des violents, et aujourd’hui ce langage je vous l’expose comme dans une vitrine, et je le moque car il ne mérite que ça ; à quel point dire cela, c’est cracher sur le langage. Tout le monde, apparemment, ne saisit pas l’intelligence totale d’oeuvres comme celles de Céline, Queneau, Guyotat, ou Marie Cosnay, qui savent mêler les dire, pour ne pas sombrer dans les jugements de valeur. Il n’y a qu’un langage, et c’est celui que je crée. La pire faiblesse d’un auteur est de se gargariser de savoir mieux parler. Une violence subie ne justifie pas une autre donnée.
Apparemment, ce travers, on le retrouve dans son deuxième roman. Je cite un article publié sur le site de Marianne (très con par ailleurs) : Édouard raconte ce qui s’est passé à sa sœur, et sa sœur reraconte tout cela à sa manière. Et comme sa sœur, Clara, est un peu simple et qu’elle n’habite pas à Paris, elle retranscrit la réalité à coups d’idées reçues et de phrases syntaxiquement incorrectes. On trouve donc, sur une même page, imaginez ! - le dialogue de Clara et de son époux – mal construit, fautif, simpliste ; et entre parenthèses et en italiques, les remarques d’Édouard Louis, posées, en bon français, avec du subjonctif. Je ne sais pas si je suis le seul à trouver de tels procédés honteux. C’est faire un pas de plus dans l’incorrection. Auparavant, il se contentait de montrer du doigt. À présent, il s’insinue dans la prose même qu’il dénigre pour la traduire (!). Ce virus. Ce mur.
Édouard Louis parvient toujours à s’en sortir, arguant par-ci la fiction, par là l’implacable vérité des faits et des dits. Mais il est sans discussion possible une souillure, car sous couvert de bienveillance, il s’essuit les pieds sur toute une frange sociale poète malgré elle.
Ça me fait penser à Genet, qui disait avoir eu besoin d’écrire comme un bourgeois pour sortir de prison (se faire bien voir en somme, utiliser la langue des puissants), mais avoir été incapable de réutiliser cette langue une fois sorti, puisqu’il n’y voyait plus aucune nécessité. A-t-il dénigré pour autant l’univers carcéral ? Bien au contraire : il savait que dans la bourgeoisie on ne trouve rien que des lustres accrochés au plafond, et des livres en carton sur les étagères.
Alors si vous pouvez vous faire un cadeau en cette rentrée littéraire de janvier, c’est de repartir un an en arrière, et d’acheter le premier roman de Fabien Clouette, Quelques rides, qui fait lui quelque chose d’intelligent de la langue, et du décor, et qui parle aussi des petites villes abandonnées, et des crasseux qui trafiquent, mais en les illuminant. C’est tout ce qu’on cherche. Il y en a assez de la bêtise.
Bien s’assurer chaque jour que personne ne parle de vous.
Voici une liste de certains livres lus en 2015, non pas ceux que j’ai préférés, mais ceux qui m’ont le plus guidé dans mon propre travail :
- Merci et Quoi faire, de Pablo Katchadjian
- Pas Liev, de Philippe Annocque
- L’Orage et la loutre, de Lucien Ganiayre
- Nouvelles et textes pour rien, de Samuel Beckett
- Fissions et Forêts noires, de Romain Verger
- Archives du vent, de Pierre Cendors
Il y a cette autre phrase de Blanchot, qui aurait aussi pu figurer en exergue de Saccage : Le voeu de tous, là-bas, le dernier voeu : sachez ce qui s’est passé, n’oubliez pas, et en même temps jamais vous ne saurez.
J’ai remarqué, alors que j’entrais dans le bus à la gare de Rennes, non loin du siège de la chauffeuse, un homme, assis sur la droite, qui parlait à voix haute, seul. Il parlait comme s’il entretenait une conversation, sans hausser le ton ni faire de mouvements brusques, sauf qu’en face de lui, il n’y avait personne. Je me suis moi-même assis au milieu de l’accordéon, et, alors qu’il n’était qu’à trois places de moi, je ne l’ai plus entendu. Je l’ai vite oublié. Quand, après plusieurs minutes de route, la chauffeuse (je crois, mais il est possible que ce soit une passagère) a demandé au monsieur de bien vouloir se taire, car il parlait trop fort, et que ça suffisait. Parce qu’il était sans doute malade, cette dame s’est permise de le faire taire. Une personne intimait à une autre de ne plus dire car elle ne l’estimait pas apte à savoir s’il était bon ou non de parler. Une personne s’est crue la supériorité morale de faire cela. Je n’avais jamais assisté à une telle violence envers quelqu’un d’aussi inoffensif. Même contre ceux discutant à haute voix au téléphone, ne se souciant absolument pas des personnes qui les entourent, je n’avais été témoin d’une aussi sèche et définitive mise en garde. Est-ce l’interlocuteur qui fait la validité de la parole ? Est-ce que se parler à soi-même est de trop ? Est-ce vraiment de la folie ? Est-ce si intolérable de n’avoir que soi comme ami ? L’homme s’est tu. Une femme s’est ainsi satisfaite d’avoir fait taire un simple malade, croyant là, j’en suis persuadé, rendre un grand service au calme social, à la foule muette. À l’arrêt suivant, des adolescents sont entrés en riant.
Possible projet : Le Livre nouveau des enfers et du ciel.
Alors qu’il regardait la télévision, Namrej entendit un bruit strident venir de l’appareil, puis l’image se brouilla complètement, et de l’écran sortit celui qu’il attendait : le voyant Orstir, guide parmi les astres, détenteur du savoir premier, ancien vagabond prophète, dernier fils de l’unique mère source : Miraj. Sans mot dire, Orstir prit la main de Namrej et lui grava au dos l’oeil troisième du père fautif : Calvarde. Puis Orstir dit à Namrej : À présent que ton fils est mort et que tu connais la souffrance, entre dans le domaine-gouffre, seul chemin vers la mère source Miraj, qui t’appelle aujourd’hui pour que tu la rejoignes sur son trône. En effet, le fils de Namrej était mort un jour plus tôt, et sa peine depuis était sans remède. Orstir ouvrit la télévision, et, par là où il s’était présenté à Namrej, l’engouffra, protégé désormais par la force de l’oeil troisième du père fautif Calvarde. Orstir dit enfin à Namrej, alors qu’ils se trouvaient tous deux dans le dédale obscur qui mène au domaine de la mère source : les supplices seront nombreux et les tentations grandes. Prends garde et console ta douleur dans la Voix sacrée. Si jamais la Voix sacrée ne peut rien à ta peine, retourne-toi, et observe le chemin parcouru. Tu verras alors ton fils saluer ton départ, et dans sa bouche la lumière infinie.
Dans une salle entière de vitrines, Orstir présenta à Namrej la vision du premier de ses frères : Gabja le damné.
Gabja le damné, ancien prince des poisons, était le troisième fils de l’unique mère Miraj. Il avait vécu isolé au sommet de la montagne enneigée Kiliviv. Sa tâche était de faire couler sur la terre fertile des hommes les contenus de deux sachets. L’un était la vermine, l’autre la guérison. Gabja le damné était devenu fou, et, sans se soucier de quel sachet il avait dans la main, il avait déversé entièrement la vermine sur la terre fertile des hommes. Plusieurs générations moururent à cause du poison. Gabja le damné ne fit jamais couler la guérison, car il avait troué le sachet, et l’avait bu en son entier. Ainsi il demeura sans solution, témoin hilare de l’extinction de la race bénie. Sa montagne se désintégra progressivement sans que l’unique mère Miraj n’intervienne. La montagne sur laquelle était assis Gabja le damné se brisait car il était puni par la colère de l’unique mère Miraj. Quand il n’y eut plus de montagne, le sol sous Gabja le damné pourrit encore, et il se retrouva, toujours assis, à descendre infiniment vers le centre de la Terre. Arrivé dans la lave infernale où ne régnait rien sinon la démence des flammes noires, il cessa de rire, et voulut pleurer, mais ses larmes étaient de lave et lui ont tué les yeux. Depuis, l’unique mère Miraj l’a enfermé dans la lave infiniment en ébulition, pour le punir de son inattention et de sa bêtise. Gabja le damné pleure toujours, et ses larmes enflammées toujours creusent son crâne comme lui avait creusé la terre pourrie et la confiance des hommes.
Bram prit le chauffeur sur son dos, et il se mit en route vers le village. Le chemin paraissait beaucoup plus long que d’habitude car le chauffeur était lourd et Bram avançait très lentement. Bram devait parfois le reposer au sol pour ne pas tout à fait s’épuiser. Les paysages avaient beaucoup moins de charme. Les vaches paissaient toujours. Ils arrivèrent finalement à l’entrée du village, et Bram déposa le chauffeur dans le bar de la veuve qui, après plusieurs minutes, ne venait toujours pas. Il vit au sol les flaques de la veille, quand Bram avait cassé la machine à bières et que tout l’alcool s’était répandu derrière le comptoir. Bram dit au chauffeur de rester assis là. Il sortit et alla en face dans la boucherie. Le boucher sortit de l’arrière-boutique, alerté par le son de la clochette à l’entrée de la boucherie. Il demanda à Bram ce qui lui plairait, et Bram lui demanda alors où se trouvait la veuve. Le boucher lui dit qu’elle était partie en ville depuis deux jours chercher de la bière, et qu’elle devait revenir d’un instant à l’autre. Bram remercia le boucher puis fit demi-tour jusqu’au bar. Depuis la rue, on pouvait apercevoir le boucher triste de n’avoir rien vendu à Bram. Dans le bar, le chauffeur était toujours assis à la table où Bram l’avait laissé, mutique, comme mort. La veuve alors sortit de l’arrière-cuisine, sa robe pleine de terre, et demanda à Bram ce que lui et son ami souhaitaient. Bram commanda deux bières et s’installa en face du chauffeur. La veuve se mit alors à quatre pattes sur le sol et commença de tranvaser la bière répandue sur le sol dans de grands verres. Dans les grands verres de bière, sans s’en rendre compte, elle mettait aussi un peu de terre. Elle déposa les deux bières sur la table où Bram et le chauffeur était assis, puis retourna dans l’arrière-cuisine. Alors Bram fut surpris par le bruit cinglant d’une explosion. Il se retourna aussitôt et s’aperçut que la vitrine de la boucherie avait volé en éclats, et que le boucher était attaché par le ventre aux crochets qui suspendaient jusqu’alors les trippes qu’il vendait. Depuis que la ville fondait, tout partout volait en éclats. Bram était loin de l’imaginer.
Tout coûte toujours.
« Les fragments s’écrivent comme séparation inaccomplies ; ce qu’ils ont d’incomplet, d’insuffisant, travail de la déception, est leur dérive, l’indice que, ni unifiables, ni consistants, ils laissent s’espacer des marques avec lesquelles la pensée, en déclinant et se déclinant, figure des ensembles furtifs qui fictivement ouvrent et ferment l’absence d’ensemble, sans que, fascinée définitivement, elle s’y arrête, toujours relayée par la veille qui ne s’interrompt pas. » — Maurice Blanchot, L’écriture du désastre.