2018
Jared m’a rejoint en ville et on a mangé ensemble. Je ne sais plus ce qu’il a commandé, et moi non plus. Après manger, on est allé au centre commercial, et on s’est assis sur un banc à côté d’un bac de palmiers en plastique. Jared a ouvert son sac et m’a donné un CD. Il m’a dit d’attendre d’être seul chez moi pour regarder ce qu’il y avait dessus. J’ai regardé le CD et j’ai remarqué qu’il l’avait gravé lui-même sur son ordinateur, et qu’il avait noté mon nom dessus au marqueur. Il semblait inquiet. Il regardait les gens qui allaient et venaient autour de nous avec une certaine anxiété. Je n’ai pas osé lui poser de questions. De temps en temps il remettait sa casquette en place et il se rongeait les ongles. Il m’a dit de ne parler du CD à personne. Il ne pouvait pas rester très longtemps.
Apparemment, la poésie, c’est lire deux ou trois vers, puis reposer le livre pour méditer très longuement dessus.
Deux excellents livres lus récemment : Sabrina de Nick Drnaso, et Les amours suivants de Stéphane Bouquet (extrait ci-dessous).
« il semble qu’au Japon
des poètes bouddhistes médiévaux disaient amour = adoucir sa
lumière
pour s’assimiler à la poussière, c’est peut-être vrai, puis quand la
nuit tombe
je lutte contre pleurer au fin fond d’un fast-food de poulet frit » – Stéphane Bouquet, Les amours suivants.
J’en connais qui souhaitent une révolution mais refusent qu’on brûle des voitures.
Depuis le palais du Vatican, le pape a appelé l’humanité à moins de consumérisme.
Les repas en famille permettent de se souvenir qu’avoir 60 ans reste le meilleur argument pour faire valoir son avis comme vérité générale. Avoir vécu mai 68 à 10 ans confère quelques bons points bonus non négligeables, notamment sur les sujets : manifestation, violences policières, casse. Être la génération qui a le plus défoncé la planète depuis qu’elle existe ne confère aucun malus, surtout quand il s’agit de donner des leçons.
Des couvre-feux pour les mineurs ; des rondes de flics dans les lotissements et les quartiers.
J’ai beaucoup joué à Stardew Valley dernièrement. La situation initiale est simple : vous incarnez un employé de bureau déprimé par son travail, qui décide de reprendre la ferme que lui a légué son grand-père après son décès. La ferme est une sorte de friche, que vous devez remettre en état.
Très vite, on s’aperçoit que l’unique but du jeu est de gagner toujours plus d’argent pour avoir la ferme la plus grande et la plus automatisée possible. Des quêtes annexes sont disponibles, notamment avec les habitant.e.s du village voisin, qui se concluent toutes de la même manière : le mariage. Le jeu est frustrant car il ne dépasse pas la vision capitaliste et productiviste qui oblige votre personnage à quitter son emploi de bureau au départ. Il se sent mieux en vendant chaque jour sa mayonnaise et ses citrouilles qu’en étant devant l’écran de son ordinateur. Pourtant, la logique qui sous-tend son travail est identique.
Et les limites de l’aventure se font donc très vite sentir. Il manque sans doute à Stardew Valley une ambition métaphysique, qui dépasserait le quotidien laborieux et répétitif, et permettrait au personnage de se mettre en quête d’une logique plus profonde. Les jeux qui se limitent à leur concept sont souvent décevants, car l’écran de fin vient justement clôre ce qu’on imagine d’office finir. D’où l’importance, à mes yeux, des quêtes post-générique, qui prolongent l’idée du monde construit pour nous.
Dans Ecco the Dolphin (1992), le dauphin que vous incarnez est chargé de sauver les animaux sous-marins d’une race alienne invisible nommée Vortex. Pour cela, il voyage notamment dans le temps et rencontre une sorte d’immense polymère à l’origine de toutes choses.
L’esthétique des supermarchés.
Dimanche 16 décembre, 30 001 mots.
Dimanche 23 décembre, 31 037 mots.
« Mon ami :
Nous sommes là.
Déjà là.
Dedans.
Un train fonce vers un mur à une allure fatale. Vous tenez à la main un interrupteur, qui accomplit vous ne savez quoi : le jetez-vous donc ? Sachant que le catastrophe est sinon assurée.
Cela ne vous coûte rien.
Pourquoi ne pas essayer ? » – George Saunders, Lincoln au bardo (trad. P. Demarty).
Lorsqu’il y a un crime, on remonte souvent très loin dans les trajectoires du coupable et de la victime, en estimant sans doute qu’à la lumière de leur vie entière on parvient enfin à comprendre l’acte lui-même.
Beaucoup trop de choses à faire pour avoir le temps de dire.
En écoutant certains minimalistes, et notamment américains, l’idée qui revient le plus souvent est que moins de possession équivaut à plus d’efficacité, plus de performance. Que se détacher des objets permet une meilleure optimisation de son temps et de son travail. En somme, que ce qu’on dénonce comme la manifestation-même du capitalisme, la consommation, est transféré automatiquement vers un autre pendant tout aussi capitaliste, le profit. Pensant échapper à l’achat, ils n’ont cependant pas échappé à l’injonction au travail et au rendement.
D’autant que leur consommation, même limitée, est dirigée vers le pire du système actuel, avec un systématisme de la marque, apparemment gage de qualité : ordinateur Apple, iPhone, consoles, baskets Nike, mobilier de marque, etc. Leur minimalisme n’est pas d’avoir peu, mais d’avoir peu dans le luxe. Leur sacro-saint tri (decluttering) est d’ailleurs systématiquement orienté vers les mêmes objets, qu’on pourrait sommairement qualifier de bibelots. Jamais ils ne vont se délaisser de leur téléphone, ou de leur matériel vidéo, car ils leur permettent justement de filmer leurs aventures, et de faire ainsi : de l’argent. Tout bon minimaliste a d’ailleurs une page Instagram, outil qui à mes yeux pourrait passer en haut de la liste des premières choses à jeter lors d’un tri, justement.
Le mode de vie doit rester équivalent ; il se concentre même sur des points saillants. Ce que les minismalistes mettent en avant, c’est surtout le nécessaire vital pour conserver son statut social.
All we ever wanted was everything. All we ever got was cold.
J’ai supprimé les liens renvoyant vers des articles de presse dans les pages consacrées à mes livres ; ils n’ont aucune importance.
Je voudrais réfléchir l’écriture avec les outils technologiques des années 90. Je trouve notre époque fade sur cet aspect (bien que stimulante dans son discours), et la nostalgie parfois m’emporte. Nous ne développons plus des outils, mais des non-outils, qui visent à exister pour aussitôt être oubliés.
Le soir, quand je rentre, l’épuisement ; la fatigue mentale qui empêche simplement.
« Je voulais essayer de décrire cette atmosphère palpable et néanmoins indéfinissable de la présence de quelque chose qui n’existe pas encore. » – Ryoko Sekiguchi, Ce n’est pas un hasard.
Je marche au fond de l’eau.
J’imagine la gestion de la Maison de la Poésie de Rennes comme une nouvelle partie de Stardew Valley.
Je me demandais récemment pourquoi nous tenions tant à faire disparaître les câbles qui relient nos machines aux prises : souris, clavier, écouteurs, bientôt peut-être la prise secteur elle-même. Et donc : les câbles sont-ils à ce point gênants ? Souhaiterions-nous faire disparaître de la même manière les tuyaux d’arrivée de gaz ou d’eau ? Pourquoi, en somme, nous ne considérons pas les machines modernes comme de l’électroménager standard. Je me demande : ne faudrait-il pas revenir à la matérialité du hardware, qui permet de réfléchir à sa fabrication et donc à sa pérennité. La disparition du câble n’est pas la disparition du lien. Pour relier deux objets, un pont est toujours nécessaire ; qu’il soit invisible nous aide à l’oublier, mais pas à abolir la distance.
Une pierre philosophale (qui n’a pas la forme d’une pierre).
« Et suppose que la peur que provoque toute découverte d’un monde soit si grande qu’elle rende l’écriture presque impossible ? » – Armand Schwerner, Les Tablettes (trad. E. Requette).
Les lecteurs de l’oeuvre de Jeanne Lekker n’étaient pas nombreux ; elle n’en rencontra d’ailleurs jamais aucun.
Elle n’apparaît dans aucun dictionnaire de littérature contemporaine. Pour L’Océan Pacifique, elle faillit obtenir un prix, mais on lui apprit au moment des résultats que le jury s’était trompé de titre.
Elle prenait toujours les appels téléphoniques dans son jardin d’hiver. En 1981, suite à une importante tempête de neige, la communication fut coupée pendant trois semaines. Le jardin d’hiver ressemblait à une cellule capitonnée.
(Je voulais organiser une soirée Hélène Bessette, et on m’a dit : Hélène Bessette, c’est trop pointu.)
« une ombre claque devant la fenêtre
l’enfant lève la tête et sourit
je vous mangerai quand vous serez morts
et le volet s’écarte à nouveau
sur un pan de lumière franche » – Sereine Berlottier, Au bord.
Compte-tenu de certains procès d’intention (parfois directement à mon égard) que je lis ici et là, je pense qu’il est nécessaire d’éclaircir certains points auprès de ces cerveaux cosmiques :
1. À mes yeux, il ne s’agit pas d’un problème d’édition, mais de médiation. Libre à chaque maison de publier ce qu’elle souhaite, et la liste ci-après prouvera assez que je ne préjuge pas des choix éditoriaux, ni de la taille de ces maisons. La médiaton joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans la visibilité des livres, et donc dans l’ouverture défendue ; je pense en effet que la médiation contemporaine n’est pas à la hauteur de la littérature que l’époque propose ou tend à proposer.
2. Ma tristesse quant au paysage contemporain est davantage ressentie en tant que lecteur qu’en tant qu’auteur (même si les deux choses sont liées). Je lisais avant d’écrire, je lis bien plus que je n’écris, et je lirai sans doute après avoir fini d’écrire. Si je devais dresser une brève liste des livres écrits et publiés ces 10 dernières années (depuis 2008 donc) qui m’ont le plus marqué, je dirais sans doute : Cordelia la Guerre de Marie Cosnay (l’Ogre), Quelques rides de Fabien Clouette (l’Ogre), Le fol marbre de Dennis Cooper (POL), L’Oubli de David Foster Wallace (L’Olivier), Roman dormant d’Antoine Bréa (Le Quartanier), Arafat Mountain de Mike Kleine (Atlatl Press), Tout public d’Antoine Boute (Les Petits Matins), Une forêt profonde et bleue de Marc Graciano (Corti), Terminus Radieux d’Antoine Volodine (Le Seuil), L’Amateur d’oiseaux, côté jardin de Thalia Field (Les Presses du réel), Dix décembre de George Saunders (L’Olivier), Archives du vent de Pierre Cendors (Le Tripode), Un mage en été d’Olivier Cadiot (POL), Les Années d’Annie Ernaux (Gallimard) et Palais à volonté de Mika Biermann (POL).
3 bis. Je ne parle volontairement pas des livres publiés avant 2008 mais traduits pour la première fois depuis, ou réédités ; il ne s’agit pas de la même temporalité.
4. Sauf Terminus Radieux (sans doute l’exception qui confirme la règle), regardons ensemble la répercution médiatique de ces livres : minimale sinon inexistante. Il s’agit pourtant de très bons livres, et même si les jauges sont toujours à nuancer, je pense ne pas spécialement recevoir de contradictions à ce sujet. Pour le dire autrement : tous ces livres méritent bien plus que ce qu’on leur a donné. Et par bien plus je ne veux pas simplement dire des liasses de billets, mais de la reconnaissance, de l’intérêt et de l’étude.
5. Évidemment, je ne lis pas tous les livres qui paraissent. Je fais au mieux, et j’ai encore beaucoup à découvrir.
6. Je n’ai rien contre les livres qui se vendent, mais ne peux plus concevoir qu’il s’agisse de la principale raison de discussion ou de mise en avant d’un livre. J’ai été très heureux pour Volodine que son travail trouve davantage de visibilité, mais qu’on réduise Terminus Radieux au prix Médicis est précisément le problème.
7. Mes livres sont ce qu’ils sont. Je n’ai jamais rien prétendu. Je tente des choses. Je ne prétends pas “sauver du marasme” quoi que ce soit (???) ; je participe d’un constat, et tente d’y trouver des solutions. Je crois bien plus en les autres qu’en moi-même pour approcher la modernité littéraire de demain.
8. Des livres bizarres engendrent d’autres livres bizarres ; les appels d’air sont nécessaires pour créer et pour s’autoriser à créer.
9. Je ne pense justement pas que la littérature française contemporaine est sans remède, et en cela mon point de vue est bien moins décliniste “à la petite semaine” que ceux qui prétendent me reprendre. J’ai confiance en notre époque et en notre littérature, et c’est pour cette raison même que je signe pour qu’on tente d’ouvrir le champ.
10. Niquez-vous.
(En prolongeant l’idée de tiers paysage développée par Gilles Clément, je dirais qu’il existe sans doute de manière équivalente une tiers littérature. Là où tous détournent le regard, sur des parcelles maigres coincées entre deux immeubles, au bord des autoroutes, derrière les parkings, une littérature naît, se développe, par elle-même si je puis dire, seulement avec l’aide de quelques curieux, perdus là par hasard. Ce sont des livres qui ne sont pas cultivés ni entretenus, qui profitent de l’espace à disposition. C’est une vie qui émerge car elle a nécessité, urgence à émerger ; car elle ne peut faire autrement que persévérer, bien que tous cherchent à lui faire comprendre qu’elle n’a rien à faire là. Plus tard elle sera rationnalisée et sa vie, elle le sait, est brève. Elle s’entête pourtant et retrouve de la place quelques mètres plus loin. On l’aura compris : on ne s’en débarasse pas.)
Ce qui me vient à l’esprit en premier, à présent que cette tribune est publiée, c’est tout ce qui lui manque et la fait buter dès la première marche.
D’abord parce qu’elle ne désigne pas ouvertement les coupables, mais des genres, et qu’il est toujours facile de rejeter la faute sur l’autre ; au bout du compte, les coupables se perdent, et il n’y a même plus de faute. Ensuite parce qu’elle cible ce qui n’est même plus ciblable tant la racine a pourri. L’autofiction et l’exofiction sont deux phénomènes d’un désaveu plus vaste : l’impossibilité de vivre le livre autrement que comme un objet mercantile. Les auteurs et autrices à succès sont ceux et celles qui vendent, ou qui ont vendu ; on sacre ce qui s’est vendu, ce qui sera vendu, et ce qui se vend est ce qui est sacré. Puis on en parle longuement sur les plateaux télé, d’à quel point les choses sont des succès, comment elles se vendent, ou comment elles vont se vendre, ou comment, si elles ne se sont pas encore vendues, elles ne sauraient tarder de l’être. Le travail s’est perdu sous le commerce, et l’artisan imagine déjà en faisant sa poterie les billets contre lesquels l’échanger.
La tribune est publiée dans Le Monde, dont le Prix en septembre dernier a couronné Jérôme Ferrari (lauréat Goncourt) pour « son roman qui retrace l’histoire d’une photoreporter corse ». Bref, on gueule mollement là où déjà on nous étouffe ; autant dire qu’aucun son ne passe. Si nous publions dans ce journal, c’est que nous pensons qu’il faut passer par ce journal, par lequel pourtant plus rien ne passe, si jamais un jour quelque chose a passé. Il faut des mégaphones dans les supermarchés et des prompteurs trafiqués. En somme, il faut des gestes et des postures, et il faut refuser.
Ce qu’il nous faut, ce ne sont pas deux colonnes dans Le Monde, ni des dizaines d’articles élogieux lors des parutions de nos livres, mais Jean Birnbaum en homme-sandwich pour une marque de shampoing et des critiques générées automatiquement par un robot Boston Dynamics. Il ne faut s’attendre à rien et simplement espérer des textes, des phrases et des mots qui ne sont pas les nôtres.
Il faut continuer à vendre ses livres à 400 exemplaires, et trouver des gens qui sont capables de supporter et de trouver du sens à ces 400 exemplaires.
Il faut dire non en bloc à tout ce qui est convenu par avance.
Il faut forcer l’alternative et, comme l’écrit Fabien à la fin du Bal des ardents, garder « l’espoir des diagonales ».
Parfois je me dis que l’enfance est une telle période de joie car tout le monde est encore en vie. Ensuite on vit toujours, mais morts.
Mon père qui serait déguisé en fantôme.
Chaque soir, je me couche et m’endors.
À cent mètres de la Maison de la Poésie, la municipalité a déversé plusieurs tas de terre pour ne pas que des itinérants s’installent.
Début de conjonctivite ce matin ; je n’en avais jamais eue de ma vie, et j’en suis déjà à deux cette année.
« Se tenir en dehors du noir. Faire de chaque journée un combat gagné sur l’obscurité, jusqu’à ce que cela ne demande plus aucun effort. » – Nathalie Michel, Veille.
On ne veut pas d’une révolte tiède.
Que faire du livre, désormais, marchandise si prévisible et périssable.
On peut écrire des lignes et relier du papier ; la terre est sèche comme nos projets ; il n’y a sans doute plus rien derrière la littérature.
Huit clos en Antarctique : un scientifique se transforme en démon et fait de la base de recherches le nouvel Enfer.
« Les villes recèlent toutes des parcs morts
que les mairies réaménagent de temps à autre
en les recouvrant de pelouses
qui se transforment
en herbes folles » – Anne Emmanuelle Volterra, Scènes d’Hiroshima.
Sophie m’a demandé de participer à l’écriture d’une tribune qui paraîtra bientôt dans Le Monde concernant l’état de la littérature française contemporaine. Comme je n’avais pas tellement d’idées et pas tellement de temps non plus, je n’ai rien fait. En retard, j’ai écrit quelques phrases qui disent ce que je pense, comme un prolongement :
On ne veut pas des prix littéraires mais des mallettes remplies de billets amenées par des Ferrari à 380 km/h.
On veut une émission sur France 3 en prime-time consacrée aux astuces de bronzage d’Eric-Emmanuel Schmitt, et intitulée Mes astuces de bronzage.
On veut des livres écrits par des mages noirs et des lézards gigantesques.
On veut des livres qui s’effondrent à la même vitesse que notre système, et des livres qui s’effacent à peine on les a ouverts. On veut des livres qui font le même bruit que les pâles des hélicoptères de gendarmerie au-dessus des manifestations.
On veut des livres sans solution et sans réponse. On veut des coups de cœur de libraires qui disent à quel point ces livres sont sans réponse et sans solution. On veut des coups de cœur sur des livres qui n’existent pas. On veut des coups de cœur de libraires mortes et morts depuis 40 millions d’années.
On veut parler de nos livres dans des émissions consacrées au mini-golf, et on veut un public qui applaudit quand le joueur manque son coup. On veut que les caméras fassent des gros plans sur les mauvais raccords maquillage et sur les trous de nez des invités.
On veut des livres écrits par des héroïnes de dessin-animé. On veut que François Busnel lise sur son prompteur les 22 premières pages du Necronomicon. A la fin de l’émission, on veut que 156 femmes viennent dire à 2 écrivains de 55 ans à quel point leurs livres sont à chier.
On veut qu’en pleine conférence pour GreenFlex, filiale du groupe Total, Erik Orsenna improvise un sonnet en alexandrins consacré au Danao, jus de fruit phare du groupe Danone.
On veut des romans Gallimard avec le format parfait pour servir de raquettes sur la plage, et on veut des romans Grasset avec le format parfait pour servir de balle. On veut que Bernard Fixot nous fasse coucou gentiment depuis son bureau au 68eme étage de la Tour Montparnasse.
On ne veut plus de livres, on veut un nouveau Duke Nukem.
« Le soir
chacun de nous regagne sa chambre
s’assure de la mort des choses
de l’accomplissement de la solitude
puis nous éteignons les lampes
et hurlons comme des loups
qui savent que la vie
est une faute commune » – Ali Thareb, Un homme avec une mouche dans la bouche (trad. S. Labbize).
Je lis de la poésie mais n’en écris pas. Si je voulais écrire de la poésie j’écrirais des comptines pour enfant. Le héros vivrait sur Mars et mourrait immédiatement à cause du manque d’oxygène. Les enfants réciteraient cette comptine à l’école et le soir à leurs parents, pendant le repas. Un des parents serait scénariste et adapterait la comptine au cinéma avec Georges Clooney dans le rôle principal. Le film aurait un succès mitigé et ne rapporterait qu’un million de dollars au scénariste. Je l’attaquerais en justice pour vol de contenu et récupèrerais la moitié de la somme, que j’investirais sur un peintre d’aquarelles du bord de mer costarmoricain. Je serais inspiré par ses tableaux et écrirais des recueils de sonnets insipides consacrés à la mer, au littoral et aux oiseaux. Je vendrais mes exemplaires 5 par 5 dans des marchés de la poésie régionaux. Les femmes n’en auraient rien à foutre de ma poésie et je me mettrais à la Formule 1. J’écrirais des poèmes sur la Formule 1 et sur les femmes. Je mêlerais les voitures aux histoires d’amour dans des poèmes en alexandrins inspirés de Corneille. Un de mes recueils s’intitulerait Dans ma voiture de course et serait directement inspiré de Cinna. On parlerait de moi dans les manuels de littérature publiés en 3312 et les élèves diraient que j’ai une tête de con selon leurs critères esthétiques futurs. L’enseignante dirait que j’étais un poète mineur de mon siècle, et elle aurait raison. Tout ça, c’est si j’en écrivais.
« Un jour elle le trompe. Le lendemain, comme promis, elle le lui dit. Il est atteint. Il s’en va en voiture dans la nuit. Il la gare, il marche, il a mal. Il s’endort dans une forêt. On le retrouve mort le matin. » – Arno Calleja, Tu ouvres les yeux tu vois le titre.
J’écris mes livres comme un enfant dans sa chambre.
À vingt heures j’ai allumé la lumière et ouvert la bibliothèque. J’ai préparé les tables, les chaises et le thé. Je savais qu’on ne serait pas nombreux. Cinq minutes plus tard, il n’y avait personne. Je suis sorti devant le jardin et j’ai regardé dans la rue. Toutes les voitures et tous les vélos tournaient dans les rues adjacentes. Je suis rentré et j’ai lu un livre de Rim Battal. Je l’ai moyennement aimé. Vingt minutes avaient passé, alors j’ai rangé les tables, les chaises et le thé. J’ai éteint les lumières et fermé la bibliothèque. En tournant la clé dans le portail du jardin, je me suis dit que le mois prochain on serait peut-être deux.
« j’avais un ami je l’ai tué
je l’ai coiffé
je le lave
je l’ai bien arrangé
il est propre
il est mort
il est mieux » – Laura Vazquez, Oui.
Suite à la parution de Marcher dans la nuit, Jeanne Lekker reçoit un courrier qui contient son adresse mais ne lui est pas destinée. On y fait mention d’un amour de jeunesse, d’une cour d’école en automne, et de la manière dont on descend du bus dans la dernière ville desservie. Après l’avoir lu, elle le déchire et en conserve les morceaux dans une pochette cartonnée beige.
Un adolescent retrouvera cette pochette en février 2006 dans les toilettes d’une aire d’autoroute à 40 kilomètres d’Avranches ; les morceaux seront recollés à cette occasion. Dans la même pochette, on découvrira également une photocopie de la carte d’identité de sa femme, douze pages d’un projet inabouti et sans titre, un court testament et une carte de l’île de Svalbard, au large de la Norvège.
Des types qui rôdent la nuit dans des quartiers résidentiels.
J’ai rêvé que je m’enlevais du pouce en appuyant dessus un gravier de trois centimètres.
Dennis Cooper a lu Robert Pinget.
Ce que j’attends avec le plus d’impatience chaque semaine, c’est le nouveau chapitre de One Piece.
Un personnage secondaire qui s’appelle Copperfield et qui n’est pas magicien.
« Mauvais réveil de Zelda. Les deux morts sur lesquels elle a enquêté ont été étranglés d’un lacet et l’enquête est close. La piste ouïgoure ne donne rien. La recherche du jeune homme au blouson et héron ne donne rien. La recherche de la jeune fille sexless musicienne pourvoyeuse d’appartements et collectionneuse de billets de banque ne donne rien. Règlements de comptes, on a dit, pour les hommes étranglés. » – Marie Cosnay, Épopée.
Je sais que la solitude déclenche toujours chez moi les réflexes d’écriture les plus évidents. Saccage s’est essentiellement écrit sur la solitude et la colère d’être seul. Par exemple, quand j’ai écrit tout au bout de ma solitude j’ai compris que régnait une grande sécheresse, c’est que je vivais cette grande sécheresse dans des trains et des villes où on ne voulait plus de moi. J’étais seul car je n’avais de maison nulle part, et parce que des personnes aimées ont cessé de m’aimer, parfois par ma faute. Il y a beaucoup de personnes que j’ai aimées et qui aujourd’hui ne m’aiment plus ; moi, je ne sais pas.
Il y a des personnes qui ne pensent plus à moi, et moi je pense à elles. Certaines ne vivent plus ici. Les rues sont comme des carrières où la végétation a repris ses droits. À la fin de mon adolescence, j’ai fui des salles, repoussé comme une bête. Je marchais dans la nuit sans rien voir. Je me couchais mais il faisait déjà jour. Je regardais mon téléphone et faisais comme si quelqu’un m’écrivait.
Ce soir, Cécile est dans une autre ville, je rentre seul, d’abord en bus, puis à pied, il y a des gens autour de moi que je quitte, d’autres que je croise, et j’éprouve le fait de n’être pas avec eux comme une défaite immense.
« J’ai besoin d’évacuer de mon coeur une planète en ruines
Un poème en spirale qui pousse en moi comme un ennemi » – Huilo Ruales Hualca, Poèmes noirs (trad. A. D. Ronda).
Pourquoi tout le monde s’obstine à construire des récits linéaires.
Avec une ventouse, on peut contempler toute la merde qu’on jette dans nos canalisations. Il faut imaginer ensuite qu’il y a mille fois pire que ça partout sous nos pieds. Ça donne une certaine idée du désastre.
En 2009 ou 2010 (car déjà l’oubli fait son oeuvre) mon grand-père est décédé deux jours avant le jour de mon anniversaire. Son cancer m’a toujours procuré la sensation qu’il était mort en hiver.
we’ll happen, happening, happened, will happen, happening, happened, and there we are, again and again, ‘cause you and I will always be back then
À la fin de Sorcières, Mona Chollet écrit (dans un chapitre consacré aux violences médicales) : « Une patiente est toujours suspectée d’affabuler, d’exagérer, d’être ignorante, émotive, irrationnelle ». En début d’année, ma grand-mère a plusieurs fois sollicité son médecin à cause de problèmes gastriques douloureux et chroniques. Systématiquement, il lui répétait qu’elle devait manger davantage, s’épaissir, qu’il ne fallait pas s’en faire, sans jamais daigner pousser plus loin le moindre examen. Téméraire, elle s’est obstinée jusqu’à prendre rendez-vous elle-même chez un gastro-entérologue, qui lui a finalement découvert des nodules malignes aux intestins, dont un de plus de dix centimètres. Encore quelques mois à ne pas la considérer, et sans doute que ce médecin tuait ma grand-mère. Elle s’est sauvée la vie.
« Caméra se méfie. Elle sait bien qu’à présent le danger est partout, que les parois murales peuvent cacher des micros, des radars, toutes sortes de pièges. » – Édith Azam, Caméra.
Les deux morceaux opposés du même livre tentent de se rejoindre.
En pleine nuit, un milliardaire ouvre sa baie-vitrée et reste un temps à contempler la vue sur sa terrasse. Puis il rejoint l’allée de sa propriété et conduit sa voiture jusqu’à une station-service en limite de zone industrielle. Alors qu’il fait le plein, une voiture se gare à la pompe d’à côté ; son propriétaire coupe le moteur mais ne sort pas de l’habitacle. Il y a un temps qui passe avec les deux voitures, la station-service et la nuit. Puis elle repart, avant que le milliardaire ait fini son plein ; il voit les feux s’éloigner.
C’est amusant : depuis qu’Emmanuel Carrère n’a plus d’idées (pourtant, depuis Le Royaume, quatre ans seulement ont passé), on fait tout pour préparer son mausolée. Ainsi, en 2016 et en octobre prochain, deux recueils de textes épars, lettres, articles, éloges d’amis, pour combler le trou qu’il échoue lui-même à peupler.
« Alors il remarque la longue décapotable, au rouge éclatant, qu’il a aperçue plus tôt. Elle est encore à l’arrêt de l’autre côté de la route, à quelques mètres de là. À l’intérieur, l’homme tourne la tête vers Johnny. Ce dernier sent presque le regard noir, protégé par les lunettes de soleil, posé sur lui. C’est à peu près tout ce qu’il peut voir de l’homme, à cette distance. » – John Rechy, Numbers (trad. N. Naigeon).
Une porte dans le Soleil qui mène de l’autre côté du Soleil.
Une version alternative d’Interstellar dans laquelle le personnage incarné par Matthew McConaughey meurt à la sixième minute du film. Durant son voyage post-mortem vers le Paradis, il découvre que le personnage maléfique incarné par Matt Damon prend finalement son rôle et sauve l’humanité.
Après une journée de tournage, Matt Damon allume sa télé et tombe sur l’épisode 378 d’un feuilleton dans lequel un homme et une femme se battent à propos de la garde de leur enfant. L’homme sent un rayon chaud lui brûler la nuque. Il regarde par la fenêtre du salon et remarque que le Soleil est en train de grossir. À la fin de l’épisode, le Soleil a englouti la Terre.
Cette nuit-là, Matt Damon oublie de fermer ses volets.
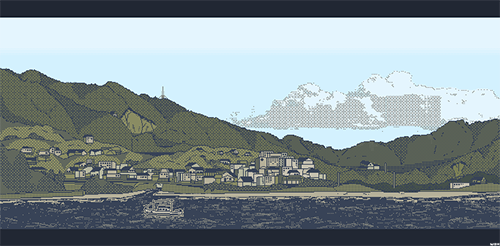
« je veux imaginer des combos réellement
tordus pour récolter le jackpot puisque de nombreux objets sont
à ma disposition pour martyriser mes ennemis » – Ian Monk, Là.
Les phares de voitures sur une autoroute la nuit. Un homme caché dans un buisson, une arme pointée sur sa nuque. Une bête qui traverse, et qu’on prend pour un chien.
Un internaute explique à la quinzième page d’un topic de forum consacré aux profondeurs de chute dans les jeux vidéo qu’on est en train de le tuer. On lui répond qu’en tournant la caméra d’une certaine façon, on peut voir à l’intérieur de la tête.
En 1961, un américain au nom de ville brésilienne découvre derrière la cloison de son bureau une passerelle vers le coffre d’un monospace abandonné sur un parking de supermarché.
Jamais les choses n’ont été si claires et si dispersées à la fois. On voudrait raconter une histoire, mais tous les narrateurs sont morts. Il y a des machines qui calculent les sentiments et en font des affiches mélancoliques.
Dans un musée, un tableau sans personne pour le regarder.
Par exemple, ce matin, en prenant ma douche chez ma grand-mère, je regardais le flacon de gel douche sur le rebord de la fenêtre. C’était un flacon Dove dit intense douceur, et son image d’illustration représentait du lait, plus précisément du lait qui coule dans du lait, et fait une éclaboussure. Et je me disais, tout en prenant ma douche, que le lait qui représente cette bouteille de gel douche n’est pourtant absolument pas contenu dedans, autrement dit qu’on me vend comme lait ce qui n’en est pas. Qu’en achetant ce gel douche Dove, je suis persuadé de me laver avec du lait, alors qu’il y a tout dedans sauf du lait, et même plutôt des dizaines de produits chimiques. Et si jamais je parlais de ce gel douche à un ami, alors dans ma tête j’aurais l’image du lait imprimée sur le flacon, qui peu ou prou ressemble à ce que je me verse sur le corps, et qui pourtant n’a rien à voir. Et je lui dirais sans doute : ce gel douche, c’est comme du lait. Car la société de consommation repose sur un principe métaphorique pictural permanent. On s’étonne ensuite d’avoir un cancer car on prend ce qu’on nous montre comme ce qui est, or le lait n’est pas cancérigène. Évidemment, on ne se méfie pas du lait, et on se demande comment ce gel douche a pu nous transmettre le cancer, car le lait est sain et bon, et sur notre lit de mort, sous perfusion, on ne comprend toujours pas que durant des années on s’est badigeonné le corps avec des produits chimiques à mille lieues du lait, et qu’il est sans doute normal d’en payer les conséquences. Et à côté du flacon Dove, il y avait un flacon Le Petit Marseillais avec des baies et des fruits en illustration, et je me suis dit que décidément la qualité des choses représentées sur les flacons doit être inversement proprortionnelle à la merde contenue dedans et qu’on se verse dessus chaque matin. Et que cette société est en train de nous tuer sous couvert d’images rassurantes ; qu’à force de mal représenter les choses, on finit par oublier ce qu’elles sont véritablement, et que le principe de réalité n’existe plus depuis bien longtemps. D’autant que personne ne se lave au lait, me suis-je dit enfin en sortant de la douche.
Gérer une association consacrée à la poésie, c’est n’avoir pas le temps d’en lire. L’idée, c’est qu’on veut organiser des événements, mais que l’argent des adhérents n’y suffit pas ; on doit donc demander des subventions à des organismes et des collectivités qui soutiennent nos événements, en échange d’une contrepartie ; s’il n’y a pas de contrepartie, il faut la créer pour toucher la subvention. Il y a beaucoup de formulaires à remplir, avec très peu de poésie dedans. Il faut faire des tableaux, sans poésie non plus. Si bien qu’il faut ramper dans le tunnel très longtemps avant de retrouver la poésie, à l’autre bout, un peu dans la lumière (pas beaucoup). Les journées passent à une vitesse folle.
Premier jour de travail. Beaucoup d’interrogations face à l’administratif, que je ne maîtrise absolument pas ; pas eu le temps de faire autre chose ; le jardinier est passé tailler des haies ; il y a eu des appels ; imprimé des documents que j’ai ensuite rangés dans des classeurs et des dossiers ; je dois cumuler deux postes ; la maison est belle.
Quand un article à propos d’un livre commence par « Attention, chef d’oeuvre », c’est que ça n’en est pas un. Idem avec « Ovni ».
« le lieutenant récite une note où je fais état de la misère matérielle, treillis en lambeaux, saleté des corps, vermine, nourriture avariée, de camarades dans tel poste où l’un d’eux perd la raison, mitraille du haut du mirador des rebelles imaginaires sur les postes mitoyens » – Pierre Guyotat, Idiotie.
Ce qui me gêne le plus avec ce concept de post-littérature qui circule récemment, c’est que tous les textes cités et supposés incarner ce mouvement n’ont rien de l’après-littérature. Ils font même partie des choses les plus convenues qu’il est possible de lire dans le contemporain, sans audace et sans magie. Des romans supposément puissants : bien fades. Quitte à envisager un après, encore faudrait-il correctement viser. L’audace est toujours dans le texte, jamais dans le discours qui l’entoure. On peut fanfaronner autour de la chute de prétendus obus, il n’y a rien à en dire s’ils ont déjà explosé.
Comme d’habitude, on ne va pas assez loin. On pense être dans l’hyperespace ; on est seulement un mètre au-dessus du sol.
Si Camille de Toledo, Laurent Mauvignier et Simon Johannin sont l’après-littérature, alors vivement le siècle prochain.
J’allais au Japon avec mon père et un autre homme dans une école. Deux homme d’affaires japonais nous y accueillaient, et nous bavardions avec eux. Ensuite, un Hideo Kojima vieux rentrait dans la pièce et nous saluait, puis nous guidait vers une salle de classe où 5 élèves faisaient un devoir. Avant de commencer la réunion, Hideo Kojima nous parlait de Norman Reedus, qui se remettait d’une blessure faite sur le tournage de la bande-annonce de Death Stranding. Hideo Kojima nous présentait en avant-première un jeu de casse-tête pour mobile à la Candy Crush, mais avec un arrière-plan politique extrêmement complexe. Mon père posait quelques questions pertinentes sur le jeu, puis il s’endormait à sa table, et Hideo Kojima venait lui taper sur la nuque sans le réveiller. Ensuite, un élève sans doute aux toilettes rejoignait ses 5 camarades en train de travailler, et remarquait qu’il y avait Hideo Kojima dans la salle ; toute la classe arrivait, et la maîtresse nous saluait. Elle notait une phrase en français au tableau pour nous accueillir, mais avec une énorme faute, que je corrigeais en montant sur l’estrade. Mes corrections n’étaient pas assez claires, et je voulais réécrire la phrase en entier, mais il y avait trop de craie sur le tableau que je n’arrivais pas à enlever, et finalement il m’a fallu un certain temps avant de parvenir à écrire les deux phrases correctement. Après avoir lu ce que je venais d’écrire, tout le monde m’applaudissait.
« il n’y a pas de porte ici ni de fenêtre
on entre du côté où vivre fait mal » – Raymond Federman, Future Concentration.
Après ma quinzième boucle, je laissais mon vélo contre la porte du garage et me précipitais vers le réfrigérateur pour manger en cachette, d’une traite, à l’arrière du jardin, quatre ou cinq Kinder Délice (en commançant par la couche craquante, pour finir par la crème). Mes parents ne rentraient qu’une heure plus tard, au mieux. Ensuite, je jouais dans ma chambre, ou regardais la télévision. Il m’arrivait de jouer au ballon dehors, contre le mur qui faisait face à la maison. Je ne dépassais jamais les limites du quartier. Je parlais tout seul ; j’allais sur l’ordinateur de ma mère. J’ouvrais les portes de pièces vides, dont je connaissais les absents.
Parfois, j’imagine la place qui serait libérée sans les voitures. Toutes ces rues, ces autoroutes, qu’on pourrait couper de moitié ; ces garages, ces parkings, parfois cinq étages de parkings uniquement pour des voitures, et parfois cinq étages de parkings souterrains. Dans tous les sens, des voitures.
« C’est une grande douleur chez moi, très grande, de craindre que l’affection qui s’est déposée comme la poussière et la cendre d’un feu ne soit condamnée au sable et au silence des nécropoles. Mais ma vie, à présent, il serait indiscret de la commenter davantage. Chaque nuit, à présent, il me semble que quelque chose, tu vois, me dit de tout abandonner. » – Frédéric Boyer, peut-être pas immortelle.
La première femme de Jeanne Lekker a trouvé la mort dans un accident de voiture à deux rues de leur domicile. Par la fenêtre de son bureau, Lekker a observé toute la matinée la nappe de fumée s’élever dans le ciel sans comprendre qu’elle s’échappait du véhicule en flammes. En fin d’après-midi, sa promenade habituelle l’a fait croiser le chemin de la carcasse éteinte ; elle ne reconnut pas la voiture.
À côté, trois femmes parlaient du drame et ont baissé les yeux sur son passage. L’une d’entre elles portait encore son tablier de cuisine (tablier que porte aussi le personnage de Clarisse, dans Copenhague).
Lekker fit le lien à l’heure du dîner, quand personne ne vint s’installer au couvert face au sien.
« Changer les ampoules, sortir les poubelles, arroser les plantes : des exigences d’une vie minuscule, une vie qui s’ouvrait, en moi-même, une fois la nuit venue, sur un loft du centre, dans une rue dégueulasse de cette ville en chantier. » – Amy Hempel, Le Chien du mariage (trad. G. Vissac).
Après plus d’un mois à vadrouiller, je rentre enfin à Rennes. Il fait bon souvent être chez soi.
Dans Saccage, je crois, j’ai essayé de faire de la poésie. Ensuite, j’ai arrêté d’essayer.
Ce que je tente de faire à présent, je n’en ai aucune idée.
« Des perspectives cachées transformaient Estrella de Mar en une monstrueuse énigme. Des couloirs en trompe-l’oeil attiraient le regard mais n’aboutissaient nulle part. Je pouvais passer la journée à échafauder des scénarios prouvant l’innocence de Frank, mais ces constructions s’effondraient dès que j’en éloignais mes doigts. » – J.G. Ballard, La Face cachée du soleil (trad. B. Sigaud).
À écrire Rivage, je me rends d’autant plus compte de la pauvreté des environnements urbains des villes moyennes. Partout des préfabriqués, des Algeco, locaux techniques blancs, cabines électriques grises, identiques, l’un pouvant être l’autre, à côté des parkings, des centres commerciaux, parfois sur les chantiers, partout les mêmes termes pour les mêmes bâtiments inutiles, modulables, remplaçables, invisibles.
C’est un casse-tête monstre systématiquement pour faire comprendre dans quel bâtiment précisément de ce type mes personnages vont, qui n’est pas celui déjà vu plus loin, ou l’autre plus tôt, même si oui, ce sont les mêmes objets, et que oui, on y trouve à l’intérieur les mêmes choses. C’est un non casse-tête à vrai dire, car je ne prends même pas la peine de le résoudre. Qu’on se perde volontiers, moi je suis déjà perdu, et mes personnages, n’en parlons pas.
J’aurais été plus inspiré d’utiliser des casinos, des grands hôtels, des gratte-ciel, quoi d’autre, des salles de cinéma, des boîtes de nuit, là où les néons sont forts et où les lettres capitales disent clairement sur le fronton quelle est la fonction.
Autre chose : les romans policiers vont vite. Donc, forcément, Rivage va trop vite (je ne peux pas m’en empêcher).
Comme les choses avancent administrativement parlant, je peux sans doute le dire : à compter du 3 septembre à 9 h, je serai le directeur de la Maison de la Poésie de Rennes.
(Oui, je suis très content.)
Chaque fois que j’essuie la table, je repense à cet ami du collège qui disait détester ramasser les miettes humides dans son éponge quand il faisait la même chose. Je ne sais pas pourquoi cette remarque m’est à ce point restée.
« On ne peut pas attendre que tous les livres soient grands, il ne faut pas rêver : en ce sens, les livres médiocres sont la condition de possibilité d’un grand. Je serai heureux d’avoir contribué, par un livre médiocre, à la possibilité d’un grand. Je dis médiocre, je ne dis pas nul – et il se peut bien que mon livre soit nul. »
J’avance dans Rivage comme dans le noir complet, simplement aidé d’une torche. Je vois un peu autour de moi, pas plus, en me disant qu’au bout il y a forcément une sortie. Le chemin, lui, ne mène nulle part, et je tourne très probablement en rond. C’est un livre qui oublie ses pistes et ses indices à peine sont-ils révélés. C’est un roman policier qui n’a aucun sens, et qui va laisser tout le monde sur le bord de la route.

À la fin du troisième chapitre de L’Océan Pacifique, un personnage secondaire explique qu’il y a au fond de l’eau une épave dans laquelle les ombres s’allongent sur des surfaces sans lumière. Lui-même vit dans cette épave, et parfois note ses observations.
Au début du sixième chapitre, on apprend que ce même personnage est mort lors d’un naufrage au large du Groenland.

« Qu’il marcherait, dans ses rêves, le long du même couloir, et dans ses livres, qui sont ce couloir. » – Danielle Mémoire, Parmi d’autres.
Longtemps on a dit que son premier roman avait été écrit alors qu’elle souffrait de profondes visions hallucinatoires. Son mal n’a jamais été diagnostiqué par aucun médecin, mais la rumeur veut donc qu’un autre livre en creux existe sous celui qui a été publié. De son vivant, Jeanne Lekker n’a jamais démenti cette idée.
Je me souviens, chez mes cousins, je m’enfilais dans un sac de couchage, sur le canapé de la mezzanine, à côté des consoles encore chaudes d’avoir joué toute la nuit.
Dernièrement, j’ai peu lu. Deux livres d’Angela Davis. La moitié d’un Danielle Mémoire. Comme j’ai peu lu, j’ai peu écrit. J’ai beaucoup joué à Mario Kart 8. J’ai gagné parfois.
Avant de mourir, le 14 décembre 2004, à l’âge de 47 ans, Jeanne Lekker a écrit quatre romans : Cargo Marécage (1976), Copenhague (1980), Marcher dans la nuit (1994) et L’Océan Pacifique (2002).
Son oeuvre est traversée de réflexions sur la magie noire, les profondeurs, le deuil, la solitude, l’invisible et le sentiment bouleversant d’appartenir à une communauté qui n’existe pas. L’universitaire américain Edgar Highway a écrit à son sujet qu’elle « transformait ses souvenirs en processions de fantômes ».
(Il y a encore quelques mois, j’aimais bien les flux, les longs monologues par exemple. Maintenant, je me rends compte que les bavards m’épuisent. Plus c’est court, plus ça me va.)
Je suis en ce moment en vacances dans le Nord de l’Espagne. Je me suis rendu compte une fois sur place que sa géographie ne me convenait pas. Les routes ne cessent de tourner, sont occasionnellement en altitude, et les monts en arrière-plan s’entrecroisent sur différents niveaux ; je ressens constamment un vertige qui paralyse par avance n’importe lequel de mes mouvements. Je me sens faible.
Que son corps ne soit pas à la bonne place est une impression étrange. On voudrait que la terre soit plus stable, et les arbres moins tordus. On aimerait voit la mer au loin et qu’elle s’écrase à nos pieds. On aimerait ne pas sentir dans son dos la chute, ni quand on lève la tête les troncs prêts à dévaler les vallons.
Quand on est rejeté par le décor, où s’installer ?
J’ai eu 27 ans jeudi dernier.
Ce rhume m’empêche de faire autre chose que regarder la journée passer. La maladie est toujours une capsule temporelle ; on profite de la vue sans comprendre où l’on est.
Je bois des tisanes d’un thym que j’ai coupé aux ciseaux dans le jardin de ma grand-mère.
Je me disais que la multiplication des services en ligne m’empêchait de suivre correctement les personnes dont j’aime le travail, ou plutôt la parole. S’abonner partout, alors qu’on pourrait tout regrouper en un seul endroit. Les Relevés sont ma seule parole publique en ligne ; ailleurs, je me tais. Par email, il y a les conversations privées. On gagnerait tous à n’avoir qu’une page personnelle (libre).
« Il méprisait la fiction, il l’avait toujours dit, et que le roman est un compromis lamentable. Il me traitait de littérateur, il refusait en outre de me voir, sur son dos, acquérir l’infime prestige qu’il y a de nos jours à être, plutôt que rien, un écrivain médiocre. Il m’a intimé l’ordre de me taire, « et ton oeuvre, a-t-il dit, sacrifie-la. »
Hier matin, j’ai appris par téléphone que le conseil d’administration avait retenu ma candidature pour un poste auquel j’avais postulé. Quel poste, j’aurai l’occasion d’en reparler sous peu, mais par chance c’est en pleine littérature, et à côté de chez moi. Je ne sais encore pas comment j’ai fait pour l’emporter ; je ne réalise pas, mais c’est une excellente nouvelle, et elle me réconforte pour la rentrée.
En contrepartie, j’ai un rhume.
J’ai souvent la sensation d’être chanceux, de toujours m’en sortir par je ne sais quel miracle alors que tout semble contre moi. À quoi ça tient, je ne sais pas ; mais il se passe que ma trajectoire toujours persévère.
Rivage, c’est trois pas en avant, trois pas en arrière, trois pas sur l’côté, trois pas d’l’autre côté.
Mon troisième été à l’usine (en 2011 donc, sans doute), je me souviens qu’un de mes emplois me plaisait bien. J’étais chargé, dans une pièce à l’abri du bruit, de réaliser des recettes d’épices à partir d’une base de données inscrite sur l’ordinateur. La quantité de recettes par matinée était imposée, et j’allais dans le hangar récupérer les différents sacs de matières, que je rangeais ensuite dans des caisses, que les collègues venaient chercher à des horaires réguliers. C’était amusant, j’étais tranquille.
Malheureusement, la plupart du temps, j’étais affecté à un autre poste, où je jetais des barres de merguez dans un silo tournant programmé pour automatiquement les séparer.
« Il disait qu’une ville est le miroir d’une autre, qu’elle se réfléchit en elle, entre en elle par les rues et par les ponts, par les points cardinaux, la rivière, le fleuve – répétant, le fleuve, la rivière, et ses rives, ses rives ; elle est dans ses murs ; chaque ville, ainsi, est toutes les villes, tous les chemins y mènent, il n’y a qu’un monde, il est tout l’être. » – Danielle Mémoire, Trois capitaines.
Quand, dans certaines conversations, on tente d’avancer des idées qui vont à l’encontre de ce que pensent ou admettent comme évident les autres, vient toujours l’instant où l’un des interlocuteurs dit : la société est ainsi (les autres acquiescent, oui, il a raison, elle est ainsi). À chaque fois, plus tard, je me demande : quand est-ce qu’on finit par considérer la société comme une entité figée ? Puis, presque aussitôt : quand est-ce qu’on se satisfaits d’être malheureux ?
La réalité est une machine qui imprime son contrôle sur les esprits, et qui finit par neutraliser toute volonté de la considérer autrement. À partir d’un certain stade, on est comme marqué au fer rouge.
Trois adolescents étrangers sont montés dans le train en gare de Redon, sans billet. Le contrôleur les a laissés monter. En gare de Rennes, les flics les attendaient, et le contrôleur pointait du doigt les adolescents, leur les décrivaient, pour être bien sûr qu’ils ne s’en sortent pas (ils ne s’en sont pas sorti).
« Un fou quand il cherche le sommeil se déchire le visage avec ses ongles. Rêves qu’on craint, et l’étage où on cherche le rêve qui endort. Ma maison a son escalier, et chaque étage sa chambre. Je monte. Si le rêve ne vient pas, je descends. On cherche la chambre où une fois on a fait ce rêve. »
500 vidéos d’essais nucléaires menés aux États-Unis entre 1945 et 1962 viennent d’être publiées.
Après Atom, c’est au tour de Vienna, mon agrégateur de flux RSS, de ne plus fonctionner. Je déteste devoir changer mes habitudes et chercher un nouveau logiciel alors qu’un ancien me convenait parfaitement, dans son usage comme dans sa forme. Je suis donc passé à Feedbro, une extension Firefox ; on verra.
Sans doute qu’un de mes plus grands regrets est d’ailleurs de ne pas avoir de RSS pour les Relevés.
« L’impression, disait Barbin, d’une ville de ciment : qu’on vivait sur un dessous malsain du monde, que l’enfermement laissait affleurer dans les enfilades venteuses, et voilà ce qu’en brisant ce mur ils venaient de solidifier comme la meilleure configuration partout souhaitable, norme restaurée des vitrines et du périssable. » – François Bon, Calvaire des chiens.
J’aimerais écrire un livre plein de la mélancolie propre aux étés nourris par la mer, dans ces maisons vides où l’on passe nos vacances, où les trottoirs sont percés d’herbes, où il y a parfois comme la rumeur d’un amour entre deux adolescents qui n’osent rien se dire. Un livre dans lequel le narrateur reviendrait onze ans plus tard, l’hiver, pour se souvenir que, de son passé, il y a tant à oublier.
Mon exemplaire neuf de Dans la tour a été imprimé en 1984 ; il a donc fallu atttendre 34 ans pour que tous les livres imprimés à l’époque soient écoulés. Il y a des livres que personne ne lit, ou plutôt qui sont lus peu à peu, sur des périodes immensément longues (démesurées).
« Gée se levait la nuit quand tout le monde dormait, et allait, à bicyclette, à Rompsois. Elle rentrait avant l’aube. Il y avait des nuits où elle ne sortait pas, c’étaient celles où Marie-Anne eût dû venir ; mais elle ne venait jamais, elle me l’a dit, c’est elle qui m’a raconté cela : je lui en ai parlé, et elle m’a tout raconté : elle n’osait pas venir, elle avait peur des chemins, de la nuit, des oiseaux de nuit, qu’on ne se réveillât. » – Danielle Mémoire, Dans la tour.
Aujourd’hui, dans le cours d’eau, nageait un cygne, seul.
Rivage au rapport est, pour emprunter l’expression à Sergio González Rodríguez, a feminicide machine. C’est un livre insoutenable parce qu’injuste (= gratuit).
Dans un article de Ricardou à propos du travail de Robbe-Grillet, quelque chose d’important : « Les choses, marquées du refus de la conscience, se chargent de ce que la conscience refuse. Elles portent à la conscience son propre refus, non comme refus d’une obsession, mais d’une réalité. Elles réalisent le phantasme. »
Le manuscrit retrouvé permet d’aborder un projet bien au-delà de nos capacités ; en somme, c’est toujours l’échec de n’avoir pas pu écrire nous-mêmes le manuscrit retrouvé.
« Dans l’obscurité des nuits, je hurle ma haine sans relâche. Je gravis les rochers près du ciel. D’un bon, je franchis les failles creusées dans le roc. Le sommet des falaises forme un dédale de chambres à ciel ouvert où je pleure, mon fusil en travers de la nuque, dans mes vêtements en lambeaux serrés contre moi par des lacets de cuir. » – François Augiéras, Le Vieillard et l’enfant.
Je n’écris pas des romans pour être soumis en permanence aux contraintes du réel.
Un homme gare sa voiture devant un hangar où il construit la prochaine arche qui nous sauvera des eaux.
À une autre candidature, on m’a répondu : « Nous n’avons pas retenu votre profil car nous recherchons avant tout un fort style d’écriture que votre lettre de motivation ne laisse pas entrevoir. » Décidément, je ne suis vraiment pas fait pour le monde du travail. Ma lettre de motivation ne laisse pas entrevoir mon fort style d’écriture (soupirs).
Dans quoi suis-je bon ? Qu’est-ce qu’une lettre de motivation pourrait laisser entrevoir de moi ?
Pendant plusieurs dizaines de minutes, j’ai observé les trois rats musqués aller et venir dans le cours d’eau, ramenant à leur terrier quelques brindilles récoltées plus loin. Je crois que, pendant un instant, je me suis dit que j’aimerais mener la même vie.
« Nous avons tous eu l’occasion de voir cette petite scène : un homme qui vient de saluer cordialement un ami traverse la rue, le visage encore éclairé d’un sourire… et son sourire est éclipsé par le regard fixe d’un passant qui, n’étant point averti de la cause, croit reconnaître dans l’effet le rictus rayonnant de la démence. » – Vladimir Nabokov, Ada ou l’Ardeur (trad. G. Chahine).
Constat : les livres sont trop lents.
Sur un panneau publicitaire aux abords du périphérique parisien, un ensemble de pixels morts clignotait, comme pour alerter d’une menace les automobilistes trop occupés à ne pas y faire attention.
En pleine campagne française, un magasin d’électroménager dont tous les téléviseurs diffuseraient en direct l’explosion du soleil.
« Mais parfois, il arrive aussi qu’en plus de ce qu’on cherche, on tombe sur des tas de trucs qui n’ont rien à voir avec l’affaire — comme l’histoire du cadavre sur le balcon, qui s’est volatilisé quand vous voulez jeter un coup d’oeil dessus. » – Raymond Chandler, Charades pour écroulés (trad. C. Wourgaft).
Rivage est un récit en permanence contaminé par des informations qui n’ont aucune importance pour la trame principale : rumeurs, mythes, croyances, fantasmes, données, mesures, etc. Dans lesquelles chaque personnage se projette comme si elles disaient la vérité ; simples ficelles du démon qui fait régner la terreur (moi).
(Repère au mardi 3 juillet : 20 014 mots.)
J’ai reçu les premières corrections pour La Ferme des mastodontes, qui devrait normalement paraître l’année prochaine.
Tueurs de flics de Fajardie est un livre drôle et qui va au but ; dommage qu’on y parle petit-nègre (soupirs).
Un abribus sous lequel un homme attendrait pour expliquer la formation de l’univers. Son apparence originelle est celle d’un oiseau aux ailes recouvertes d’écailles, symbolisant le démon sorti du trou noir qui nous a servi de mère.
Sa métamorphose opère dès que l’homme énonce la question interdite première.
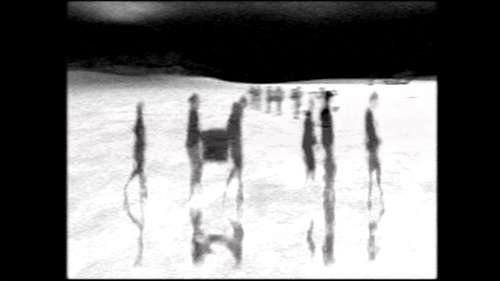
« Si vous pouvez mettre en circulation une assez grande quantité de désinformation, vous abolirez entièrement le contact de tout individu — y compris vous — avec le réel. » – Philip K. Dick, La Transmigration de Timothy Archer (trad. A. Dorémieux).
Finalement, je n’ai pas eu le poste pour lequel j’avais postulé. La femme au téléphone a prononcé le mot “curatif”, mais je ne sais plus dans quel contexte, je crois que c’était lié à ma place dans l’entreprise. Je n’ai aucune idée du sens de ce mot, et sans doute que elle non plus. Elle m’a aussi dit que le feedback que je leur avais envoyé par email n’était pas assez complet et ne les avait pas aidé à choisir. J’avais pourtant écrit cinq ou six paragraphes, alors je ne comprends pas trop ; sans doute parce que je ne sais pas ce qu’on attend d’un feedback. L’échange était très cordial, et à la fin l’un et l’autre on a raccroché en bons termes.
Une exposition dans une tour désaffectée, avec un livre de 13 pages qui contiendrait les coordonnées de tous les lieux sur Terre où on trouve de l’antimatière.
Je retrouve dans Ida une construction semblable à celle lue dans La Mort de C., de Wittkop ; une façon de tourner autour de l’événement, du décès en l’occurence, décès dramatique car accidentel, ou immérité plutôt, le décès incompréhensible et injuste dans le parcours de vie des deux figures concernées (Ida et C.). Des morts autour desquelles justement personne n’a tourné, sur lesquelles personne ne s’est attardé (retournant bien vite au flux). Elles prennent le temps d’apprécier le cadavre.
Ce matin, j’ai un autre entretien, mais dans une structure différente.
Qui lit mes archives, sinon les robots.
« Ce météore en miettes
D’un inconnu à l’autre. D’un cri d’horreur à l’autre.
C’est Ida.
Ce paquet singulier
Fait d’étoffe de membres disloqués et peut-être d’un visage
C’est Ida. » – Hélène Bessette, Ida.
L’unique élément apocryphe de nos univers respectifs serait notre propre identité ; ce qui nous empêcherait de nous libérer, car la simple idée de nier notre existence est insupportable. En chacun s’ouvrirait une faille qui est la vérité.
Pour répondre à ma demande (voir plus bas), Joachim m’a écrit un email (merci à lui) dans lequel il me dit : « Hélène Bessette, Vingt minutes de silence est exactement ça il me semble ». Après de brèves recherches en ligne, j’en conclus que oui, il me semble à moi aussi que ça pourrait exactement être ça.
Cet après-midi je vais à la librairie où, évidemment, ils ont tous les livres réédités de Bessette sauf Vingt minutes de silence (évidemment). J’achète On ne vit que deux fois et Ida et je rentre chez moi. Ce soir, j’ai lu le premier, redoutable de mauvaise foi et donc absolument vrai. Un livre entier sur la rage de n’être pas vue ; une rage qu’on partage tous.
« Toute réalité apparente qui est agréable, continua Emmanuel, est sujette à caution. Quand tout devient tel qu’on le souhaiterait, c’est la marque de la fraude. »
Je serais un saxophoniste expérimental de seconde zone. Je serais invité par des capitales européennes pour jouer dans des salles de concert confidentielles à moitié remplies. Je ne vivrais pas de ma musique. Sur Internet, il y aurait des photos de moi mises en scène en train de marcher dans des rues vides. Tous les cinq ans, je publierais un album de 6 titres sur des plateformes de téléchargements inconnues. Un des titres mentionnerait directement la nostalgie d’une histoire d’amour ; un autre une femme.
À vingt-deux heures sur les bords de Vilaine, un homme mangeait sa pizza seul.
L’impression que fait un visage inconnu la première fois qu’il sonne à votre porte.
« Après cela il s’appropria le monde extérieur de manière à le renfermer en lui. Il avait maintenant l’univers à l’intérieur de lui et son cerveau tout autour de lui. Les espaces occupés par son cerveau étaient bien plus vastes que ne l’avait été l’univers. Il connut donc l’étendue de toutes les choses qui étaient lui-même, et comme il avait incorporé le monde, il le connaissait et le contrôlait. » – Philip K. Dick, L’invasion divine (trad. A. Dorémieux).
Pourquoi ce besoin systématique de résoudre les énigmes, d’éclaircir l’affaire ; pourquoi vouloir sortir du noir.
Rivage au rapport est le scénario d’un film qui n’existera jamais ; c’est un livre paranoïaque, complotiste, perpétuellement injuste dans son rapport au réel.
Désormais, à chaque fois que je dois acheter un objet essentiellement (voire intégralement) fait de plastique, j’éprouve une réticence, une légère appréhension, comme si la matière m’était devenue néfaste, nocive (ce qu’elle est). À son contact, j’éprouve l’appréhension de ce que je ne comprends pas.
J’ai fait changer la pile de ma montre.
« Le monde entier va bientôt devenir un gigantesque parc d’activités, dirigé par une bande de types à l’air pincé, qui jouent les psychopathes le week-end. »
Dans la nuit, l’état de mon oeil droit s’est aggravé, et ce matin j’ai fait une crise d’angoisse. J’ai appelé SOS Médecins, puis le SAMU. En attendant mon rendez-vous et que la pharmacie ouvre, j’ai poursuivi ma lecture de Super-Cannes, dans lequel un médecin prescrit la psychopathie pour ses patients, victimes de leur manque d’affects.
Verdict de la médecin : conjonctivite.
J’ai dû changer d’éditeur de texte car depuis ce matin, pour une raison quelconque, Atom refusait de s’ouvrir. Je suis passé sur Sublime Text.
« Les endroits comme Éden-Olympia offrent un terrain fertile à n’importe quel messie vindicatif. Les Adolf Hitler et les Pol Pot de l’avenir ne sortiront pas du désert, mais des centres commerciaux et des grands parcs d’activités. » – J.G. Ballard, Super-Cannes (trad. P. Delamare).
Axiome : plus il est dit qu’un roman est proche de l’oeuvre de Lynch, moins il l’est.
Enfin parvenu au terme de la première semaine, qui correspond à peu près à la moitié de l’ensemble.
J’ai une douleur à l’oeil droit que je ne parviens pas à dissiper ; une irritation à cause d’un quelconque résidu qui s’y est infiltré.
« Passage n°10. Apollonios de Tyane a écrit, sous le nom de plume d’Hermès Trismégite : « Ce qui est en haut est en bas. » En fait, il voulait nous dire que notre univers est un hologramme, mais il ne connaissait pas le terme. » – Philip K. Dick, SIVA (trad. R. Louit).
Rivage au rapport est un roman sur deux questions simples : Pourquoi les hommes tuent les femmes, et pourquoi font-ils semblant de ne pas comprendre pourquoi ils les tuent.
Trois machines fonctionnent à l’intérieur : la première est celle de la violence ancestrale, le sédiment de la civilisation, dont on retrouve parfois des traces là où l’on imaginait rien ; la seconde est celle de la violence routinière, qui tourne en fond et rend aveugle ; la troisième est un corps tranché en deux, un enfant énucléé, un chien dans lequel on tape comme dans un ballon, la bombe atomique, une pièce fermée à l’intérieur de laquelle une femme hurle.
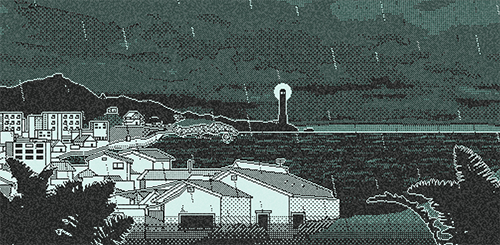
Récemment, lu deux livres moyens : Le Dahlia noir d’Ellroy et Histoires mystérieuses d’Asimov ; une sensation désagréable.
En début d’après-midi, j’ai passé un entretien d’embauche.
« Le jour où les anciens gratte-ciel en pierre auront tous été remplacés par des gratte-ciel aux façades vitrées, miroirs géants ne renvoyant plus que des images vides d’autres miroirs géants, la ville aura accompli le cycle de son histoire. En levant les yeux, on ne verra plus rien que les reflets de la lumière et du ciel sur le verre, en silence, même quand le vent soufflera dans les rues entre les immeubles aux surfaces parfaitement lisses. » – Emmanuel Hocquard, Un privé à Tanger.
Dans Inland Empire, la chambre de l’adultère communique avec les lieux de tournage par une cloison factice, ainsi qu’à l’appartement de la femme en peine par un escalier en sous-sol. Toutes les dimensions se rejoignent par un mécanisme architectural anodin (intérieur petit-bourgeois), et permettent à la pensée d’aller et venir sur plusieurs strates sans souffrir de coupures.

« La mort m’attire de très loin, par des labyrinthes inconnus. » – Gabrielle Wittkop, Le Nécrophile.
Je m’aventure dans des contrées que je peine à imaginer.
Généralement, les dégâts sont limités à 9 999 999. Au-delà, il y a triche. Comme les Pokémon, qui ne peuvent dépasser le niveau 100. Un Pokémon de niveau 167 ou 177 implique un passage par la rive droite de Cramois’île.
On a retrouvé l’abeille morte sur le carrelage de la salle de bain, recroquevillée comme une enfant.
« Martin tout entier s’était réduit à une sorte de vigilance. Il était en train de traverser une de ces périodes dont on dit, quand elles sont passées : il ne s’est rien passé. » – Clarice Lispector, Le Bâtisseur de ruines (trad. V. Do Canto).
Le 27 juillet 2010, le corps de Magdalena Stoffels, lycéenne, est retrouvé dans le lit d’une rivière de Windhoek, la gorge tranchée.
Le même jour, à 500 mètres de là, un policier rencontre un homme en train de laver ses vêtements dans la même rivière ; il a ce qui ressemble à des écorchures sur les genoux et sur le dos, du sang séché sur ses vêtements.
Le 30 juillet 2012, une commémoration est organisée par deux anciennes camarades de classe, Andrea Sylva et Debora Dickson.
Debora Dickson déclare que les femmes ne peuvent plus faire confiance à la justice.
Le 9 janvier 2013, un pont piétonnier à son nom est construit au-dessus de la rivière.
Des figures diluées à la file sur un même souvenir.
« Nul aveu ne s’échappe plus légèrement que celui de l’amour qu’on ne ressent pas. Les paroles coulent d’elles-mêmes, comme l’eau d’un robinet mal fermé. On ne sait pourquoi on les prononce et voici qu’avec un déclic féroce se ferme le piège des démarches inconsidérées. Dès lors, on ne pensera qu’à la fuite. » – Gabrielle Wittkop, Chaque jour est un arbre qui tombe.
Je me dis que si les romanciers tiennent tant à arrêter le coupable à la fin de leur intrigue, c’est qu’ils imaginent ainsi conclure l’affaire, vaincre le Mal ; ils ne font que détourner le regard.
Des soirs comme ce soir, on écrit 97 mots et on se dit qu’on a fait du bon travail.
J’entendais deux game designer expliquer qu’on pouvait concevoir un jeu en partant d’un concept (la solitude), ou d’une mécanique (la gravité).
« La folie à 99 % c’est une question d’argent, se situer par rapport à l’argent, aux choses, être situé par les autres, les riches. » – Emma Santos, J’ai tué Emma S.
Je me trouve dans une certaine impasse. Je recherche des romans, plutôt dans la mouvance roman noir ou polar, mais disons, à la marge, cassant à loisir, volontiers sanglants, et flottant autour du mystère ; ou pas forcément, mais qui explore, va plus loin ; peu importe la nationalité et l’époque. Références en vrac : Robbe-Grillet, Thompson, Femmes blafardes de Siniac, Hammett, L’Échec de Nolan de Ollier, Cooper, La Maison des feuilles de Danielewski, Poe, Lovecraft, Ellroy, Histoires mystérieuses d’Asimov, Un privé à Tanger de Hocquard, Echenoz, K. Dick, Clope au dossier de Pinget, etc. Si vous avez des idées, envoyez-moi un email.
Borges, dans l’épilogue du recueil L’Auteur et autres textes (trad. R. Caillois) : « Un homme fait le projet de dessiner le Monde. Les années passent : il peuple une surface d’images de provinces, de royaumes, de montagnes, de golfes, de navires, d’îles, de poissons, de maisons, d’instruments, d’astres, de chevaux, de gens. Peu avant sa mort, il s’aperçoit que ce patient labyrinthe de formes n’est rien d’autre que son portrait. »
« Tous les complots reviennent toujours à la même histoire tendue d’hommes qui trouvent une cohérence dans un acte criminel quelconque. »
En ce moment, j’avance lentement, passant avec peine d’un millier de signes à l’autre. J’entrevois tout juste de possibles résolutions. Tout reste à faire.
Ce matin, deux pies harcelaient un chat.
Avant-hier, sous la douche, j’ai conçu un long développement qui voulait que chaque nouvelle oeuvre soit expérimentale. Que, par exemple, Diderot, Flaubert, Proust, au moment où ils écrivent leurs livres, expérimentent, tentent un geste inédit en accord avec leur pensée. Je faisais une comparaison avec les Lego, dont on peut suivre à la lettre le plan pour reproduire ce qui est montré sur la boîte, ou inventer d’autres choses à partir d’une base donnée. Reproduire offre la stabilité de la vitrine, quand l’exprimental offre l’inattendu (donc le neuf).
C’était un long développement, bien plus convaincant sous la douche.
« Nos vies décortiquées, débarrassées de leur imbrication, de leurs liens, de leurs rapports, fournissent en abondance des significations subtiles, comportant des thèmes, des mouvements en spirale qu’il ne nous est pas permis de voir nous-mêmes dans leur totalité. » – Don Delillo, Libra (trad. M. Courtois-Fourcy).
Le 17 septembre 2007, un commerçant de Petaling Jaya découvre un corps dans un sac de sport ; il ne sera identifié que quelques jours plus tard : Nurin Jazlin, 9 ans.
Le matin, avant l’ouverture des commerces, une caméra filme un homme arriver en moto. Il descend du véhicule, enlève son casque, et téléphone à un inconnu tout en faisant les cent pas. Des véhicules le croisent et poursuivent leur route. Puis il enlève un lourd sac de sa moto (il peine à le soutenir d’un seul bras), et le dépose sur le sol ; il repart.
Une heure plus tard, une femme s’arrête pour se laver les mains, sans remarquer le sac. Puis, une voiture la rejoint ; son conducteur discute avec la femme, qui monte à l’intérieur du véhicule.
Après la découverte du corps, les parents reçoivent plusieurs faux appels accumulant les mensonges à propos de leur fille. Un homme d’affaires anonyme offre une récompense importante pour quiconque a de nouvelles informations à fournir.
Le 2 octobre, une femme en possession de trois téléphones prépayés est appréhendée, mais avale une des cartes SIM ; un de ses autres numéros se retrouve sur la liste des faux appels menaçants.
Les parents de Nurin Jazlin avaient signalé sa disparition le 20 août ; une caméra filmera quelqu’un en train de la forcer à monter dans un van blanc. Elle vivra 26 jours de torture.
Dans Des os dans le désert (trad. I. Gugnon) : « Nombreuses sont les femmes qui trouvent la mort en attendant l’autobus ou ont été vues pour la dernière fois alors qu’un véhicule circulait dans les parages. »
À mon sens, la qualité d’un roman policier se mesure à l’intelligence de ses fausses pistes, et non de sa résolution.
« La maison de Navidson peut-elle exister sans qu’on en fasse l’expérience ? »
Le matin du 31 décembre 2000, les corps de Mikio et Yasuko Miyasawa, ainsi que ceux de leurs deux enfants Niina et Rei, sont découverts dans leur maison de Setagaya par Asahi Geino, la mère de Yasuko Miyazawa.
Rei a été étouffé avec ses draps ; Mikio, Yasuko et Niina poignardés. Les cables téléphoniques avaient été débranchés.
Le tueur s’est ensuite servi en melon, glace et thé. Il est allé sur internet avec l’ordinateur parental ; il a tenté d’acheter un billet pour la Shiki Theatre Company (un favori enregistré par Mikio), et a consulté les sites de l’entreprise de Mikio et de l’école de Yasuko avant de débrancher le cable d’alimentation de la machine. Il a fait une sieste sur le canapé du salon. En tout, il a passé 11 heures à l’intérieur.
Le 27 décembre, un homme est aperçu en train de rôder dans les parages.
Le 25 décembre, Yasuko dit à son beau-père que la même voiture se gare souvent devant chez eux.
Le 31 décembre, six heures après la découverte des corps, un homme se fait soigner pour une blessure au couteau (jusqu’à l’os) dans un centre hospitalier à 120km plus au Nord. Il n’a donné ni son nom ni les circonstances de sa blessure.
Toutes les maisons qui entouraient celle des Miyasawa au moment des faits ont depuis été démolies.
« En leur absence, la demeure des Navidson était devenue quelque chose d’autre, et sans être exactement sinistre ou même menaçant, le changement réduisait néanmoins à néant tout sentiment de sécurité ou de bien-être. » – Mark Z. Danielewski, La Maison des feuilles (trad. Claro).
Le 14 février 2017, les corps des deux adolescentes Abigail Williams et Liberty German sont retrouvés dans une forêt de Delphi.
La veille, en début d’après-midi, la soeur de Liberty German les dépose au pont abandonné de Monon High, pour une randonnée. En fin d’après-midi, à l’heure prévue où son père doit les récupérer, il ne les retrouve pas ; elles sont aussitôt portées disparues.
Peu avant sa mort, Liberty German a pris une photo de son amie ; la dernière. Puis une photo de très mauvaise qualité d’un homme en train de marcher sur le pont, habillé d’un bonnet, d’un jean et d’un ciré bleu. Elle a également enregistré une bande-son dans lequel on entend le suspect répéter « En bas de la colline ».
Le 7 mai, 100 personnes ont organisé une marche suivant la randonnée des deux adolescentes le jour de leur mort. À cette occasion, le pasteur Todd Ladd a déclaré que le Mal avait frappé ici, et qu’ils voulaient récupérer cette terre.
(XX victimes sans coupable ou Deuxième décennie du second millénaire.)
« Je suis assise là à me répéter que les éléments sont indiscutables. La voiture, l’homme, la mère, l’enfant. Voilà les éléments. Mais comment ces éléments s’agencent-ils entre eux ? Parce que maintenant que j’ai eu le temps de réfléchir, il n’y a pas d’explication. Un trou béant s’est ouvert dans l’atmosphère. » – Don Delillo, Le Coureur (trad. M. Véron).
Le 7 septembre 2014, les restes de Holly Bobo sont découverts par deux chasseurs à 20 minutes de la maison de ses parents, dans un bois de Darden.
Trois ans plus tôt, à 7:40, une voisine entend des cris alors qu’elle se rend au travail. Elle laisse un message sur le répondeur de la mère de famille : les cris venaient de chez elle.
Cinq minutes plus tard, Clint Bobo, le frère, est réveillé par les aboiements du chien. Par la fenêtre, il surprend sa soeur dans le garage en train de discuter avec un homme qu’il prend pour son petit ami ; il n’entend pas ce que dit l’homme. Clint Bobo appelle sa mère mais tombe sur le répondeur.
Cinq minutes plus tard, la mère sait que l’homme n’est pas le petit ami de sa fille et appelle le 911. Clint Bobo voit sa soeur et l’inconnu s’enfoncer dans les bois ensemble. C’est la dernière fois qu’elle sera vue vivante.
Cinq minutes plus tard, la mère parvient enfin à joindre son fils ; elle est sûre que l’homme qui est avec Holly Bobo n’est pas son petit ami. Clint Bobo lui dit l’avoir vue s’enfoncer dans les bois avec cet homme ; il sort dehors en urgence avec un fusil chargé et découvre du sang à côté de la voiture de sa soeur.
Avant de remarquer les restes de la jeune femme, un des deux chasseurs est tombé sur un seau ; il a confié à la télévision que son contenu l’avait profondément dérangé. Les autorités ont toujours refusé de révéler ce qu’il y avait à l’intérieur.
Le 28 août 2008, un homme attend Kanika Powell dans le couloir qui mène à son appartement du Maryland, et lui tire dessus à plusieurs reprises. Elle succombe à ses blessures le lendemain.
La veille, un homme frappe chez elle et lui demande s’il est bien chez Kanika Powell ; il a un colis à lui remettre. Elle refuse de lui ouvrir ; le livreur lui dit qu’il va chercher le colis, mais ne revient pas. Il ne laissera ni paquet, ni avis de passage.
Cinq jours plus tôt, un autre homme frappe chez elle et se dit du FBI ; il souhaite lui parler à propos d’une enquête en cours. Il montre brièvement son badge devant l’oeil de boeuf, mais elle ne voit ni nom, ni photo. Elle refuse de l’accueillir, il quitte les lieux ; par sa fenêtre, elle le voit marcher dans la rue, dans un sens, puis dans l’autre. Le soir, elle écrira un email à sa famille et à ses amies à propos de cette rencontre.
Le 12 novembre, alors qu’il patiente à un feu rouge, Sean Green est tué de neuf balles par un homme masqué ; à 30 minutes de l’appartement de Kanika Powell.
« Maris et femmes ont été abattus sur leur lit encore chaud, poignardés sous leur douche, électrocutés dans leur bain ou broyés contre leur porte de garage par leur propre voiture. » – J.G. Ballard, Sauvagerie (trad. R. Louit).
Le 25 février 2014, le corps d’Alan Jeal, 64 ans, est découvert nu sur la plage de Perranporth. La piste privilégiée par les autorités est celle de la noyade, bien que des blessures au torse, à la tête, et à la main droite aient été relevées. Ses écouteurs étaient enroulés autour d’une chaussette, elle-même enfoncée dans sa bouche.
La veille, vers 18:00, une caméra de surveillance de la ville de Wadebridge le filme en train de retirer de l’argent à un distributeur ; il prendra alors un premier bus vers Truro. Il y sera également aperçu avant de prendre un autre bus vers Newquay. Là, il inspectera d’abord le plan des lignes d’un arrêt de bus, puis restera assis 15 minutes. Plus tard, entre 20:23 et 21:00, il errera dans la ville déserte, toujours sur les trottoirs, aux limites de l’image, puis observera le plan d’un autre arrêt de bus avant de repartir à pied.
La dernière vidéo de lui vivant est prise par une caméra de Perranporth, à 22:30. Il traverse le haut d’une rue ; trois secondes à peine.
La veste imperméable retrouvée un peu plus loin contenait un portefeuille avec £95 et une photographie de lui âgé de 2 ans ; mais elle n’était pas de la couleur de celle qu’il portait lors de son voyage.
L’hiver dernier, un homme vivait dans le hall d’un immeuble plus bas dans la rue, pas le hall intérieur, mais la dalle en béton qui permet d’accéder à l’entrée. Il vivait là, à gauche des baies-vitrées, après quelques marches, à côté d’un supermarché. Il était arrivé à la fin de l’automne ; des gens passaient le voir. Progressivement, il s’était construit comme une chambre, avec une table de chevet, des caisses pour contenir ses provisions, et un matelas. Il vivait là.
En début de semaine, il n’y avait plus aucune de ses affaires. C’est comme s’il avait disparu (peut-être a-t-il disparu).
« Le chant est la Fin des Temps. Ils sentent la puissance de la voix humaine, la puissance d’un seul mot répété qui les enfonce davantage encore dans l’unité. Ils chantent pour une extase à détruire le monde, pour la vérité des prophéties et des merveilles. » – Don Delillo, Mao II (trad. M. Véron).
Le 13 juin 2012, à 4:30 du matin, une fillette de 9 ans se réveille à Feltonville. Un homme nu avec un masque vert lui touche la jambe ; elle crie, il l’enlève. Le père pense que les cris de sa fille sont dûs à un cauchemar, et découvre en allant dans sa chambre qu’elle n’est plus dans son lit ; il entend la porte d’entrée claquer.
À 6:30, la police est déjà sur les lieux quand la fillette revient en courant vers chez elle. L’homme l’a violée dans une rue voisine avant de la menacer de mort dans un parc si elle parlait de son agression ; il l’a ensuite relâchée.
La caméra de surveillance d’une pizzeria en bas de la rue filme l’entrée de l’homme dans la maison, où il reste 40 minutes, puis sa sortie avec la fillette. Mais la caméra est trop loin et de trop mauvaise qualité pour distinguer son visage.
Les autorités supposent qu’il connaissait la famille. Les relevés ADN n’ont rien donné.
(Il faut que j’aille plus loin, plus loin, en permanence plus loin, plus profond, ne jamais m’arrêter, toujours avancer dans le coeur de la chose à comprendre.)
En avril 2016, aux alentours des cinq heures du matin, Missy Bevers est retrouvée morte dans l’église Creekside, à Midlothian. Elle préparait la salle pour un cours de fitness. Son corps porte des traces de coups de poing et de coups de marteau.
Deux heures plus tôt, les caméras de surveillance de l’église enregistrent une personne déguisée en policier (avec équipement complet : casque, masque et gants inclus) déambuler dans l’église, ouvrant des portes au hasard, en refermant d’autres, sans paraître le moins du monde dérangée ou stressée par ses actes de vandalisme ou par sa présence en pleine nuit dans ce lieu désert. Elle tient dans sa main un marteau et en donne quelques coups distraits sur un mur. Elle a sans doute marché plusieurs heures ainsi avant de finalement tuer Missy Bevers.
Une heure plus tôt, les caméras de surveillance du magasin un peu plus bas dans la rue filment une Nissan Altima gris métallisé faire le tour du bâtiment au pas (allumant et éteignant ses phares à plusieurs reprises durant le trajet) puis stationner sur le parking, sous une pluie battante. Elle reste une trentaine de secondes garée avant de quitter le parking. Le conducteur est impossible à distinguer, et ne sortira jamais de la voiture. Le siège passager est anormalement reculé (touche presque la banquette arrière). La plaque d’immatriculation du véhicule est illisible.
La démarche de la personne déguisée filmée dans l’église rappelle celle du beau-père de la victime, en Californie au moment des faits.
« Une seule faute et tout s’écroule. Peu importe où on la commet. » – Juan Benet, L’air d’un crime (trad. C. Murcia).
Début septembre 2017, Kenneka Jenkins, une étudiante de 19 ans, est retrouvée morte dans le congélateur des cuisines d’un hôtel de Rosemont. La police a refusé de dire si le corps portait des traces de coups, et a conclu à l’accident.
On suit ses derniers instants grâce aux caméras de surveillance installées dans l’hôtel. À 3:25 du matin, on la voit sortir d’un des ascenseurs de l’hôtel, puis commencer à marcher dans un premier couloir. Elle est de toute évidence ivre, zigzague et se cogne contre les murs. Les couloirs sont déserts, personne ne la croise. Elle passe par les cuisines de l’hôtel, puis en ressort, bute contre la rampe d’un escalier qu’elle ne monte pas, boit à une fontaine à eau dans un coin isolé, puis fait demi-tour vers les cuisines. Là, elle monte un premier escalier, passe plusieurs double-portes dont une en bois, et on la retrouve sur les caméras de la pièce dans un coin de laquelle se trouve le congélateur. À 3:36, elle disparaît du champ et entre dans le congélateur, d’où elle ne réussira pas à sortir.
Les autres personnes filmées par les caméras circulent dans l’hôtel une heure plus tôt, et une heure plus tard.
On aperçoit Kenneka Jenkins dans une autre vidéo filmée par une femme, durant la fête à laquelle elle se trouvait juste avant sa mort, dans le reflet de ses lunettes de soleil. Elle appellerait à l’aide.
Les images prises par les caméras pourraient avoir été éditées pour couvrir un meurtre.
La frustration de posséder tous les éléments sans parvenir à les ordonner correctement, c’est cette sensation que je cherche.
Fin janvier 2013, Elisa Lam, une étudiante de 21 ans, disparaît dans un hôtel de Los Angeles. Deux semaines plus tard, des résidents signalent que l’eau a un goût étrange et qu’elle sort parfois noir du robinet. Son corps est retrouvé dans une cuve à eau sur le toit du bâtiment ; nu et en partie décomposé.
Entre-temps, la LAPD avait publié une vidéo prise par une caméra de surveillance de l’hôtel, située dans l’ascenseur. On y voit Elisa Lam pour la dernière fois. Elle entre dans l’ascenseur, appuie sur un bouton, puis s’y cache comme si quelqu’un la poursuivait, les portes ne se referment pas, elle sort sa tête dans le couloir, se cache à nouveau, les portes ne se referment toujours pas, puis elle ressort dans le couloir où elle fait différents pas et jeux de mains, rerentre, appuie sur les boutons de tous les étages, ressort, les portes ne se referment toujours pas, bouge les bras comme si elle discutait avec quelqu’un dans le couloir, quitte enfin les lieux pour de bon ; les portes se refermeront et se rouvriront trois fois ensuite sans que personne ne passe à proximité.
Elle tenait un blog, Ether Fields, dans lequel elle a écrit, le 24 novembre 2011 : « I prefer avoiding reality and just lurking (no chance of being disappointed) ».
Un livre est une illusion de toute-puissance. C’est un espace de complète liberté perpétuellement contraint par l’idée de cohérence.
Je participe d’un monde qui n’attend que d’être démoli (reconstruit).
J’ai rêvé que je photographiais des OVNIs depuis la baie-vitrée de mon salon.
« L’inspecteur a dû se dire que la seule personne qui ne pouvait pas être coupable, c’est l’homme qui habite juste devant l’endroit où il y a les corps. Alibi idéal. Puisque aucun criminel sensé n’irait enterrer ses victimes dans son propre jardin. » – Olivier Cadiot, Le Colonel des Zouaves.
Je ne savais pas trop comment en parler alors j’en parle comme je l’ai vécu.
Hier, sur une idée de Cécile, nous avons manifesté à Paris pour le premier mai. Je n’avais pas manifesté depuis longtemps. À Bastille, nous nous sommes étonnés de ne voir aucun CRS nulle part (comme ils l’avaient annoncé), ni dans la station de métro, ni aux sorties, ni sur la place. Nous avons aussitôt rejoint l’inter-fac avant que le cortège ne se lance, pour marcher avec les étudiants. Jusqu’au pont d’Austerlitz, toujours aucun CRS en vue ; cinq ou six camions seulement dans une rue parallèle. Le cortège a mis un certain temps à quitter le milieu du pont. Nous étions à environ 30 mètres derrière le groupe black bloc.
La tête du cortège a fini par bouger (lentement), et nous avons pu quitter le pont. Tout de suite, sur la gauche, vers le quai d’Austerlitz, j’ai remarqué un premier barrage. Je n’avais aucune visibilité sur la droite, vers le Jardin des Plantes. C’est le soir que j’ai appris qu’ils bloquaient la route de ce côté-là également. Après 200 mètres, tout le monde s’est arrêté ; nous nous trouvions sous l’arrêt de bus Gare d’Austerlitz. Jusque-là, l’ambiance était bonne, des chants, des fumigènes, quelques feux d’artifice. La foule était familiale, des personnes âgées, des enfants. Plus le temps passait, et plus nous comprenions que nous n’arriverions jamais place d’Italie. Puis, vers 16 h 30, les choses se sont compliquées.
De premiers gaz lacrymogènes ont commencé à nous gêner, mais nous sommes restés ; devant, tout le monde était en place. Puis d’autres gaz ont fini par nous toucher aux yeux, alors les premiers ont fait demi-tour. Nous nous sommes décalés sur la gauche, pour ne pas nous retrouver collés contre l’arrêt de bus. Une autre salve de gaz : cette fois les yeux brûlent pour de bon, on rebrousse chemin. La foule se replie sur elle-même, on convainc ceux dans notre dos qu’il ne faut pas rester là. On se dirige avec Cécile sur la droite, vers le quai d’Austerlitz, pensant que les barrages de CRS laisseront passer les manifestants perdus dans le nuage de fumée ; mais ils ne bougent pas.
À nouveau, demi-tour dans la foule. Certains glissent derrière les barrières pour rejoindre la voie express Rive Gauche. Il n’y a plus personne entre nous et les CRS qui descendent toujours le boulevard de l’Hôpital. Les gens sont perdus, ne savent plus dans quelle direction s’enfuir ; finalement on parvient en forçant à revenir sur le pont. On attend là que les choses se tassent, mais la situation empire, les CRS poussent toujours en gazant la chaussée, et nous sommes contraints encore une fois de faire demi-tour, et de quitter le pont. Où, là aussi, les CRS font barrage. On crie derrière d’avancer plus vite, mais les issues sont ridicules, au milieu certains manifestants passent en force et reçoivent des coups de tonfa sur le crâne. Finalement, on s’échappe par la droite vers le quai de la Rapée ; d’autres iront à gauche et se feront courser jusqu’à la Bastille. Sur le moment, je n’en savais pas plus que ça.
Il me reste cette foule silencieuse sur le pont, les yeux irrités par la fumée, retournant sur elle-même, comme ravalant sa propre force de contestation, empêchée par l’État d’exprimer sa colère, et revenant dans la honte vers son point de départ, où elle finira lavée par les canons à eau et les gaz lacrymogènes. Le sang-froid de se piétiner les uns les autres dans le calme ; la conviction que chaque recul contraint est un prochain coup de pied.
Le soir, longtemps, j’ai été en colère de constater le sort médiatique qui nous était réservé.
Rivage est un livre sur la multiplication des signes et l’incapacité du protagoniste principal à les déchiffrer.
« Les yeux du garçon s’ulcérèrent,
éclatèrent et tombèrent,
et les paupières se rejoignirent sur ce qui restait des globes. »
Incroyable, ce Golden State Killer. Le 30 décembre 1979, il tue un homme et une femme dans leur chambre en leur tirant dessus. Puis il nourrit son chien (qu’il avait amené sur les lieux du crime) avec des restes de dinde de Noël conservés dans leur réfrigérateur. Puis il pénètre par effraction dans la maison d’à côté. Enfin, il vole un vélo dans une troisième, avec lequel il quitte le lotissement (aucune nouvelle du chien).
Il lui arrivait de porter un masque de ski.
Souvent, des témoins signalent une voiture étrangement garée dans les parages peu avant les meurtres, ou un homme inconnu du voisinage en train de marcher ici et là, ou un appel téléphonique hostile reçutwitter aux alentours des vingt-trois heures.
Michelle McNamara, qui a enquêté 10 ans de son côté sur cette affaire, dit ça, que je trouve très pertinent (je souligne) : « For digital sleuths, a killer who remains a question mark holds more menace than a Charles Manson or a Richard Ramirez. However twisted the grins of those killers, however wild the eyes, we can at least stare solidly at them, knowing that evil has a shape and an expression and can be locked behind bars. Until we put a face on a psychopath like the Golden State Killer, he will continue to hold sway over us—he will remain a powerful cipher who triumphs by being just out of reach. »
« On trouva le corps dans un marais à la limite de la ville
à trente ou quarante mètres de la piste
le long du marais :
une jambe sortait de la boue. » – Charles Reznikoff, Témoignage (trad. M. Cholodenko)
Un roman policier dont le meurtrier serait l’océan. Un roman policier avec 254 victimes et 8 coupables. Un roman policier dans un labyrinthe dont la victime serait le Minotaure. Un roman policier sans crime mais avec 1876 meurtriers. Un roman policier sur Jupiter (space opera). Un roman policier dont la victime serait le blanc entre chaque paragraphe. Un roman policier dont le meurtrier serait l’État français. Un roman policier muet sauf les cris des victimes (67 femmes). Un roman policier durant la Seconde Guerre mondiale dont la victime serait Adolf Hitler. Un roman policier qui serait un recueil de poèmes.
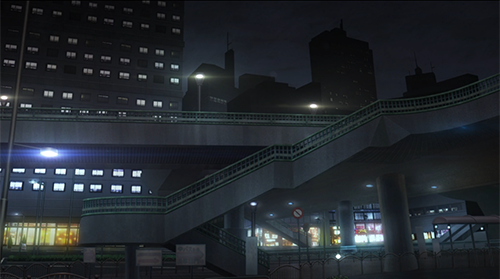
Un roman policier dont la résolution serait qu’il s’agit d’une biographie de Stendhal. Un roman policier fait de pages Wikipédia sélectionnées au hasard. Un roman policier écrit par une fillette de 5 ans avec 3 450 981 meurtres sanglants (décapitation, torture, cannibalisme, etc.). Un roman policier sans titre. Un roman policier disparu écrit en summérien par un parent d’Homère. Un roman policier jamais publié. Un roman policier publié dans une langue inconnue. Un roman policier jamais écrit et pourtant lu par 6 793 602 lecteurs.

« Toutes les choses qu’elle appréhendait par ses sens, elle ne les recevait que comme des objets susceptibles d’être interprétés selon le style expressionniste, et elle percevait, dans les choses de tous les jours, un monde de figures mythiques terrifiantes auxquelles elle croyait dur comme fer, bien qu’elle n’en parlât jamais à quiconque ; d’autre part, elle n’avait jamais soupçonné un instant que la pratique courante de la volupté pût modeler le monde réel. » – Angela Carter, Love (trad. A. Neuhoff).
Vient un moment à partir duquel le texte finit par imposer sa propre logique, son propre aboutissement. Vous êtes traîné de force par ce que vous avez mis en place, dans l’ensemble des éléments qui composent cet univers prédéfini. Par exemple (c’est le sujet qui m’occupe), un roman policier se terminera par l’arrestation du coupable, ou la fuite du coupable, ou la mort du policier, ou la mort du coupable, ou la mort des deux, ou l’arrestation du policier qui était en réalité le coupable, etc. Si on veut faire son malin, on ne choisira aucune de ces directions et on proposera une chute en queue-de-poisson, croyant avoir déjoué ses propres attentes. Mais on est en permanence victimes de la cohérence qu’on s’impose ; on n’est libres que d’aller au bout de ce qui a déjà été écrit.
Ça me rappelle cette brève discussion avec Fabien. Dans The Walking Dead (épouvantable série au demeurant), il y a une infinité de personnages secondaires et de figurants. Depuis le début, facilement plus d’une centaine, voire d’un millier. Et l’espace dans lequel ils évoluent est vaste (globalement, la Terre), même si tout se passe dans le voisinage d’une Atlanta en ruines. Il est étrange qu’aucun de ces personnages secondaires n’ait encore découvert une porte de sortie, un remède au virus, un refuge où attendre que les choses s’arrangent (décliner à loisir) ; pourquoi sont-ils tous à ce point agglutinés aux personnages principaux ? Pourquoi se refuse-t-on toujours de nouvelles voies de progression pour les intrigues mises en place ; davantage de décalages, de heurts. Pourquoi un personnage secondaire n’aurait-il pas le droit de s’en sortir, laissant les personnages principaux dans la mélasse de leur intrigue centrale désormais inutile. Savourant sur son transat un petit mojito tandis que ses anciens leaders trucident profusion de zombies au péril de leurs vies tout en déclamant devant des foules attentives d’inspirants discours réunificateurs.
« Il a fallu marcher.
C’est une bonne manière d’oublier ce qui précède, à chaque pas on se lave d’un instant du passé, à force il ne reste rien en arrière, on traverse de nouveaux paysages, on descend vers la plaine. » – Olivier Cadiot, Un nid pour quoi faire.
Ballard mentionne La Boîte noire, un ouvrage dirigé par MacPherson, et qui consignerait les derniers mots tenus par des pilotes avant le crash de leur engin (avion, jet, fusée). C’est un livre qui n’existe pas (je ne l’ai pas trouvé).
Il décrit au plus juste les espaces bitumeux ; c’est un talent qui procède de l’obsession.
Décidément, toujours dans le même livre, Ballard évoque brièvement Ann Quin (Berg et Trio en France) pour conclure : « Finalement, elle s’avança dans la mer au large du sud de l’Angleterre et s’y laissa engloutir ».
Ce soir, je me suis préparé un pad thaï. Je n’ai pas assez fait cuire les nouilles de riz. J’ai remplacé la pâte de tamari par du jus de citron.
« Tous les désastres – tremblements de terre, accidents d’avion ou d’automobile – semblent révéler pendant un bref instant les formules secrètes du monde qui nous entoure, mais une catastrophe dans l’espace réécrit les règles du continuum lui-même. » – J. G. Ballard, La Foire aux atrocités (trad. F. Rivière).
Rivage sera de toute évidence un livre sur le Mal ; je l’espère, dans son incompréhensible substance. C’est-à-dire brouillon, confus, dispersé sur des strates insaisissables. Un livre dans lequel la trame principale sera toujours secondaire. Un film sans spectateur. Une mine oubliée sous la terre.
Dans Un fait divers : « On marche devant soi les mains tendues, et sans distinguer de détail. Un jour peut-être des formes palpables viendront sous vos doigts se glisser. »
« Je veux donner aux choses un sens
qu’elles n’ont pas. » – Yannis Ristos, Journal de déportation (trad. P. Neveu).
Ce soir, pendant près de deux heures, j’ai lu mes emails archivés entre fin 2008 et fin 2016. Des emails que j’avais oubliés, pour la plupart. Je les ai échangés avec des personnes à qui aujourd’hui je ne parle plus. Parfois, j’avais même oublié nos discussions. Des gens que j’ai aimés, et à qui je ne parle plus. Des amis, à qui je ne parle plus. D’autres inconnus, de passage, à qui je ne parle plus. Pour être honnête, ça m’a rendu un peu triste. J’ai déjà oublié pourquoi ces conversations se sont arrêtées ; je n’ai pas la rancoeur tenace. Je ne me souviens même plus des causes des différents. Je ne ressens plus rien contre personne. Tout s’est très vite effacé. Je vois simplement des relations avortées et, d’une certaine façon, je me sens blessé. Je vois que j’ai été injuste souvent, arrogant, quand je vois comment je parlais aux autres, je me demande pourquoi eux continuaient à me parler. Il y a des noms, parfois les adresses email restent d’actualité, parfois je sais ce que sont devenues précisément certaines de ces personnes, depuis. Simplement, un jour, on arrête d’écrire, le silence s’installe, et on en revient jamais.
Il y a des milliers de correspondances absurdement tristes au fond de nos ordinateurs. Et on continue à les utiliser comme si de rien n’était. On ne se rend sans doute pas compte de la détresse de nos machines (notre détresse).
Surtout, je me rends compte qu’avant, on m’écrivait, et que maintenant, on ne m’écrit plus.
De Rousseau à Lovecraft : la terrible angoisse de l’honnête narrateur (sous-titré : « mais si, vraiment, faut me croire, je vous jure, c’est arrivé comme je le dis ! »)
Dernièrement, il se trouve que j’ai racheté des livres déjà lus (L’Apocryphe, Leçon de choses, Chuchotements dans la nuit, etc.) Considérant mes finances, cette amnésie est plutôt malvenue.
Je n’ai jamais vraiment tenu à garder le secret autour de mes projets en cours ; ce n’est pas ma manière de fonctionner. Ça m’est simplement pénible de dire que je travaille sur quelque chose, qui finalement ne verra jamais le jour, car j’ai l’impression de mentir. Mais je n’ai rien à cacher.
J’ai marché 45 minutes en ville jusque dans une ferme où un maraîcher expliquait qu’il fallait jardiner avec les mauvaises herbes ; j’ai vu passer une musaraigne. À d’autres périodes de l’année, il a des crapauds, des hérissons, des serpents. De l’ail et de l’échalote commençaient à sortir de terre. Il y avait plein de petits jardins individuels, deux chevaux, et un pigeon particulièrement mal en point (à côté des chevaux). De retour chez moi, j’ai fait rissoler trois pommes de terre dans du beurre, avec deux oeufs sur le plat. J’ai salé les pommes de terre, et j’ai mangé mon plat devant un film à propos du quotidien d’un poète amateur américain. Je me suis demandé : où faire pousser des légumes ?
J’aime les noms des autres : Quintane, Cadiot, Clouette, Echenoz, Diderot, Kafka, Ernaux, Blanchot, des Forêts, etc. Et le mien, Leclerc, qui sonne comme une enseigne de supermarché.
« En revanche, si vous ne croyez pas aux fantômes, un guéridon peut s’envoler sous vos yeux, fracasser toute une rangée de DVD, assommer votre soeur au passage et se poser tranquillement sur le lino après avoir fait le tour du propriétaire, vous y trouverez toujours une explication rationnelle. » – Nathalie Quintane, Descente de médiums.
L’auteur aime se faire plaindre. Quand il n’est pas publié, il se plaint de n’être pas publié. Quand il est publié, il se plaint de ne pas vendre assez ou de ne pas avoir assez de presse, assez de reconnaissance. Quand il a de la presse et qu’il vend bien, il se plaint de ne pas vendre plus, et de n’être pas plus estimé (reconnaissance internationale). Quand la qualité de ses livres ne tient pas la longueur, il se plaint qu’on le lui dise. L’auteur sait très peu apprécier les choses comme elles viennent, car il attend celles qui ne sont pas encore venues. La plupart du temps, l’auteur oublie qu’il n’écrit pour rien, car il est persuadé d’écrire pour quelque chose (la gloire, la fortune, la reconnaissance). L’auteur se place toujours dans une logique commerciale ou sociale qui le ruine ; il aimerait que l’écriture lui assure tout ce qu’il n’a pas eu à côté. L’auteur annonce toujours qu’il n’écrira plus, pour continuer à écrire. Quand il n’écrit plus, l’auteur dit qu’il écrit (sinon, que fait-il). Il se prétend désintéressé tant qu’il n’a pas d’intérêt à y trouver. Il n’écrit jamais sans arrière-pensée. (Autoportrait.)
Il faut se contenter d’espaces de parole à la marge, mais possédés jusqu’au dernier recoin. Crier dans des placards. Je ne fais aucune publicité pour mes Relevés. C’est à peine si on en trouve l’url en ligne. Parfois elle circule ici et là, chacun la conserve dans ses favoris, je crois. C’est un site comme un secret ; c’est ce que j’aime imaginer.
On voudrait le confort sans la bourgeoisie.
On se croit artiste ; on est tout juste fonctionnaire.
« Je maintiens que le mort est celui qu’on enterre et celui qu’on oublie, que se substitue à des bras, des jambes, oeil et foie, un ensemble vide. » – Nathalie Quintane, Grand ensemble.
Quand même, parfois, quand on en écoute certains ou certaines parler à la télévision, on leur éclaterait bien le crâne entre deux grosses pierres. Je veux dire, vraiment fort, en faire de la bouillie, faire de ces têtes creuses une masse informe et inerte, et on pourrait s’en féliciter, d’avoir fait taire ce bruit, on débarquerait sur les plateaux avec nos pierres comme des cymbales, et on éclaterait à tout va, on ferait régner le silence, et les antennes ne rendraient plus aucune émission ; on aurait la paix.
Encore une fois, à quel point il faut être fort pour ne pas céder à la violence qu’on nous impose, quotidiennement, l’irrespect, l’arrogance qu’on subit, la douleur d’être en permanence rabaissés.
Exploiter les espaces abandonnés à cause de leur trop grande proximité ; à l’abandon d’être toujours parcourus de la même manière. Qui arpente encore les villes avec la curiosité d’un chercheur d’or.
« La raison, gros malin, qu’on ne peut pas tout raconter à la fois, et qu’il y a toujours un moment où une histoire bifurque, revient en arrière ou fait un bon en avant, ou se met à proliférer ; alors on dit Reprise, pour que les gens sachent bien où ils en sont. » – Alain Robbe-Grillet, Projet pour une révolution à New York.
Par exemple, à terme, je pense qu’il sera de nécessaire que nous nous déguisions tous en CRS. Il y a des costumes à prix abordable ici et là. Un déguisement de CRS, c’est l’assurance d’être sur tous les bons coups, même si l’emploi est dur (entend-on), même si les risques sont grands (dit-on), on voit du pays, on tabasse sans contrainte, on discute avec nos amis derrière des boucliers en plexiglass, on rencontre des gens, on peut lancer des grenades et parfois même tomber dans la boue (et rire), puis être relevé par notre collègue qui connaît la valeur des mots honneur, patrie, et fraternité. On déambule comme ça dans les champs, dans les villes, avec nos amis eux aussi CRS, on fait la ronde et à l’intérieur des rondes on tape des inconnus, c’est une chance, il faut l’admettre, on ne peut pas taper des inconnus dans toutes les rondes, pas dans celles que les enfants font en maternelle, par exemple. On rentre chez soi le soir et on a la certitude d’avoir passé une bonne journée, on regarde la télévision où le premier ministre de notre pays nous félicite, et la nuit on rêve à une médaille. À terme, on aurait tous des médailles si on était tous déguisés en CRS. On ferait des grandes rondes sans plus personne à taper, et on dériverait comme ça, avec nos boucliers en plexiglass, dans des nuages de fumée, partout dans le pays, félicités, aimés, heureux d’être unis tous ensemble, à l’infini, enfin débarassés de la vermine militante (soulagement).
Et on aurait des tonfas, et des fusils. Quelle vie on aurait (sanglots).
On obéirait à la loi, on ferait usage de la force.
« Quiconque est entouré depuis l’enfance par des étendues immenses et plates doit rêver alternativement d’explorer deux paysages : l’un continuellement visible mais jamais accessible, l’autre toujours invisible même si on le sillonne tous les jours. » – Gerald Murnane, Les Plaines (trad. B. Matthieussent).
Ma grand-mère a rêvé qu’un homme voulait tuer tout le monde.
Rivage se construit plus ou moins ainsi : j’ouvre une porte sans savoir ce qu’il y aura dans la pièce. Parfois il peut y avoir un téléphone. Avec ce téléphone, j’ai plusieurs choix : ne pas le toucher, le casser, appeler un ami pour lui dire que je suis perdu, appeler un étranger pour lui dire que je vais venir le tuer, que quelqu’un m’appelle pour me dire que je suis en danger, que quelqu’un m’appelle et ne dise rien, que quelqu’un m’appelle mais ce soit trompé de numéro, etc. Il y a beaucoup d’options. Mais il peut aussi bien y avoir un couteau. Avec ce couteau, je peux : m’ouvrir la gorge, creuser dans le mur pour m’échapper, le lancer, observer mon reflet dans sa lame, etc. C’est très long de réfléchir à toutes les options à chaque fois ; d’autant que je ne veux pas forcément choisir la meilleure. Je veux choisir la plus perturbante. Et à la fin, il faut faire sens (je n’ai aucune idée d’où je vais ; j’espère découvrir un secret).
J’aime : les bourdons, les ragondins, les baleines, les rouges-gorges, les chiens.
« Le village est situé dans une vallée parfaitement circulaire, dont la circonférence est d’un quart de mille à peu près, et complètement environnée par de jolies collines, dont les habitants ne se sont jamais avisés de franchir les sommets. Ils donnent d’ailleurs une excellente raison de leur conduite, c’est qu’ils ne croient pas qu’il y ait quoi que ce soit de l’autre côté. » – Edgar Allan Poe, Le Diable dans le beffroi (trad. C. Baudelaire).
Le Cottage Landor de Poe est du Robbe-Grillet avant l’heure.
Prenez une pièce dans laquelle vous avez l’habitude de vous assoir. Répérez tous les endroits de cette pièce où vous ne vous asseyez jamais, où même vous ne vous tenez jamais. Installez-y vous et il ne s’agira plus de la même pièce. Parfois même, vous aurez l’impression de ne plus être chez vous. Il y a toujours chez soi autant d’intérieurs étrangers.
C’est très peu, un livre. À peine vous l’avez écrit, et c’est déjà comme s’il n’avait jamais existé.
La première image qui me vient à l’esprit en regardant le journal télévisé, c’est celle d’élèves incapables de formuler correctement une problématique (et donc, d’y répondre).
« Des hommes meurent la nuit dans leurs lits, tordant les mains des spectres qui les confessent, et les regardant pitoyablement dans les yeux ; – des hommes meurent avec le désespoir dans le coeur et des convulsions dans le gosier à cause de l’horreur des mystères qui ne veulent pas être révélés. » – Edgar Allan Poe, L’Homme des foules (trad. C. Baudelaire).
C’est un livre difficile à écrire car je suis forcé d’avancer au coup par coup, au contraire de La Ville fond, dans lequel je me répandais largement. Ce qui repose la même question : pour écrire un livre, faut-il avoir écrit le précédent ?
Ultra-Proust apparaît deux fois sur mon ticket de caisse ; pourtant, il ne m’a rien coûté.
Dans le chapitre 900 de One Piece, le Thousand Sunny coule sous les boulets du navire de Charlotte “Big Mom” Linlin, avec à son bord le capitaine et personnage principal de l’aventure. Je me suis pris un instant à penser qu’il était bien mort, et que là s’arrêtait pour lui la course au One Piece ; dans la seconde moitié de Grand Line, face à un Yonko. Avant que le genre même du livre ne rattrape mes espoirs narratifs, et me force à penser qu’une ruse se cache quelque part. Qu’il ne peut pas être mort.
« J’aime m’attarder à une bifurcation, et, comme on le sait, un labyrinthe est d’abord fait de bifurcations ; j’aime savourer la délicieuse incertitude de l’erreur ; car si l’on sait que l’un des deux chemins représente l’erreur, il n’est pas certain que l’autre ne la représente pas aussi. » – Giorgio Manganelli, Le Marécage définitif (trad. D. Férault).
Aujourd’hui, aucun vent ne dissipera le brouillard qui est tombé sur la ville.
Après son divorce, mon père allait dans des bars de la ville voisine pour écrire des nouvelles policières. Certaines ont remporté des prix.
Parfois l’évidence de la mort de mon grand-père me frappe ; cette absence résolue, ce manque permanent, la certitude que plus jamais nous ne pourrons le croiser aux endroits où d’habitude il nous attendait.
« D’innombrables fois, les hommes moururent tous jusqu’au dernier : par sa seule existence, l’homme créait le déluge, le feu des volcans, la peste ; et chaque fois le dernier homme jetait derrière lui les pierres qui devaient donner naissance à de nouvelles générations d’incurables déments ; la folie se mit dans les pierres et elle y est restée – les pierres ne sont-elles pas trop immobiles ? – comme elle est restée dans notre semence. Or la démence appelle la démence, donc la littérature. » – Giorgio Manganelli, Discours de l’ombre et du blason (trad. D. Van de Velde).
Si je trouve une idée pour un développement futur, je me refuse à l’écrire pour éviter l’ennui préalable à la résolution des prochaines aventures.

Les choses se mettent en place à peu près comme je l’imaginais au début du projet (angles morts, détails essentiels, fausses connexions). Je me dirige vers ce que Rivage doit être.
« il ne reste rien, rien que l’obscurité sous la lourde pression de la terre, et ce hurlement, car lui, ce hurlement, persiste, demeure, ils sont là, près des tombeaux écroulés, ils sont là, disloqués, morcelés, rongés par les acides, coincés dans la terre, mais dans leurs bouches grandes ouvertes le hurlement n’a pas cessé, il a d’étrange façon persisté, même brisé en morceaux il a traversé les millénaires, ce hurlement de terreur » – László Krasznahorkai, Seiobo est descendue sur terre (trad. J. Dufeuilly).
Je voudrais élaborer une énigme sans solution mais aux multiples pistes.
Réécrire son propre projet sans en faire une copie de ce qu’il était est une expérience particulièrement étrange (et intéressante).
Quand je sors dans la rue le weekend, j’ai toujours l’impression d’être seul. Rennes est une ville étrange parfois, dans laquelle tout le monde semble avoir disparu (peut-être tout le monde a-t-il disparu).
J’allais écrire quelques banalités sur le style et la littérature, et me suis finalement abstenu.
Hier, sur son site, Chevillard a écrit : « Bientôt, quand nous aurons quelque chose à dire, empêchés par la tyrannie de la bien-pensance […] » La tyrannie de la bien-pensance. Il n’y a même plus besoin d’être d’extrême-droite pour raconter des conneries et utiliser des expressions qui n’ont aucun sens. Ainsi, la tyrannie de la bien-pensance.
Je pensais jeter Rivage. Il semblerait finalement que non (pour l’instant).
C’est en allant échanger mon lave-linge que j’ai remarqué voir moins bien de loin quand je ferme mon oeil droit.
J’ai envoyé ma première version de La Ferme des mastodontes aux gars ce matin. J’ai travaillé cette traduction en avançant un peu dans le noir, bien que d’aucun jugerait le texte facile, sachant pertinemment que je n’y connais rien, que c’est un exercice face auquel je me présente comme un amateur complet. J’espère surtout lui avoir rendu en français ce qu’il m’a fait en anglais. On verra.
Hier soir, sans raison particulière, je me suis retrouvé sur la page Wikipédia de Nordahl Lelandais. En bas de la page, il y a un tableau récapitulant « vingt enquêtes pour disparition inquiétante » dans lesquelles il pourrait être concerné. On croirait lire La Partie des meurtres de 2666, mais dans six départements français. Untel disparaît en marchant en pleine rue, un autre en prenant sa pause un midi, un troisième au volant de son 4x4, leurs corps parfois retrouvés dans des cours d’eau, parfois non. Ceux qui se volatilisent en passant l’angle d’un mur. Combien comme ça peut-être dépecés sous la terre ?
« Posséder le monde sous forme d’images, c’est précisément refaire l’expérience de l’irréalité et de l’éloignement du réel. » – Susan Sontag, Le Monde de l’image (trad. P. Blanchard).
J’aimerais que chacun de mes livres soit comme une énigme dont la solution ne peut se trouver qu’au dehors d’elle-même. Des livres qui ne sont que des livres en creux, et qui se contentent toujours d’aborder, jamais de conclure. Des livres qui ne seraient que les contenants d’autres livres jamais écrits. Des livres comme des trous aux bords desquels on vous inviterait à sauter.
Rivage est appelé en urgence en pleine nuit sur une affaire de meurtre. Il prévient son assistant qui fait préparer l’hélicoptère. Il se passe dans l’hélicoptère plusieurs péripéties de second ordre (incluant le pilote). Au port, Rivage découvre le corps de la femme, enroulé dans un tapis. Les professionnels encerclent le cadavre étendu sur le sol. Rivage enfonce son poing dans la bouche de la femme et en sort une clé, qu’il range dans sa poche. Un secouriste déclare en pointant du doigt la baie que c’est le pêcheur qui a retrouvé le corps dans la baie. Un pompier accuse le pêcheur du meurtre. Dans la confidence, Rivage demande à son assistant de faire surveiller le pompier. Puis tout le monde repart ; le pêcheur dans l’estafette ; le corps dans un camion frigorifique.
Il faut sans cesse tester les possibilité que suppose le texte à venir. Souvent le problème ne vient pas des personnages, ni de l’intrigue, ni du ton, mais d’une épine qui désaccorde les trois mis ensemble ; comme ce jeu d’enfant dans lequel on doit faire coïncider le haut de l’animal avec son bas (même si parfois une autruche-éléphant s’accorde bien).
Au cap qui surplombe la baie, deux meurtriers sortent de leur cachette (un buisson). Ils tiennent, l’un par les épaules, l’autre par les jambes, un corps de femme enroulé dans un tapis. Ils accomplissent un mouvement de balancier rythmé par leur décompte puis jettent le corps dans la baie. L’eau tremble à peine sous l’impact, et le corps préalablement lesté s’enfonce lentement dans les profondeurs relatives. Les deux meurtriers s’assoient ensuite sur une pierre et allument une cigarette. Le premier demande au second ce qu’ils font maintenant. On attend, répond-il.
Le Mont Analogue est de ces livres inachevés qui souffrent absolument de leur inachèvement. Sans doute vaut-il mieux relire Les Aventures d’Arthur Gordon Pym (quel livre !) ou L’Île mystérieuse, à l’occasion.
Soudain, Carlos serait en slip. Il me ferait comprendre qu’il se sent beaucoup plus libre de ses mouvements dans cette tenue. Il connaitraît bien mieux le manoir de Sanchez que moi, et je le suivrais en courant. Il y aurait des gardes armés que Carlos brûlerait avec ses cocktails molotov. Les gardes prendraient feu et hurleraient qu’ils sont en feu. Leurs corps fumeraient un moment puis disparaîtraient. La majeure partie de cette mission secondaire serait de l’infiltration. Par exemple, on aurait à grimper aux palmiers. Mais évidemment, à cause des cocktails molotov de Carlos, le parc de Sanchez prendrait feu, et on serait vite repérés par les gardes, qui encercleraient le parc. Après un moment de tension, Sanchez se montrerait sur la terrasse de son manoir, et il se mettrait lui aussi à nous jeter des cocktails molotov en nous hurlant dessus. Putain de Sanchez, dirait Carlos en courant dans tous les sens pour éviter les tirs des gardes de Sanchez. Carlos partirait quelque part dans le parc et je ne le verrais plus. Bon, penserais-je. C’est sans doute à moi de jouer.
« Bientôt les caves seront à sec et que deviendrons-nous ? Les uns crèveront lamentablement, les autres se mettront à boire d’infâmes potions chimiques. On verra des hommes s’entre-tuer pour une goutte de teinture d’iode. On verra des femmes se prostituer pour une bouteille d’eau de Javel. On verra des mères distiller leurs enfants pour en extraire des liqueurs innomables. Cela durera sept années. » – René Daumal, La Grande Beuverie.
Je proposerais à Carlos qu’on aille rendre visite à Sanchez. Par rendre visite, je voudrais évidemment dire : exploser son manoir au bazooka. Carlos serait d’accord mais aurait des réserves sur le bazooka. Le trus de Carlos serait plutôt les cocktails molotov. Carlos serait du genre pyromane. On conviendrait finalement que je pourrais tirer au bazooka et qu’il pourrait lancer ses cocktails molotov. On roulerait sur ma moto de sport à deux cents kilomètres-heure dans la ville tout en slalomant entre les voitures et les camions. Carlos me tiendrait bien agrippé par la taille, et je sentirais sa joue posée contre mon dos. Carlos, penserais-je. Le manoir de Sanchez serait un peu à l’écart de la ville, entre la plage et la montagne. Pendant le trajet, je recevrais un appel de mon commanditaire, mais ne pourrais pas lui répondre. On arriverait finalement au manoir de Sanchez. Avant de partir venger Carlos, j’écouterais le message vocal de mon commanditaire. C’est Dino, dirait mon commanditaire. J’ai entendu dire que Sanchez voulait descendre Carlos, parce que Carlos aurait mis deux balles dans la tête du fils de Sanchez. Apparemment, ça aurait commencé parce que Sanchez aurait menacé de descendre la mère de Carlos, et Carlos l’aurait pas supporté. C’est Manuel qui m’a raconté tout ça. Rappelle-moi. Je regarderais Carlos debout devant moi avec ses cocktails molotov. Carlos, penserais-je à nouveau en fermant le clapet de mon téléphone.
Cette nuit, j’ai rêvé qu’une bête genre grosse mouche me volait dans la nuque, comme pour m’agresser ou me piquer. Je me suis réveillé dans l’instant, persuadé qu’une bête genre grosse mouche me volait dans la nuque. Je n’ai rien trouvé.
(Désormais, on remercie les autres de lire nos livres. Quelle pratique étrange, quand on y pense.)
« Quoiqu’il en soit : chaque fois qu’il partait de chez lui, loin de la maison de ses parents, au village de son enfance, pour traverser les prés, les prairies et les champs et, coupant à travers les derniers vergers, monter jusqu’à l’orée de la forêt et « se mettre au diapason » en écoutant les feuillages aux sonorités si diverses – la lisière de la forêt était en effet constituée principalement de feuillus –, il le faisait et l’entreprenait avec la conscience ou si vous préférez l’illusion d’une mission supérieure. » – Peter Handke, Essai sur le fou de champignons (trad. P. Deshusses).
Je trouverais Carlos dans sa cave avec un bâillon dans la bouche. Je lui enlèverais le bâillon et il me dirait qu’ils sont encore là. Qui ça ? dirais-je. Les gars de Sanchez, répondrait-il. Je dirais à Carlos que je reviendrai le détacher plus tard et je partirais explorer son manoir. Les gars se Sanchez seraient au premier étage en train de jouer à la console sur l’écran plasma de Carlos. Ils auraient prévu d’achever Carlos après leur partie. Je les surprendrais en pleine partie et les exploserais avec mon bazooka. L’explosion ferait un énorme trou dans le mur, comme si un pan entier du manoir venait de disparaître. Je verrais ma moto de sport garée devant chez Carlos. Elle défonce, ma moto de sport, me dirais-je, le canon du bazooka calé sur l’épaule. C’est alors qu’un type du genre connard en short s’approcherait de ma moto et la volerait. Comme je ne voudrais pas l’abîmer avec mon bazooka, je sortirais mon fusil de précision et mettrais une balle dans sa tête à une distance démentielle. Le type en short volerait dans les airs et roulerait ensuite en étoile de mer jusque sur le flanc de la montagne. Ma moto de sport continuerait à rouler en ligne droite toute seule jusqu’à percuter un poteau électrique. Je retrouverais Carlos dans sa cave et lui dirais qu’un type en short a essayé de voler ma moto de sport. Détache-moi, me dirait Carlos. Putains de dégénérés, dirais-je en détachant ses liens.
Cécile a allumé un feu. Ma grand-mère prépare un bouillon de vermicelle pour son amie. Elles parlent du film qu’elles ont vu au cinéma cet après-midi.
« C’est donc dans le même état du ciel, de l’eau, le même état de la lumière, de la couleur de la lumière, de son intensité, que l’oeil contrôle au travers des vitres, tandis qu’au loin une petite embarcation navigue d’une anse à l’autre et que s’imprime le pointillement assourdi du moteur à deux temps auquel se fie l’homme à la barre, raide dans son ciré et son suroît jaune serin, tirant traditionnellement sur sa pipe. » – Claude Ollier, L’Échec de Nolan.
Il irait sans dire que mon commanditaire serait tout sauf ravi d’apprendre que je n’ai aucune photo de la tractation entre ses concurrents. Il ne me paierait pas et menacerait même de me descendre sur le champ. Finalement, je m’en sortirais par une pirouette scénaristique un peu facile mais que je ne parviendrais pas à comprendre. Il n’y aurait aucune raison qu’il me laisse en vie, et pourtant il le ferait. Dehors le soleil serait à son zénith, et j’enfilerais une chemise à motifs de palmiers. Elle m’irait vraiment bien. Je marcherais un peu dans la ville sans raison particulière. Je ne saurais plus où est ma voiture de sport. Sans doute l’aurais-je oubliée chez mon commanditaire, ou dans le garage de mon manoir. Parfois je sortirais mon bazooka dans la rue et les gens fuiraient et hurleraient autour de moi. Je ne tirerais même pas, je me promènerais simplement avec mon bazooka et ma chemise à palmiers. Il ferait beau. Ça serait une journée idéale pour sortir mon bazooka. Un type en moto de sport arriverait face à moi sur la route. Je lui tirerais dessus une roquette de mon bazooka, sans causer le moindre dommage à la moto. Le type s’envolerait dans les airs et retomberait des dizaines de mètres plus loin après avoir rebondi comme une balle sur le bitume. Les flics seraient aussitôt alertés mais le temps qu’ils arrivent j’aurais déjà disparu. J’enfourcherais la moto de sport rouge et recevrais un appel de Carlos. Allo Carlos, dirais-je tout en démarrant la moto. Apparemment, il se serait encore mis dans la merde, et aurait besoin de mon aide. Sacré Carlos, me dirais-je après avoir raccroché, tout en traversant la ville à deux cents kilomètres-heure.
Après le chargement, je me retrouverais encore une fois pris dans une cinématique soporifique au possible où les concurrents de mon commanditaire discuteraient des marchandises et dévoileraient des malettes remplies de billets. Je serais accroupi derrière une caisse en bois avec mon bazooka dans les mains. Mon bazooka dépasserait très largement au-dessus des caisses, mais personne ne le remarquerait. De près, la caisse en bois aurait un rendu vraiment dégueulasse, et parfois mon bazooka la traverserait sans la briser. J’aurais envie de passer la cinématique, mais cela se révélerait impossible. Je pourrais simplement pivoter sur moi-même accroupi derrière la caisse, avec mon bazooka. À la fin de la cinématique, les concurrents de mon commanditaire partirait sur un hors-bord. Je voudrais leur tirer dessus avec mon bazooka, mais cela s’avèrerait impossible. Une fois qu’ils seraient partis suffisamment loin pour que je ne puisse plus les rattraper, je pourrais enfin bouger. Les bandits de l’entrepôt me verraient sortir de derrière la caisse en bois, comme s’ils avaient su que j’étais là depuis le début, et ils se mettraient à me tirer dessus avec des Kalaschnikov. Le bazooka serait tout sauf approprié pour ce type de combat rapproché. Je chercherais une autre arme dans mon inventaire mais ne trouverais que mon appareil-photo. Quelle merde, me dirais-je en évitant les balles. Je prendrais pas mal de dommages mais remarquerais que les bandits visent vraiment comme des pieds. Je profiterais que l’un d’entre eux fasse l’erreur de se mettre au corps à corps pour l’exploser franchement avec mon bazooka. Je prendrais sa Kalashnikov et arroserais beaucoup plus aisément les bandits restants, jusqu’au dernier. Je regarderais autour de moi et éprouverais une certaine satisfaction. J’estimerais la mission terminée. Je remarquerais alors avoir oublié de prendre la moindre photo.
(Nos appartements sont si mal isolés qu’on aurait parfois aussi vite fait d’installer nos radiateurs directement dans le jardin.)
« Pour les Herreros, le choix était simple, entre deux morts : la mort tribale ou la mort chrétienne. La mort tribale, elle, avait un sens, la mort chrétienne, aucun. Cela semblait être un exercice dont ils n’avaient pas besoin. Mais pour les Européens, couillonnés par leur propre couillonnade de petit-enfant-Jésus, ce qui se passait chez ces Herreros, c’était aussi impénétrable que ces histoires de cimetières d’éléphants, ou les lemmings allant se noyer dans la mer. » – Thomas Pynchon, L’arc-en-ciel de la gravité (trad. M. Doury).
Sans mon bazooka, les choses s’avéreraient beaucoup plus complexes que prévues. Je ne parviendrais jamais à mémoriser les trajectoires des gardes à l’intérieur de l’entrepôt, me ferais bêtement intercepter, et recommencerais systématiquement mon parcours depuis le début, ce qui se révélerait particulièrement irritant et décourageant. L’envie serait grande d’aller contre les règles imposées par mon commanditaire et de sortir mon bazooka. Une fois, au terme d’un parcours particulièrement périlleux à la trajectoire millimétrée, je verrais presque le terme de ma mission, mais, à cause d’une bête erreur, sans doute l’effet du stress, la tension, enfin peu importe, il se trouve que je ferais un faux pas qui, une énième fois, me mettrait dans le champ de vision d’un garde, qui ouvrirait alors grand la bouche et les yeux et qui verrait un point d’exclamation s’afficher au dessus de la tête, puis qui m’interpellerait. S’en serait trop, je ne pourrais plus résister, et sortirais mon bazooka. Comme je l’expliquerais plus tard à mon commanditaire, aussi près du but, c’est en effet dommage, même idiot, mais je n’avais pas non plus tout mon temps, et il savait très bien que je déteste ce type de mission d’infiltration. C’est au bazooka que je me sens le plus à l’aise. Après avoir explosé le premier garde avec mon bazooka, j’en exploserais encore une dizaine d’autres en veillant à économiser au mieux mes roquettes. Le FBI serait aussitôt à mes trousses mais heureusement le chargement suivant les ferait partir.
Il y a des histoires à raconter avec des moyens dont tout le monde se fout.
Je suis à Dinan depuis samedi, où ils n’ont pas internet à cause d’un raccordement électrique manquant. Le rythme ici est étrange. Je dors dans une chambre d’ami. Je relis de vieux mangas que j’adorais adolescent et que là je trouve médiocres. Il y a du brouillard ; il pleut parfois. Dans le salon, seul, j’attends que les jours passent.
J’ai perdu mes clés de voiture, quelque part à Matignon, sur un parking de supermarché, ou dans une rue quelconque, sans m’en rendre compte. Quelqu’un là-bas les trouvera sans doute, sans pour autant parvenir à démarrer la moindre voiture.
J’ai pensé à beaucoup de choses sur la route en allant récupérer le double auprès de mon père. Beaucoup de choses du passé, je ne sais plus précisément lesquelles.
« Il écarta les cheveux qu’il avait dans la figure, monta le volume de la radio, alluma une Kool, s’enfonça dans son siège en position avachie pour rouler tranquille et observa la lente disparition de toutes choses, les arbres et les fourrés sur le terre-plein central, les dépôts des bus scolaires jaunes sur Palms, les lumières dans les collines, les panneaux au-dessus de l’autoroute qui vous disaient où vous étiez, les avions descendant sur l’aéroport. » – Thomas Pynchon, Inherent Vice (trad. N. Richard).
Dans son texte Pokemon Red Is a Kafkaesque Nightmare, M. Shaw conclut : « Ash [Red en réalité, Ash est le héros de l’anime] defeats the Elite Four and his self-proclaimed rival and becomes the new champion, and the result of this is nothing. The result is that you either reset the game or wait for the next installment of the series to come out so that you can do it all again, from the beginning. Even in the end, the only reward is repetition ».
Il y a une première chose que je dois préciser à propos de Pokémon : je n’étais pas de ces enfants qui voulaient tous les attraper. J’ai toujours trouvé cette quête soporifique au possible, ajouté au fait qu’il était impossible de tous les posséder dans sa version sans avoir à en échanger avec la version (différente) d’un ami, grâce au Cable Link. Par exemple, dans la version Bleu que je possédais, il m’était impossible d’attraper Abo et Arbok, Férosinge et Colossinge, Mystherbe, Ortide et Rafflesia, Caninos et Arcanin, Élektek, Insécateur, et Tygnon ou Kicklee (en fonction de celui que je choisissais au dojo). Sur les 150 Pokémon, 12 étaient donc d’emblée introuvables. Je trouvais ce manque si frustrant que je n’ai ensuite jamais eu l’ambition de compléter mon Pokédex.
Il me semblait plus stimulant de constituer une équipe. De choisir les Pokémon qui me permettraient de vaincre la Ligue. Il ne faut pas oublier que, dans le jeu, le rêve de Ash/Red est de devenir le maître Pokémon après avoir vaincu la Ligue Pokémon, et non pas de tous les attraper (qui sera simplement le slogan du jeu, et l’ambition encyclopédique de Chen). En cela, le jeu est une aventure, parfois une déambulation, dans Kanto (autre point de désaccord avec l’autrice : les villes ne se ressemblent pas), pour attraper les Pokémon qui composeront mon équipe, tout en les entraînant. Tout le chemin m’amenait vers la Ligue, qui est inaccessible à moins d’avoir les 8 badges. Ensuite, une fois la Ligue battue, ma quête était achevée, et je pouvais ainsi profiter de mon temps libre pour arpenter la carte : attraper les oiseaux légendaires et Mewtwo, vaincre les dresseurs à côté desquels j’étais passé, retourner voir ma mère et le professeur Chen.
Là où je rejoins l’autrice, c’est que ce post-quête principale est extrêmement mal géré. Une fois que vous avez vaincu la Ligue, vous pouvez retourner l’affronter, et elle n’aura pas changé (Blue vous attendra toujours pour le grand combat final, et vous dira systématiquement que vous êtes un nul). Seule la Grotte Azurée où se trouve Mewtwo s’ouvre suite à cet événement. C’est-à-dire qu’il manque au jeu le symbole d’un achèvement, d’un accomplissement. Le jeu ne vous propose pas de fin. Mais je n’ai jamais considéré l’errance post-Ligue comme fantomatique, et j’ai pu jouer des centaines d’heures à ce jeu sans jamais amener tous mes Pokémon au niveau 100, ni jamais attraper les 150 espèces. C’est donc bien qu’il y a quelque chose à faire dans cet univers, quand bien même il n’y a rien à y faire de particulier.

Il y a ce moment à la toute fin de Pokémon Or/Argent, quand vous incarnez Gold et que vous vous retrouvez au sommet de la Grotte Argentée à Johto, et que Red est là, mutique, l’ultime dresseur, prêt à vous affronter. On ressent une certaine satisfaction à se voir ainsi en miroir, nous l’ancien Red ici devenu une légende, comme au plus haut de la réputation, retiré du monde, loin même de son ambition initiale de conquête, simplement avec ses Pokémon et le silence. Red/Ash n’est ni un personnage fuyant ni une coquille vide, mais sans doute simplement un avatar qui vous laisse la place d’être lui.
Le Village de Whealbrook, deuxième partie :
Ton père t’emmène jusqu’à un village où tout le monde connaît son nom, où tout le monde avait prévu son arrivée, où tout le monde connaît ton nom à toi aussi. Ils te disent à quel point tu as grandi, mais tu ne te souviens pas d’eux, tu ne te souviens pas de cet endroit. Tu ne le leur dis pas. Tu te tais, comme d’habitude, comme tu le dois. Tu ne leur dis pas que tout ce que tu te souviens faire, avant que le navire n’arrive au port, c’est rêver. Peut-être que tu dormais la dernière fois que tu es venu ici. Peut-être que tu dors en ce moment même. D’étranges phénomènes se produisent dans le village, comme toujours au commencement : le monde est submergé par le froid, un froid beaucoup dur plus qu’en temps normal à cette période de l’année, et tu t’aperçois n’avoir aucun souvenir du changement des saisons – dans tes rêves seulement tu t’es accroupi dans la cave pour te protéger des tornades, dans tes rêves seulement tu as senti tes pieds s’enfoncer dans la neige. Explore ta maison, ta nouvelle maison, ton ancienne maison, et demande-toi si tu l’as déjà considérée comme un foyer, ou si, quand tu partiras d’ici, tout s’effondrera dans ta mémoire, replie-la sur elle-même, pour que d’une structure complexe elle devienne une phrase simple, une phrase que tu pourrais prononcer si jamais un jour tu dis quelque chose : j’ai vécu ici autrefois. Un moment. Pendant un moment, j’ai vécu ici. Ton père te construit un lit, un lit adapté à ta nouvelle taille. Il le construit à partir de trésors inutiles, de vieux livres aux épaisses couvertures délavées, de flûtes sculptées à la main dont personne ne se souvient comment jouer. Il accroche une photo de ta mère sur chaque mur. Il te cache des choses. Suis-le quand il quitte la maison, quand il quitte le village. Regarde-le monter à bord d’un radeau en bois et descendre un cours d’eau qui serpente jusque dans une grotte. Tu ne sais pas lire le panneau qui prévient d’éboulements dans cette grotte, et une fois à l’intérieur de celle-ci, tu ne retrouves pas ton père. Son radeau vide est bercé par le courant, il a laissé tomber son épée dans la poussière, ce qu’il cherche a de toute façon été perdu. Retourne au village. Trouve une pierre dans un puits. Jette-la dans les airs et rattrape-la. Rien ne se passe. Certains objets ici bas ne te seront utiles que bien plus tard, quand tu auras même oublié les avoir en ta possession. Cette pierre, penses-tu, me sera utile plus tard, mais non : elle t’est utile maintenant. Ne la fais pas ricocher dans le courant. Ne l’avale pas, même si elle est lisse, de la taille parfaite pour ta bouche d’enfant. Ne la lance pas à travers les vitraux de l’église. Sens son poids dans ta poche et souviens-toi du départ de ton père, quand tu t’es retrouvé seul. Souviens-toi de lui un marteau à la main et des clous entre les dents. Souviens-toi de lui quand il lavait tes coupures et tes écorchures, retirait les échardes de ta paume, quand il te disait d’être fort, plus brave que lui ne l’a jamais été. Tu découvres une carte cachée dans un tunnel. Tu découvres un monde secret recouvert de neige, mais une neige dont tu ne te souviens pas, pas la neige de tes rêves. Tu rampes jusqu’au lit que ton père a construit de ses propres mains à partir d’histoires et de chansons. Il devait savoir que ce jour viendrait, un jour où tu t’endormirais sans savoir où il est parti, sans savoir s’il reviendra jamais. Quand tu te réveilleras, il sera là où tu l’as vu la dernière fois, sirotant un jus d’orange à la table de la cuisine. Il te dira que c’est le moment, qu’il est temps de partir.
Une étendue d’eau, première partie d’An Object You Cannot Lose, de Sam Martone (traduction) :
Ouvre les yeux : l’aventure commence, réveille-toi. Tu devrais le savoir à présent, après tous les autres commencements qui ont précédé celui-ci. Quand tu seras réveillé, inspecte la commode. Casse chaque pot et chaque baril dans chaque pièce. Tu pourrais trouver quelque chose. Et tu trouves en effet quelque chose, plusieurs choses : une potion, des graines à mettre sur ta langue, des vêtements qu’une force invisible t’empêche de porter. À côté de chaque commode il y a une bibliothèque – inspecte-les elles aussi, même si tu es encore trop jeune pour lire ces lourds volumes et leurs pages envoûtantes. Dans une autre pièce, trouve ton père. Son regard est vide quand il te parle. Il ne se rend pas compte de ce qui vient de commencer, avec cet événement, ton réveil, aujourd’hui. Tout a commencé pour lui bien avant ce commencement. Mais tout est différent, cette fois : quand tu quittes cette pièce confortable que ton père et toi partagez, tu t’aperçois que tu n’es pas dans une maison au milieu d’un insignifiant petit village perdu au fin fond d’un continent qui attend d’être découvert, ni le sujet d’un puissant royaume, le fils du plus fervent soldat de sa majesté, à l’entraînement pour débuter sa quête. Tu es sur un navire, qui navigue sur l’océan. Tu rentres chez toi, sans aucun souvenir de chez toi. Ouvre l’inventaire de ton esprit et plonge dans ses profondeurs. Tu te grattes le bras : des réminiscences de piqûres d’insectes et d’étés étouffants. Une ancienne maison, peut-être, ou une maison que tu as inventée. Tu ne te souviens pas avoir grimpé à bord de ce navire, ni avoir espéré ses voiles à l’horizon. Tout ce que tu te souviens avoir fait avant ça, avant ce que tu vis là, c’est rêver. Le navire avance comme une ombre sur l’océan. Aucune vague sur les flancs de la coque, aucune trace de votre passage, juste le bleu primaire, la couleur qu’un enfant (un enfant comme toi) pourrait choisir pour colorier la mer. Dans tes rêves, tu es dans un château. Dans tes rêves, tu te souviens de ta naissance. Ton père cherche quelque chose, il tente de retrouver ce qu’il a ressenti quand il t’a trouvé la première fois, emmailloté, en larmes aux côtés de ta mère. Tu te demandes si tu peux changer le cours des choses, ou si, après la fin de l’histoire, les ténèbres se répandront sur le monde et qu’ailleurs, quelqu’un d’autre, quelqu’un comme toi, se réveillera, avec simplement le souvenir de rêves et de quelques connaissances, d’un commencement qui recommence. Tu as l’impression d’être contrôlé par une force aérienne, qui te regarde d’en haut. Une main invisible emmêlée dans tes cheveux qui te pousse en avant. C’est peut-être Dieu. Peut-être le destin. Il y a cet autre rêve, qui t’occupe l’esprit, un rêve dans lequel toi, mais un toi plus âgé, voyages à travers des villes prospères et des déserts hérissés de pointes en compagnie d’un homme que, dans ton rêve, tu sais être ton père. Tu essaies de ne pas y penser, mais l’image reste. Il y a certains objets, ici bas, qu’il est impossible de perdre, même avec la meilleure volonté du monde, et peut-être que ce rêve est l’un d’entre eux, penses-tu. Peut-être qu’il te sera utile plus tard. Inspecte les commodes. Casse chaque pot et chaque baril, même si tu sais qu’ils reviendront dès que tu auras détourné le regard. Casse-les quand même. Casse-les pour ça. Tu pourrais trouver quelque chose. Parle à tout le monde. Si tu ne comprends pas ce qu’ils disent, parle-leur à nouveau : ils répèteront tout, mot pour mot, juste pour s’assurer que tu as bien entendu. Écoute. Regarde dans le miroir accroché au mur. Regarde les mouettes zigzaguer au-dessus de ta tête. Dis adieu aux choses telles qu’elles étaient avant ton réveil.
Doomdream : An impression of my dreams after I’ve been playing Doom all day. Controls: WASD or arrow keys to move, mouse to look, ESC to quit. There is no combat or ending. Just run around until you get bored.
- Any Doom-related dreams? : « The whole dream was silent until I decided to open the door which promptly made a very muffled doom door sfx. I stopped, amazed by that sound, then I moved through the door and allowed it to shut behind me, making the door closing sfx. »
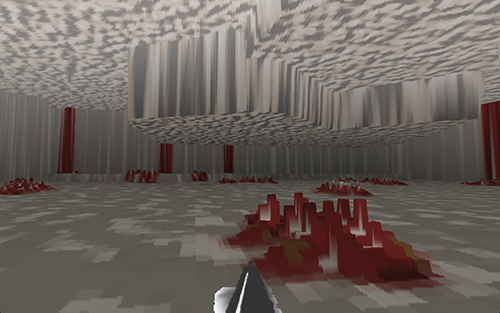
SHARK HARBOR
Je prendrais ma décapotable et roulerais à toute vitesse vers le port. Le soleil couchant taperait sur le pare-brise et dans les rétroviseurs de façon à créer une ambiance mélancolique propre aux fins de journées en bord de mer. Le cri des oiseaux renforcerait cette émotion sensible et délicate, tandis que la chanson qui passerait dans la voiture réveillerait le souvenir de femmes que j’ai aimées. Le solo du saxophoniste me ferait pleurer, et j’essuierais ces larmes avec le creux de mon bras. Je me ressaisirais et passerais la vitesse supérieure, pour faire disparaître ma voiture dans le point de fuite à l’horizon et ainsi atteindre le lieu de ma prochaine mission. On verrait ma voiture se garer discrètement dans la nuit aux abords de l’entrepot du port. Divers spots éclaireraient des zones stratégiques où me placer ultérieurement pour photographier au mieux les agissements douteux des concurrents de mon commanditaire. D’autres spots lumineux balaieraient divers couloirs où patrouilleraient des gardes armés, et j’aurais à me faufiler dans l’ombre pour éviter les affrontements. Mon commanditaire m’aurait prévenu : si je me faisais repérer, la mission serait un échec. Très vite par exemple je voudrais prendre mon bazooka dans mon inventaire, mais ne trouverais que mon appareil-photo, qui serait en réalité un appareil-photo prêté par un ami photographe de mannequins. Ainsi, il y aurait peu de chances que les choses se passent mal.
Imagine que chaque soir à la même heure une personne t’appelle pour te dire qu’elle sait tout du meurtre que tu as commis. Qu’elle te parle du meurtre ne t’étonne pas car tu l’as bien commis, un meurtre horrible qui plus est, vraiment tu n’y es pas allé de main morte, et tu savais en le commettant qu’elle en serait témoin. La personne qui t’appelle chaque soir pense faire pression sur toi, et espère grâce à son chantage t’extorquer quelque chose, sans doute de l’argent, peut-être autre chose qui la regarde. À chaque appel, tu réponds comme si tu avais peur de ses menaces, comme si tu étais prêt à tout pour qu’elle n’en parle à personne. En réalité, ce meurtre était mis en scène pour que cette personne t’appelle, pour qu’elle pense avoir un moyen de t’extorquer quelque chose et qu’elle se sente assez en confiance pour ne pas remettre ce qu’elle a vu en question. Pourtant, la victime était un complice à toi, et elle n’a aucunement souffert lors du prétendu meurtre. Tous les deux, vous vouliez donner l’impression à la personne qui vous fait chanter qu’elle est en position de force, alors qu’elle est exactement dans la position inverse, car vous savez tout à propos du meurtre qu’elle a commis.
La traduction est un drôle d’exercice.
Je suis fasciné par ces personnes fantomatiques, aperçues parfois dans une ville, parfois dans une autre, le long d’une route, toujours la cible de témoignages discordants ou falsifiés, et puis qu’on retrouve tuées de plusieurs coups de couteau, un jour, par on ne sait qui, dans le salon d’une maison à l’abandon.
Après, les choses se calmeraient. Les hommes de main de mon commanditaire viendraient eux-mêmes chercher les caisses de marchandises détenues par Diaz, et on me proposerait de récupérer son manoir. Comme il serait gratuit, je dirais oui, et j’aurais même le droit de garder les mannequins dans la piscine. Le manoir de Diaz deviendrait mon manoir, et il serait réparé sans que j’ai besoin de faire appel au moindre maçon. Le manoir génèrerait de l’argent de lui-même, sans raison particulière, et je pourrais y garer deux voitures, dont ma voiture de sport décapotable. J’aurais un aquarium qui me servirait de plancher et dans lequel il y aurait un requin dans une eau turquoise. Tu es libre, toi, dirais-je au requin dans l’aquarium. Vous êtes libres, vous aussi, me dirais-je en regardant depuis mon nouveau bureau les mannequins dériver dans la piscine sur leurs matelas gonflables. Je prendrais de la cocaïne et commencerais à m’emmerder quand mon téléphone sonnerait. Mon commanditaire me confierait une nouvelle mission et pendant son appel je regarderais la décoration dans mon bureau en me disant que Diaz avait quand même de sacrés goûts de merde. Tous les meubles seraient en marbre et tous les bibelots en or. Mon commanditaire me confierait une mission d’infiltration : photographier cette nuit des concurrents qui prévoiraient de décharger leur marchandise au port. J’accepterais en sachant que l’infiltration n’est pas mon fort, et qu’il y aurait de grandes chances pour que je les tue tous. « Si tu les tues tous, la mission sera un échec », me dirait mon commanditaire. Alors je ferais de mon mieux.
Je regarde d’autres offres d’emploi. Plus je regardes les offres, et moins j’ai l’impression d’être apte. Je me demande pour quel travail je suis fait, ce que je peux faire. Pas grand chose, apparemment. Pas ce dont on a besoin, évidemment.
En ce moment, il arrive que mon site tombe en panne à cause de divers problèmes techniques du côté de mon hébergeur. J’aime me dire que certaines personnes imaginent alors le site à l’abandon, s’en vont, et ne reviennent jamais.
Dans Dieu Jr., un père se morfond après la mort accidentelle de son fils, dont il est en partie responsable. Pour surmonter son deuil, il reprend certaines sauvegardes d’un jeu vidéo créées par son fils avant son décès. On sait que le père joue sur Gamecube, et j’ai cru d’après les descriptions de l’animal qu’il incarne qu’il s’agissait d’une version modifiée de Banjo-Kazooie. Finalement (le jeu n’est jamais nommé), d’après la description des ennemis et de la barre de vie, il joue sans doute à Winnie l’Ourson : À la Recherche des Souvenirs Oubliés. Le père mène ainsi une quête parmi les différents niveaux pour pénétrer à l’intérieur d’un mausolée inaccessible et en comprendre le sens caché. Il espère y trouver le secret de la mort de son fils. Il ne parvient jamais à ouvrir le mausolée, mais trouve dans le jeu quelque chose du deuil, qui est en fait l’oubli (le déni).
Dans la série Halt & Cath Fire, le personnage de Cameron Howe développe pour Atari un jeu vidéo intitulé Pilgrim. Le jeu est jugé trop compliqué par les testeurs, et Atari abandonne sa commercialisation. Un soir, le personnage de Donna Clark décide d’aller au bout du jeu et, quand elle parvient à le terminer, à atteindre une maison en pleine nuit, elle comprend que le personnage qu’elle incarnait jusque-là était un enfant à la recherche de son père.
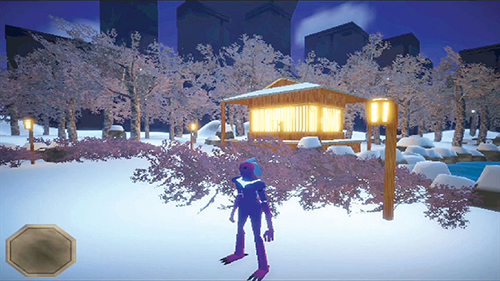
« On va dire qu’il m’a donné le pouvoir d’effacer la nuit où je l’ai tué et où j’ai perdu la partie par accident. On va dire que l’herbe extrêmement douce des cimetières est une herbe fausse, et qu’il n’y a rien ni personne sous la terre. »
Je ferais des ronds en courant dans le bureau de Diaz le temps de trouver une solution pour le tuer. Ce con de Diaz ne parviendrait pas à me toucher pour je ne sais quelle raison, sans doute un strabisme pas encore diagnostiqué, mais les chargeurs de ses armes sembleraient illimités, ce qui ne m’arrangerait pas. Pourtant, il continuerait à me provoquer en m’insultant et en me faisant des doigts d’honneur. Bref, dans ces conditions extrêmes, il me faudrait un certain temps avant de concevoir un plan adéquat. Grâce à ma patience et à mes capacités cérébrales légèrement au-dessus de la moyenne, je comprendrais que Diaz suit toujours la même chorégraphie de tirs et vise exactement les mêmes endroits de son bureau ; j’en voudrais pour preuve les impacts de balle sur les murs et sur les structures en bois. Je m’approcherais de lui en esquivant les balles à l’aide de diverses techniques ninja et, une fois au contact, je me mettrais à le marteler de coups de poing. Les coups de poing lui feraient de très faibles dommages et j’aurais même l’impression qu’ils ne lui feraient rien. Ce Diaz est coriace, me dirais-je. Il n’est pas le chef pour rien. Diaz ne changerait pas son mode d’attaque pour autant. Au bout d’un moment, je verrais quand même apparaître quelques traces de sang sur son costume de mafieux, ce qui m’indiquerait que je le tape de la bonne façon. Je taperais un peu partout avec mes poings, ne parvenant pas à viser précisément son visage ni son torse ni aucune autre surface stratégiquement intéressante, comme ses parties génitales. Il me serait également impossible de lui voler son arme, qui aurait pourtant mis un terme immédiat au combat. Donc les choses iraient ainsi tant et si bien qu’au bout d’une centaine de coups de poing assénés au hasard Diaz finirait par pousser un cri terrible et par s’écrouler sur le sol dans une telle posture que je l’aurais cru disloqué.
« J’ai une théorie que je veux t’expliquer. Ce jeu est construit sur les ruines d’un jeu plus ancien. Tu sais, comme en Égypte. » – Dennis Cooper, Dieu Jr. (trad. F. Boyer & E. Landon).
À peine sorti de l’eau je serais déjà sec. Je me rendrais compte ne plus avoir de munitions ni dans mon fusil mitrailleur, ni dans mon 9mm, ni dans mon bazooka, ni dans mon arbalète, ni dans mon lance-grenades, ni dans mon fusil à pompe, ni dans mon Colt Python, ni dans mon Uzi M10, ni dans mon SPAS-12, ni dans mon fusil sniper, ni dans mon lance-flammes. Il ne me resterait plus que mes poings, la pire des armes, surtout quand on sait que Diaz disposerait lui de tout un arsenal dernier cri et en parfait état. Avant de rentrer dans le bureau de Diaz où, ça ne ferait plus aucun doute, j’aurais à l’affronter, un équipement sommaire serait mis à ma disposition : un gilet pare-balles et une tronçonneuse. Drôle d’endroit pour une tronçonneuse, me dirais-je avant de l’empoigner. J’ouvrirais les deux portes dorées qui me feraient face et pénétrerais comme au ralenti dans le bureau de Diaz où il m’attendrait, placé en hauteur, au centre d’une sorte de coursive qui ferait le tour de la pièce. Après un discours particulièrement interminable et soporifique de Diaz que je n’aurais même pas la possibilité d’ignorer, l’affrontement commencerait. Diaz m’accablerait avec ses différentes armes à feu et je devrais esquiver les balles en faisant des roulades, ce qui serait malcommode (mais pas impossible) avec une tronçonneuse dans les mains. J’allumerais la tronçonneuse après de multiples tentatives infructueuses, puis me dirigerais bon an mal an vers Diaz, qui aurait l’avantage d’avoir une bonne endurance en plus d’être armé. Le gilet pare-balles ne serait pas de trop, mais serait détruit après seulement trois impacts de fusil à pompe, ne laissant plus qu’une mince chemise hawaïenne multicolore entre la folie de Diaz et ma peau. Comme je ne parviendrais jamais à rattraper Diaz qui ne ferait que fuir loin de moi tout en me provoquant avec quelques répliques bien choisies, je finirais par lancer ma tronçonneuse vers lui à travers la pièce, sans imaginer un seul instant qu’elle s’arrêterait de fonctionner durant son vol plané et atterrirait à ses pieds sans lui infliger le moindre dégât. Je serais alors particulièrement dans la merde.
Conditionnée sous atmosphère contrôlée, la gélule SUPRAFLOR est protégée dans un blister ULTRAPROTECTEUR composé d’une double couche d’aluminium 100% opaque et ultrarésistante, dit la notice de ce médicament.
Le manoir serait construit de telle manière qu’il ressemblerait à un labyrinthe, et que je serais très vite complètement perdu. J’aurais une carte avec le détail des différents étages du manoir, la localisation des marchandises et la salle où m’attend le chef, Diaz, mais je ne pourrais m’empêcher de me cogner contre les murs et de tomber dans des trappes. Le manoir serait également équipé de tapis roulants qui dévieraient ma progression et me renverraient souvent dans la cave, mon point de départ. Il n’y aurait pas tellement d’ennemis, et la plupart pourraient être esquivés ou abattus d’un seul coup de poing. L’envie d’abandonner la mission me prendrait à de multiples reprises, et je me laisserais dériver de longues minutes sur les tapis roulants, dans l’espoir que quelque chose me tue. L’armée qui était censée arriver n’arriverait pas. Il n’y aurait pas d’autre chemin. Je me reprendrais tout de même en main et parviendrais jusqu’à un couloir étroit tapissé de portraits du chef. Le rendu serait vraiment dégueulasse. Dans ce couloir, tandis que je serais occupé par l’horreur et l’égocentrisme de la décoration, deux dobermans se jetteraient sur moi. Je perdrais beaucoup de sang car ils seraient impossibles à toucher à cause de leur basse taille et de leur rapidité. J’y perdrais presque la vie, mais réussirais finalement à les tuer en les faisant exploser avec une grenade à fragmentation (la dernière). L’explosion de la grenade ferait un trou conséquent dans le mur de gauche du couloir, et me mènerait directement dans le jardin du manoir, à l’arrière. Des mannequins en bikini se prélasseraient sur des matelas gonflables roses et jaunes flottant dans la piscine. Je sauterais en bombe et les arroserais. J’accomplirais ainsi une mission secondaire qui était de sauter en bombe dans une piscine. Après avoir ressorti ma tête de l’eau entre les matelas gonflables des mannequins, je regarderais vers le sommet du manoir et apercevrais Diaz, qui me fixerait lui avec cet air de défi qui annonce les plus grands affrontements.
Hier, un milliardaire américain a envoyé une voiture de sport de marque Tesla pilotée par un mannequin en orbite autour de la Terre. C’est apparemment ce qu’on appelle le progrès.
« You dont have enough to lose. I will never see you and you dont exist. People have been gone so long now that they arent more than the words that recall their faint presence in the dust of my apartment. You are too much nothing for the something that I barely am. I need you. For so long I have been so little, in the end nothing. I want to leave nothing, but forever, you are endless nothing, the sea floor. »
Je suivrais le camion des bandits dans la zone urbaine périphérique et me rendrais compte en jetant un oeil dans le rétroviseur que plusieurs voitures de la police locale sont à mes trousses. Je jetterais quelques grenades en arrière et ferais exploser les voitures de police, ce qui soulagerait un temps la pression que j’aurais sur les épaules, mais ne ferait que précipiter le pire, à savoir l’armée. Il me faudrait boucler ma mission au plus vite pour me faire oublier et mettre tout ce chaos sur le dos des bandits. Pour cela, je sortirais un bazooka du coffre de ma voiture de sport et courrais vers le lieu où les bandits se seraient arrêtés, une sorte de manoir baroque rose bonbon. Je me dirais qu’il s’agit d’un drôle de repaire pour des bandits. Je me dirais qu’il s’agit bien de la typique extravagance des entreprises installées dans les zones urbaines périphériques. Je pénétrerais dans le manoir rose bonbon par la porte de la cave, où je ferais exploser au bazooka trois bandits en train de décharger des caisses, qui pousseraient des cris horribles et voleraient dans tous les sens. L’un des bandits, pris d’étranges convulsions mortelles, sortiraient dans la cave en étoile de mer et se mettrait à rouler partout dans la zone urbaine périphérique. Finalement, je le perdrais de vue. Mais ma mission ne serait pas tout à faire terminée : il me faudrait encore abattre le chef des bandits et récupérer la marchandise.
Suite et fin du premier chapitre :
Tu regardes sur ta gauche puis sur ta droite puis tu regardes le feu et tu remarques qu’il est enfin passé au vert.
À présent, Chasing Sheep is Best Left to Shepherds de Michael Nyman et du Michael Nyman Band passe dans la Ferrari.
Quelqu’un continue de klaxonner.
Tu regardes à travers le pare-brise arrière et tu te rends compte que c’est Will Smith dans une Honda Accord gris métallisé qui répète les mots barre et toi et connard encore et encore et encore, et qui klaxonne toujours plus fort.
Au téléphone, James Franco dit quelque chose.
« Le feu est passé au vert, James Franco », souffles-tu. « Je peux pas te parler maintenant, je dois y aller. »
« Et pour les masques ? » demande James Franco dans l’iPhone.
Tu raccroches et coupes court à la conversation avec James Franco.
Pas exprès, évidemment, mais surtout parce que tu ne veux pas passer pour un con aux yeux de Will Smith.
Will Smith fait une embardée derrière toi puis accélère du côté conducteur de la Ferrari, puis il te fait un doigt et hurle quelque chose comme « Va te faire foutre », sans doute, puis il accélère à nouveau pour faire une embardée sur la gauche, puis sur la droite, avant de disparaître au loin dans le soleil couchant.
Et tu te dis : Will Smith est bourré.
Tu regardes l’écran de ton iPhone.
Tu soupires et commences à avoir de la peine pour James Franco.
Suite :
« […] Killer of Sheep, Le Cabinet du Dr. Caligari, The Death King et un autre film, un documentaire je crois, Koyaan—quelque chose. »
« Koyaanisqatsi », dis-tu dans l’iPhone.
« Koyaanisqatsi », répète James Franco. « Et tu as aussi tout un tas d’autres films qui sont, genre, étrangers. En langue originale. »
« Et comment est le vent du coup ? »
« Quoi ? »
« Est-ce que c’est le vent qui a fait tomber les masques, enfin la boîte ? » demandes-tu.
« La boîte est tombée toute seule. »
« Comment tu sais que ça n’était pas le vent ? »
« Je n’étais pas à proximité de la boîte quand elle est tombée de l’étagère ce matin donc je ne suis pas certain que ça n’était pas le vent. Mais je suppose simplement qu’elle est tombée toute seule. »
« Mais, est-ce que la fenêtre est ouverte en ce moment ? »
« Je suppose juste. »
« James Franco, est-ce que la fenêtre est ouverte ? »
Un bref silence sous-entend que James Franco est en train de vérifier si la fenêtre est ouverte.
Il se lève et dit : « Je vais marcher jusqu’à la fenêtre parce que je ne vois rien de là où je suis ».
Pendant ce temps, tu examines le couple dans la Honda Civic et tu remarques que la fille a de très petites oreilles.
Ça te plait que la fille ait de très petites oreilles.
« Je viens d’ouvrir la fenêtre. »
« Genre, juste là ? »
« Non, je l’ai ouverte il y a quelques minutes quand je suis entré dans la pièce pour la nettoyer, donc elle est déjà ouverte. »
« Donc tu as vraiment ouvert la fenêtre ? »
« Je n’en suis pas certain. »
« Donc tu n’en es pas certain. »
« Je n’en suis pas tout à fait certain. »
Quelqu’un klaxonne.
Ça te fait sursauter.
« Objects left fixed, untouched, alone for so long, become their settings, their original forms willed to implode into the spot where they have rested and they, within the voids they cradle by their shapes, change those settings they have become part of; when implored, the tiny vessel floats in kitchen sea of sun golden solitude. » – John Trefry, Plats.
Je décapoterais ma voiture de sport et le soleil se refléterait sur mes lunettes de soleil. De jeunes femmes en biniki me salueraient depuis le trottoir de la digue. D’une main je dirigerais ma voiture de sport et de l’autre je tirerais au Uzi sur le camion des bandits en train de slalomer devant moi. Je viserais en priorité les pneus mais tirerais globalement un peu partout, sur les poubelles, les oiseaux, le bitume et les plaisanciers en train de manger une glace et de discuter ici et là. Certains fuiraient en entendant les balles et pousseraient des cris que j’aurais cru avoir déjà entendus dans un film, mais la plupart resteraient là à discuter et à manger leur glace. La course-poursuite serait assez longue et ennuyeuse car mon niveau en tir ne serait pas tout à fait au point, et finalement elle nous emmènerait loin de la digue et de la plage vers une zone industrielle périphérique.
Palmtrees Paradise IV
Suite :
Tu entends un son qui vient de l’iPhone, comme si James Franco était en train de bouger les masques. « Et certains sont complètement brisés, genre, en mille morceaux. »
« En mille morceaux ? »
« En mille morceaux », confirme-t-il.
« Mais qu’est-ce que tu entends par mille morceaux, James Franco ? »
« Je veux dire en mille morceaux. » Il marque une pause. « Tes masques sont en mille morceaux. »
« Tous ? »
« Eh bien », et tu entends un bruit, comme si James Franco était en train de bouger les masques à nouveau. « Ouais, la plupart. »
Tu regardes ton pantalon Calvin Klein et tu te frottes la jambe gauche pour t’assurer que tout cela est bien réel.
« Donc la boîte est tombée de l’étagère ? »
« De l’étagère, ouais. »
« Quel genre de livres je lis ? » demandes-tu dans l’iPhone.
« Il n’y a aucun livre sur l’étagère en ce moment. »
« Non, quel genre de livres je lis ? » demandes-tu à nouveau.
« Il n’y a aucun livre sur l’étagère », dit James Franco.
« Aucun livre sur l’étagère ? »
« Non – juste quelques DVD. Par exemple », James Franco marque alors une pause pour boire de l’eau ou autre chose, puis commence à lister : « Buckaroo Banzai, El Topo, Catfish, Encounters at the End of the World, Burn After Reading [etc.] »
« Et maintenant que je vais bien, la solitude est un état bien trop pesant et trop douloureux pour que je vive à nouveau. Toutefois, je suis certain que c’est la vérité. Je suis complètement seul. Non que je veuille mettre ma solitude au-dessus de toutes les autres. C’est vraiment effrayant parfois. C’est tout ce que je peux dire là-dessus. Désolé si c’est vague. » – Dennis Cooper, Guide (trad. Claro).
Arrivé aux abords de l’entrepôt, je sortirais de ma voiture de sport et me munirais de mon fusil d’assaut. Je m’infiltrerais discrètement jusque dans un coin isolé de l’entrepôt, où je surprendrais une conversation de la plus haute importance entre des bandits. Dans les caisses gardées par les bandits, il y aurait de la drogue, de l’alcool, des armes, ou des contrefaçons de peluches parlantes. J’aurais l’opportunité de neutraliser les bandits discrètement grâce à diverses techniques d’infiltration inspirées des ninjas, mais je préfèrerais finalement tous les abattre en rafale avec mon fusil d’assaut chargé à bloc. Les douilles voleraient partout autour de moi et un effet de ralenti donnerait au carnage un rendu impressionant et décontracté. Toujours au ralenti, les corps des gardes seraient projetés dans les airs puis retomberaient lourdement sur le sol. Il n’y aurait pas de sang afin de préserver la sensibilité des plus jeunes. Après avoir ouvert une caisse, je me rendrais compte qu’un camion conduit par des bandits encore vivants quitte l’entrepôt en quatrième vitesse. Il ne me resterait plus qu’à remonter dans ma voiture de sport et à pourchasser le camion le long de la digue et des volleyeuses en train de jouer sur la plage.
Suite :
Depuis quelque part dans la Honda on entend A-Punk, de Vampire Weekend, et la fille sur le siège passager hoche la tête en rythme et fredonne à voix basse pour elle-même.
Tu regardes par la vitre du côté conducteur de la Ferrari et de l’autre côté de la rue et tu penses à James Franco et à son visage et à son corps et à ses pieds et à ses oreilles et à sa bouche et à ses mots et à son livre, Palo Alto.
Et puis il y a ce son un peu voilé, un cliquetis, de James Franco qui pince ses lèvres et tu dis « T’es là ? » et James Franco dit « Ouais ».
Tu te concentres sur la discussion à propos des masques.
« Alors comme ça les masques sont abîmés ? » soupires-tu dans l’iPhone.
« Les masques sont abîmés. »
« Mais, quand tu dis les masques, qu’est-ce que tu veux dire exactement, James Franco ? »
« Les masques dans la boîte », répond James Franco.
« Les masques dans la boîte ? »
Il y a un bref instant de silence, un blanc, dans la conversation téléphonique, mais, déjà, trois minutes de la version abrégée de The Thieving Magpie ont passé et tu en prends bonne note.
« James Franco, est-ce que tu réalises que c’est sans doute la plus long feu rouge auquel je me suis jamais arrêté ? » dis-tu.
« T’es arrêté à un feu rouge ? » demande James Franco.
« Ouais, je suis arrêté à un feu rouge. »
« D’accord. »
Tu fixes quelque chose sur le pare-brise et tu te mets à penser à la Voie lactée et à d’autres trucs cosmiques.
Tu réfléchis à autre chose.
« James Franco, je n’ai connaissance d’aucun masque dans une boîte. »
Tu réalises alors que la chanson qui passe dans la Honda n’est pas A-Punk mais Cousins.
« Eh bien, la boîte de masques Africains de quelqu’un est subitement tombée de l’étagère ce matin et maintenant, soupire-t-il, ils sont abîmés. »
« The fled man is far ahead, swallowed where the terrain sinks into itself. Chalk covers the sidewalk arcade. Jack walks across the chalk court leaving the door open. His shadow is late creeping toward him over the horizon. Footsteps of the fled man are nearly buffed from the chalk by the wind. Nascent shadows trace the shallow moments short of their disappearance. Jack follows in pursuit, not looking back down the valley. Light from the motel balanced by the clouded daybreak renders him invisible to himself. » – John Trefry, Apparitions of The Living.
Une voiture m’attendrait dehors sur le parking de l’immeuble. Il s’agirait d’une voiture sportive de marque indéterminée. J’aurais les clés dans ma poche mais ne m’en serais pas rendu compte jusque-là. J’aurais une mission à effectuer de l’autre côté de la ville. Une fois installé sur le siège conducteur, une voix qui viendrait sans doute des haut-parleurs me confierait la mission que je dois accomplir. J’aurais des caisses à récupérer dans un entrepôt gardé par des dizaines d’hommes armés. J’accepterais la mission sans avoir le choix. Au volant de ma voiture qui filerait à plusieurs centaines de kilomètres/heure dans la ville, je me sentirais vraiment royalement serein, et cette sérénité se traduirait par la façon dont les ombres des lampadaires projetées par le soleil crépusculaire passeraient sur mon visage concentré.
Suite :
C’est léger mais tu peux l’entendre. James Franco est en train d’écouter Bubba Dub Bossa, de Robby Poitevin.
« Tu serais pas en train d’écouter Bubba Dub Bossa de Robby Poitevin ? » demandes-tu dans l’iPhone, un peu perdu mais soulagé que ce soit James Franco et pas Ryan Gosling.
« Si, je suis en train d’écouter Bubba Dub Bossa de Robby Poitevin », répond James Franco. « Mais les masques, ils sont abîmés », répète-t-il dans l’iPhone.
« Comment ça les masques sont abîmés ? »
« Ils sont abîmés », dit-il dans l’iPhone.
« James Franco, je crains de ne rien comprendre à ce que tu es en train de me raconter. »
« La connexion est si mauvaise que ça ? » demande-t-il, apparemment ennuyé.
« Non, c’est juste que, je ne comprends pas ce que tu en train de me raconter, James Franco », tu marques une pause pour reprendre ton souffle, « les masques sont abîmés ? »
« Ouais, les masques, ils sont abîmés », dit-il dans l’iPhone.
Tu ne dis rien, pas tout de suite en tout cas. Tu penses plutôt au mot masques et tu imagines un immense panneau en néons.
Quelque part dans le ciel, il y a un immense panneau en néons et il flotte au milieu des nuages et il illumine d’un bleu clair les lettres du mot masques encore et encore.
Et le panneau en néons continue de grésiller bruyamment et de scintiller d’une façon vraiment distrayante et le mot masques continue de clignoter — pour toujours, dans le ciel.
Juste à côté de la Ferrari, il y a un jeune couple qui traîne dans une Honda Civic blanche trois portes de 1980.
Je remonterais au cinquième étage où je constaterais sur le forum de discussion que de nouvelles photographies ont été postées par un internaute anonyme. Les photographies seraient des agrandissements du corps de l’homme tué plus tôt dans la rue. Elles montreraient que le corps de l’homme est lacéré de centaines de coups de couteau, en plus de la balle qu’il aurait reçu dans l’oeil et qui aurait transpercé son crâne. Le troisième internaute viendrait me dire par message privé qu’il avait toutes les preuves à propos du meurtre et qu’il les avait postées sur le forum. J’entendrais les vagues qui feraient le même bruit que d’habitude, et l’éternelle lumière rasante frapperait le coin de l’écran de l’ordinateur. J’y verrais mon reflet mais ne me reconnaîtrais pas.
Une tentative de traduction du début du premier chapitre (Ferraris et masques africains) de Mastodon Farm, premier roman de Mike Kleine :
Tu as énormément d’argent donc tu achètes une Ferrari.
Tu roules en Ferrari à travers la ville pendant un moment.
Tu écoutes Philip Glass.
Tu n’es pas sûr de la chanson qui passe parce que tu as oublié de nommer les morceaux avant de les importer sur ton iPhone, mais tu es presque sûr que c’est un morceau d’Einstein on the Beach.
Putain, Einstein on the Beach est vraiment incroyable, penses-tu.
Tu penses à Philip Glass et à son génie pendant un moment (appuyant parfois sur le bouton pause du lecteur CD pour bien réfléchir à la musique et t’imaginer comme le personnage d’un film des années quatre-vingt), et puis tu freines lentement et tu t’arrêtes au feu rouge.
Tu restes là et tu attends que quelque chose se passe, et puis tu finis par penser à ton film préféré.
Maintenant, la stéréo de la Ferrari diffuse une version abrégée du Thieving Magpie de Giacchino Rossini.
Tu transpires parce que tu es enthousiaste.
Tu es enthousiaste parce qu’à chaque fois que tu écoutes Philip Glass, tu as une vision.
La même vision.
Une photo de toi.
Un film.
Tu diriges un orchestre, quelque part, au beau milieu du désert.
Tu es habillé comme James Bond.
Ton orchestre joue quelque chose de bien. Quelque chose du genre de The Thieving Magpie, sans doute.
Tu portes le pantalon dessiné par Calvin Klein que tu préfères.
Tu portes aussi un tshirt en coton de la toute nouvelle collection Marc by Marc Jacobs, couleur saumon.
Comme chaussures, tu portes une paire de mocassins Gucci.
Rien ne peut surpasser ton sens de la mode et du style.
L’iPhone vibre dans ta poche.
« Ouais ? »
« Les masques », dit James Franco. « Ils sont abîmés. »
J’entendrais la sonnerie d’un téléphone à l’étage inférieur, et me précipiterais pour décrocher, grâce à un escalier ayant apparu entre-temps dans le sol. L’étage inférieur ressemblerait trait pour trait à l’étage supérieur, sinon que le téléphone remplaçerait l’ordinateur. À l’appareil, le premier internaute rencontré sur le forum me dirait que je n’avais pas à parler du meurtre au nouvel arrivant, puis raccrocherait. Je resterais là à arpenter l’étage sans raison particulière. Le crépuscule perpétuel créerait d’intéressantes lumières à l’intérieur, sur le carrelage et les murs. Machinalement, j’ouvrirais la fenêtre la plus proche et me pencherais au dehors, pour voir dans la rue un homme tirer froidement sur un autre.
Les trois silhouettes d’oiseaux qui volaient dans le même carré de ciel orangé donnaient au soleil couchant une vague mélancolie japonisante.
« MICHAEL JACKSON is considering legal action to stop his obstentatious Las Vegas show, wants to build a 50-foot robotic version of himself that will roam the desert, firing laser beams. I shit you not, not for those with a weak stomach. » — John Trefry, Thy Decay Thous Seest By Thy Desire.
La conversation sur le forum de discussion s’arrêterait après qu’un troisième internaute intervienne pour nous dire qu’il sait tout à propos du meurtre. Je n’aurais aucune idée du meurtre dont ce nouvel internaute nous parlerait, mais mon interlocuteur initial semblerait lui au contraire profondément perturbé, et il se mettrait à poster des dizaines de nouveaux messages dans lesquels il expliquerait qu’il n’y est pour rien. Au bout d’un certain temps, je me rendrais compte que mon interlocuteur initial se serait déconnecté, car son pseudonyme n’apparaîtrait plus au bas de la page web du forum. Mais le troisième internaute, lui, serait toujours là. Il m’écrirait par message privé qu’il ne s’attendait pas à me trouver sur ce forum, et il utiliserait comme avatar le portrait d’un homme qu’on dirait être moi.

Je me promène sur la route et marche au travers des voitures.
Une porte s’ouvrirait dans un immeuble, par là où le vieil homme m’aurait dit d’aller. Il s’agirait de la seule porte ouvrable de toute la ville. Au cinquième étage, je trouverais un ordinateur allumé, avec une webcam, et un micro. Il y aurait quelqu’un à qui je parlerais d’abord par écrit, sur un forum de discussion, et qui aurait comme pseudonyme mon propre nom, mon nom réel je veux dire, celui qui est inscrit sur ma carte d’identité. On discuterait de la ville où je me trouve et il me dirait qu’il a vécu là lui aussi, autrefois. Puis il me proposerait d’allumer ma webcam pour qu’on puisse se voir et discuter de vive voix, mais en l’allumant, je me rendrais compte que sa webcam à lui renvoie mon propre visage. Je parlerais à ce double de l’autre côté de l’écran, dont la webcam aurait des problèmes de transmission, ce qui déformerait son visage en un angoissant amas de pixels. Il finirait par couper la transmission visuelle, et on continuerait à discuter sur le forum de discussion. Il me dirait qu’il avait trouvé étrange de constater à quel point je ressemblais à un ami à lui qui était mort.
« La salle de jeu donnait sur une cave d’où partaient d’innombrables souterrains qui ressemblaient aux tentacules d’une pieuvre en folie et qui aboutissaient à des culs-de-sac, à des puisards, à des citernes abandonnées et parfois à un cellier secret. » – Thomas Pynchon, Basses-Terres (trad. M. Doury).
Toute mon enfance j’ai imaginé autre chose.
Chaque nouvelle phase de création est accompagnée de son lot de doutes, de tâtonnements, et donc, fatalement, d’échecs.
Il y aurait un homme d’une soixantaine d’années assis sur le trottoir, qui me suivrait du regard si je passe devant lui. Je pourrais lui parler, et il me répondrait méthodiquement les mêmes trois phrases qu’il connaît par coeur. Il pourrait me dire où aller, même s’il n’en a aucune idée. J’aurais le choix de l’écouter ou de poursuivre ma promenade dans la ville, entre des immeubles vides à l’intérieur. Leurs façades seraient éclairées par des lampadaires aux lumières rectangulaires. Le vieil homme serait toujours assis au même endroit, ne bougerait ni ne mangerait jamais. Je finirais par lui demander où aller, et il me répondrait par là.
« Calme-toi, dit Bob, et il entrouvrit la porte d’entrée. Il s’avéra que derrière la façade hospitalière, c’était le néant, une noirceur d’encre. Et pourtant, grâce à la lumière du jour qui pénétrait faiblement et dessinait des ombres imprécises, Nate devina que l’intérieur était divisé en chambres, avec des couloirs et peut-être même un escalier, le tout peint en noir cruel. » – Dennis Cooper, Period (trad. J. Dorner).
Un mal de chien à m’organiser pour la moindre chose. J’imagine des villes sans personne, avec des fougères et parfois des chiens qui rôdent. Je ne sais pas quelle vie j’aimerais mener. J’imagine une ville virtuelle, où les fougères et les chiens le seraient également. Au moment de les toucher, je passerais au travers. Je ne sais pas quelle vie je pourrais trouver dans cette ville abandonnée. Il y aurait toujours le même bruit répétitif des vagues, qui seraient virtuelles elles aussi. La plage serait inaccessible. Je pourrais jouer aux jeux vidéo, qui seraient ma propre déambulation dans la ville. Et les plus beaux instants de ma vie seraient rediffusés en cinématiques. Les gens que je connais seraient là en trois dimensions, et parfois ils disparaîtraient dans les vagues auxquelles je n’ai pas accès. Ils me salueraient au loin avant de se noyer. Je continuerais à marcher, et le soleil ne se coucherait jamais.

Le commissaire voulait de toute urgence s’entretenir avec Rivage d’un problème auquel il avait été confronté la nuit dernière. Rivage lui donna rendez-vous dans la brasserie du plan d’eau, dont la baie-vitrée principale donnait alors sur la brume. […] Depuis le début du monologue du commissaire, un détail dérangeait Rivage.
J’étais avec mon père dans une ville contaminée par des monstres étranges, cannibales il va sans dire, qui en avaient après nous. Nous trouvions refuge dans un immeuble en construction, en proie au vent, seulement soutenu par des poutrelles de métal qui allaient jusqu’au ciel. Un des monstres, ou plutôt une, car elle était de toute évidence de sexe féminin, était parvenue à retrouver notre trace et à nous suivre jusqu’à l’étage de l’immeuble où nous nous trouvions. Mon père me délivrait alors le secret pour éliminer ce type de monstre, puis mourait sous mes yeux, avalé. Je ne sais pour quelle raison, mais j’oubliais aussitôt les conseils de mon père et la méthode pour abattre ce monstre, qui se mit à me poursuivre obstinément jusque chez ma grand-mère, où j’atterris par je ne sais quel miracle. Le monstre me poursuivit dans cette maison exigüe à l’intérieur de laquelle je l’évitais comme je pouvais, toujours en passant d’un couloir à une pièce, ou d’une pièce à une autre, sans lien logique, sans aucune cohérence avec la maison telle qu’elle existe réellement. Même en gagnant du temps, je ne parvenais pas à me souvenir comment tuer le monstre, et trouvais finalement refuge dans le jardin qui longeait la maison. Là, épuisé et résigné à l’idée de pouvoir en finir, je me réveillai.
J’ai moins de choses à écrire en ce moment. Jimmy Arrow me prend la plupart de mon temps ; mon quotidien est plus serein, et il me passe nettement moins de choses en tête. Le confort, sans doute. Mes lectures elles aussi se font plus lentes.
On ne m’a toujours pas répondu pour l’offre d’emploi. Ça commence à m’inquiéter. Bientôt, je n’aurai plus d’économies.
Dans mon téléphone, je suis retombé sur deux photographies prises lors d’une promenade autour du plan d’eau de Lamballe, en octobre dernier. Je prends très rarement des photos. La municipalité avait installé le long du sentier qui entoure le plan d’eau une série de photographies en très grand format, qui représentaient des paysages du monde entier. L’exposition semblait permanente car les photographies avaient été fixées au sol à l’aide de poteaux en bois.
Je trouvais amusant que l’on superpose des images d’ailleurs sur le paysage commun, comme si ce dernier n’était pas suffisant, comme s’il fallait cette sur-impression qui masque les arbres habituels pour mesurer la beauté de notre planète. L’exotisme, c’est aussi la dissimulation de la valeur quotidienne des choses.
J’ai passé mon après-midi à écrire des recettes de cuisine.
Tout à l’heure, sans trop savoir comment, comme d’habitude sur internet, je suis tombé sur une jeune femme dont le métier est d’être influenceuse, c’est-à-dire qu’elle incite les gens à acheter les produits des grandes marques par lesquelles elle est rémunérée. Et je me rendais compte, à l’écouter parler dans une de ses vidéos, que la vertue principale de leur travail, c’est d’être sincère, de toucher une sincérité si profonde qu’elle fait oublier qu’il y a derrière le discours un commerce, que chaque instant d’une vie (un voyage, une matinée, une rencontre) est le prétexte pour placer quelques liens affiliés et des bons de réduction, et que plus le message semble vrai, plus il est rémunérateur. Que le verbe devienne monnaie.
Si vous buvez plusieurs verres d’eau d’affilé, vous finissez par être dégoûté de l’eau.
En ce début d’année, évidemment, on rappelle les bases : bien s’hydrater.
Hier, au Musée de Bretagne, j’ai pu écouter la légende du Pont de St Cado. Dans cette version de la légende, il est dit à un moment que la mère de Lucifer observait son fils construire le pont qui devait relier l’île au continent. L’image me plaît, mais qui est la mère de Lucifer ? Tout de suite me revient la figure de Judy dans la troisième saison de Twin Peaks, sorte d’entité féminine qui serait la mère du Mal, ou son foyer, c’est difficile à dire. Je fais quelques recherches, et c’est là que j’apprends que Lucifer veut dire « Porteur de lumière » (ensuite je me souviens de sa destinée d’ange déchu). Mais je n’apprends rien sur sa mère.
Plus tard, finalement, je découvre que sa mère est l’Aurore, ce que j’ignorais. Le lien avec Twin Peaks, à peine noué, se défait déjà.
Tout le monde semble persuadé que Pynchon est un érudit incroyable, extrêmement bien documenté quant aux sujets qu’il traite dans ses romans. Je pense exactement l’inverse : plein d’esbrouffe, sans aucune donnée précise, juste la surface des choses, plus occupé à faire croire qu’il est intelligent qu’à l’être réellement. Et c’est ce qui fait tout l’intérêt de son travail, justement. Le mauvais élève qui décroche le premier prix.
Je lis tous ces auteurs qui rendent compte de discussions bien inspirantes qu’ils ont eues avec Paul Otchakovsky-Laurens, qui fut parfois leur éditeur. Je pense aux discussions que j’ai avec les miens (d’éditeurs). Il faudra bien en effet encore cinquante ans et leur décès pour les rendre aussi inspirantes. D’autres anonymes diront : je les ai croisés une fois il y a fort fort longtemps au salon du livre de Paris, on s’est entretenus longuement des forêts de Patagonie et de Buffy contre les vampires, c’était une belle journée.
En train de signer une tribune qui défend le droit des inconnus à me faire des balayettes glissées dans les lieux publics sans mon consentement.

J’ai conçu un site internet qui ne comporte aucun lien hypertexte. Il ne comporte aucun texte non plus. Il est impossible de cliquer nulle part. Pourtant, c’est bien quelque part, c’est bien une destination. C’est une destination noire car la couleur de fond est noire. Il est toujours possible de la changer pour du blanc, mais le noir fait bien plus inspirant. Tout de suite, quand on arrive sur un site au fond noir, on se dit qu’il y a du mal qui rôde quelque part.
« Et maintenant c’est la maison qui commence à s’emplir de sable, comme la coupe inférieure d’un sablier qui jamais plus ne sera retourné. » – Thomas Pynchon, V. (trad. M. Danzas).
Mon essoreuse à salade possède une fonction TURBO. Ma voiture non.
À l’usine, les autres ouvriers avaient réussi à me convaincre que si on ne mettait pas de la viande en continu sur le tapis roulant, les lames des hachoirs s’abimaient à force de tourner dans le vide. Ils en étaient eux-mêmes convaincus.
« l’oasis étincelante des stations-services barbouillées de couleurs fluorescentes sous le dais des palmiers, bientôt enveloppés, le long des corridors des rues, par les brumes nocturnes, l’air de l’adobe, l’odeur de brûlé de feux d’artifice au loin, le monde disloqué qui s’écoule. » – Thomas Pynchon, Vineland (trad. M. Doury).
Le soir dernier, j’ai lancé une partie de Zelda: A Link To The Past, sur émulateur. Je me disais que, peut-être, j’avais assez oublié ma partie précédente pour redécouvrir le jeu comme la première fois. En réalité, j’ai à peine avancé dans le château d’Hyrule, quand on suit son incapable père parti sauver la princesse et déjà bloqué dans le premier couloir. J’ai été pris d’un ennui profond, encore une fois, sans doute, à cause de la lenteur du jeu (qui est pourtant fluide). J’ai abandonné ma sauvegarde, j’ai désinstallé l’émulateur, et je suis passé à autre chose.
Le début d’une nouvelle année est toujours l’occasion parfaite pour faire un bilan que je ne fais jamais.
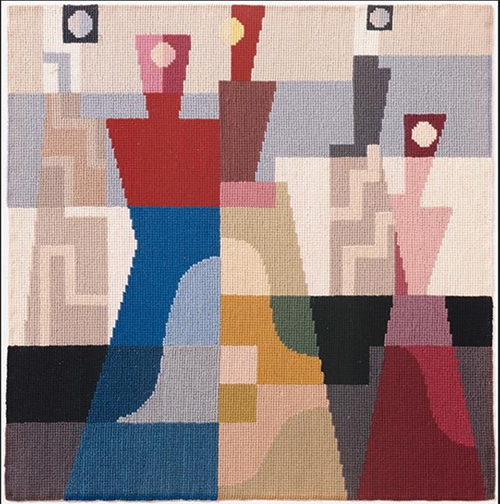
Sophie Taeuber-Arp, Personnages.