2020
Bientôt une nouvelle année, et cette page rejoindra le dossier de ma vie.
Si j’avais pu créer les Relevés à 10 ans, je l’aurais fait. Je suis heureux d’avoir inventé ce merveilleux confident.
J’écris mes plus beaux textes dans les commentaires de vidéos Youtube.
Dylan est assise sur mon lit et me regarde sans rien dire.
Dans ma tête il y a tous mes amis : Rivage, Copperfield, Mista, Sam Delta, Diavolo, Pluton, Nick, Casca, Trish, Scott Pantone, Mircea Speedwagon, Upamecano, Brian Vega, Chloé Price, et tous les autres qui sont moins connus. Ils ont confiance en moi. Ils me disent : maintenant, on est là pour toi. J’aimerais qu’ils ne partent jamais car ils me connaissent comme personne ne me connaîtra jamais. Je n’ai pas besoin de me confier ou de leur expliquer des émotions sur lesquelles je ne mets aucun mot. Certains sont assis sur le sol de ma chambre et discutent ensemble, d’autres jouent à la console, d’autres dorment. Casca regarde par-dessus mon épaule ce que je suis en train d’écrire. Rivage et Copperfield aussi, même si ça les rend tristes. Ils me rendent courageux.
Je vis pour eux et pour leur donner un destin.
Je les aime plus que tout au monde.
Dylan dit : tu y arriveras.
Je me retourne vers elle et elle dit : sois patient, tu y arriveras.
Je souris et je pleure en même temps comme dans les mangas. Quand je bouge la tête les larmes deviennent des perles très visibles.
Dylan quitte le lit et regarde par la fenêtre le ciel d’un bleu artificiel. Je la vois de dos regarder par la fenêtre. J’essuie mes yeux.
Tu n’es plus tout seul, dit-elle.
Ensuite une vague me submerge et tout autour de moi devient vrai.
J’aimerais avoir des conversations intimes en ligne.
Tout ce que je vois me rend nostalgique d’une vie que je n’ai jamais vécue. À bientôt 30 ans, je me demande déjà où j’en suis. J’aimerais vivre à Copenhague mais ne sais pas pourquoi. J’ai toujours en mémoire la pochette d’album de Copenhagen Dreams de Johann Johannsson. Ce n’est pas tant à Copenhague que dans cette image que j’aimerais vivre, car toutes les autres photos de cette ville ne me disent rien. J’imagine rencontrer là-bas quelqu’un qui me comprend et qui éprouve les mêmes émotions que moi. Quand j’écoute She Loves To Ride The Port Ferry When It Rains, je visualise parfaitement la forme que prend mon imaginaire. J’ai peur que ma solitude là-bas soit la même qu’ici et que toutes les villes se ressemblent. J’ai parfois peur d’oublier pourquoi j’aime vivre. Je me demande comment vivent les autres entre chaque événement, et comment une simple marche peut devenir si douloureuse.
Il rassembla en lui-même son esprit bienheureux et son pauvre corps de souffrance et c’est ainsi, sans aucun cortège humain, mais avec un cortège d’anges, qu’il s’en alla vers la vie éternelle.
Quatre heures plus tard.
Dylan est allongée sur mon lit et moi je suis assis par terre. Je ne vois pas son visage ni même vraiment son corps. Je ne sais pas si elle a les yeux ouverts.
Elle me demande si je vais dormir par terre. Je n’avais pas encore pensé à ce qui arriverait après qu’on aurait fini de discuter ; je croyais qu’il n’y aurait pas de pause. Je dis : je sais pas, sans doute.
Je ne sais pas si sa phrase m’invitait à la rejoindre mais dans le doute je reste là. Elle dit : je commence à m’endormir. Je n’ai pas envie qu’elle dorme parce qu’ensuite elle aura tout oublié. Je sors de la chambre et descends m’allonger dans le salon.
Je pense au trajet de chez Cliff à chez moi.
Je pense à la réaction de Dylan quand j’ai proposé de la déposer chez elle. Non, plutôt chez toi, a-t-elle dit.
Dylan n’était jamais venue chez moi. Elle ne savait pas à quoi ressemblait la maison de mes parents ni où elle pourrait dormir. Elle ne savait pas non plus où moi je pourrais dormir.
Dans la voiture j’ai mis un album de Clairo qui a évité qu’on parle. À un moment j’ai cru qu’elle pleurait mais c’est sans doute un prétexte que je cherchais pour avoir quelque chose à lui dire. Au bout du compte je n’ai rien dit, et je ne sais pas vraiment si elle a pleuré.
Je ne sais pas si Dylan est réellement la fille que j’aime ou si je m’y accroche pour éviter que tout le reste ne s’effondre.
Je pense à elle en train de dormir dans mon lit et d’une certaine façon cette image me semble suffisante.
Les choses sont dans l’ordre.
Je pourrais m’endormir si je n’étais pas aussi triste.
et l’enfant bienheureux se mit en quête non seulement d’un lieu de retraite, mais d’un désert et d’une grotte effrayante, quoique sacrée. Ceux qui ont vu l’endroit s’imaginent avoir vu, en un certain sens, l’entrée du paradis.
Chloé Price aura peut-être un vrai rôle dans Miami = Paradis.
J’essaie sincèrement de faire de mon mieux.
Dès que le doute s’installe, je peine à m’en débarrasser. Parfois je pense à ma vie si elle n’était pas celle que je mène, aussi en temps normal je m’efforce de ne pas y penser. Je ne peux jamais anticiper quel sera le déclencheur qui amènera ce doute. Quand il arrive, c’est toujours comme un plein choc. Ensuite, je mets des jours à en revenir. Je n’ai aucune carte pour le voyage retour. Je m’accroche de toutes mes forces à la réalité et j’essaie de détourner mes yeux de l’ombre.
J’aimerais pleurer mais ce qui me manque n’existe pas.
Quelle qu’ait été l’opinion d’autrui sur sa solitude, Jérôme en personne, dans son livre contre Jovinian, exalte celle du sage : « Le sage ne peut jamais être seul ; car il a à ses côtés tous les êtres qui sont et qui ont été bons ; il porte et transporte avec lui, où bon lui semble, son âme libre et il embrasse par la pensée ce qu’il ne peut embrasser, corporellement s’entend. Et si la présence des hommes lui fait défaut, il parle avec Dieu, et n’est jamais moins seul. » – Pétrarque, La vie solitaire (trad. P. Maréchaux).
Trois mois plus tard.
Dylan m’appelle un peu après une heure du matin pour que je vienne la chercher. Elle dit : viens s’il te plaît. Je raccroche et ensuite j’emprunte la voiture de ma mère.
La nuit les arbres n’ont pas la même forme.
soft instrumental music playing
Je pense à la forme qu’ont les mêmes arbres en plein jour mais rien ne vient. La nuit, je ne me souviens pas des choses que je vois le jour. Je pense à la posture de Dylan devant chez Cliff ; je pense à la façon dont elle se tient debout, comment elle croise les bras.
Dans la nuit, elle non plus je ne la verrai pas, et j’aurai oublié à quoi elle ressemble.
Plus tard j’arrive devant chez Cliff et ne vois pas Dylan. J’attends un peu dans la voiture car je ne veux pas que Cliff voit que c’est moi qui viens récupérer Dylan. Je ne veux pas qu’il pense à Dylan et moi dans cette voiture.
D’une certaine façon, je me mets à la place de Cliff.
Je vois la silhouette de Dylan passer devant les phares de la voiture. Deux secondes passent ensuite sans que je sache où elle est, puis la portière s’ouvre.
J’entends l’autre bruit de la portière quand Dylan la referme, et ensuite le bruit que fait Dylan quand elle n’en fait pas.
Au début elle ne dit rien.
Elle regarde devant elle et moi aussi. On peut y aller, dit-elle.
Je vois de la lumière à l’étage chez Cliff et je pense à lui assis dans sa chambre sur le bord de son lit. Je pense à la chanson qu’il écoute et aux sentiments qu’il éprouve. Peut-être que Cliff pleure de colère.
Je mets un moment avant de démarrer.
Je ne sais pas où Dylan veut que j’aille.
Je la regarde en train de penser à ce qui vient de se passer avec Cliff et je ne comprends pas pourquoi je suis là. J’aimerais qu’il fasse jour.
Mon adolescence m’échappe mais il me reste encore les souvenirs pour tout déformer.
Je crois que j’ai peur de vieillir.
Est-ce que l’avoir dit rend la peur plus réelle ?
Dylan me dit : si j’avais réellement vécu, tu n’aurais pas pu me créer. Je ne sais pas si c’est une consolation suffisante.
Dylan m’attend devant le magasin où elle m’a dit de la retrouver ; je la vois de loin avant d’arriver devant elle et je la regarde m’attendre.
D’une certaine façon, elle n’a pas l’air de m’attendre. Si je n’arrivais pas à l’heure prévue, elle partirait sans que mon absence ne la dérange.
Elle ne pense pas à moi.
Il y a plein de gens qui vont et viennent autour de moi et d’elle qui influencent l’atmosphère mais ne changent rien à la façon dont les choses se déroulent.
Quand j’arrive, Dylan me dit que je suis en retard, alors que je suis à l’heure. Elle me dit qu’ensuite elle doit rejoindre d’autres amis qui viennent la chercher en voiture. Elle dit : je n’ai pas beaucoup de temps.
On entre dans le magasin et elle me demande conseil. Elle dit : toi tu choisirais lequel ? Je pense au temps que je vais prendre à lui dire quoi choisir, car je n’aurai pas de temps en plus une fois que j’aurai décidé pour elle. Quand j’aurai fait ce qu’elle attend de moi, elle paiera et rejoindra ses autres amis.
Devant le magasin, elle pensait à eux.
Je pense à une discothèque avec des néons bleu et rouge sur nos visages.
Dedans, la musique qui passe correspond bien à l’ambiance mais pas aux sentiments éprouvés. Je regarde Dylan alors que je suis près du bar et elle en train de danser. Si la musique correspondait à ce que j’éprouve, il n’y aurait personne dans la discothèque.
Dylan non plus ne serait pas là.
Je pense que la musique est une sorte de camouflage.
De retour dans le magasin, je la vois qui me regarde avec impatience car elle veut que je parle et la libère. Je la regarde et je regarde les rayons devant nous, et je dis : celui-là me semble bien. Je prends l’objet dans ma main et lui dis : ouais, prends celui-là, ça ira.
Quand je le lui tends et qu’elle le touche, je sens ce qu’elle touche.
Je sais comment elle touche cet objet car je l’ai touché moi aussi juste avant.
Elle dit : ok, super.
Elle paie et sort comme je l’avais dit. Dehors, elle a l’air gênée. Elle sait que tout est allé trop vite. Elle sait que même vis-à-vis de moi, c’était trop rapide. Elle reste devant le magasin car on dirait qu’elle ne veut pas me quitter mais pour de mauvaises raisons. Je pense : ne pars pas.
Je pense à la discothèque sans personne dedans.
Je pense à une autre discothèque ouverte en même temps et dans laquelle elle serait.
Je pense aux différentes couleurs dans les deux discothèques.
La discothèque avec moi dedans ressemble à ma chambre ; il y a des posters de gens que j’aime mais qui ne me connaissent pas. Quand je regarde par la fenêtre, je sais où les voitures vont. Je comprends pourquoi je suis là.
Dylan me demande si je l’écoute.
Je dis oui mais je n’ai rien entendu.
Elle a dû me dire qu’elle y allait car elle y va ; elle part et on inverse les rôles de tout à l’heure.
Je reste devant le magasin. Quand elle arrive là où j’étais, elle ne se retourne pas pour me regarder. Si elle pense à moi, ce n’est pas comme quand je pensais à elle.
Quelques fois dans ma vie je n’ai pas été sur le moment triste d’avoir rendu des personnes tristes.
La tristesse est venue ensuite.
(Je cache dans les archives des Relevés des souvenirs que je ne veux pas qu’on trouve.)
Pidi est au local et comme l’occasion s’y prête elle va faire son premier tatouage.
En plus Valouzz n’est pas là donc elle l’a appelé en Facetime. À l’écran, Valouzz n’avait pas l’air ravi. Clairement, dit Pidi, il était pas du tout chaud, pas du tout prêt.
Ce que Pidi veut, c’est un 100 %, parce qu’en fait elle a un frère jumeau, et ils sont Djum 100 %. Depuis plusieurs années ils s’appellent 100 % Djum.
Bouzi demande si ça va tatouer sale.
Pidi est hyper stressée. En plus, elle a choisi le pire endroit. Après avoir vu le tatouage, elle est plus sereine. Elle va faire le tatouage en rouge, parce que l’émoji forcément il est rouge.
Pidi dit au tatoueur qu’il y a de l’histoire et que le tatouage est significatif. Elle lui raconte un peu : en fait elle a un frère jumeau, et en fait comme ils sont hyper fusionnels, ils disent qu’ils sont 100 %.
Comme le tatoueur est venu au local, Pidi se dit que c’est le moment. Elle a totalement confiance.
Elle explique à Bastos que dans le son qu’ils ont fait avec Bouzi, il a fait la punchline : le sang de la veine c’est Djum Djum Djum. Et Bastos dit : ok.
Pidi veut son tatouage là, sur la côte. Elle commence à stresser, ça se voit à sa tête.
Le tatoueur montre les tests et Pidi adore de ouf.
Pidi s’allonge sur la table et elle a le coeur qui bat fort. Je suis pas une chochotte, dit Pidi. Celle-là elle est pour toi, dit-elle à Djum.
Surtout, il ne faut pas qu’elle bouge.
Elle sue et appelle à l’aide. La vérité c’est pas une chochotte mais là nique sa mère ça lui fait trop mal.
Il faut avoir mal, dit Bastos.
Au bout d’un moment le tatoueur a fini de tatouer.
Ah ouais il est magnifique, dit Bouzi. Franchement c’est niquel, dit quelqu’un d’autre.
Quand Pidi se regarde dans le miroir, elle est vraiment heureuse et elle dit : il est très beau. Elle est trop contente et elle remercie le tatoueur. Il est stylé de ouf, dit-elle, je suis trop happy putain. En vrai il beau, dit-elle.
Ce tatouage il t’est 100 % dédié, dit-elle à Djum.
Holy shit, dit Djum. Je suis mort, dit-il ensuite en applaudissant. Oh my fucking god, dit-il enfin.
Elle a fait son premier tatouage 100 % Djum.
Djum dit : des barres, t’as fait un 100 %. Par contre, lui il l’aurait fait en noir. En tout cas, Djum pensait jamais qu’elle allait le faire.
Maintenant, il va falloir le dire à Valouzz.
3 jours plus tard, Pidi montre le tatouage à Valouzz. Elle n’a pas pu le faire avant parce qu’il était occupé, il travaillait, etc., donc elle préfère voir sa réaction maintenant. Au moins le tatouage a eu un peu le temps de cicatriser et surtout elle a plus le pansement.
Roulement de tambour, dit Valouzz, on allume les lumières.
Valouzz trouve que le rouge ça fait bizarre. Il trouve que c’est stylé parce qu’on dirait pas un tatouage. On dirait que c’est une griffe, dit Valouzz, mais qui fait un 100. Valouzz dit : en vrai c’est stylé mais à la fois ça fait bizarre.
Car Valouzz n’aime pas les tatouages de base. Et les tatouages en couleur, il est encore moins fan.
Après c’est son avis, mais Valouzz trouve que les tatouages ça salit le corps. Genre se faire tatouer le bras et tout, ça salit le corps.
Valouzz espère bien que Pidi s’en fera pas des centaines et des centaines. Il dit : imagine un jour t’arrives à la maison et t’as des tatouages sur tout le corps.
En vrai, sur 10, Valouzz mettrait un 6.
Pidi s’attendait à pire.
On ne se rend jamais compte de tout le travail encore à fournir sur un texte qu’on croit pourtant terminé.
Regarder les strates de textes qui se superposent est une occupation fascinante qui ne me fascine pas.
Je me dis qu’il est incroyable que mon ordinateur ralentisse sur un logiciel de traitement de texte, quand bien même il comporte trois strates d’annotations et de corrections. À quel point l’informatique a progressé pour en arriver là.
Entre le moment où j’ai écrit le paragraphe précédent et celui-ci, mon logiciel a d’ailleurs planté.
Je travaille encore en écoutant le deuxième album de Placebo.
L’année dernière, j’écrivais un projet noir qui ne verra jamais le jour, dans lequel je me servais de la figure ambiguë d’honebrine. Par exemple, il y avait ce poème.
à 3:21
honebrine
envoie le fichier
carl.avi
dans lequel
on voit un ado
se faire taillader
les bras
et les yeux
au cutter
Plus loin, il y avait cet autre passage dans lequel un personnage expliquait ce qu’il pensait que honebrine était.
j’ai fait des recherches sur honebrine et apparemment c’est une sorte de bot ou de pnj, personne sait vraiment, qui apparaît comme ça aléatoirement en ciblant un joueur, et ensuite il vient te hanter dans ton sommeil et te briser psychologiquement jusqu’à ce que tu meures ou que tu disparaisses
Aujourd’hui, je découvre cet article dans mes RSS : Minecraft is haunted and Twitter too
Herobrine shows a lot of characteristics of being a form of virus, such as manipulating game worlds, deleting threads and sending messages through the Minecraft Forums.
Tout le monde est hanté par les mêmes fantômes.
Quand les deux compagnons les aperçurent, ils ne voulurent pas les poursuivre mais ils s’approchèrent de la vieille aux cheveux gris, la saisirent et la jetèrent en bas de la falaise. La vieille se mit alors à rouler d’une roche sur l’autre et termina sa chute dans la rivière. Ils jetèrent ensuite le corps de tous ceux qu’ils avaient tués. – Les Premiers Faits du roi Arthur (trad. I. Freire-Nunes).
N’empêche, l’énergie que perd tout un tas de gens à communiquer sur ce qu’ils font : auteurs, éditeurs, libraires, on dirait que rien n’existe sans en parler. Désormais, l’angoisse est de passer inaperçu.
Est-ce que c’est la précarité de l’époque qui oblige à nous rendre si commerçants.
Par curiosité, tentez encore de créer quelque chose dont vous ne direz rien ; faites-le pour vous.
Je me demande parfois si je suis un bon témoin de mon époque.
Il s’agit de voir aussi bien dans le passé que dans l’avenir car la chose vient d’un passé extrêmement reculé mais je crois que son avenir est proche.
Parfois j’oublie à quel point c’est bien d’écrire.
Si on ferme les yeux sur notre époque qui est un monde dans lequel il y a en même temps tout un tas de trucs qui n’ont rien à voir ensemble, évidemment on ne peut rien créer de bon. Aucune matière n’est pure. Si vous pensez pouvoir parler du Sublime sans y intégrer les nouveaux processeurs Intel ou la colonisation de Mars, tant mieux pour vous, mais à mon avis vous faites fausse route.
Même à Jérusalem ils ont des drones.
Maxime Michel était un de mes meilleurs amis à l’école primaire. Maintenant, quand je tape son nom dans Facebook, je me rends compte qu’il vit à Taiwan, et que lui et sa femme GiaGia Chang ont eu une petite fille qui s’appelle Zelda. Zelda a toujours été la licence Nintendo préférée de Maxime. En primaire, on jouait à Ocarina of Time sur sa N64 et il avait des posters de Link dans sa chambre. Quand on jouait à Super Smash Bros, il prenait toujours Ganondorf. Il adorait vraiment Zelda, et maintenant il peut appeler sa petite fille pareil.
Lou Pichard était un autre de mes meilleurs amis au primaire. En 5ème après le challenge il a embrassé Marine Hercouët alors que j’étais amoureux d’elle depuis le début d’année. Il ne le savait pas et elle non plus. Je crois que c’est après cet événement que j’ai arrêté d’être son ami, même si je n’en avais pas conscience à l’époque. Le 14 octobre 2010, c’est lui qui a marqué le but qui a donné la victoire au FC Lamballe contre le Cob. Le Télégramme avait écrit que c’était une victoire encourageante pour l’avenir. Maintenant il est SEO chez Itelios, une entreprise qui appartient à Capgemini. Il n’a rien écrit sur Twitter depuis 2018.
Si je ne croyais pas dans les images mystiques de mon coeur je ne pourrais pas arriver à leur donner la vie.
Grâce à mon nouveau setup je suis devenu le meilleur joueur d’échecs au monde. Une sonde chinoise est revenue sur Terre avec des échantillons de la Lune. Elle a atterri en Mongolie dans une plaine avec personne sauf des chevaux sauvages. Pendant un moment elle a vécu libre. Je roule partout dans un buggy électrique de luxe dont les roues motrices s’adaptent parfaitement à la difficulté du terrain. Je peux profiter du paysage et pleurer en écoutant U2. Quand Bono chante you’re all that’s left to hang on, i’m still waiting je le comprends comme si c’est moi qui chantais. Les émotions sont sincères quand elles sont éprouvées dans des paysages sublimes comme la Mongolie ou la Lune, qui en plus d’être sublime est céleste. Si les chevaux sauvages avaient des lecteurs mp3 ils pourraient mieux comprendre ce que le rock des années 80 a apporté à l’humanité.
Comme mon énergie se disperse plus vite qu’auparavant, je tente de canaliser mes zones d’attention. Savoir comment les gens peuvent me joindre, ce que je prends du temps à regarder et comprendre, comment je communique avec mon entourage. Je simplifie tant que je peux simplifier, surtout pour ne pas m’épuiser, pour ne pas laisser les choses en attente. J’essaie d’être le plus clair et précis possible. Je veille à faire bien, et cela implique en ce moment de faire moins.
Je veux savoir maintenant après dix ans d’internement et de travail occulte contre le Mal où en est arrivé le Monde et s’il opte pour Dieu ou pour Satan. – Antonin Artaud, Nouveaux écrits de Rodez.
Entre différents auteurs d’une même génération circule un sentiment commun qui influence propos et forme sans s’être pourtant lus.
S’en détacher demande non seulement de la volonté, mais surtout un éveil ; une forme de dépassement qui transcende le lieu et l’époque, où pourtant la tentation est grande de rester enfermé (par le milieu notamment, mais pas que).
Cette transcendance doit quitter l’atmosphère commune pour atteindre autre chose. Je me sens incapable de mieux le formuler pour l’instant.
Il n’y a pas de mode d’emploi pour cela. Par génération, seules quelques personnes (à peine dix) y parviennent, car elles s’y obstinent.
Souvent, ceux qui pensent le mieux savoir qui sont ces dix personnes se trompent complètement.
Je note énormément d’idée pour Casca revient, qui doit être réfléchi comme un pont solide entre Rivage au rapport et Miami = Paradis (car ce qui s’y déroule change radicalement tout).
Opicino écrit d’abord pour lui-même des textes cryptiques dont lui seul a la clé. Cherchant à réconcilier les termes d’une réalité qu’il perçoit comme scindée, il tente de colmater les failles d’une unité qui se dérobe.
Scott Pantone dessine des cartes qu’il est le seul à pouvoir déchiffrer.
Quand il dessine ses cartes, il est possédé par une force divine qui influence sa main pendant plusieurs heures sans interruption ; ses fulgurances que des savants ont qualifié d’épileptiques ne sont comprises qu’à 15 %, même par lui.
Pantone est une sorte de réceptacle à l’esprit de quelqu’un d’autre.
Et il vend très cher ses cartes à des musées et à des milliardaires esthètes, qui croient y voir le chemin vers un trésor millénaire.
Il y a trois ans, cet esprit lui a fait dessiner une carte avec des paysages côtiers et des symboles mystiques entremêlés. Pantone a mis deux semaines à dessiner cette carte, au bout desquelles il est ressorti de chez lui très maigre comme un mendiant.
Cette carte, après l’avoir finie, il a su qu’il ne la vendrait pas, car pour une fois il avait compris à 100 % ce qu’elle voulait dire.
Ensuite Pantone s’est mis en route en suivant le chemin que cette carte lui indiquait mais il a mis longtemps avant de trouver une piste assez solide, qui devait au bout du compte le mener à Myriad Pro.
La carte ne symbolisait pas à proprement parler Myriad Pro et personne d’autre que Pantone n’aurait pu comprendre en la lisant qu’il fallait aller là-bas.
Quand il est arrivé à Myriad Pro, Pantone a pensé qu’il était au bon endroit et il a acheté tout de suite un appartement gigantesque grâce à la vente de ses cartes et au faible coût de l’immobilier. Puis il a continué ses recherches, sans dessiner de nouvelles cartes. Comme si toutes les autres cartes avant n’étaient que des brouillons de cette carte qui était la dernière.
Comme une sorte de carte ultime dans sa conception et dans son message.
Deux ans et demi ont passé ensuite et Pantone est arrivé au bout de ses recherches. Il savait quel trésor la carte lui indiquait et où il pouvait le trouver. C’est aussi à cette époque que Pantone a commencé à tuer selon un mode opératoire violent et précis que les inspectrices Nocturne et Leblanc ont déjà identifié.
Pourtant, un matin, il s’est aperçu que le dessin sur la carte n’était plus le même. Il n’avait rien dessiné pendant la nuit, mais les paysages et les formes avaient été supprimés, déplacés ou modifiés.
Myriad Pro n’apparaissait plus, ni le trésor.
Scott Pantone avait perdu la trace qu’il suivait depuis tout ce temps, et il ne comprenait plus cette carte, comme les précédentes, qu’à 15 ou 20 %. Il a continué à vivre encore trois mois dans son appartement à Myriad Pro, obsédé par cette nouvelle carte qu’il ne comprenait plus, passant chaque heure de chaque journée dessus si bien que ses yeux étaient devenus rouge.
Il pensait : je suis maudit, car il avait toutes les raisons de le penser.
Mais un autre matin, pareil à ceux d’avant, la carte avait retrouvé son sens.
Le trésor était là, et il se déplaçait.
Alors Pantone a mis son appartement en vente, et il est parti pour Portobello.
Chose rare quand je lis un livre, mais deux passages des Premiers Faits du roi Arthur m’ont donné la chair de poule : la charge de Gauvain pour venger sa mère humiliée, et le premier affrontement entre Arthur et le roi Rion. Je vous les conseille.
Le soleil baissait déjà, si bien que l’obscurité envahissait tout à cause des montagnes alentour et du bois qui masquait la lumière.
En début de semaine, nous avons discuté pendant plus de deux heures avec Benoît des modifications à apporter à Rivage au rapport, après les premières corrections.
En ce moment je dors beaucoup, de neuf à dix heures par nuit, pourtant je me réveille toujours épuisé. L’occupation de mes journées a une influence très forte sur mon moral général, et il m’arrive quand la nuit tombe de ne plus avoir de motivation pour rien.
Les conditions de travail étranges (peu d’échanges par email, rendez-vous perpétuellement ajournés ou annulés, depuis mon appartement) n’aident pas à donner de la consistance aux heures passées sur l’ordinateur.
Je rends mon cerveau disponible à des tâches qui n’arrivent pas.
Parfois je rêve d’une autre vie, sans savoir laquelle.
Je veux quitter les routines et les réflexes qui me pèsent.
L’un des hommes du XIVe siècle qui a le plus abondamment écrit sur lui-même ne nous fournit aucun portrait univoque ; il laisse au contraire les historiens dans l’embarras face au sens exact de sa démarche. C’est qu’en dépit de tous ses efforts pour se comprendre, il demeure opaque à lui-même. – Sylvain Piron, Dialectique du monstre.
Souvent quand je fais du yoga je pense : respirer dans la douleur. Car c’est ce que me semble être cette pratique, une voie de détente dans un corps malmené.
C’est seulement après plus de huit ans à écrire dessus que je me rends compte que les Relevés peuvent devenir une plus grande chambre d’échos que je n’imaginais. C’est une sorte de cercle vertueux : plus j’avance dans mon travail littéraire, et plus les Relevés attirent ceux qui veulent en découvrir davantage ; dans le même temps, plus les Relevés grossissent, et plus ils consolident mon travail littéraire.
Une sorte de communauté souterraine, patiente, et lente, comme moi.
Toute proportion gardée, je pense qu’un type comme Dennis Cooper a aussi construit sa mythologie comme cela (à tel point que ses lecteurs finissent même par accorder de l’attention à des gif novels).
Dès que Merlin eut quitté Léonce, il s’en alla voir une jeune fille très belle ; elle était très jeune et résidait dans un beau château très riche, dans une vallée au pied d’une montagne arrondie, tout près de la forêt de Briosque qui était très plaisante et agréable pour la chasse, car elle était riche en biches, en cerfs et en daims. – Le Livre du Graal (trad. I. Freire-Nunes).
Pidi est dans sa salle de bains car elle va refaire ses cheveux.
Elle a des mèches un peu cuivrées, mais elle ne peut plus les voir. Donc aujourd’hui, elle va se refaire une tête.
Pidi va être une nouvelle femme.
Elle est allée s’acheter du stuff, des petits pinceaux. Normalement, elle a du bon matos pour se faire une nouvelle tête.
Avant de commencer, Pidi a reçu un nouveau bébé : un petit robot qui aspire tout seul. C’est clairement le feu. C’est l’aspirateur Robotrock. Pidi est vraiment contente car elle a reçu ce nouveau joujou gratuitement pour le tester et voir ce qu’il donne.
Et c’est plutôt le feu car il aspire tout seul.
Pour dire à quel point ça aspire : Pidi a une femme de ménage qui vient tous les vendredi chez elle, elle aspire même plus.
La femme de ménage a vu que Pidi avait un robot et elle a dit : ok je vois que maintenant on fait le travail à ma place, j’aspire plus.
Mais il ne fait pas que aspirer, il lave aussi, donc c’est plutôt pas mal.
Avec Valouzz, ils l’ont appelé Bob.
Franchement, c’est le top.
Et maintenant, let’s go sur la teinture.
Déjà, Pidi va peigner tout ça pour avoir zéro noeud. Les cheveux de Pidi sont gras mais pour que la couleur pénètre bien il faut la faire sur cheveux sales. Déjà elle est là à faire la belle alors qu’elle n’a même pas encore fait sa mixture.
Dans un bol, Pidi met du révélateur et une coloration ton sur ton moca latte 7.8
Pidi a vraiment peur.
Elle appelle sa meilleure pote, parce qu’elle est coiffeuse. Et sa meilleure pote lui dit : il fallait doser. Elle dit à Pidi de bien touiller pour que la mixture soit vraiment liquide. On dirait des blancs en neige, dit-elle.
Pidi se munit de ses plus beaux gants bleus et commence à teindre ses mèches. Elle dit à sa mère : ne m’en veux pas, pour Noël je vais être une bombe.
Elle a trop peur.
Si jamais elle se rate, elle va voir sa meilleure pote sur Lille et elle l’arrange.
En vrai elle s’en sort plutôt bien. De toute manière, elle a fini le pot. Elle va laisser poser 20 minutes et pendant ce temps elle n’hésite pas à mettre en route le petit robot.
Valouzz demande si Pidi a mis Bob en route et si elle a fait un truc sur ses cheveux.
Pidi dit : bah ouais, mais Valouzz voit zéro diff. Il a juste l’impression que ses cheveux sont mouillés, c’est tout.
Valouzz n’a pas peur car il ne sait pas trop à quoi s’attendre.
Bob a un problème.
Valouzz demande : ça va Bobby ?
Houlala, dit Pidi.
Bob s’en sort finalement très bien tout seul.
Mais c’est le boss en fait Bob, dit Pidi, parce qu’il fait les tapis et tout.
Pidi explique à Valouzz qu’il n’y aura plus de petites mèches cuivrées, elle sera vraiment brune brune. Tout ça pour ça ? demande Valouzz, qui pensait qu’elle allait faire une coloration qui allait se voir.
Quand Pidi se rince les cheveux, elle n’a plus d’eau chaude. Elle crie car elle se rince les cheveux à l’eau froide. Après, elle est en plein shampoing. Après, elle fait le petit soin. Elle est plutôt confiante de ce qu’elle a fait. Après, elle se sèche les cheveux.
Elle met un petit protecteur de chaleur pour les protéger du lisseur.
En vrai, elle est conquise.
Valouzz est dans le fauteuil massant et dit : éblouissante. Mais en fait, sous la lumière, il ne voit pas la différence.
Pidi dit : c’est parce que t’es daltonien, parce qu’elle est sûre qu’il y a de la différence.
Pidi a beau lui expliquer que les reflets ne sont plus là, Valouzz voit juste des cheveux marrons. Il dit : moi je vois des cheveux marrons.
Sa meilleure amie demande à Pidi de tourner et trouve ça bien. Valouzz ne voit pas de diff mais sa meilleure amie si. Elle dit : c’est bien.
Pidi pensait que Valouzz dirait qu’il a une nouvelle femme mais en fait il ne voit rien.
De son côté, Bob retourne tout seul à sa station de chargement.
Valouzz n’aura jamais à passer l’aspirateur.
Dans Le Livre du Graal, là précisément dans Les Premiers Faits du roi Arthur, on trouve des tournures vraiment amusantes, comme (trad. I. Freire-Nunes) :
Haran, le fils de Bramangue, était entré en Loénois et avait pas mal ravagé la contrée en passant
Ou encore :
ils se dirigèrent vers eux et se mirent à accomplir de tels prodiges, un tel massacre, que c’était vraiment un spectacle étonnant.
Il y a comme ça fréquemment des décrochages dans le ton qui entretiennent une forme de proximité orale avec le lecteur, et donnent envie de continuer la lecture comme on dirait à qui nous conte de poursuivre son histoire.
Parfois, j’ai des lectures parallèles qui m’amusent, comment en ce moment Uzumaki, Les incommensurables et Le Livre du Graal. Je trouve ce croisement auquel je me trouve particulièrement caractéristique du XXIème siècle.
J’apprends qu’en France, si vous achetez un terrain, vous en êtes propriétaire jusqu’au centre de la Terre ; un bout du noyau de feu aussi est à vous.
On reconnaît de bonnes bougies en plastique à ce qu’elles paraissent être en cire ; idem pour les plantes.
Tenir un site sur le long terme, c’est aussi accepter constamment celui que nous étions hier et qui avait tous les défauts.
En fait, on ne connaît que 4 % de la structure de l’univers ! – Sophie Houdart, Les incommensurables.
Quand ils arrivent à Barrow, Upamecano explique à Casca et Trish qu’il n’y a plus aucun natif en Arctique parce que soit ils ont été tués, soit ils sont partis travailler dans des centres commerciaux comme tout le monde.
À la place des natifs il y a des scientifiques, mais ils ne jouent pas du tout le même rôle. Ils sont là surtout pour faire des expériences, et pas tellement pour vivre. Ils ne restent pas toute l’année en Arctique, dit Upamecano, sinon ils deviennent fous. Il fait une boule de neige et la jette comme ça quelques mètres plus loin ; la boule de neige arrête d’être boule. Ici, tout le monde devient fou, dit-il enfin.
Un ours polaire passe au loin en marchant à quatre pattes et pense à des trucs d’animaux en voie d’extinction.
Les portes d’un nouveau royaume.
Monsieur Bison, Petitchateau, Vega et Guile.
Bryan Fury, Gun Jack et Panda.
Les auteurs en mal d’attention ont trouvé sur Facebook le parfait lieu où croire qu’on écoute ce qu’ils disent.
On s’interroge forcément sur sa trajectoire : vais-je connaître le succès, la reconnaissance des pairs, une forme de sérénité qui allie confiance en son travail et vérité des regards. Quelles sont les raisons qui nous confèrent une place ; dans quels motifs les autres trouvent-ils la valeur que l’on pense mériter. Par quel chemin arrive-t-on mort plus entier qu’au début.
Quels jeux joue-t-on et auxquels voulons-nous jouer.
Pourquoi s’attrister de ne pas être dans le champ quand il n’y a pas de mode d’emploi.
On ne perçoit la valeur d’un événement qu’avec les yeux de dix ans plus tard. Et souvent, cet événement n’apparaît pas.
À votre avis, pour quelle oeuvre Shakespeare aurait-il gagné un prix ?
Les cendres sont jetées au vent ; les traces du sorcier, effacées, parce que contagieuses. La place publique en est nettoyée. Mais pas la mémoire : la polémique va se multiplier, une littérature proliférer, nées précisément de cette dangereuse absence.
En ce moment, à cause du travail à distance, j’interroge davantage mes outils numériques. Je m’aperçois que ceux qui restent sont ceux qui fonctionnent le plus simplement. Par exemple, je pense qu’un outil comme Discord est voué à disparaître de nos usages, car son interface et son usage sont suffisamment compliqués pour dissuader. Moi-même je l’utilise moitié à reculons, et pas du tout quand je n’y suis pas obligé. Il ne fait rien qu’un salon IRC ou un forum ne faisait ; il est lourd et brouillon.
Après presque quinze ans en ligne, les outils que j’utilise au quotidien sont ceux qui me demandent le moins d’effort : cette page, Firefox, Thunderbird, Adium pour communiquer avec Fabien, et Vienna pour mes RSS. Au fond, mon usage du numérique se limite à ces quelques outils, mais ils remplissent parfaitement leur rôle. J’utilise Nitter si besoin pour récupérer les flux RSS des rares comptes Twitter qui peuvent encore m’intéresser.
Ce sont des outils qui m’ont suivi sans faillir à travers les années, et que je prends toujours plaisir à utiliser. Ils me permettent de créer, communiquer et m’informer.
Si j’ai pu utiliser un service comme Google Drive/Docs par le passé pour collaborer en ligne, je ne l’utilise plus aujourd’hui. C’est un outil lourd, lent, contraignant car il demande de s’identifier, etc.
J’aimerais qu’Internet soit plus simple qu’il ne l’est, ou que ce qu’on en a fait ; que tout le monde retrouve un usage spontané d’outils qui durent.
Les sites les plus puissants nous ont désappris les usages de base : qui enregistre encore des pages en favoris, sélectionne et agence ses informations, partage dans un forum ou envoie des mails pour prendre des nouvelles, écrit ses pensées dans un endroit qui lui est personnel ?
Je ne veux pas qu’Internet me devienne un obstacle.
Pourtant, partout où l’on me donne rendez-vous, je rechigne à venir.
Est-ce que je vieillis.
Au début de tout ça, il doit y avoir du plaisir, non un poids. Je n’utilise pas Internet pour avoir l’impression que tout est aussi compliqué qu’en vrai, mais pour y voir clair.
L’anormalité des faits et la contrariété des interprétations ouvrent donc dans le voir la faille du doute. Dans le scepticisme ambiant, [les médecins] la ressentent comme une incertitude épistémologique : il y a de la tromperie. Mais où la localiser ? Question voisine de celle qui consistait à faire quelque part une place à l’inconnu.
Dans le ciel le vent déforme les nuages en spirales et amène avec lui un bruit de saxophone angoissant. Casca regarde les spirales et pense à la fin du monde.
Dans la chambre il y a un lit une place, une table avec une lampe d’appoint et une chaise du même faux-bois, une télé, des radiateurs longs et bas, un porte-manteau, une penderie, des cintres sans vêtements, de la moquette, un mort, deux miroirs quasiment à côté, une télécommande qui permet d’utiliser la télé à distance, un téléphone pour appeler l’accueil, des échantillons de thé et de café, une serviette en papier, un petit plateau en plastique, et d’autres objets dans les tiroirs des deux tables de chevet.
Au XVIème siècle, les ordinateurs n’existaient pas encore.
J’aimerais vivre dans une commune de moyenne taille.
La langue du diable est une autre langue, où l’on ne s’introduit pas grâce à un apprentissage. De ces mots, on doit être « possédé », sans les entendre. – Michel de Certeau, La possession de Loudun.
Je me contente toujours du minimum d’informations nécessaires pour inclure une idée extérieure à mon travail ; je déteste approfondir. Pour un sujet, un livre, peut-être deux, et cela est largement suffisant. Je privilégie davantage les approches que le détail, car le détail restreint mon imagination : plus j’en sais, moins je crée.
Pense-bête : la parousie est précédée par le règne de l’Antéchrist.
En 1894, Cyrus Teed, médecin et alchimiste, créa avec ses disciples une communauté utopiste à Estero en Floride. En 1897, ces disciples firent des calculs à Naples qui prouvèrent la concavité de la courbure de la Terre.
Miami aussi se trouve en Floride.
(Si on ne peut plus photographier les flics, on peut toujours les décrire.)
La Théomanie a pour objet les idées qui se rapportent à l’être suprême, aux anges, à la mysticité, aux miracles, aux prédictions d’événements futurs. Les théomanes se croient toujours prophètes ; c’est Dieu qui parle par leur bouche ; ils ont la prétention de réformer les religions et de faire des miracles. Ces exaltés ont des hallucinations, des illusions, des visions en rapport avec leurs idées délirantes, phénomènes qui les confirment dans ces idées. – Pierre Déléage, La folie arctique.
Forcément, le risque d’écrire la suite d’un livre à paraître, c’est qu’on est très tenté de modifier le premier à partir des nouveautés stylistiques qui apparaissent dans le second, et qui pourtant ne peuvent pas y exister.
En bref, il faut toujours que le projet publié soit conforme à l’intuition initiale. Sinon, les déformations, ou devrais-je dire les malformations, apparaissent, et on écrit autre chose. Et alors, cela peut être pour le pire.
Rivage au rapport doit tenir sans Casca revient (le garder en tête quoiqu’il arrive).
Je ne lis plus aucun roman contemporain.
Fabien m’a appris l’existence d’un certain François69113 qui, voulant créer ma page Wikipédia, a créé une page à mon propos dans sa page de profil à lui. J’aime bien cette incompétence. À cette occasion, j’ai remarqué que dans les sources de la page se trouvait l’adresse vers les Relevés, qui décidément sont connus de tout le monde. Donc, une fois ma page Wikipédia bien répertoriée, quand je ne sais pas, je changerai pour de bon l’url (ai-je dit à Fabien).
Je ne crois pas que Yucca Mountain soit une solution ou un problème. Ce que je crois, c’est que la montagne est le lieu où nous sommes, le point où on en est – un lieu que nous avons étudié en long et en large, plus que n’importe quel autre endroit du monde – et qui pourtant reste inconnu, révélant l’étendue de la fragilité de ce que nous pouvons connaître. – John D’Agata, Yucca Mountain (trad. S. Renaut).
Pidi est super contente aujourd’hui, parce qu’elle va faire une petite recette qu’elle n’a jamais faite, et qui est pourtant simple et qui plaît toujours.
Pidi montre une énorme cagette remplie de pommes et dit : on va faire une tarte aux pommes. On est obligé de faire masse recette avec des pommes, dit-elle.
Voici la raison pour laquelle elle a des grosses cagettes de pommes, mais aussi de pommes de terre : un jour, elle va au local, elle revient chez elle, et là, elle voit les cagettes.
Et Valouzz lui dit : un maraîcher est venu sonner à la maison et il a voulu me vendre des trucs. Il faisait trop de peine à Valouzz, donc il lui a dit qu’il voulait prendre des pommes et des patates parce qu’il fait beaucoup de raclettes.
Mais Valouzz est aussi un fana de jus de pommes, donc le maraîcher lui a mis des pommes. Il y avait plein de sortes, a expliqué Valouzz à Pidi.
Du coup Pidi et Valouzz se retrouvent avec 15 kg de pommes et 15 kg de patates ; et aussi au moins 15 bouteilles de jus de pomme.
Valouzz en a eu pour 140 balles de pommes et de patates.
Donc Pidi est obligée de liquider les pommes, et elle fait la tarte aux pommes en suivant les indications de la recette sur le Thermomix.
En plus, les pommes ont extrêmement de bienfaits, dit Pidi, donc manger des pommes c’est trop bien.
Au bout d’un moment, il faut cuire la tarte. Malheureusement, la tarte ne rentre pas dans le petit four de Pidi ; elle n’avait pas pensé à ça. Oh non, je suis trop deg, dit-elle.
Valouzz arrive et dit : ah ouais là y a un souci. Il propose de faire cuire la tarte dans le four d’Apo, et ensuite il mange de la compote.
On dirait une vraie compote, dit Valouzz.
Ton four c’est mon four, dit Apo. Du coup Pidi va chez Apo, pas le choix. Elle en a profité pour faire deux petits ramequins pour que Doc Jazy et Apo puissent goûter la compote de pommes. Elle utilise leur four mais elle les met quand même bien, elle va les régaler.
Elle est belle, dit Apo en découvrant la tarte, elle est vraiment belle.
Elle est belle, dit Pidi quand la tarte sort du four d’Apo. Elle donne grave envie, dit Apo.
Pidi a l’impression que la pate n’est pas trop trop cuite mais c’est sans doute parce que la compote l’a humidifiée.
Oh elle est bonne, dit Apo après l’avoir goûtée, elle est trop bonne. Pidi trouve qu’elle n’est pas hyper sucrée, c’est le juste milieu. Apo est d’accord.
10/10, dit Apo, parce que y a rien à dire.
Pendant ce temps, Valouzz avait le ventre qui gargouillait et il s’est fait un petit bol de céréales devant le foot.
Donc quand Pidi revient il goûte la tarte et dit : elle est vraiment hyper bonne. Elle est parfaite, dit-il, cuisson parfaite, recette parfait, goût parfait, on dirait une tarte de grand-mère.
À la fin il dit à Pidi : t’imagines quand t’auras 50 ans, tu vas faire des trucs de ouf du coup.
Et Pidi est trop contente, parce que tout le monde a kiffé sa petite tarte aux pommes.
On nous dit que la veille [de son suicide] Mishima brûla son journal intime : soin banal qui ne change pas grand-chose aux faits quotidiens : avec ou sans journal, la vie continue. – Marguerite Yourcenar, Mishima ou La vision du vide.
Je ne sais pas si Araki a lu Mishima (d’après mes brèves recherches en ligne, non), mais je lis pourtant dans Mishima ou La vision du vide de Yourcenar, à propos de La Mer de la Fertilité :
La prenante vertu de cette tétralogie tient en la notion de réincarnation qui sous-tend toute l’oeuvre. […] L’insistance au long des quatre volumes de La Mer de la Fertilité sur les trois grains de beauté qui marquent à la même place l’épiderme pâle de Kiyoaki, la peau hâlée d’Isao, et la peau dorée de la princesse thaïlandaise irrite plus qu’elle ne convainc.
En dehors des remarques esthétiques de Yourcenar sur le procédé, ces « trois grains de beauté » ne peuvent que me rappeler la marque de naissance des Joestar dans Jojo’s Bizarre Adventure, cette étoile noire tatouée, ou plutôt incrustée, derrière l’épaule gauche des héros et héroïnes de la série, ainsi que de DIO, l’antagoniste principal, et qui se transmet de génération en génération ; symbole de l’attachement inné à un combat éternel.
Ce parallélisme entre deux oeuvres d’une même nationalité, qu’on ne doit pourtant jamais relier, m’a amusé, d’autant que seulement seize ans les séparent. Je me demande si la réincarnation est forcément représentée par une similitude corporelle, qui marche comme un repère pour les personnages-témoins, ou s’il s’agit d’une invention partagée seulement par ces deux artistes.
Sur le site We Mystic, Laura titre un article dont la lecture est estimé à 4 min : Est-il possible d’avoir des marques de naissance d’une vie passée ?
Sur le site Mémoire des Vies Antérieures, une référence à un livre de Patrick Drouot raconte qu’un homme torturé au fer rouge avait conservé ces marques comme taches de naissance dans son corps réincarné, notamment car il n’avait pas surmonté ni évacué le traumatisme.
Sur le topic Qui ont sur leurs corps ,des marques de naissances inexpliquées? du forum Au Féminin, le 1er mars 2010, mamman10 a écrit : moi, j’ai mes 2 fils qui ont 3 points en forme de triangle au niveau des fesses !!!c’est drôle-mais c’est vrai et inexpliquees-car il n’y a que eux seuls!!
Je n’ai pas lu d’autres livres que ceux dont j’ai parlé plus haut, ni appris ces erreurs de quelqu’un, mais j’ai rêvé tout seul, ou bien c’est le diable qui m’aura mis ces choses dans l’esprit, comme je le crois : parce que plusieurs fois, il m’a persécuté et je l’ai combattu dans plusieurs apparitions et visions, tant de jour que de nuit, combattant contre lui comme si c’était un homme. À la fin, je m’apercevais que c’était un esprit.
Beaucoup de mon travail d’auteur consiste à déchiffrer ce que je pressens. Par exemple, depuis plusieurs semaines, Casca revient était arrêté en plein milieu d’une scène dont je ne comprenais pas l’objet. Je me demandais : pourquoi avoir mis mes personnages là ? Et cette question, je ne pouvais pas y répondre en forçant une solution, en m’y mêtant comme on décide de descendre les poubelles. Je ne pouvais y répondre qu’en laissant quelque chose en moi monter, une sorte d’instinct, formé par un amalgame d’éléments inconscients. Alors, j’ai su comment continuer.
Parfois, aussi bien, la solution apparaît d’emblée, dans la continuité du problème. C’est là que je me sens le mieux.
C’est la couronne qui fait le roi.
Ce dieu était dans le chaos comme quelqu’un qui est dans l’eau et qui veut s’en sortir ou comme quelqu’un qui est dans un bois et qui veut s’en dégager : de la même façon cet intellect, ayant acquis la connaissance, a voulu se dégager pour faire ce monde. — Mais alors, demanda l’inquisiteur, Dieu a été éternel et toujours avec le chaos ? — Je crois, répondit Menocchio, qu’ils ont toujours été ensemble, qu’ils n’ont jamais été séparés, je veux dire ni le chaos sans Dieu, ni Dieu sans le chaos. – Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers (trad. M. Aymard).
En ce moment, je me sens surtout fatigué.
Dans une des dernières vidéos de François Bon, un bandeau défilant affiche, alors qu’il feuillette trois livres d’une maison d’édition qu’il ne connaît pas : mais vous pensez vraiment que je peux lire trois bouquins d’auteurs avec qui je n’ai jamais dialogué par ailleurs ? Merci les éditions je-sais-pas-quoi, conclut-il enfin.
Word m’est utile car il m’offre un moyen d’écrire et de mettre en forme mon travail, mais surtout parce que mes éditeurs, mes collègues, mes coauteurs et coautrices, mes étudiants et étudiantes, l’administration de mon université et plus de 1,2 milliard de correspondants potentiels travaillent également avec ce logiciel, ce qui garantit l’intégrité des documents que je veux envoyer ou recevoir. […] Au final, si Word persiste, c’est parce que sa diffusion progressive depuis sa première version de 1983 a créé une « contrainte de sentier », un effet de verouillage. – Cédric Durand, Techno-féodalisme, critique de l’économie numérique.
Pour ceux qui ne le savent pas, Doc Jazy est né le 15 novembre, et il va avoir 25 ans.
Et pour ses 25 ans, il voulait se faire un gros kiff. Il voulait s’acheter un gros gamos.
En tant que homme qui conduit des Ferrari, Lamborghini, il avait envie d’un vrai truc ; il avait envie de se faire un vrai kiff, avec un vrai vrai vrai bolide.
Quinze jours plus tard, Doc Jazy est avec deux autres personnes sur un parking, devant le gamos, devant le bijou, dit Doc Jazy. Il enlève la bâche qui protège la voiture et il dit : quel bolide.
S63 AMG 585 chevaux. 50 chevaux fiscaux, c’est énorme. Quatre roues motrices, donc ça ne glisse pas, il peut se faire plaisir. L’intérieur, il n’en parle pas. Là, le modèle est full noir. Il y a des jantes, une dinguerie. Et le pompon sur le haricot, c’est les quatre sorties AMG.
C’est mon nouveau bolide, dit Doc Jazy.
Tout l’intérieur, le méga-écran, les petites palettes, le petit gadget.
Que dire de plus.
Doc Jazy la démarre, pour écouter le bruit qu’elle fait. C’est quand même un des trucs les plus importants ; sachant qu’il y a des clapets sur les échappements, donc s’il la démarre en mode confort elle fera moins de bruit qu’en mode sport. V8 Bi-turbo. C’est un monstre.
Du coup, c’est son nouveau bolide, pour ses 25 ans, pour son cadeau d’anniversaire.
Ensuite, il va faire un tour avec Apo, sa copine. Il dit : niveau confort, cette caisse, c’est insane. Elle est trop bien, dit Apo, surtout quand tu tournes, les petits coussins qui se gonflent.
Elle est en double vitrage, dit Doc Jazy à Apo, t’imagines. Putain, c’est vrai ? dit Apo en regardant les vitres. C’est la meilleure voiture pour tous les jours. Apo lui met un 10/10, car il n’y a rien qui manque.
Doc Jazy montre toutes les autres options de la voiture à Apo. Par exemple, dit Doc Jazy, si t’es avec une fille et qu’il y a un peu d’étoiles, tu ouvres le toit, tu lui montres les étoiles, et après elle te suce la bite.
Apo regarde Doc Jazy et dit : tu kiffes plus ta voiture que moi.
Clairement, dit Doc Jazy.
Aujourd’hui, Michou va se péter le bide, car il a un petit creux, et envie de nouveauté.
Donc il va manger des burgers spéciaux qu’il va créer. Par exemple, il va commander un Big Tasty, de chez McDo, et un Whooper, de chez BK, et il les mixe, pour en faire un nouveau burger et goûter cette nouvelle saveur.
Si ça va être une dinguerie ou si ça va être dégueu, Michou n’en sait rien.
Bref, Michou passe aux choses sérieuses.
Il commande différents menus et déballe tout ça. Il ne s’est pas rendu compte de ce qu’il avait commandé.
Déjà, il a pris un Cheese McDo, un Cheese BK et un Cheese Quick. Du coup il va se faire un triple Cheese BK, McDo, Quick. Évidemment, il ne va pas les manger comme ça avec le pain, il va enlever le pain. Ce qu’il est en train de faire, c’est une dinguerie. Il récupère le Double Cheese de chez McDo, il récupère le Cheese de chez Quick, et il referme. Il a un Quadruple Cheese. Il l’appelle le McQuicking.
Ah ouais, c’est trop bizarre, dit Michou.
Il sent la sauce signature McDo, mais aussi le steak fumé de chez Burger King, c’est spécial. Le steak de Burger King, il le sent à mort, parce que c’est un steak grillé, fumé ; il le sent direct.
Mais par contre la sauce, c’est la sauce de McDo.
Celui-là, c’est vraiment une valeur sûre. Après, il a mixé des Cheese entre eux, donc c’était sûr que ça allait passer.
Ce burger, Michou l’a démoli, c’est incroyable.
Une dinguerie, dit Michou.
À la fin, Michou va se peser avant de faire un petit débrief. Quand il monte sur la balance, elle indique 60 kg. Il est passé de 58,1 kg environ à 60 kg ; il a pris deux kilos en mangeant, c’est beaucoup.
Du coup : le petit Chicken avec le pain et la sauce du Royale Deluxe, pas ouf. Par contre, le Big Giant, il était incroyable. On n’imagine même pas comment il était bon, c’est le meilleur burger que Michou a mangé de toute sa vie. Ensuite, il a beaucoup aimé le Whooper Deluxe, même s’il n’a pas pris beaucoup de plaisir à le manger parce qu’il n’avait plus très faim à ce moment-là.
Et ensuite, il y a le Triple Cheese, McDo, Quick et BK, c’était une dinguerie.
Et puis voilà quoi, Michou s’est pété le bide, et son chien aussi.
Je prends une navette qui ressemble à une rame de métro mais qui va d’un module lunaire à l’autre. Dedans les banquettes sont alignées comme je connais et les écrans montrent des calculs compliqués avec des graphiques. Dans ma combinaison je suis bien grâce à l’oxygénation sur mesure ; tranquille vers le Nostromo.
Depuis que je suis sur la Lune, je vois les choses autrement. L’ambiance est bonne, même si une créature nous traque. Avec les collègues, on est soudés et on discute bien. Parfois, quand j’ai le mal du pays, quelqu’un me raconte une histoire qui me rappelle des souvenirs de mon enfance. C’est une relation professionnelle mais à l’écoute, respectueuse et bienveillante.
Quelqu’un a dit que pas très loin, en sous-sol, on avait trouvé des centaines d’oeufs. À mon avis, c’est bon signe pour la suite.
Ceci est ma première note écrite en Markdown. J’ai enfin réussi ce vieux rêve d’enfant : faire des Relevés un site statique.
Tout ne doit pas être idéalement optimisé dans le code, mais ça marche ; je peaufinerai plus tard. Et j’ai même pu harmoniser mon usage en interne avec celui d’INTERNET EXPLOREUR et de mes manuscrits.
Mon rapport au temps de l’écriture est un peu différent, puisque j’ai d’abord une version hors-ligne, que je mets ensuite en ligne en passant par le Terminal. Je peux moins faire d’allers-retours, mais ce n’est sans doute pas plus mal. La mise en page Markdown évite les erreurs que je pouvais faire en écrivant en HTML.
C’est amusant de m’enthousiasmer d’un truc que vous ne pouvez même pas voir.
Finalement, l’idée que j’avais d’entretiens avec des auteurs et autrices à propos de leurs outils de travail, je vais la faire en audio, sur le serveur Discord MAIPOwORLD : discord.gg/2FqB9vRntzwv
L’émission (si on peut appeler ça une émission, plutôt une conversation) s’intitulera Les Outils et durera environ une heure.
Je poserai des questions vastes et d’autres précises sur les ordinateurs, les carnets, les cahiers, les logiciels, les claviers, les souris, les crayons, les stylos, les bureaux, etc.
Si parmi les auteurs et autrices qui me lisent, certains et certaines souhaitent se prêter au jeu, écrivez-moi à l’adresse email en haut des Relevés.
Il est possible que certaines questions, par la bande, révèlent des choses plus ou moins intimes de vos processus de création ; je pense donc préférable de ne pas avoir trop de pudeurs à montrer, même si rien ne sera visible à l’image.
Pour leurs dix ans de vie en couple, Valouzz et Pidi ont fait une folie : ils ont acheté un siège massant de malade mental semblable à un vaisseau spatial, avec des programmes spécifiques, dont estime de soi, qui aide à gagner en estime.
Grâce à sa télécommande, Valouzz compresse Pidi à mort dans le siège.
Parfois, Valouzz pense que cette machine va lui déchirer le corps.
Pidi ne sait pas comment l’expliquer, mais en même temps ça fait mal, et en même temps ça fait du bien. En vrai de vrai, Valouzz n’a pas encore tout testé.
Dans l’ensemble, dit l’écran de la télécommande, il faut être focus sur le massage de guérison et sur la musique qui soigne votre esprit. Tout est massé en symbiose. En vrai, l’image de Pidi dans le siège massant est un peu futuriste.
C’est Iron Man le bazard, dit Valouzz.
Pour Bouzi, le meilleur ami de Valouzz, ce dernier a envie de mettre le truc au max du max, pour voir sa réaction. Il va le mettre bien.
Pidi imagine quand ils auront une putain de grande maison, avec un salon épuré, parce que c’est vrai que c’est quand même un gros truc, et qu’ils n’ont pas forcément le salon dédié à ce type de fauteuil. Valouzz, lui, s’en bat les couilles.
Il dit : ça masse bien le cul en vrai.
Au fond d’une caverne, une paillasse, un pichet d’eau, un panier en osier avec du pain et de l’huile, une lampe accrochée à la voûte et un crucifix de plomb.
Dans les appartements, ces bruits de voix assez éloignés pour ne pas les comprendre, mais trop proches pour réussir à les ignorer.
Je déteste les environnements de bureau avec de la transparence. C’est vraiment la pire idée de ces dernières années en design concernant l’informatique et la téléphonie. C’est toujours la première option que je désactive, sur Windows comme sur Mac.
Maintenant, je ne peux pas regarder une vidéo sur Youtube sans que le site me demande de créer un compte, ce que je n’ai pas envie de faire. Quand je me souviens de la façon dont je consultais les sites il y a dix ans, et la peine que j’ai à le faire aujourd’hui, je me dis que sans aucun doute on a perdu quelque chose ; tout est propriété, vous ne pouvez plus accéder à rien sans vous identifier.
Parfois, je vois des sites qui passent plusieurs secondes à charger du texte ; il faut se rendre compte de l’absurdité de notre web et repenser nos outils. Arrêtez d’utiliser des SUV pour rouler à 30km/h dans votre quartier.
On a atteint le stade où l’édition indépendante bénéficie des honneurs des institutions traditionnelles ; on peut donc s’interroger soit sur ce que sont devenues les institutions traditionnelles, soit sur ce qu’est devenue l’édition indépendante.
Est-ce que le chant des oiseaux dans GTA V procure la même émotion que celui entendu par la fenêtre ?
J’ai reçu ce matin mon nouveau clavier mécanique. C’est mon premier vrai clavier mécanique ; avant, j’ai toujours utilisé des claviers à membrane ou ceux déjà intégrés à mes ordinateurs portables. J’ai choisi des switch Cherry MX Silent Red pour ne pas trop déranger Cécile à côté de moi quand je tape. Ce sont des habitudes à prendre : retrouver l’emplacement exact de chaque signe typographique, découvrir les raccourcis qui permettent d’accéder à toutes les options, mesurer la pression nécessaire pour actionner la touche, placer ses poignets et ses doigts. C’est amusant, dépaysant. Dans deux semaines au maximum, ça sera devenu une routine.
Cela me fait penser que j’ai une grande curiosité, depuis très longtemps, pour le matériel de travail des auteurs : quel ordinateur, quel clavier, quelle souris, quel logiciel, en quelle matière est le bureau, pourquoi ces choix, contraints ou voulus, etc. J’aimerais faire une série d’entretiens écrits, avec des photos, mêmes moyennes ; si j’avais le temps et le courage, je le ferais, ça m’amuserait beaucoup.
Dans la même idée, je me souviens d’un bref documentaire sur Franzen, et de son tout petit IBM noir sans connexion internet ; ça m’avait fasciné, alors que je me contrefous de Franzen.
Je suis face à un dilemme : soit acheter un clavier mécanique à moitié compatible avec Mac OS, soit acheter un nouveau PC alors que le mien marche toujours très bien, si ce n’est ces quelques touches défectueuses.
Quand on tape des milliers de mots par jour, une dizaine de caractères manquants deviennent une obsession à régler au plus vite.
À Copenhague, il y a des grues, des containers et de la nuit.
Pour oublier, je regarde la vidéo MINECRAFT - Musique relaxante avec crépitement de feu.
« On eut aussitôt l’impression que la cathédrale s’écroulait. Les moines prires leurs jambes à leur cou, poussant des hurlements atroces. Les lampes s’éteignirent, l’autel s’effondra et, à sa place, apparut un abîme qui vomissait des nuages de flammes. Poussant un cri violent et terrifiant, le monstre plongea dans le gouffre et tenta, en sautant, d’entraîner Antonia avec lui. C’est en vain qu’il lutta. Animée d’un pouvoir surnaturel, elle se dégagea de son étreinte ; mais sa robe blanche restait en sa possession. Aussitôt à chaque bras d’Antonia se déploya une aile resplendissante de lumière. » – Matthew Gregory Lewis, Le Moine (trad. A. Morvan).
Depuis ce matin, je lis Argent de Christophe Hanna, que Cécile m’a offert ; c’est un livre qui m’est utile à plein d’égards, et que je vous conseille de lire, si ce n’est déjà fait, surtout si vous travaillez dans le milieu littéraire.
Sa lecture m’a refait penser à plusieurs choses, dont celle-ci : avant que Speedboat ne sorte, on imaginait avec Fabien n’en faire tirer qu’un ou deux exemplaires, qui auraient été mis en vente à un prix démentiel, du genre 100 000€. On imaginait qu’un homme d’affaires ou un mécène aurait été capable de mettre ce prix-là, en fonction de la facture de l’objet. C’était une idée tout à fait sérieuse, qui nous semblait même réaliste.
Finalement, nos éditeurs nous ont dissuadés de faire ce choix, et il a été vendu 10€. On en a vendu 1500 exemplaires, qui nous ont rapporté environ 600€ chacun.
Cependant, avec du recul, je me dis : est-ce que je préfère en avoir vendu 1500 pour 600€, ou imaginer que j’aurais pu en vendre un seul et me faire 50 000€ ; et la seconde proposition me paraît finalement désormais la meilleure. Car 600€ ne changent rien à mon quotidien, 50 000 oui. Et je pense que dans un univers parallèle proche, Speedboat aurait pu valoir 50 000€.
À mon avis, c’est aux poètes et aux auteurs de fixer le prix de leurs livres, si parfois ils en ont envie ; cela ne me pose aucun problème moral de vendre parfois un objet 30 millions d’euros, et le suivant 50 centimes ; ils ne sont pas destinés aux mêmes personnes, ne servent pas les mêmes enjeux, mais ils entretiennent ma pratique (ou une pratique collective), ce qui compte je crois plus que tout : avoir les conditions de création.
Encore plus drôle, j’imagine tout à fait pouvoir sortir un livre pour 30 millions d’euros à un seul exemplaire, puis faire paraître exactement le même pour 50 centimes à 10 000 exemplaires. Le but, c’est de créer de l’instabilité (un des enjeux de la littérature aussi, à mon sens).
Le conformisme joue le jeu du capitalisme.
Pour me consoler, je me dis que Speedboat a été écrit en une soirée, et qu’il est le livre m’ayant rapporté (et Fabien idem) le meilleur ratio temps/argent/visibilité ; pour un livre que je trouve en plus de très bonne qualité, dans son genre.
Bref, monneyez-vous à la hausse, car personne ne le fera pour vous.
Upamecano leur dit que le voyage jusqu’en Arctique sera très compliqué à cause du froid, de la solitude et d’autre chose.
Trish demande à Upamecano d’expliciter autre chose mais il ne le fait pas ; il change de sujet et dit : vous avez une bonne doudoune ?
Une bonne doudoune est une doudoune qui tient très chaud mais qui en même temps ne retient pas la transpiration et laisse le haut du corps libre de ses mouvements. Si un ours vous attaque, dit Upamecano, il ne faut pas que votre doudoune vous empêche de vous défendre.
Upamecano mime l’attaque d’un ours.
Casca se regarde dans le miroir avec sa doudoune, son pantalon rembourré, ses Moon Boot, ses moufles et son bonnet. L’ensemble est assorti de sorte que les couleurs se répondent bien entre la doudoune et les moufles, le bonnet et le pantalon.
Au début elle voulait une tenue de camouflage intégralement blanche, mais Upamecano a expliqué que pour se repérer dans les étendues glaciaires il valait mieux être habillé en fluo. Upamecano a dit : personne d’autre que nous ne sera fluo là-bas.
Le fluo n’a pas sa place en Arctique.
Ce qui, d’une certaine manière, est un mauvais présage, pense Casca.
Ensuite Upamecano demande comment elles vont payer, et Casca sort du sac de sport plusieurs liasses de billet qui suffisent largement. Upamecano compte les billets puis dit merci en les rangeant dans le tiroir d’un meuble à côté.
D’abord, dit Upamecano, on va prendre un bateau de pêche jusque Ny-Alesund. Dans sa cathédrale arctique, on va retrouver un ami à moi que je n’ai pas vu depuis très longtemps et qui doit me donner un objet qui nous sera utile pour la suite de l’expédition.
Ensuite ils prendront un petit avion vers Barrow, où le climat est froid et sec ; il n’y a aucune route là-bas, mais des baleines oui.
À la fin, ils iront à Alert, mais Upamecano ne dit rien sur Alert.
C’est là-bas que les trois scientifiques disparus ont été vus vivants pour la dernière fois. Depuis, les autres scientifiques qui travaillent encore sur place ont peur et veulent quitter la base pour retourner vivre dans des coins plus tranquilles. Ils voudraient faire leurs courses dans des supermarchés et se promener sur des plages de bonne taille.
À Alert, une scientifique pense : encore quinze jours.
Tous ces livres qui répondent à des questions plutôt que de poser des problèmes.
Miami = Paradis
Le soleil noir dans un ciel pareil.
J’aimerais réussir à me passer de la prise de notes en html pour passer au tout Markdown ; malheureusement, rien n’est plus simple qu’une page index.html mise en ligne à chaque mise à jour. Il existe peut-être un script qui convertirait automatiquement ma page index.md en page index.html, que je pourrai ensuite mettre en ligne.
« À bien considérer les choses, pensa-t-elle peut-être, les mots disent-ils vraiment tout ? Disent-ils même quelque chose ? Les mots ne détruisent-ils pas une réalité qui dépasse les mots ? » – Virginia Woolf, Flush : une biographie (trad. C. Mauron).
Je me rends compte maintenant que mes livres se prêtent très peu, voire pas du tout, à la lecture à voix haute. Peut-etre car moi-même je les lis à voix basse, et donc ne les adapte pas à un autre format. Quand je me prête à l’exercice, les phrases me semblent froides et mal construites, sans liant et sans nuance. Mais quand je les lis dans ma tête, elles me semblent sincères et justes. Mais peut-être me fais-je des idées, et que cela sonne faux.
« Au-dedans du cristal qui le nom porte,
cerclant le monde, de son chef bien-aimé
sous la loi de toute malice est morte,
je vis, de couleur d’or laissant passer
un rayon, une échelle si haut dressée
dans les airs que mon oeil ne la suivait. » – Dante Alighieri, Paradis (trad. D. Robert).
« Un bon coup de latte dans les couilles
ça t’apprendra à vivre
avec un monochrome couleur chrome
des étoiles de ninja
un sweater avec des emojis
un poing américain et un poster de
Samantha Fox » – Guillaume Dorvillé, Double Dragon.
salut
je viens d’acheter un DVD
de fou
l’histoire d’un mec
hyper froid
sans sentiment
qui conduit des voitures
pour des mafieux criminels
un jour il tombe amoureux
de sa voisine
carey mulligan
mais il peut pas lui dire
qui il est vraiment
sauf qu’à un moment
il défonce un tueur à gages
à coups de talon
devant elle
dans un ascenceur
donc elle comprend qui il est
en vrai
bref à la fin il se fait poignarder
dans le ventre par un vieux type
sur un parking
qu’il tue quand même
et puis il part
le bide en sang
avec le souvenir
de carey mulligan dans son top rouge
c’est un film super connu
donc forcément tu connais
Le soir de leur arrivée à Copenhague, Casca et Trish passent devant une librairie ouverte à une heure où elle devrait être fermée. À l’intérieur, elles voient les dos de dizaines de personnes tournées vers le fond de la salle.
Elles entrent et restent debout près de la porte ; Jeanne Lekker est assise sur une chaise et parle depuis plusieurs minutes car tout le monde l’écoute et plus personne ne chuchotte.
Casca pense : c’est Jeanne Lekker.
Derrière Jeanne Lekker, il y a une affiche d’elle à côté de la couverture de son dernier roman, L’Océan Pacifique. Son visage sur l’affiche n’est pas le même qu’en vrai, pense Casca.
Dans la salle, une femme demande si ce que l’héroïne découvre en Arctique est réel. Toutes les autres personnes dans la salle murmurent car c’est une question que tout le monde voulait poser sans oser le faire. Le découverte de l’héroïne en Arctique est en quelque sorte le noeud du roman.
À la fin du roman, ce noeud ouvre sur un vide interprétatif.
Jeanne Lekker dit : l’Arctique est une image.
Les gens sont très attentifs car ils pensent qu’il s’agit du début d’une phrase plus longue, alors que la phrase est déjà finie. Comme Jeanne Lekker ne dit rien après image, un long silence s’installe qui ne la dérange pas.
À l’exact opposé de Jeanne Lekker, Trish lui demande si elle croit aux dernières découvertes scientifiques faites là-bas. Jeanne Lekker lui demande de répéter la question qu’elle n’a pas bien entendu, ce que Trish fait.
Tous les gens se retournent vers Trish et la regardent.
Puis aussitôt après ils se retournent vers Jeanne Lekker, qui réfléchit à la question de Trish comme si elle était plus importante que la question d’avant, alors qu’elle est presque pareil.
Et Jeanne Lekker répond à la question de Trish.
Personne ne comprend sa réponse sauf Trish et Casca, car en écrivant son roman Jeanne Lekker a compris certaines choses que Trish et Casca ont compris aussi en découvrant la couronne dans le sac de sport.
Des choses qui les lient à un niveau profondément intime et presque mystique ou divin.
Jeanne Lekker pense à l’aventure qui attend ces deux femmes debout près de l’entrée. Elle les voit quitter la librairie et marcher dans la rue pour partir vers la droite ; elle pense à elles encore quand les autres personnes posent leurs autres questions.
Et quand la discussion est finie et que tous les gens sortent de la librairie par petits groupes avec leur livre dédicacé, elle ferme les yeux quelques minutes et elle pense encore à elles.
Ce matin en me réveillant, je n’ai pas ressenti d’enthousiasme. J’ai vu le weekend qui arrivait devant moi et je ne savais pas quoi en faire. De plus en plus, mes journées ressemblent à des obligations à remplir. Je regarde les livres. Je regarde ce que j’écris. Je regarde ce qui n’a rien à voir avec les livres et ce que j’écris. Tout est là, comme d’habitude.
Des enfants se suicident parce qu’ils sont tristes.
Comme je n’ai toujours aucun retour sur Rivage au rapport, j’ai continué à le modifier et le corriger un peu. J’aime bien quand je comprends enfin le sens d’une scène, et que je l’amène là où c’est le mieux ; souvent c’est le temps qui permet de comprendre ça. Le temps fait beaucoup à la qualité d’un texte ; ou plutôt l’absence du texte. Que le texte soit à distance permet de le voir bouger dans sa tête. Je dis des banalités affligeantes. Je m’arrête là. Il n’y a plus rien à dire sur les livres ou la création.
L’excitation de la publication disparaît. Depuis que j’ai envoyé le manuscrit de Rivage à mes éditeurs (un peu moins de deux mois), je me dis que ça pourrait en rester là ; le livre est déjà en train de s’évanouir. C’était bien sur le moment, mais l’ennui ne tarde jamais. La prévision des mêmes routines ; la littérature est sans surprise. Je me revois envoyer le manuscrit de Saccage, et espérer le meilleur d’un geste pareil, parce que j’ignorais tout du futur, qui n’a rien à proposer.
Souvent, ce sont des gens qui écrivent qui me font des retours sur mes livres ; mais moi, je ne leur parle pas de leurs livres.
Qui attend encore les nouvelles parutions ; où sont les lecteurs des romans que personne ne veut.
Je suis peut-être déprimé.
Orlando est un roman incroyable et libre.
Ce que je me disais, c’est que l’art, dans une ville, c’est une question d’écosystème. Par exemple, la poésie, à Rennes, nous sommes les seuls à la défendre. C’est peu, parce que nous sommes une petite association. Par exemple, aucune librairie à Rennes ne défend la poésie. Où acheter la poésie qu’on ne connaît pas déjà, à Rennes : aucune idée. Il n’y a aucune économie de la poésie à Rennes ; si les auteurs et autrices vivent, ce n’est pas grâce à Rennes. Les plus jeunes artistes l’ont compris et s’en vont, à Paris, à Marseille, à Bruxelles, où sais-je encore, car à Rennes il n’y a rien pour eux, ce qui est vrai. Je n’ai rien à leur offrir, car j’ai déjà très peu. Pour que la poésie survive dans une ville, il faut que l’écosystème la favorise ; sinon, elle s’en va. Bientôt, la littérature à Rennes sera totalement partie. Et reconstruire dans le désert c’est comme gravir la montagne de Sisyphe en marche arrière.
Alors j’avance ce que je peux, avec les quelques personnes encore présentes et motivées dans le coin, pour ne pas que les choses disparaissent. Je le prends comme une responsabilité personnelle, ce qui est toujours à double tranchant. Mon angoisse, c’est que tout le monde finisse par partir, et que je me retrouve seul avec l’absurde conviction qu’il y a encore quelque chose à faire (car parfois, il n’y a plus rien à faire).
La littérature est trop importante pour moi pour que je baisse les bras.
Des livres de plus en plus chiants défendus par des communicants de plus en plus putassiers. Parfois j’ai la gerbe de l’industrie, comme de toutes les industries. Pourquoi on continue à écrire, à lire, dans ce contexte et cette situation. Pourquoi c’est si dégueulasse. Je ne suis pas décliniste, je suis épuisé. À quel point artiste, à quel point commercial. Tous les adolescents du monde sont morts dans leur coeur et on torche des manuels de développement personnel qui autrefois s’appelaient romans. Dans un let’s play Dofus au moins les émotions sont réelles. La littérature est devenue le nouveau gadget qui fait du bruit ; on appuie sur un bouton et le génie coule. C’est ce qu’on appelle la fuite des cerveaux.
ouh
ouais
Dems
ok
Playlist : japanese jazz when driving on a warm night
Dylan me demande si tout va bien car il voit que je suis songeur à la façon dont je tiens mon volant et regarde au loin. Je dis : ouais, ça va. Dylan tourne la tête vers dehors et me parle de la fille chez qui on va. Je préfèrerais qu’on ne parle pas d’elle maintenant, dis-je, enfin, genre, pas pendant que je conduis. Sans se retourner vers moi, Dylan dit : ok, si tu veux. Je pense à la fille chez qui on va depuis que j’ai récupéré Dylan chez lui. Je ne l’ai pas revue depuis hyper longtemps, et je ne sais pas ce qu’on va se dire. La dernière fois qu’on a parlé, je ne connaissais pas encore Dylan, et je me souviens qu’elle m’a dit des choses sincères à propos d’elle, que je n’ai pas comprises sur le moment. Quand je suis sorti juste après la nuit était la même que dans les animés romantiques. Dehors, je lui ai dit : à plus tard, mais elle n’a rien dit et elle est rentrée chez elle. J’ai imaginé qu’elle pleurait de son côté parce que moi je pleurais du mien. C’était en 2014 et les lotissements n’étaient pas construits pareil. Je pense à la première chose qu’on va se dire quand je vais rentrer dans la maison où elle organise cette fête. Sans doute que je vais dire : salut, et elle aussi, et qu’il va se passer un truc qui n’aura rien à voir avec ce que j’ai imaginé.
salut
juste pour te dire
j’attends en bas
j’ai pas ton numéro d’interphone
j’ai pris des bières
comme vous m’avez demandé
ça serait cool de m’ouvrir
en même temps ouais j’ai un peu d’avance
je sais pas si vous êtes arrivés
bon voilà
à toute
J’ai parfois la nostalgie de la vie que je vivrais si je n’étais pas parti de Lamballe ; quand je reviens en voiture le vendredi, tard, que je traverse des bourgs, des communes, et que la lumière dans les maisons ne passe que par une toute petite fenêtre qui est à l’opposé du salon, ou ne passe pas du tout.
Cette vie aurait ressemblé sans doute un peu à celle que je vivais autour de mes vingt ans, rentrer de Rennes, aller à Yffiniac, regarder un match de basket de l’équipe de la commune, qui affronte l’équipe d’une autre commune, ensuite commander au MacDo, manger chez un des joueurs de l’équipe, boire des bières, vouloir vivre autre chose et puis vivre ça quand même, rentrer dormir vers deux heures, dormir tout de suite, à côté de quelqu’un, qui sans doute dort aussi.
C’est ce que je vois quand je conduis.
Je me demande si j’aurais éprouvé la même nostalgie en conduisant dans les rues où je vis aujourd’hui, et que je n’aurais pas connues ; les univers parallèles sont-ils forcément des univers tristes ?
Les deux extrêmes de mon univers sont Mars d’un côté, qui est l’Enfer, et l’Arctique de l’autre, qui est le Purgatoire, et qui permet d’accéder au Paradis, qui est une Terre retournée, là où le noyau de feu est devenu une montagne blanche. Les villes les plus connues sont Myriad Pro, Portobello, Miami et Copenhague. Pour aller de Portobello à Copenhague, il y a un trajet en bateau d’environ trois jours. Tout le monde connaît Mars, mais tout le monde ne connaît pas l’entrée vers le Paradis, qui vient tout juste d’être révélée grâce à la fonte de l’Arctique.
Je pense que l’utilisation dans les romans de concepts de physique quantique comme la relativité, les dimensions parallèles, l’espace-temps, les trous noirs, les modèles d’Univers, etc., devrait forcément avoir quelque chose à faire avec Dieu, notre origine, la Vérité et la Justice. Parce que je crois qu’on commence à comprendre que tournent en rond ces textes où je peux être en même temps moi ici, et boulanger ailleurs, et qu’en fait ma maison est un autocar, et que la tasse dans laquelle je bois se transforme en pendule qui parle et qui me dit : à quoi bon ?
Même en jouant (surtout en jouant !) on peut atteindre à l’essentiel de notre condition, car on avance sans que personne n’y prête attention, pris moitié pour fou, moitié pour râté, sans vent contraire, sinon notre propre obsession à fouiller dans la lumière.
« À la fin, pourtant, Orlando s’arrêta. Il était en train de décrire, comme tous les jeunes poètes le font toujours, la nature ; et, afin d’accorder son épithète à une nuance précise de vert, il regarda – en quoi il montra plus d’audace que beaucoup – la chose elle-même : un massif de lauriers qui, justement, poussait sous sa fenêtre. Et, naturellement, c’en fut fini d’écrire. » – Virginia Woolf, Orlando : une biographie (trad. C. Mauron).
J’ai regardé une vidéo dans laquelle Cécile Coulon et un libraire dont j’ai oublié le nom parlaient de la collection de poésie qu’ils lancent aux éditions de l’Iconoclaste, et tout dans cette vidéo m’a donné le cafard. À les écouter, c’est rupi kaur qui sauve la poésie.
Pour rédiger ces deux paragraphes et retranscrire la citation ci-dessous, j’ai du cliquer 25 fois sur les symboles correspondant de mon clavier virtuel. Cette panne de clavier est une purge, d’autant qu’en dehors de ça mon ordinateur marche toujours très bien.
« Il voit les tableaux aux murs
Un bout de vérité seulement
Mais on n’en a jamais assez
La vérité ne suffit pas. » – John Ashbery, Autoportrait dans un miroir convexe (trad. P. Alferi, O. Brossard, M. Chénetier).
Il y a quelque chose qui me fascine, mais je ne sais pas quoi, dans la remise à zéro du high-tech. Par exemple, j’ai un iPhone 5C blanc depuis 5 ou 6 ans. Je ne compte pas en changer, car la modernité téléphonique me déprime ; si je change, ça sera pour du plus vieux (genre un Nokia C3). Plus tôt dans la journée, sans savoir trop pourquoi (une image subliminale qui m’a influencé), j’ai remis le fond d’écran de base, et les icônes là où elles étaient lors du premier allumage. Et j’ai aimé ça. À nouveau, j’ai aimé l’objet parce qu’il était comme au départ, avant qu’il ne mange mon temps, quand il n’était encore qu’un outil que j’utilisais pour l’outil qu’il était, et non pour autre chose. Cette banalité de l’objet pas utilisé m’apaise, en quelque sorte, ou me rassure, me rend nostalgique, je ne sais pas. Je me dis que peut-être, il peut redevenir inoffensif, lointain, banal.
« La poésie naît et s’insère dans le silence qui, lui, demeure. C’est pourquoi, et très spécialement je me suis méfié de ce qu’on dit « socio-littéraire », à savoir ce jeu d’intérêts, de motivations, cet appétit de succès, cette recherche de réactions qui préoccupent généralement les écrivains et les poètes. Toute recherche profonde implique une responsabilité beaucoup plus grave qui consiste à ne pas se laisser absorber par les mécanismes courants de la promotion et de l’autoexaltation. S’engager dans cet appareil perturbe presque inévitablement le recueillement, la concentration et le travail fondamental. Mon objectif n’est pas le succès et ne l’a jamais été. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Mon but est de sentir que je suis en train de vivre ce que je crois devoir vivre. Le regard public, la promotion sont choses inconsistantes, et dangereuses. » – Roberto Juarroz, Poésie et création (trad. F. Verhesen).
« Je me suis imaginé, continua-t-il, être dans le Soleil, et que le Soleil était un monde. » – Cyrano de Bergerac, Les États et Empires du Soleil.
Tout à l’heure, je regardais une vidéo de gens qui mangent des aliments de marques différentes, et doivent deviner lequel est de la marque “reconnue” et lequel est de la “sous-marque”. Ce qui est amusant, c’est que les participants à cette vidéo utilisaient les adjectifs vrai et faux pour qualifier les marques. Par exemple, le saucisson Justin Bridou et les chips Lays sont le vrai saucisson et les vraies chips ; à l’inverse, les aliments Marque Repère sont faux. Conceptuellement, un saucisson est donc pour eux un saucisson Justin Bridou ; l’entité saucisson universelle. D’une certaine manière, la réalité a été capturée par les marques, qui a su imposer les choses à travers leur image. D’une autre manière, je dirais que les simulacres de Baudrillard s’expriment dans cet usage langagier impropre ; la réalité, le vrai, c’est ce qu’on nous vend avec le plus bel emballage et la plus forte publicité. C’est en même temps intéressant et en même temps profondément déprimant. Car derrière le vrai se cache un autre vrai, le vrai vrai si je puis dire, expurgé de ces enjeux, mais au contact duquel plus grand-monde ne vit (moi compris). La recherche du vrai se fait à l’encontre de la façon dont il se présente à nous.
« L’obsession qui se révèle dans mon premier livre sous le nom de Dieu et, dans ceux où je ne le nomme pas, signifie ceci : la part visibles de choses, écrite, racontée, historique, connue de tous, ne nous a servi à rien. C’est l’envers des choses qu’il faut découvrir, et c’est là tout le sens de ma recherche. Raison pour laquelle je parle du dos, de l’envers des paroles, et que je retourne les choses, en quête de leur envers. » – Roberto Juarroz, Poésie et création (trad. F. Verhesen).
Quand j’étais enfant, je me souviens qu’où mettre un point pour conclure une phrase ne m’était pas évident. Je me demandais : comment sait-on qu’on doit finir une phrase. Le découpage des idées qu’impose la grammaire n’est pas inné.
J’aimerais vivre dans le même univers que les personnages principaux de The OC.
Quand je dois aller dans le Super U de la commune où vit ma grand-mère, et où j’allais déjà il y a plus de dix ans, je fais parfois des détours par le rayon des jeux vidéo, et je regarde avec un filtre étrange tous les objets que je voulais acheter enfant, et que je ne veux plus acheter adulte.
Le désir des choses que je n’ai jamais pu acheter crée en moi une profonde tristesse a posteriori.
Le Sublime et la Vérité se cachent forcément dans le prosaïque ; ils y prennent une forme qui endort notre curiosité. Derrière une foule de simulacres (parkings de supermarchés, banlieux luxueuses de Los Angeles, dessins-animés internationaux, hits de l’année 2005, figurines manufacturées en Chine), une source profonde de beauté sommeille. Plus les artefacts sont vulgaires et plus il est difficile d’y accéder. On visualise mieux la porte du Paradis devant la voûte d’une cathédrale qu’en écoutant Mr. Brightside.
En préambule du tome 18 de Steel Ball Run, Araki écrit : « Je commence à voir le point commun des personnages : tout le monde veut rentrer chez soi. Plus précisément, ils cherchent où rentrer et le sens de leur retour. Même pour Jayro [Zeppeli] qui, pourtant, a un pays natal où rentrer. De tous les personnages de la série, seul Mountain Tim y est parvenu pour l’instant. Auteur de la série, moi-même je n’attends plus que la fin de la course pour rentrer chez moi. Mais c’est ça le plus dur ; je ne peux pas rentrer, jusqu’au jour où les personnages trouveront une vraie raison de rentrer chez eux ».
Ce que je cherche à écrire, ce sont des phrases ambiguës. En gros, des phrases qui semblent simples, évidentes, et puis qui d’un coup font quelque chose qui met mal à l’aise ; souvent c’est une bizarrerie grammaticale. J’avance toujours mine de rien ; je n’ai pas de grandes idées, mais plutôt des bouts de détails qui forment un ensemble ok, habituel, mais d’un habituel inconfortable.
Nous vivons dans un monde simple pourtant toujours à la lisière de l’horrible. Cette lisière se retrouve dans la parole et dans les relations humaines. Nous nous dirigeons inexorablement vers une forme de Mal que nous ne concevons pas encore ; cette forme inédite mérite d’être étudiée.
Sa lumière est de la même intensité que celle du soleil, pourtant aucun astre n’est à son origine. Elle réside dans l’état des choses et dans la façon dont nos yeux les voient. Si un ange la propage, son allure rappelle la vôtre.
« Parjures infracteurs des lois,
Corrupteurs des plus belles âmes,
Effroyables meurtriers des Rois,
Ouvriers de couteaux et de flammes,
Pâles prophètes de tombeaux,
Fantômes, loups-garous, corbeaux,
Horrible et venimeuse engeance,
Malgré vous, race des enfers,
À la fin j’aurai la vengeance
De l’injuste affront de mes fers. » – Théophile de Viau, Lettre de Théophile à son frère.
Ce qui s’accroît, c’est la confusion entre livre et littérature. Elle s’accroît non pas car personne ne fait la différence, mais parce que tout le monde croit la faire, et dès lors se trompe dans ses intentions. La confusion est un mal terrible, car elle empêche d’atteindre la vérité. Dans la confusion, tout est possible ; mais personne n’est clairvoyant.
Les garants de la littérature, désormais (et malheureusement) sont les fachos ; qui croient par leur posture réactionnaire être le contrepoint aux commerçants du livre, qui eux pensent faire de la littérature mais n’en font pas (ou alors ne pensent pas en faire mais font bien semblant). Le livre et la littérature forment deux grands cercles qui se recoupent en un point très petit qui est la modernité. C’est-à-dire un livre avec de nouvelles ambitions, et qui par cette ambition-même dépasse le simple objet commercial.
C’est-à-dire : une oeuvre.
Personne ne peut savoir à l’avance quelles oeuvres se cachent dans ce minuscule point, ni comment faire pour l’atteindre, mais tout le monde vous convaincra du contraire.
Aujourd’hui, il ne faut pas choisir un camp (car tous puent) ; il faut comme les Lemmings s’armer d’outils, et avancer.
« Il faut écrire à la moderne ; Démosthène et Virgile n’ont point écrit en notre temps, et nous ne saurions écrire en leur siècle ; leurs livres quand ils les firent étaient nouveaux, et nous en faisons tous les jours de vieux. » – Théophile de Viau, [Théophile en procès].
Au début, il y a toujours un tâtonnement. En tout cas, moi, je tâtonne. C’est excitant et en même temps c’est terrifiant. C’est comme lancer un avion sur la piste sans être sûr qu’il décolle et avec un ravin au bout. Je n’ai jamais d’idée attendue de ce que je veux faire, sauf au bout d’un moment, où j’ai surtout une idée de comment je veux terminer, et donc faire dans l’ensemble. Donc au début, ce que je fais, c’est que je mets en place certains éléments qui me semblent primordiaux, et qui à eux seuls fixent l’intégralité du projet final, même si encore une fois je n’ai aucune idée de ce que sera le projet final ; c’est une intuition. C’est dans cette intuition que je mets toutes mes forces, et que je me projette jusqu’au bout. Le reste consiste essentiellement à me faire confiance, et à ne pas me décourager quand je ne me fais plus confiance.
Là, par exemple, en ce moment, je me dis qu’il y a moyen de faire trois romans qui partagent le même univers et forment un ensemble. C’est mon intuition. Pour l’instant, je mets toutes mes forces dedans. Mais aussi bien je vais finir par ne plus me faire confiance, et donc abandonner. Car en dehors de cette intuition, je n’ai rien.
« Au cas où Dieu ne serait pas mort, nos astronautes portent des armes de poing. » – Ben Lerner, L’Angle de lacet (trad. V. Poitrasson).
Bien qu’il n’advienne pas immédiatement après, Casca revient est la suite directe de Rivage au rapport.
La réalité est faite d’éléments très simples que nous côtoyons tous les jours. Ces éléments se présentent à nous tels qu’ils sont, et plus l’humanité avance, plus ils sont évidents, car moins ils ont de mystère et d’histoire. Au début, les choses n’étaient pas aussi évidentes, et donc la réalité non plus. Ce que j’aime faire, c’est dire comme je vois, car c’est là que résident ma sincérité et ma sensibilité ; c’est donc là que je crois atteindre la vérité. Dans Rivage au rapport, il y a beaucoup de descriptions d’environnements intérieurs ou communs qui sont résumés au strict essentiel ; c’est dans cet essentiel que j’ai vécu : des meubles quelconques, des éclairages à plat, des arbres sans nom, une grande indifférence de tout.
« Il n’était plus d’étoile qui ne se fût enfuie de l’orient déjà, hormis celle-là seule que nous appelons Lucifer, et qui luisait encore dans la blanchoyante aurore, quand le sénéchal, après s’être levé, suivi d’un grand charroi partit pour le Val des Dames, afin d’y apprêter chaque chose selon l’ordre prescrit et le commandement donné par son seigneur. » – Boccace, Le Décaméron (trad. G. Clerico).
En mars 1990, l’Université de Las Vegas a accueilli un colloque sur Théophile de Viau.
Une des raisons qui me poussent le plus à renvoyer les Relevés dans l’anonymat, c’est qu’on m’en parle bien plus qu’avant ; je veux dire, on m’en parle quand on me voit. Il y a même une fois un mec ivre qui m’en a parlé en soirée. Or, je n’aime pas qu’on me parle des Relevés, c’est même une des choses que j’aime le moins dans ma vie, qui me met le plus mal à l’aise. L’accord que je pensais tacite que ce qui est écrit ici reste ici, dans l’écrit, n’est finalement pas tacite pour grand monde. On ne m’a pourtant jamais dit du mal des Relevés, mais c’est bien du mal que je ressens quand on m’en parle ; une gêne profonde, comme si ces conversations ne devaient pas avoir lieu, qu’elles ne se déroulaient pas au bon endroit, ni avec les bons interlocuteurs. Et même quand ça me fait du bien, je sais qu’au fond, ça me fait du mal, parce que ce n’est pas le but. Les Relevés n’ont rien d’un livre, ils n’ont pas à être discutés. C’est dommage, je vous faisais confiance, pourtant.
« Si vous vous attendez, Lecteur, que ce livre soit la suite du premier, et qu’il y ait une connexité nécessaire entre eux, vous êtes pris pour dupe. Détrompez-vous de bonne heure, et sachez que cet enchaînement d’intrigues les uns avec les autres est bien séant à ces poèmes héroïques et fabuleux où l’on peut tailler et rogner à sa fantaisie. Il est aisé de les farcir d’épisodes, et de les coudre ensemble avec du fil de roman, suivant le caprice et le génie de celui qui les invente. Mais il n’en est pas de même de ce très véritable et très sincère récit, auquel je ne donne que la forme, sans altérer aucunement la matière. » – Antoine Furetière, Le Roman bourgeois.
Au début, je ne savais pas trop bien ce que je cherchais. Il y avait quelque chose à chercher, et donc je me suis mis en route pour le chercher, parce que j’ai ressenti que c’était à moi de le faire, comme si j’étais un envoyé de Dieu. Je ne savais pas par où commencer ni comment faire. Au débût, donc, il ne s’est rien passé de spécial. Pourtant, à force de chercher sans me décourager, parce que je me sentais justement investi d’une mission, j’ai commencé à comprendre, et comprenant je n’ai plus voulu m’arrêter de chercher. Les choses à trouver sont en même temps très vastes et très précises ; comme un médaillon d’or avec le visage du Christ. Ce que je devais trouver n’était pas à trouver par hasard ; si c’était à moi de le trouver, c’était pour une raison précise. Et ma seule particularité est d’être né à un moment. Et ce moment, cette date, j’en ai la responsabilité, car elle véhicule un sens inédit ; et par sens inédit j’entends : un bout de vérité sur le monde et l’histoire des hommes. Dans les années 1990 s’est produit un événement qui ne connut aucun précédent ni aucune suite. J’ignore lequel. Cette décennie, comme toute décennie, porte la marque d’une singularité. C’est un travail qui ne trouvera jamais de fin, car ce qu’il y a à trouver, comme tout ce qui doit être trouvé un jour, est de l’ordre du sublime et de l’infini, qui n’ont aucune matérialité, sinon celle que l’on invente pour eux.
Je ne me l’explique pas autrement : les poètes français contemporains obscurs (ils sont légion) ont comme une sorte de fascination pour Wikipédia, car leurs fiches y sont toujours les plus détaillées ; à grand renfort de citations, de notes, de repères bibliographiques, etc. J’en éprouve toujours un certain amusement, de les voir (ou leurs lecteurs ?) espérer acquérir une légitimé en ligne par ce biais, comme une fois son nom consigné dans Le Larousse ; il y a quelque chose de touchant là-dedans, au fond.
Le livre de Guyotat que je relis le plus souvent, ce sont ses Leçons sur la langue française ; alors que je ne l’avais pas lu après l’avoir acheté ; comme s’il était venu trop tôt.
Dès qu’on prend un peu de recul, vraiment pas beaucoup de recul, tout ce qu’on lit de contemporain devient catastrophique. Je pense que l’état des textes, des livres actuellement est catastrophique, mais comme on a le nez dessus, on ne peut plus s’en rendre compte. Quand je lis les premières pages des livres, je pense : c’est catastrophique, et je n’arrive pas à me sortir cette idée de la tête, car je crois que profondément, c’est ce que j’éprouve, sans même avoir à dire le moindre mot, ni à penser la moindre pensée. Avant, je ne pensais pas ça, mais maintenant oui, je le pense profondément. Et je ne le dis pas, je ne sais pas, pour faire chier par exemple, ou par jalousie, ou par aveuglement ; je le dis parce que je l’éprouve.
Parce que mes textes aussi sont catastrophiques.
La littérature ce sont des personnes qui croient bien faire et font de la merde, des personnes qui font ouvertement de la merde, des personnes qui font de la merde qui passe pour bonne, et des personnes qui font des trucs profondément bien, mais personne n’est capable de savoir qui fait quoi.
On a plus de vingt siècles de littérature derrière nous, et quand un livre sort en librairie, on n’est toujours pas capable de savoir si c’est une daube ou du génie ; et je crois que c’est fou quand on y pense.
C’est fou de se dire : en vingt siècles, on a des pistes, mais pas plus.
Aussi bien c’est tout ou rien, un peu au hasard.
Par exemple, les livres de Pierre Ducrozet pour moi c’est un mystère. À lire partout, c’est un génie underground ou quelque chose dans le genre, genre un grand décrypteur du contemporain ou une autre idée à la con comme ça. Pourtant, quand je vais sur actes-sud.fr et que je lis les premières pages de son dernier roman en PDF, ce que je vois, c’est rien. Et donc je me demande : comment là où tant d’autres voient un génie underground grand décrypteur du contemporain, moi je ne vois rien ?
Et je n’ai aucune conclusion probante.
Mais j’en conclus pour moi que c’est de la merde parce que je fais toujours bien plus confiance à mon jugement qu’à celui des autres, qui n’existe pas.
Les articles dans les magazines, les ventes et les prix ça n’existe pas. Ce n’est pas de la littérature, c’est autre chose.
Pierre Ducrozet existe très bien dans cet autre chose, mais dans la littérature, il n’existe pas.
J’ai pris Pierre Ducrozet parce qu’il me tombait sous la main, mais aussi bien j’aurais pu prendre Simon Johannin ou Miguel Bonnefoy ; c’est le même principe. C’est 99% des livres, en fait.
La littérature, c’est rare, mais on veut nous faire croire que c’est commun. Et paradoxalement, plus il y a de monde à écrire, et plus c’est rare. Justement parce qu’on a aucune piste (cf supra) et que donc l’enquête pour trouver la littérature est bien plus difficile à mener.
Par exemple, toujours pour continuer, je dirais que Pierre Guyotat me donne bien plus de pistes de littérature que Pierre Michon, qui finalement (après l’avoir lu et avoir laissé le temps peser dans la balance) ne m’en donne pas beaucoup, en tout cas largement moins.
Au bout du compte, je dirais, si je le dis sincèrement : Pierre Guyotat, c’est de la littérature, mais Pierre Michon, bof. Mais aussi bien c’est autre chose de très bien aussi, mais pas de la littérature, vous comprenez. Toujours selon le principe de : la littérature, c’est rare, donc fatalement il ne peut pas y avoir et Guyotat et Michon. Si c’est rare, il ne peut pas y avoir les deux.
Maintenant, mettez en regard Guyotat avec Ducrozet, Johannin, Bonnefoy ou vous-même.
Vous voyez, c’est évident au fond, si on veut bien regarder les choses avec un peu de recul. C’est pas qu’une histoire de comparaison, c’est une histoire de relief.
Je crois que c’est Quintane qui a dit un truc du genre que c’était pas facile tous les jours de ne pas être Guyotat.
Ce qui est vrai.
Quintane à ce moment-là a comme qui dirait touché du doigt le relief qui la sépare de Guyotat. Elle a eu l’honnêteté de regarder la réalité en face, ce que personne d’autre ne fait (moi compris). Elle sait être très sage, Quintane.
J’aime bien dire que des choses sont merdiques parce que ça m’aide à mieux apprécier ce qui ne l’est pas. Plus je vois la merde, et plus je vois ce qui n’en est pas. Quand je vais à St-Cast et que je vois les merdes des aquarellistes bretons, ensuite je comprends mieux pourquoi les tableaux de Staël ne sont pas de la merde.
C’est pareil avec les livres.
C’est une question de relief.
Dernier exemple, imaginons que vous ayez lu à la suite, au pif, L’Énéide, Les Confessions, Madame Bovary et Des arbres à abattre. Et puis là vous vous dites : tiens, si je lisais le dernier Pierre Ducrozet (le pauvre) ; eh bien en fait c’est simple, vous ne le voyez même pas, tellement il est en tout petit tout en bas de la montagne, caché entre deux sortes d’arbustes dont vous ignorez les noms.
Parce que vous avez, à ce moment-là, le recul nécessaire.
Prenez ce recul de temps en temps, regardez comme les paysages montent et descendent autour de vous ; à tout niveler on finit par se perdre au centre de terrains vagues.
Tout ça c’est important de le dire même si ça n’a aucun sens ; parce que si ce n’est pas dit, ça n’existe pas ; et si ça n’existe pas, c’est dommage.
« Il est de l’essence des bons livres d’avoir des censeurs ; et la plus grande disgrâce qui puisse arriver à un écrit qu’on met au jour, ce n’est pas que beaucoup de gens en disent du mal, c’est que personne n’en dise rien. »
« Rien n’est beau que le vrai : le vrai seul est aimable ;
Il doit régner partout, et même dans la fable :
De toute fiction l’adroite fausseté
Ne tend qu’à faire aux yeux briller la vérité. »
« Il me souvient d’avoir lu dans la fable que l’espérance était renfermée dans la boîte de Pandore, et que lorsqu’elle en sortit avec tous les maux du monde, on ne sut jamais discerner si elle était un mal ou un bien, ou si c’étaient tous les deux ensemble ; et je trouve quelque chose de fort admirable en cette incertaine description. » – Tristan L’Hermite, Le Page disgracié.
Casca descend marcher sur la plage de Portobello à une saison où tous les gens sont partis. Dans deux heures, elle ira chez Trish pour manger et discuter.
La plage est grise à cause du ciel ; l’eau aussi mais pas de la même manière. Si ce gris devenait plus foncé je ne verrais plus rien, pense-t-elle.
Pour l’instant, personne n’habite dans les maisons qui ont vue sur la mer.
Deux heures plus tard, elle est assise dans la cuisine de Trish, à une table avec des verres et des couverts éclairés par un abat-jour qui l’éclaire aussi. Trish parle à Casca en lui tournant le dos pour finir de préparer sa nouvelle recette. Elle a mis de la musique qui évite que les silences ne soient trop gênants.
Casca ne reconnaît pas qui chante, même si sa voix lui dit quelque chose.
Quand elle était plus jeune, elle a entendu cette voix dans d’autres circonstances. Elle pense : j’étais à l’arrière d’une voiture mais je ne me souviens plus qui la conduisait.
Tous les silences de leur conversation permettent d’entendre les chansons qui ne sont pas du même artiste ; plusieurs de ces chansons parlent d’amour et Casca éprouve en les écoutant des sentiments profonds et sincères.
Trish n’éprouve rien à cause de toute l’attention que lui demande la fin de sa recette. C’est une recette qu’elle a trouvée sur internet et qu’elle cuisine pour la première fois ; elle a changé trois ingrédients de la recette par d’autres ingrédients, mais elle pense que le goût sera bon quand même. Trois ingrédients, ça ne change presque rien, pense-t-elle. Ce ne sont pas les ingrédients primordiaux, pense-t-elle.
Elle pense : les ingrédients primordiaux sont ceux qui donnent son nom à la recette.
Casca pose une question à laquelle Trish ne veut pas répondre.
Une artiste chante sa chanson de cinq minutes trente dans son intégralité sans que personne ne l’interrompe et puis finalement Trish pose les deux assiettes sur la table et dit bon appétit.
En face de chez moi, côté est, il y a un centre de formation. Je peux voir tout un pan du bâtiment depuis ma chambre, ma salle de bain et ma cuisine. Je n’y vois pas grand-chose, donc je ne le regarde pas beaucoup. C’est un lieu plutôt quelconque, avec un grand jardin dans lequel personne ne va ; un jour un homme a commencé un potager qu’il a aussitôt abandonné. Seulement, depuis quelques jours, j’ai remarqué quelque chose. Au premier étage, dans ce qui ressemble à une salle de cours, l’écran d’un ordinateur reste allumé. Le premier soir je ne m’en suis pas étonné, car cela arrive souvent, même si nous sommes en période de vacances. Mais ce soir, en fermant mes volets, je me suis aperçu que l’écran de l’ordinateur était toujours allumé, ce qui n’est pas normal, car de nos jours les ordinateurs se mettent automatiquement en veille. Cet ordinateur-là reste allumé comme si quelqu’un venait bouger la souris régulièrement et s’assurait qu’il ne se mette surtout pas en veille. Penser à ce genre de choses rend inquiet, car qui pourrait passer son temps à répéter une telle consigne. Désormais, je pense que quelqu’un arpente les salles de classe vides la nuit et bouge la souris de cet ordinateur précisément, ou appuie sur la barre d’espace, pour que l’écran reste allumé, et que je puisse le voir depuis ma chambre, dans le noir.
« Mais mon esprit, tremblant dans le choix de ses mots,
N’en dira jamais un, s’il ne tombe à propos,
Et ne saurait souffrir qu’une phrase insipide
Vienne à la fin d’un vers remplir la place vide ;
Ainsi, recommençant un ouvrage vingt fois,
Si j’écris quatre mots, j’en effacerai trois. » – Nicolas Boileau, Satires, Epîtres, Art poétique.
Désormais, plus besoin d’écrire de nouveaux livres après avoir écrit le premier. Grâce à leur durée de vie minuscule, vous pourrez le rééditer tous les cinq ans jusqu’à ce qu’il connaisse enfin le succès (jamais).
Je dors très mal en ce moment, à cause de tout un tas d’angoisses que je n’identifie pas.
« Toute couleur s’était absentée, à l’exception d’un ton pourpre et reposant qui recouvrait les eaux et les cieux en mêlant dans une tendre confusion chaque trait du paysage. » – Ann Radcliffe, L’Italien (trad. M. Porée).
Je songe depuis quelques temps à changer l’url des Relevés. Au tout début, il y a huit ans, personne ne lisait les Relevés. J’étais dans une logique différente, et je publiais sur les réseaux sociaux l’adresse à chaque fois que j’écrivais de nouvelles choses. Maintenant, je me fous de la publicité, mais fatalement davantage de gens me lisent parce que l’adresse a bien eu le temps de circuler, toutes ces années. J’aimerais retourner à l’époque quand personne ne me lisait. Si jamais un jour à cette adresse-ci il n’y a plus les Relevés, c’est qu’ils sont ailleurs, mais je ne vous dirai pas où.
Exemple de livre que j’aimerais traduire si je savais traduire : Do Graves Get Wifi, de Kristie Shoemaker.
Guidebook, un site qui satisfait totalement mon fétichisme des environnements de bureau circa 2000. Mes préférés : Mac OS X DP 2, Windows XP Professional (même si je préférais la variante vert/gris) et Windows 98 SE.
Au temps des chevaliers, un mage vivait au service d’un roi. Le roi était très aimé de son peuple, mais le mage nourrissait contre lui de tristes projets ; il souhaitait prendre sa place pour atteindre le statut d’élu divin. Maître des illusions, il lui faisait chaque jour de nouveaux tours pour tromper ses sens et le précipiter dans l’oubli. Le roi restait insensible aux manigances du mage car son coeur était pur et son esprit sans faille. Après une année entière à tenter sa chance, le mage comprit qu’il ne parviendrait à ses fins qu’en faisant appel à la plus grande des illusions. Un soir, il prit les traits de Dieu et se présenta au roi dans sa chambre. Il lui dit que pour remercier son dévouement, il pourrait lui procurer l’immortalité. Il lui montra une pierre rouge qui brillait sous les reflets de la lune. Le roi était émerveillé. Pour accéder à la vie éternelle, il devrait faire un choix : sacrifier son peuple, ou se sacrifier lui. Le roi ne pensait qu’à la pierre rouge qui brillait devant ses yeux. Il ignora la proposition de son Roi, dégaina son épée et le transperça. L’illusion se rompit, le mage mourut et la fausse pierre explosa. Deux jours plus tard, dans un accès de démence, le roi se jeta du haut de son château. Ensuite, une horde de barbares attaqua sa cité et massacra son peuple.
Il y a deux jours, sur r/nosurf, achessbeginner a écrit : does anyone else feel self-loathing after wasting yet another day online; I keep telling myself I won’t and then I end up spending half the day online I’m so hopeless.
epicgangforcemanga lui a répondu : go for a 15 min walk each day. make it a requirement and eventually you’ll look forward to it and it will turn into an hour long walk. i wish u luck my friend!
Est-ce que parfois, certaines tristesses que vous n’éprouvez plus vous manquent ?
Moi oui.
« Ce lac singulier, ces flammes réfléchies dans les eaux paisibles, les pâles couleurs de la terre, ces cabanes bizarres ; ces joncs qui se balançaient tristement d’eux-mêmes, ces cigognes, dont le cri lugubre se mêlait aux voix des nains ; tout la convainquit que l’ange de la mort lui avait ouvert le portail de quelque nouvelle existence. » – William Beckford, Vathek (trad. A. Morvan).
Les romans, ce n’est pas la logique, c’est une logique. Il n’y a pas de général en littérature ; il y a du particulier érigé en généralité. En tant que lecteur, on doit accepter ces logiques pour reconstruire généralement le monde tel qu’écrit. Si on veut mettre notre logique dans la logique dont on est témoin, c’est qu’on n’a rien compris.
Développer sur l’idée de confiance dans le roman.
Pour rétablir un semblant de jugement critique : le nouveau Mauvignier est nul, et ça se voit dès les premières pages. Dans l’ensemble, ce qu’écrit Mauvignier est assez nul, et surtout depuis Autour du monde, qui est vraiment super nul autant que chiant. Pour son dernier, il a lu Wallace (en exergue), il s’est dit : mais oui, les phrases longues, quelle bonne idée, sauf qu’il ne sait pas en écrire et transforme le tout en bouillie indigeste ; c’est donc une purge (cqfd). Comme il fait 600 pages, tout le monde est pris par l’illusion du gros.
Les phrases à rallonge mal faites, c’est un vrai créneau littéraire du contemporain, que tout le monde semble apprécier.
Chateaubriand The Necromancer
Chateaubriand, jeune nécromancien vivant à Cosmo Canyon, décide de ressusciter tous les rois d’une lignée monarchique dite descendante du Christ. Sur sa route vers la toute puissance, il affronte d’autres mages aux motifs bien plus sombres…
On met du temps à comprendre que ce qui fait son style, c’est ce qu’on est seul à écrire, c’est-à-dire ce que personne d’autre ne pourrait imaginer à notre place. Ça semble être une idée évidente, mais j’ai l’impression que personne ne la respecte. J’essaie de me secouer le plus souvent possible pour y revenir.
« Personne ne se crée comme moi une société réelle en évoquant des ombres ; c’est au piint que la vie de mes souvenirs absorbe le sentiment de ma vie réelle. Des personnes mêmes dont je ne me suis jamais occupé, si elles meurent, envahissent ma mémoire : on dirait que nul ne peut devenir mon compagnon s’il n’a passé à travers la tombe, ce qui me porte à croire que je suis un mort. »
Les touches de mon clavier commencent à déconner ; dysfonctionnement particulièrement agaçant. La batterie aussi crève peu à peu.
J’ai eu 29 ans il y a quelques jours.
Les Mémoires d’outre-tombe c’est un livre foutu de manière assez marrante. Les premiers livres, Chateaubriand parle de son enfance, de ses voyages, de ses exils, etc. Et puis à partir d’un certain livre, il se met à parler de Bonaparte, et c’est comme si cet homme transformait sa vie personnelle en vie historique. Si je voulais le dire avec mes mots, je dirais que Bonaparte a démoli sa facette d’enfant, qui est pourtant la plus intéressante. Ensuite, c’est un très bon historien, mais c’est comme s’il ressentait moins, vivait moins.
Il y a parfois un sentiment qui existe, je ne sais pas si je suis le seul à l’éprouver, et qui en gros est d’être persuadé que ce que l’on fait est bien, même si possiblement on vous dira que c’est nul. Mais ce n’est pas comme si c’était vraiment nul et qu’on était dans le déni, vous voyez ce que je veux dire ? On est certain que c’est bien, mais seul. C’est de l’orgueil ou de l’obstination, ou une espèce de foi intense en soi. C’est complètement mégalo mais, comme je le disais, on est obligé d’être mégalo (de toute façon), donc ce n’est pas grave.
« J’allais descendre sur la terre des prodiges, aux sources de la plus étonnante poésie, aux lieux où, même humainement parlant, s’est passé le plus grand événement qui ait jamais changé la face du monde. » – François-René de Châteaubriand, Mémoires d’outre-tombe.
« Vous n’ignorez pas d’ailleurs que, dans les âmes poétiques, le mysticisme et le doute règnent de pair. » – George Sand, Mauprat.
Après première relecture + corrections, Rivage fait sensiblement la même taille que La ville fond. C’est toujours une limite à partir de laquelle je me sens à bout de souffle. Grâce à Jimmy Arrow, je comprends désormais comment je pourrais faire plus long (de manière générale), mais je ne sais pas vraiment si j’ai envie de faire plus long. J’aime bien les trous dans l’intrigue, et j’essaie de ne pas être trop bavard, ce que je reproche à la plupart des romans, qui diluent beaucoup.
Quand on écrit un gros roman, il faut être absolument sûr de vouloir écrire un gros roman, car ça change tout à tous les points de vue.
Une autre constante, c’est que j’écris des livres qui doivent être lus lentement mais dans lesquels je fais tout pour qu’ils soient lus vite. C’est un peu con comme méthode.
Je l’ai déjà dit plein de fois mais bon je le répète : je déteste les romans didactiques, qui est la plus grande plaie du contemporain. Maintenant, quand je lis un roman, j’ai toujours la profonde impression que le romancier me trouve débile, et s’évertue à m’expliquer ce que j’avais déjà compris sans qu’il ait besoin de me le dire. C’est un peu comme l’effet Nolan au cinéma, si vous voulez.
Le dernier roman lu qui m’a fait cette impression, je l’ai déjà dit aussi, c’est La Fracture, de Nina Allan, que j’ai vraiment trouvé écrasant de bavardage. C’est un texte qui veut justement cultiver une ambiguïté d’interprétation, mais qui s’évertue à chaque page à l’aplatir la plus possible, pour que finalement il n’en reste rien (et qu’on s’en foute).
Des livres dont je parlais il n’y a pas si longtemps, comme Madame Bovary, Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, La Recherche, Le Navire de bois ou La Presqu’île (mais je pourrais encore en citer des centaines, jusqu’à Duras, Bolano et Wallace), ce sont des livres intenses car ils n’offrent aucune solution. Les narrations vous laissent avec des choix à faire qui vous sont propres et qu’elles seules seraient incapables de faire à votre place ; en fait, ces narrations offrent la possibilité d’une liberté qu’aujourd’hui les lecteurs ont presque honte de saisir, eux qui se sentent insultés quand ils ne comprennent pas ou que l’intrigue n’est pas bien menée ou que les personnages ne sont pas vraisemblables.
On peut tourner le truc dans tous les sens, le narrateur de La Recherche n’a rien de vraisemblable. Pourtant, il est bien plus réel que n’importe quel être humain ; que vous, que moi.
Le roman didactique c’est aussi le roman de l’éthos, de l’auteur qui sait ce que vous devez lire, comment, et de ce qu’il y a à trouver à chaque phrase, car il a tout compris. C’est une chasse au trésor dont les coffres apparaissent déjà aux emplacements cachés. C’est bien pour ceux qui ne veulent pas faire d’efforts et qui se contentent d’accumuler les pièces de monnaie.
Regardez comment le paratexte étouffe le texte avant même qu’il ne soit publié. Et comment le texte lui-même est étouffé par le projet qu’il cherche à construire ; où est la place pour le reste, qui est le plus important ?
Donc, dans la mesure du possible, je fais des livres dans lesquels le lecteur peut se glisser. Je n’ai pas de réponse à ce que je propose ; ce n’est pas l’objet.
J’ai bien conscience de m’exprimer très mal ; mais c’est à force de mal dire que je finirai par comprendre ce que je cherche.
À chaque fois que j’imagine la parution d’un de mes prochains livres, je suis pris de bouffées mégalomaniaques. J’espère toujours que ce livre en particulier me fera atteindre des sphères de notoriété ultimes. Quand on est une star, on peut adopter toutes les postures. Quand on n’est personne, on est constamment dans la compromission. Moi j’aimerais être une star pour disparaître, ou faire un truc inattendu pour une star. Que mon art soit un objet de fascination et que je puisse en jouer dans des vidéos Youtube ; avoir une aura, quoi. C’est dur d’imaginer que personne n’en a rien à battre de ce que vous faites, au fond. Il faut forcément vouloir être mégalo.
Et pourtant, les écrivains rockstar ont tous des têtes de con : Bernard Werber, Guillaume Musso, Marc Levy, Joel Dicker, Bernard Minier, etc. Ils pourraient faire un effort pour ressembler à quelque chose, vu l’argent qu’ils touchent, mais ils préfèrent ne ressembler à rien pour préserver une proximité qui est l’hypocrisie ultime des écrivains superstars. À l’inverse, on a toute une galerie moderne d’auteurs contemporains qui ont déjà bâti leur image avant même de savoir écrire ; donc ils sont vides mais ce vide rend bien.
Transition malhabile.
Ma fascination pour les groupes de rock du milieu des années 90 au milieu des années 2000 tient de quelque chose dans leur son qui englobe mon adolescence, une période symboliquement charnière pour moi car elle charpente la plupart des émotions profondes que j’éprouve encore aujourd’hui. Intellectuellement, j’ai évolué, mais pour le reste, tout s’est joué sur cette période-là. Donc, des titres comme There, There, Plug in Baby, By the Way, The Bitter End ou Sex on Fire (qui sont loin d’être tous de bons titres), sont moi, selon différents angles. Et ce sont eux, en plus de tout le reste (publicités, relations, vie en ligne, environnement quotidien) qui me permettent justement d’écrire, enrichis de mon approfondissement présent.
Par exemple, je sais que personne ne le relève, mais la ville de Lamballe, dans laquelle j’ai grandi, conditionne presque tous les environnements mentionnés dans mes livres. Comme c’est Lamballe, et pas Paris, tout le monde s’en fout. Et comme je ne le martèle pas à chaque occasion comme tous ces nouveaux jeunes auteurs de la banlieue périphérique, cela n’existe pas. Je n’en fais pas mon fond de commerce, mais c’est bien là.
« Et si ce que vous voulez c’est devenir écrivain, alors vous êtes foutus et je ne peux rien pour vous. Thomas Bernhard l’a dit, Deleuze l’a dit. D’autres aussi, sûrement. Ils ne le disaient pas par provocation. Ils le disaient parce qu’ils connaissaient la question, qu’ils avaient bien réfléchi, et, de toute évidence, cette conclusion s’impose. Le devenir-écrivain c’est le trou noir garanti au bout de la ligne. Écrire n’a pas grand-chose à voir avec devenir écrivain. » – Emmanuel Hocquard, Le cours de Pise.
Ce matin je me suis réveillé hyper tôt à cause de je sais pas quoi. J’avais commencé à lire Histoire de ma vie de Casanova et donc j’ai continué. Le dernier passage que j’ai lu avant de me rendormir : « Il disait que rien ne m’incommodait tant que l’incertitude, et par cette raison il condamnait la pensée parce qu’elle engendrait le doute » (je souligne). Cette phrase m’a fait un effet très fort et je n’ai pensé qu’à elle avant de me rendormir. J’ai pensé au livre que j’étais en train de finir d’écrire et qui pouvait se résumer dans cette phrase ; parfois on écrit toute une histoire pour illustrer un bout de phrase écrit au XVIIIe siècle et on ne s’en rend même pas compte. La pensée qui engendre le doute, c’est exactement le coeur de mon projet. Je dirais qu’au-delà de mon projet, c’est toute ma vie qui tourne autour de cette phrase. Au-delà de Rivage au rapport, ce que définit cette phrase, c’est moi.
J’écoute 36 Degrees de Placebo et en même temps j’écris ce paragraphe. Je suis en train d’améliorer Rivage au rapport, que j’ai terminé en fin de semaine dernière. C’est la meilleure partie, quand je suis certain de faire mieux. Réécrire, c’est toujours mon moment préféré, parce que c’est là où je suis bon. C’est comme au golf, où je suis bon au petit jeu. Frapper à 300 mètres ne m’intéresse pas trop mais le reste oui. En littérature c’est pareil : dérouler des dizaines de pages trouve vite ses limites ; je préfère y revenir. Je vais prendre le mois, je ne suis pas pressé. Tout est là, c’est l’avantage. C’est un roman que j’aime beaucoup mais évidemment il ne ressemble pas du tout à La ville fond. J’aurai eu du mal quand même. Je pense déjà à une suite, qui s’intitulerait Casca revient.
Vendredi je me suis demandé si finalement Rivage au rapport méritait réellement d’être abandonné, et en le relisant je me suis dit que peut-être non, donc je l’ai repris, je l’ai relu, je l’ai corrigé, et à la fin de là où je m’étais arrêté la dernière fois, j’ai continué à écrire, et là je prends le temps d’écrire ce paragraphe simplement pour dire que je continue encore à l’écrire, et que si je continue à ce rythme, j’arriverai bien au bout, et que ce livre existera, ce dont je suis heureux.
« J’admets que j’espère modifier, en tant qu’écrivain, la perception des lecteurs, ne serait-ce que légèrement, à condition que ce changement de « perception » soit un progrès dans la compréhension de notre monde et aille dans le sens de l’action révolutionnaire. Cela dit, en tant que personne, je ne peux pas être qu’écrivain, c’est-à-dire un écrivain + un citoyen obéissant, car de toute évidence je suis incapable d’être un citoyen obéissant et le genre d’écrivain que je m’efforce d’être. » – Jean-Patrick Manchette, Lettres du mauvais temps.
Je reviens sur les Lettres de Manchette : l’impression étrange que ce volume donne, c’est celle d’un monde oublié ; Siniac, Westlake, Cook, qui se souvient d’eux ? Quelle postérité pour le genre ? Siniac, je me rappelle, il y a trois ou quatre ans, quand je voulais lire ses livres, la moitié était introuvable, et pourtant, même cette moitié était bien meilleure que d’autres qui ont la chance de finir dans le fonds des librairies (comme… au pif… Ellroy ?). Cela me conforte dans cette idée ; la littérature blanche perdure bien, ou mieux, tandis que le genre meurt très vite. Dans vingt ans, Siniac aura définitivement disparu, au profit de toute une ribambelle de cons sans talent. Au fond, je crois que c’est un volume qui me rend triste, et m’énerve aussi, par la bande, collatéralement. Le seul rescapé du bouquin, c’est Échenoz, grâce aux prix sans doute, grâce à Minuit.
Ce soir, j’ai commencé l’arc 7 de Jojo’s Bizarre Adventure, Speed Ball Run. Je suis vraiment fasciné par Jojo’s Bizarre Adventure. C’est de loin ce que je lis de mieux en ce moment. C’est une oeuvre qui ne s’embarasse de rien et qui est portée par des sentiments purs. Quand je dis sentiments purs, je dis surtout que c’est une oeuvre qui s’affranchit de ce qu’on attend d’elle comme oeuvre depuis ses débuts, littérairement et économiquement. Quand je lis Jojo’s Bizarre Adventure, j’ai l’impression d’être libre, parce que je sais qu’Araki est libre en l’écrivant et en la dessinant. J’aimerais trouver cette même liberté, qui est la joie pure je crois, le plaisir essentiel de la création. Aucun roman qui s’écrit actuellement ne porte cette même joie ; tout est encombré de ce qu’on appelle la réalité et qui ne sert à rien pour nous construire en tant qu’êtres humains. L’être humain est porté par un désir minime de réalité, et par un désir énorme d’autre chose, or cela nous l’avons oublié. Ce que j’appelle réalité n’a rien à voir avec ce qu’on entend généralement du terme, mais correspond plutôt à une sorte d’abandon végétatif pour ce qui est. C’est très difficile à expliquer ; c’est comme une intuition. En fait je crois que la réalité c’est le présent, et que la création c’est le futur. C’est ce que je peux dire de plus proche de ce que je ressens.
salut
j’ai écouté le dernier album de phoebe bridgers
punisher
phoebe bridgers a les cheveux très blancs
un peu comme griffith
dans berserk
ce blanc a quelque chose de fascinant
c’est un blanc pur
et en même temps démoniaque
un jour j’espère
j’écrirai un livre avec comme titre
final fantasy XX
ou windows 99
mais pour ça il faut être millionaire
et acheter les droits à
microsoft
et square enix
donc peut-être juste
si je me décolorais les cheveux
je pourrais faire une promo fascinante
pure et démoniaque
et les gens me trouveraient mystérieux
je serais célèbre
et tu m’aimerais enfin
peut-être
Je voulais prendre un vol vers Cap Canaveral pour ensuite prendre une fusée vers Mars, mais finalement j’ai compris que ça n’était pas possible. Je suis resté dans ma chambre et j’ai regardé à la télévison des rediffusions des décollages d’Apollo 5, et surtout le lancement râté pendant lequel elle explose. J’ai imaginé les astronautes hurler à l’intérieur et aussi leurs esprits se perdre dans l’espace pour toujours. Un jour j’espère qu’on pourra aller dans l’espace à pied. Si je vivais sur Uranus, je pense que tout irait mieux pour moi. Dans mes rêves je pense à Uranus parce que c’est une planète sans ombre et sans lumière. À l’intérieur il doit en même temps faire très froid et très bon. Je pense aussi à Kyoto même si je n’y suis jamais allé. Je sais que là je pourrais vivre une super belle histoire d’amour avec une fille de mon âge qui aime les mêmes choses que moi. Dans une de ses chansons Clairo parle d’une fille qu’elle aime, et quand je l’écoute je m’identifie à Clairo mais aussi à la fille qu’elle aime, je ne sais pas si c’est normal. Je pense qu’une ville comme Kyoto pourrait exister telle quelle sur Mars, parce qu’elle est dans le même esprit. Tout ce que je viens de dire me rend un peu malheureux parce que j’ai peur que ça n’existe jamais. À force de trop vivre dans sa tête on oublie de vivre pour de vrai. Quand je suis en cours je regarde les autres autour de moi et je me demande s’ils pensent à Mars autant que moi. Je m’endors le soir en m’imaginant guitariste d’un groupe de rock des années 2000.
Tout ce que j’écris se superpose comme un genre de tour de combat avec des étages à l’infini. À chaque étage je m’affronte. Plus je monte et plus les combats sont durs. Ce que j’écris c’est comme des armes qui se retournent contre moi. C’est ça de chercher, je pense. C’est gravir une tour éternelle qu’on construit comme une prison, parce qu’on est prisonnier de ce qu’on sait déjà faire. En fait, il ne faut pas voir les essais comme des projets avortés, mais comme des sortes de chimères, ou de robots, qui s’assemblent et au bout d’un moment forment un ensemble convaincant. Ma tour de combat c’est là où je m’épuise chaque jour, mais c’est aussi le méca qui me permettra de dominer le monde.
J’écris mes poèmes comme les conversations MSN que je ne pourrai jamais tenir (parce que MSN n’existe plus).
J’ai acheté le livre avec les lettres de Manchette mais finalement je trouve pas ça terrible et la plupart des lettres pas très intéressantes, alors que pourtant j’adore Manchette.
La première fois que j’arrivai à Myriad Pro, je n’avais ni arme ni argent. On m’avait dit d’aller voir Diaz, aussi allais-je le voir. On m’avait donné l’adresse du casino dans lequel bossait Diaz et c’est là que je trouvai Diaz. Il était assis sur un canapé dans une des salles VIP du casino et à côté de lui d’autres types étaient assis et attendaient que quelque chose se passe. Diaz était assis tout seul dans son canapé. Il me dit qu’il avait une mission pour moi, un truc simple pour voir si je savais me débrouiller. Je lui dis que ça m’intéressait mais que je n’avais ni arme ni argent, alors il m’a donné une arme, et il m’a dit que j’aurai l’argent si je réussissais la mission. L’arme était un pistolet normal. Il me dit ensuite que j’aurai à tuer un rival qui lui volait sa came et pour que je le tue il me donna une adresse où je pourrais le trouver. J’y allai à pied et arrivai devant plusieurs garages à louer. Toutes les portes de garage étaient pareilles donc je les ouvris au hasard pour voir ce qu’il y avait derrière. Dans le troisième garage il y avait trois types en train de se piquer et je tuai tous les trois. Ensuite je les pris en photo avec mon téléphone et je retournai au casino où je montrai les photos à Diaz. Il me donna de l’argent et avec l’argent je louai un appartement dans un quartier pas terrible de Myriad Pro. Le lendemain, je retournai voir Diaz, qui avait une autre mission pour moi.
22. Nous marchâmes dans Sian, Calico, Fugo et moi, tandis que les soldats débarassaient les derniers cadavres pour les aller enterrer par-delà les remparts. Le silence était de la même angoissante perfection qu’au fond de l’enceinte glaciaire et ténébreuse abritant Lucifer ; au détour de ruelles, je vis des femmes assises comme mortes, leurs têtes couvertes dans de longues capuches. Calico dit : « Sian renaîtra », puis il ne dit plus rien avant que nous ayons atteint ses quartiers. Là, il s’entretint longuement avec nous de notre voyage et de ce que nous avions vu. J’évoquai Genya et les créatures démoniaques ; Fugo lui raconta d’autres faits que j’avais déjà entendus. Je lui demandai si les jours passés il avait entendu parler d’une femme du nom de Fionn ; mais ce nom ne lui dit rien. Calico parla : « Je dois te remettre un objet sans lequel tu ne pourras vaincre Soma. Il possède le même ; nous les avons eus chacun le jour de nos treize ans, de notre mère. Elle mourut peu après m’avoir remis le mien, d’une maladie qui l’atteignit comme une malédiction ; sa quête à elle s’acheva ainsi ; ensuite, elle rejoignit notre père aux côtés de Dieu ». L’objet dont Calico parlait, il le fit amener par un serviteur, posé sur un coffret recouvert d’un beau suaire en lin. Calico découvrit le suaire et révéla un petit médaillon fait dans l’ivoire d’un éléphant. Sur celui-ci étaient gravées les armoiries de leur famille, trois abeilles, deux en haut, d’or, la troisième en dessous, noire. Calico dit : « Je crus longtemps que les abeilles dorées représentaient notre père et notre mère, et l’abeille noire mon frère et moi, enfants, qui plus tard serions devenus d’or également. Aujourd’hui je comprends m’être trompé : Soma est l’abeille noire, et les deux abeilles dorées celles qui le vaincront ». Calico raconta qu’après que Soma eut commis l’irréparable et rejoint Lucifer, les teintes des abeilles sur son médaillon s’inversèrent, celles en or devenant noires, et celle en noire devenant d’or. Je compris alors qu’une âme tourmentée serait amenée à choisir son camp, et que cette âme tourmentée pourrait être la mienne.
21. Nous arrivâmes devant l’entrée de Sian, ville fortifiée de remparts au pied desquels une dizaine de gardes en armure nous attendaient ; sans doute des éclaireurs les avaient-ils alertés de notre présence ; la ville semblait en état de siège, et je supposai que peut-être les démons les avaient attaqués quelques jours auparavant. Les gardes pointèrent leurs lances vers nous, aussi me préparai-je à les affronter. Leur nombre ne m’effrayait d’aucune manière, et leurs armures n’auraient entravé qu’à peine le passage de ma lame. Je m’avançai, prêt à fendre par la taille le premier qui oserait m’attaquer, quand les grandes portes derrière eux s’ouvrirent ; un homme que je connaissais bien arriva sur un cheval blanc colossal, parmi les derniers de leur race. Il ordonna aux gardes de baisser leurs lances, et leur dit qu’ils auraient à rendre des comptes pour le déshonneur qu’ils me faisaient. Cet homme avait pour nom Calico, et il était le frère cadet de Soma ; ses cheveux étaient du même blanc, ses yeux du même bleu. Je connaissais bien Calico, que je considérais comme un ami, et comme un des plus braves chevaliers de son temps. Il s’excusa pour l’accueil de ses gardes, et sourit quand il comprit que je l’avais reconnu ; il descendit de cheval et me fit l’accolade. Calico dit : « Je suis heureux de te voir ce matin. Il y a deux jours, les démons de mon frère sont venus et ont massacré à l’intérieur de mes remparts quantité de bonnes âmes. Ils ont pris l’apparence d’hommes semblables à toi et à moi pour tromper la vigilance de mes gardes ; il nous fallut batailler la nuit et le jour sans répit avant que de les vaincre. Le temps presse, et toi seul peux arrêter mon frère désormais ». Puis, il m’invita à le suivre jusque dans ses quartiers ; Fugo, derrière, regardait cette ville pour la première fois.
(Cette mode à la publication, à un ou deux ans d’écart, de romans québécois chez des maisons françaises, va me tuer ; d’autant qu’elle se généralise ; je n’avais jamais envisagé que l’édition soit à ce point fainéante qu’elle se félicite de reprendre les bouquins déjà parus chez d’autres, avec quelques modifications mineures, là surtout pour faire genre, et tromper qui ?)
« Quand je filais à toute vitesse sur la route d’une banlieue de Manille
Je me souviens avoir ri
Dans le port de Keelung sous la pluie
J’ai peut-être même pleuré
Au coin d’une rue à Tokyo
Je renie tout ce qui fait de moi ce que je suis. » – Ayukawa Nobuo, Poèmes 1945 - 1955 (trad. K. Marcelle Arneodo).
20. Sur le chemin vers la ville suivante, Fugo me demanda s’il y aurait beaucoup d’autres cadavres avant que j’atteigne le terme de mon voyage, et je lui répondis que oui, car Soma ne se présenterait qu’une fois le sang impur intégralement répandu. Je lui racontai le passé qui me liait à Soma, et alors Fugo comprit comment ma quête s’achèverait, mais que cela ne devait pas arriver avant un long moment, et beaucoup de batailles. Nous dormîmes ce soir-là dans la campagne ; Fugo ne dormit pas, car il avait trop peur de la nuit, qui prit dans son esprit la forme des monstres et des cauchemars. Je l’entendis s’éloigner vers un de ces lacs où les âmes attendent d’être menées ailleurs. Il me raconta le lendemain qu’il avait vu là-bas ses frères et sa soeur ; ils le rassuraient sur leur vie dans l’au-delà, et sur les flammes du bûcher, qui n’avaient été vives qu’un instant, avant de les endormir. Fugo me dit : « Leurs visages étaient déjà formés des premières traces de l’oubli, quand les yeux changent de couleur et la peau de matière. Les fausses âmes du lac souhaitaient m’entraîner sous l’eau, là où d’autres aventuriers avant moi s’étaient laissés noyer. J’ai éprouvé de la tristesse hier soir après que tu m’aies raconté ton passé, car j’ai pris conscience de ma propre histoire, et des êtres chers qu’il me faudra venger. Aussi me suis-je éloigné de ces fantasmes translucides qui parlaient la même langue que mes frères, la même langue que ma soeur, ai-je fait demi-tour parmi les arbres, retrouvé le feu de camp, et me suis-je endormi. Ce matin, je n’avais plus de peine ». De l’entendre parler ainsi, je compris qu’il mentait, mais que ce mensonge suffirait.
(Finalement, si je faisais machine arrière dans tous mes principes, et qu’on éditait mes Relevés chaque année, ça m’éviterait d’avoir à écrire un livre que je n’arrive pas à écrire. Car c’est toujours la même question : c’est quoi, écrire un livre ? J’aime beaucoup l’idée d’un objet qui tient, tout seul, comme ça, dans la transmission humaine de la littérature. J’essaie de me convaincre que c’est pas des conneries. Est-ce qu’écrire plein de bouts de trucs ça fait oeuvre ? Ça dépend je dirais. Pascal, La Bruyère ou Montaigne, c’est grosso-modo ce qu’ils ont fait, mais ils étaient bien moins cons que moi. C’est une histoire de compensation. Plus tu t’en fous de la forme, plus il faut que ça soit fort. Moi je cumule toutes les tares : impossible de construire un objet abouti, et impossible d’être intelligent. C’est quand même du travail tout ça, et moi je suis beaucoup trop fainéant.)
« La vie lui tombera comme une chevelure
et il restera à tourner
comme une sphère parfaite
stérile et mortelle
ou moins joliment
il ira par les ciels
pourrissant en douceur
comme une seule plaie
comme un mort. » – Idea Vilariño, Ultime anthologie (trad. E. Sarner).
salut
la dernière fois
je ne sais pas si tu te souviens
tu revenais de madrid
moi j’écoutais californication
et pour une fois
t’avais l’air contente de me voir
comme si entre temps j’avais changé
et que je n’étais plus tout à fait
pareil
je crois
et même si en vrai
j’étais le même
après on a parlé
je ne sais plus de quoi
et comme le temps a passé on est arrivés
plus loin dans l’album
jusqu’à porcelain
et je crois que pendant un instant on s’est dit
que peut-être
on pourrait s’embrasser
à cause de la chanson
et d’autres choses
mais je ne sais pas quoi
et de toute façon peu importe
puisqu’il ne s’est rien passé
19. Deux jours après ces terribles événements, la villageoise qui m’avait aidé contre les hommes de Genya me rejoignit dans l’auberge, où j’achevai de récupérer de mes blessures. Là, elle me dit : « Je souhaiterais vous accompagner pour apprendre le maniement des poignards et des dagues, afin de protéger mon fils et venger la mort de mon mari ». Je ne pus accepter, car déjà la compagnie de Fugo ne durerait que le temps pour moi de retrouver Fionn, qui elle seule devait m’accompagner au terme de mon voyage. Elle sortit de l’auberge sans un autre mot. Peu après, sur la place centrale, j’annonçai aux villageois qu’ils pourraient aller jusqu’à mon manoir s’ils souhaitaient y trouver refuge ; là-bas, un érudit les accueillerait et leur montrerait où coucher ; dans les étables, ils trouveraient des bêtes, et plusieurs hectares de terre attendaient d’être cultivés. Les villageois ne se sentaient plus en sécurité à Tule, aussi acceptèrent-ils avec enthousiasme ma proposition ; mon manoir, ils devaient le penser, les protègerait ainsi que je l’avais fait. Ensuite, Fugo me rejoignit, et nous partîmes tous deux vers le prochain village, laissant derrière nous Tule et ses morts.
« Mes yeux étaient fixés sur les eaux ; je déclinais peu à peu vers cette somnolence connue des hommes qui courent les chemins du monde : nul souvenir distinct ne me restait ; je me sentais vivre et végéter avec la nature dans une espèce de panthéisme. Je m’adossai contre le tronc d’un magnolia et je m’endormis ; mon repos flottait sur un fond vague d’espérance. » – François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe.
Cela fait deux ans que j’ai pris la direction de la Maison de la Poésie de Rennes. Mon sentiment est partagé. D’un côté, je constate qu’il y a une envie énorme, colossale dirais-je, de littérature et d’écriture, à Rennes, et à côté de Rennes, partout en Bretagne en fait. On trouve des partenaires à tous les coins de rue, dans toutes les autres disciplines artistiques, et chez tous les publics : hôpitaux, prisons, MJC, etc. Tellement de partenaires d’ailleurs que nous sommes constamment obligés de choisir et de limiter, non pas pour des raisons de qualité, mais simplement d’argent.
Car malheureusement, de l’argent, pour la littérature, il n’y en a pas. J’écris ces paragraphes après avoir appris que le CNL refusait d’aider à financer notre festival de poésie contemporaine. Pas le moindre euro. Le paradoxe, c’est que le CNL est l’institution qui demande le dossier le plus complexe à constituer ; toucher de l’argent du CNL, pour une association, tient presque du miracle. Je ne comprends pas pourquoi. C’est comme s’ils faisaient tout pour ne pas en donner. Pour notre festival, on a rémunéré tous les artistes malgré l’annulation, à hauteur de 8000 euros au total. Si ces artistes sont rémunérés, ce n’est pas grâce au CNL.
En dehors de ça, toutes les structures qui faisaient de la littérature à Rennes en font de moins en moins, voire plus du tout. Moi-même, je suis seul, et ma collègue pour les scolaires est à mi-temps. Je ne sais pas pourquoi c’est si dur d’avoir de l’argent pour la littérature alors que les gens n’attendent que ça. Depuis que je suis en poste, les subventions ont baissé chaque année davantage. J’espère que je ne fais pas mal mon travail.
Les institutions, je crois, aimeraient pouvoir payer les artistes sans payer les intermédiaires qui aident les artistes. Les institutions rêvent de bénévoles qui remplaceraient les salariés, et qui ne coûteraient rien.
Après ma journée de travail, parfois, je rentre déprimé, parce que je n’ai pas trouvé d’argent pour payer les gens et pour concevoir les projets artistiques. C’est une déprime simple, celle de se dire que des choses qui pourraient exister n’existent pas, uniquement à cause de l’argent.
La littérature coûte, et on nous le fait bien comprendre. On remplit des appels à projet, on multiplie les dossiers similaires pour assembler des bouts de budgets. À la fin, on ne fait plus beaucoup de littérature. On fait autre chose. Au bout de deux ans, je n’ai pas encore compris quoi ; de la culture peut-être.
17. Nous rentrions la femme et moi vers Tule quand nous vîmes au loin une de ses maisons incendiée. Le soleil avait déjà rendu ses derniers rayons depuis une heure pleine, et je redoutai que les villageois aient péri ; les hommes envoyés alors que j’affrontais Genya les auraient empêché de fuir avant que de les massacrer. Aussi, quelle ne fut pas ma surprise lorsque nous accueillit avec joie, devant l’auberge, un groupe d’une quinzaine de villageois et de villageoises réunis en cercle et conversant ; on escorta la femme chez celle qui s’occupait de soigner son enfant. Fugo était là lui aussi, et il entreprit de me narrer les événements tels qu’ils s’étaient déroulés durant mon absence :
18. « Peu après que vous ayez rejoint le bois, un groupe de bandits arriva par le côté opposé vers le village. Nous réunîmes outils et armes pour nous défendre, et les plus faibles s’enfuirent par un passage souterrain qui allait vers le nord. Nous avions peur et savions que peut-être nous mourrions ici, quand une voix divine venue des cieux s’adressa à nous. Elle nous dit que si nous nous battions avec assez de bravoure et de volonté, nous ne compterions qu’un mort dans nos rangs et triompherions de nos ennemis. Cette révélation fit forte impression et redoubla notre vigueur. Les bandits arrivèrent ; nous nous battîmes férocement et sans faillir, étonnés et émus par notre propre force ; les hommes qui n’avaient jamais porté le moindre coup en portèrent et des plus fermes, les femmes qui ne s’étaient jamais défendues se défendirent corps et âme. Bientôt, nous crûmes dominer les bandits sans subir la moindre perte, aussi doutai-je de la prophétie et redoutai-je un événement néfaste, qui arriva comme la voix l’avait prédit. Un de nos villageois, comme nous le comprîmes ensuite le même qui avait propagé la nouvelle du meurtre des trois chevaliers et amené les bandits par ici, nous fit faux bond et révéla sa nature ambigüe : il mit sa lame sous le cou d’un de nos alliés et menaça de le tuer si nous ne nous rendions pas dans l’instant. Alors, venu du ciel, un éclair redoutable s’abattit sur lui et le réduisit en cendres ; la prophétie divine s’était accomplie. Les derniers bandits moururent peu après sous nos assauts, et nous sortîmes victorieux de cette bataille avant que le soleil ne se fut couché. Pour achever de conjurer le mauvais sort, nous brûlâmes la maison du traître telle que vous le voyez à présent, et nous réunîmes pour célébrer l’Être divin qui s’était porté à notre secours. »
16. Alors que nous quittions les bois pour rejoindre Tule, la femme me dit que, depuis la souche où elle s’était trouvée cachée et observait le duel qui m’opposait à Genya, elle avait prié pour que je l’emporte, car elle avait estimé ma situation critique et mon sort bientôt fait ; peut-être par ses prières miséricordieuses cette femme me sauva-t-elle en effet d’un plus funeste destin. Car alors nous nous rapprochions de l’orée du bois, Genya et moi, lui toujours plus précis dans ses coups, me couvrant de coupures et de pointes profondes, moi boitant et peinant à reprendre le dessus. Genya comprit que je cherchais à l’amener en dehors des bois, car là il m’aurait été permis de le vaincre loyalement, aussi anticipai-je son raisonnement en rusant doublement : je feins d’admettre ma défaite et lui tournai soudain le dos pour fuir vers l’extérieur. Je savais qu’en prêtant allégeance à la horde démoniaque, il avait renoncé au code chevaleresque, et m’aurait sans la moindre hésitation transpercé depuis le dos jusqu’à mon coeur, tel un lâche ou un fou. Je mis tous mes sens en éveil et, à cet instant qui devait me permettre de quitter le bois mais m’aurait vu transpercé, je tombai. Genya, déjà lancé dans son mouvement, se trouva par-dessus moi étendu, allongé dirais-je, tandis que je fis volte-face au sol et le tranchai en deux au niveau de la taille ; je fus arrosé de son sang, et son buste, projeté vers l’avant, continua son trajet dans les airs avant de rouler dans la clairière pour finalement s’immobiliser là. Je me trouvais étendu sur le sol, à bout de forces. La femme cachée dans le tronc accourut et m’aida à me tenir sur mes jambes. Alors, tandis que le corps de Genya se consumait de flammes noires, je vis son âme s’élever, et il m’adressa la parole : « Tu m’as délivré de l’emprise de Lucifer, qui désormais me fait honte, et m’empêchera de rejoindre mes amis là où les plus vertueux chevaliers trouvent le repos. Ton aventure rencontra nombre d’épreuves, car les pouvoirs du Démon sont sans limite. Pourtant, je pressens une forte volonté en toi, qui te fera triompher si Dieu ne t’abandonne pas. Garde la confiance en ta force, et en ta foi. ». Dans le ciel, les nuages éclairés par le soleil dessinèrent le visage de Genya, apaisé désormais, comme d’or. Puis, balayés par un vent fort qui venait de l’ouest, les nuages disparurent et Genya ne fut plus.
15. Je décrochai mon épée du tronc et du buste du premier chevalier, qui s’effondra comme une chiffe et s’agença de façon malcommode. Le quatrième chevalier se rendit visible ; je le reconnus à son épée avant même que de voir son visage, car cette épée était bien plus courte et plus fine que toute autre épée. Ce chevalier répondait au nom de Genya ; il avait été l’un des chevaliers les plus braves et les plus dévoués du roi avant qu’il ne soit tué. Il était réputé bien au-delà du pays pour ses nombreux faits d’arme, et notamment lors de la bataille des trois colosses, durant laquelle la légende dit qu’à lui seul il tua cinq cent hommes sans subir la moindre blessure. Les bois étaient à son avantage, car l’écart rapproché entre chaque tronc empêchait que mes mouvements ne se fassent librement. Il vint vite sur moi, et je ne dus d’esquiver l’estoc porté à ma tête qu’à une sorte d’instinct précieux qui m’a toujours tiré des plus terribles situations ; son épée n’avait pas de taille, aussi m’attaquait-il par des touches vives et précises, comme un scorpion lance son dard. Je parai ses assauts du plat de ma lame, mais ne trouvai aucune ouverture pour riposter. La pression subie était telle que je combattai en reculant, et manquai, lorsque les branches ou les racines sortaient trop du sol, de perdre l’équilibre et de tomber tout à fait sur le dos. Son visage était si proche du mien que plus d’une fois je vis dans ses yeux la marque du démon ; ce regard, par son pouvoir obscur, réactivait le poison encore présent dans mon épaule. Bientôt, il me fit un trou dans la cuisse gauche, pas plus large que la pointe d’une aiguille, mais traversant de part en part ma jambe ; quand il la retira de ma chair, la douleur aussitôt fut brûlante et intense. J’y resterais, j’en étais convaincu, si je ne trouvais pas un terrain plus propice pour manier mon épée.
13. La veille de notre départ, de terribles événements advinrent à Tule qui précipitèrent la fin de la formation de Fugo. En effet, le matin de cette funeste journée, alors que je discutai devant l’auberge avec Cid, un brave homme du village qui s’occupait de sculptures, nous vîmes arriver au loin un enfant d’environ dix ans, qui portait un panier assez lourd pour qu’il le tienne dans ses deux bras. Lorsqu’il fut près de nous, je vis que son visage était tuméfié, et qu’il avait pleuré abondamment, car ses joues portaient encore la trace de ses larmes ; je reconnus le fils d’un des paysans qui s’occupaient de cultiver les champs autour de Tule. Sans prononcer le moindre mot, il déposa le panier à nos pieds, et une fois cela fait, il s’effondra sur le sol et s’évanouit. Je dis à Cid de prendre l’enfant avec lui et de le porter au devant de sa mère, afin qu’elle lui prodigue les premiers soins. Après qu’il fut parti, j’ouvris le panier ; il contenait la tête du paysan, enveloppé dans une toile de jute rougie par le sang. Un mot l’accompagnait, qui réclamait vengeance pour la mort des trois chevaliers que j’avais tués le premier jour, et donnait rendez-vous à l’auteur de ces meurtres l’après-midi-même dans les bois qui bordaient l’ouest de Tule. Si je ne me présentais pas, ils menaçaient de réduire le village à néant et d’offrir ses habitants en sacrifice à Lucifer, qui était seul roi désormais. Cid revint vers moi en m’assurant qu’il n’avait pas trouvé la mère de l’enfant, et que sa maison était vide ; il avait laissé l’enfant chez une autre femme qui apprenait l’art de la médecine. Je compris que la femme du paysan devait se trouver entre les mains des disciples de Lucifer, et que bientôt sa tête nous arriverait dans un autre panier si je n’allais pas à leur rencontre. Je demandai à Cid d’alerter les habitants du village afin qu’ils se barricadent et rassemblent leurs affaires ; si je n’étais pas revenu avant que les derniers rayons du soleil aient rendu leur lumière, il leur faudrait partir. Avant de prendre la route du bois, je trouvai Fugo et lui confiai la tâche de défendre Tule tant qu’il le pourrait si quelques hommes venaient à se présenter. Je doutai alors de jamais le revoir vivant.
14. Je pénétrai dans le bois, qui était dense et plein de pénombre, à la recherche des chevaliers qui m’avaient défié. Je souhaitais vaincre mes adversaires au plus vite pour ne pas laisser Tule sans protection. C’est quand je fus tout à fait éloigné de l’orée que je vis quatre hommes me faire face, deux bien visibles, un troisième à demi camouflé par les arbres, et le dernier à une telle distance qu’il m’était impossible de deviner les traits de son visage. Je fus surpris qu’ils soient si peu nombreux et en déduis que ma venue servait de diversion pour accomplir un crime plus grand. J’aurais sitôt fait demi-tour si je n’avais vu qu’ils retenaient une femme, qui était la mère de l’enfant. Je brandis mon épée par-dessus mon épaule et la lançai tel un javelot dans la tête de celui qui gardait la femme ; mon épée s’enfonça droit dans son coeur, et la force de mon jet le projeta trois bons mètres en arrière, jusqu’à ce que la pointe de mon épée rencontre le tronc d’un arbre où elle se planta et le pendit. La femme profita de la surprise du second chevalier pour saisir le poignard accroché à sa ceinture et lui asséner plus de vingt coups rapides dans les cuisses et le bas-ventre. Accablé de douleur, le chevalier s’effrondra sur le sol fait de branches et de feuilles, et la femme poursuivit son assaut dans le torse, le visage, la gorge et les yeux. Après, le chevalier n’était plus qu’une charogne méconnaissable et inconsciente. La colère de la femme était légitime car elle avait vu son mari décapité et son enfant battu et obligé de porter la tête du bois jusqu’au village ; aussi cette colère s’était transmise dans ses coups et dans sa bravoure. Je lui demandai pourtant de se mettre à l’abri et d’attendre que je ressorte vainqueur du combat ; elle connaîtrait de plus graves dangers en retournant tout de suite à Tule ; elle suivit mes conseils et trouva refuge dans la souche creuse d’un arbre foudroyé. Le troisième chevalier s’interposa entre mon épée et moi, démontrant ainsi sa lâcheté et sa couardise, maux dont sont atteints toux ceux qui ont rompu leur serment auprès du roi pour rejoindre l’armée de Lucifer. Cependant, l’ascendant qu’il crut avoir pris sur moi en me désarmant lui coûta cher, car bientôt d’un seul coup de poing je lui écrasai la figure de telle façon que sa cervelle sortit de son crâne et qu’il retomba mort aux côtés de son compagnon aveugle et défait.
12. Grâce aux soins de notre hôtesse, le garçon récupéra vite de ses blessures et souhaita que je l’entraîne. Je lui demandai s’il savait manier l’épée, car j’en maîtrisais l’art, bien que la mienne fut de forme et de taille inhabituelles. « Non, me dit-il, j’ignore tout du maniement de l’épée. Cependant, lorsque moi et mes frères étions dans la mine, nous utilisions parfois les pioches qui nous servaient à tailler la pierre comme armes de substitution. Cela tenait plus du jeu que de l’entraînement, car plusieurs chevaliers du roi défendaient la mine qui était sa possession, et dès lors nous n’avons jamais eu à nous en servir contre aucun homme. » J’imaginai ce garçon affronter les créatures à coups de pioche, et cela me plut. J’en achetai une à un marchand itinérant, qui me la vendit comme rare car capable d’être sertie de gemmes magiques ; trois encoches rondes avaient été gravées dans le bas du manche. Le garçon m’apprit que les gemmes que lui comme des milliers d’autres ouvriers extrayaient dans les mines du pays servaient aux mages pour forger des armes ensorcelées, et que les rois achetaient leurs pouvoirs en leur fournissant ces pierres naturelles, comme le diamant, le saphir et l’émeraude. « Je crois savoir où nous pourrions en trouver de puissantes », dit-il. Je lui montrai la bille noire que m’avait donnée le mage Delilah, et lui demandai s’il avait déjà découvert des gemmes semblables dans les mines. À sa vue, il fut captivé comme si un maléfice avait envoûté ses sens et pris possession de son esprit ; je rangeai la bille et il revint à lui. « Non, me dit-il, je n’en ai jamais vu de telle. » J’en restai là. Le lendemain matin, nous nous retrouvâmes dans un champ à l’écart du village et nous mîmes en garde. Sa façon de combattre n’avait rien de commun ; plus d’une fois je fus surpris par son intelligence et sa ruse. Je sentis pourtant qu’en son coeur vivait une haine féroce qui aurait tôt fait de le dévorer et de le rallier au camp ennemi.
10. Nous passâmes plusieurs jours dans ce village qui se nommait Tule. Le garçon avait besoin de repos, et moi de soigner ma blessure à l’épaule, dont le poison paralysait le haut de mon bras et une partie de mon torse. Les événements dans l’auberge firent forte impression, et plusieurs habitants vinrent les jours suivants me remercier d’avoir tué ces trois hommes. Depuis la mort du roi, ils avaient comme nombre d’autres chevaliers rejoint les disciples de Lucifer, et formaient les rangs de son armée au côté des créatures démoniaques. Ainsi, une femme proposa de nous héberger, car son mari avait été pendu par un de ces hommes, et cette aide était pour elle comme une manière d’honorer sa mémoire. Nous couchâmes le garçon dans la pièce commune du rez-de-chaussée, près d’une cuisinière à bois, et moi dans la chambre du mort.
11. Là, le garçon me raconta son histoire. Plus vieux fils d’une famille de cinq enfants, il travaillait dans une mine de pierres précieuses avec son père, trois frères et deux de ses oncles, comme ses ancêtres avant eux. Un jour, la mine s’effondra sur les ouvriers, et il fut le seul à en réchapper, car il se trouvait justement dehors pour vider un chariot de ses gravas. Les habitants interprétèrent sa survie comme un terrible présage, et exigèrent réparation. La mère de Fugo fut brûlée vive sur la place centrale du village, ainsi que ses deux frères et soeurs qui ne travaillaient pas à la mine ; lui fut condamné à l’exil après avoir été forcé d’assister à la mort de ses proches et qu’on l’ait lynché de cent coups de fouet. Ne sachant où aller, il erra des jours et des nuits comme un mendiant sur les routes et dans les montagnes ; il vit lors de son voyage des choses que son imagination ne parvenait pas à mettre en mots. Très faible, il s’endormit un soir dans une clairière. Il me dit avoir eu l’impression que le temps s’était distordu et qu’il avait pénétré une dimension où tous les repères avaient été abolis. Il vit dans cette dimension trois créatures qu’il prit pour des anges, car chacune avait trois paires de bras et trois paires d’ailes dans le dos, et leurs corps émanaient une lumière d’un blanc si pur que les larmes lui vinrent. Chaque ange portait une lance, symbole de guerre, une balance, symbole de justice, et un volume, symbole de connaissance. Les anges lui dirent, d’une voix qu’il connaissait depuis toujours : « Bientôt, ta peine trouvera une fin. Tu n’es cependant pas encore arrivé au terme de tes épreuves. Le destin te dirigera de telle façon qu’un jour les portes du royaume divin se présenteront devant toi. Mais il ne faudra pas que tu les ignores ou les prennes pour fausses, auquel cas elles disparaîtraient à tout jamais ». Puis les trois anges s’évanouirent comme une brume chassée par le soleil. Quand lui-même quitta cette dimension et retrouva le sol de la clairière, il vit que trois chevaliers avaient remplacé les anges ; les trois chevaliers étaient ceux-là même qui lui firent vivre ensuite tant de tourments, et que je tuai dans l’auberge. Depuis, me dit-il, il pense que les anges sont des envoyés de Lucifer qui vivent dans les rêves pour tromper les malheureux.
9. Par la grâce de Dieu, le village suivant avait été épargné. Il ne se trouvait apparemment pas sur la trajectoire des créatures, dont je comprenais encore mal le dessin. Avant les premières maisons, je vis des paysans faucher des céréales et des herbes hautes pour les rassembler en ballots ; les choses semblaient aller comme à leur habitude. Je m’arrêtai dans l’auberge où je demandai au tenancier s’il avait vu une femme, et je lui décrivis Fionn. « Un groupe de quatre voyageurs est passé par ici il y a de cela deux jours, mais je ne crois pas avoir vu de femme parmi eux », me dit-il. Je m’assis à une table et mangeai ce qu’on me servit. Je songeai à la proposition du mage Delilah, et à ce qu’il me faudrait comme force pour vaincre Soma. Je songeai à d’autres instants de mon passé, et notamment ceux qui avaient lié nos destins. Peu après, trois hommes franchirent les portes de l’auberge avec un jeune garçon coiffé d’un collier de chien et tenu par une laisse ; les trois hommes portaient des vêtements de chevaliers qui ont rompu leur serment et mènent une vie de crimes et de larcins. Ils avaient battu le garçon, car partout sur son visage couraient de vilaines plaies, et son corps était maigre. Ils demandèrent au tenancier de les servir à une autre table, au fond de la pièce, et firent coucher le garçon à plat ventre sur le sol. L’un d’entre eux posa son pied sur sa tête et l’appuya assez fort pour que son visage se plisse comme un tissu froissé. De là où j’étais, je lui demandai calmement de retirer son pied et de laisser aller le garçon. Aussitôt les trois hommes se levèrent et vinrent vers moi, toujours attablé. Le premier n’eut pas le temps de me menacer que je lui coupai les deux jambes par-dessous la table. Il s’effondra et entraîna avec lui les couverts et les assiettes ; les autres clients sortirent de l’auberge en courant. J’allongeai mon bras et pris la tête du deuxième, que je fracassai sur le bois ; j’enfonçai ensuite la pointe de mon épée dans sa nuque, jusqu’au sol ; sa tête se décrocha et roula près du buste du cul-de-jatte. Le sang coulait abondamment par tous les membres tranchés. Le troisième homme prit le garçon en otage et menaça de le tuer ; il connut pourtant un sort semblable à ses deux compagnons. Une fois libéré, le garçon demeura debout face à moi, à demi-conscient. « Quel est ton nom ? » lui demandai-je. « Fugo », répondit-il. J’avisai son état et dis : « Mon apprentie a disparu. D’ici à ce que je la retrouve, c’est toi qui m’accompagneras ».
8. Dans le village suivant, j’arrivai trop tard. Les habitations étaient dans un état tel qu’on les aurait crues mises à terre par une tempête, et les habitants transformés en créatures ou dévorés. Alors que je passais près de décombres provoquées par un incendie, un homme tranché en deux dont l’âme était possédée par une magie noire m’adressa la parole : « Chevalier, jamais tu n’aurais dû quitter ton manoir. Tu es en retard et tu sèmeras par devant toi une dévastation dont tu resteras l’impuissant témoin ». Ses yeux rouges brillaient commes les feux ardents ; son visage se trouvait déformé par la cruauté verbale. J’allais enfoncer mon épée par la tempe de son crâne pour lui ôter ces paroles débiles, mais il l’arrêta d’une seule main, son bras encore plein d’une vigueur d’homme fort. Le tranchant de ma lame s’enfonçait par les deux côtés dans son poing fermé, creusant dans sa chair, mais je ne parvenais pas à la pousser plus en avant ; je me retrouvais coincé, et compris qu’il m’attaquerait bientôt de son autre main. En effet, une marque noire la recouvrit intégralement, et il tenta de me l’enfoncer dans le bas-ventre. J’esquivai et lui l’écrasais avec la semelle de ma botte ; l’homme poussa un hurlement. Une créature qui guettait derrière moi en profita pour se jeter sur mon dos, et je sentis ses crocs s’enfoncer dans mon épaule. Si je ne dégageai pas mon épée, elle finirait par me décapiter. J’eus pourtant une autre idée. Je passai ma main gauche dans mon col et décrochai l’amulette de son pendentif pour l’enfoncer dans l’oeil de la créature. Alors, en un instant, à une vitesse telle que je crus être trompé par mes sens, la bouche sur l’amulette s’ouvrit grand et dévora la bête comme un trou noir aspire les étoiles. L’homme tronc, terrifié par ce prodige, lâcha mon épée ; mon bras droit prolongea sa trajectoire sans faillir et fendit son crâne en deux. J’entendis s’élever un murmure qui me promettait une destinée tragique. L’amulette referma sa bouche, et je m’en sortis ainsi.
salut
hier j’ai vu à la télé
qu’une petite fille de 4 ans
avait été kidnappée au portugal
il y a déjà 11 ans
et on ne l’a toujours pas retrouvée
aujourd’hui elle a 15 ans
peut-être 16 ans
peut-être qu’elle est morte
le jour de son enlèvement
c’est horrible
j’y pense toutes les nuits
j’imagine la petite fille
mais en même temps
je ne l’imagine pas du tout
sa mère a dit qu’elle l’avait imaginée aussi
dans des situations inimaginables
c’est comme un deuil éternel
et même si un jour
on la retrouvait vivante
je crois que pour tout le monde
elle resterait morte
Lancement d’INTERNET EXPLOREUR.
C’est un site dont je suis content, développé parfaitement par Lucie, car il se concentre uniquement sur le texte. C’est un site statique développé sur Jekyll, donc il va super vite ; il n’y a qu’une seule ligne de Javascript, qui sert à conserver en mémoire le mode de lecture choisi. Le reste est en HTML et CSS ; les textes sont rédigés en Markdown. Il y a plusieurs options pour adapter sa lecture à ses envies, et il est normalement aussi lisible sur ordinateur que sur téléphone. C’est un site qui se suffit à lui-même pour lire, et qui ne s’embarasse pas de 35000 formats différents pour proposer la même ressource, la plus légère.
7. Comme je quittais Duster, ma lame encore pleine de la puanteur des démons abattus, un mage apparut sur le bord du chemin, à partir d’une boue de sang, de terre et d’eau qui s’éleva jusqu’à taille humaine ; il souhaitait s’entretenir avec moi. Je reconnus à son habit qu’il appartenait à la troisième caste magicienne, qui prêta allégeance à Lucifer il y a de cela sept siècles, en trahissant par le poison Galaad, le roi premier à l’épée de lumière, père de tous les rois. Les mages changent plusieurs fois de visage chaque nuit, qui est comme leur berceau. Ils les volent aux âmes parvenant dans l’au-delà par le mauvais rivage. Celui-ci, dont le nom était Delilah, en arborra successivement plusieurs qui avaient été mes compagnons et mes amis de leur vivant ; cet affront réveilla en moi de profonds désirs de vengeance. « Vous savez que votre épée ne vous est d’aucun secours ici », me dit-il. L’amulette à nouveau se mit à vibrer, et elle éveilla sa curiosité. « Je vois que vous avez déjà recours à des reliques interdites dont vous ignorez apparemment la provenance. » Il voulut la saisir, mais elle lui brûla les doigts avant même qu’il ne la touche ; bien qu’elle fut d’origine démoniaque, mon influence sur elle en faisait ma protectrice. « Je viens en tant que messager, me dit-il. Mon Maître voudrait vous proposer son aide. Il sait que vous recherchez un pouvoir suffisant pour vaincre votre rival, et il peut vous l’offrir. Ainsi, voyez ce premier présent comme une preuve de son soutien. » Alors, Delilah déposa sur le sol une orbe noire de la taille d’une bille qui recelait, de ses mots, « la brume souterraine » ; puis sa cape devint translucide et il s’estompa dans le décor.
5. La description de l’homme faite par le tenancier correspondait à l’image de Soma tel que je l’avais vu la dernière fois, lors du combat qui me laissa une profonde blessure à l’épaule et révéla sa nature ambigüe. J’ignorais qu’il possédât de si grands pouvoirs, ni qu’il souhaitât former une armée ; un projet total croissait dans son esprit malsain. Je décidai de rester la nuit, car Soma n’avait pas l’habitude d’être généreux, et je craignais que cet or ne cache une nouvelle monstruosité. Je fis bien ; le lendemain, Duster connut la pire hécatombe de son histoire, et le village s’en trouva transformé définitivement.
6. Pour la première fois, l’amulette se mit à battre avec une intensité inquiétante, et les yeux sur ses faces s’entrouvirent, révélant leur sclère blanche. Je me précipitai à l’extérieur, où déjà le mal se répandait. Les amas d’or s’étaient transformés en créatures maléfiques, qui dévoraient les habitants ou tentaient de les corrompre en dévorant leurs âmes. Certaines avaient des rangées d’yeux verts et des crocs longs comme les pires poignards. Leurs corps sombres étaient recouverts de poils et d’épines. Je saisis ma lame et tranchai dans la hauteur la première qui me fit obstacle ; aussitôt, elle se consuma par les flammes dans des cris atroces. D’autres se regroupèrent autour de moi, me piquant de leurs bras taillés comme des faux et de leurs langues pleines du même venin que les serpents. Dans l’une, j’enfonçai mon épée par la gueule jusqu’aux entrailles, d’où le sang gicla telle une pluie acide et fit fondre les membres de ses congénères. Ma confiance en la justice divine m’empêchait de subir leurs assauts corruptifs ; elle redoubla ma vigueur et me permit d’achever trois autres bêtes avec la force d’un seul coup. J’y vis alors plus clair dans ce massacre ; mais les malheureux habitants avaient presque tous succombés à l’attaque, et le village comme les récoltes se retrouvaient calcinés. L’or alchimique avait retrouvé son origine noire. Les créatures restantes, prenant peur quand j’approchai, fuirent accompagnées des habitants corrompus et d’otages qui mourraient bientôt. Dès lors je compris quel genre d’épreuves j’aurais à surmonter avant de confronter Soma.
4. J’arrivai à Duster, village à peine plus grand que Midgar, connu pour la très grande pauvreté de ses habitants, presque tous contraints de mendier sur les routes ou dans les villages voisins pour gagner de quoi manger. Les plus hardis attaquaient les convois de nobles pour les voler ; l’habitude voulait qu’ensuite ils leur coupent les mains et les enterrent. Sur la place centrale, pourtant, une fête était donnée pour célébrer un grand miracle ; depuis la veille, les habitants étaient tous infiniment plus riches que le roi, et des pièces d’or à l’effigie inconnue s’entassaient par monticules devant les maisons. Autant d’or ne pouvait être qu’un funeste présage, car l’or est rare, et il tend à le demeurer. J’entendis un homme dire à son voisin que la paille qu’il transportait d’un champ à l’autre s’était subitement alourdie et avait passé avec un grand fracas entre les griffes de sa fourche. Toutes les cultures fauchées autour de Duster avaient subi le même sort ; leur richesse dépassait l’imagination. Je m’installai à l’auberge où je questionnai le tenancier sur l’origine de ce miracle. « Un homme est passé par ici hier, très beau, et très brave, me dit-il. Il avait les cheveux d’un blanc qui nous rendit tous aveugles, et nous l’aurions pris pour un sage s’il n’avait tenu son épée à la ceinture. Il nous dit qu’il était là pour renverser l’ordre imposé par le roi, et le défaire de son trône car il était le serviteur de Lucifer. Il nous rendrait riches pour que nous forgions des armes et rejoignions son armée. Puis il a quitté le village et les choses sont devenues comme elles sont à présent. »
2. Je devais trouver l’entrée vers les Enfers. Dans le manoir, j’avais lu plusieurs ouvrages qui la plaçaient sous des dunes désertiques, d’autres au centre de mausolées de pierres à flanc de falaise, les derniers enfin dans des cratères volcaniques. Quelques jours avant mon départ, j’avais interrogé un érudit qui logeait dans le manoir et profitait de la bibliothèque de ma famille ; il m’avait répondu qu’aucune de ces pistes n’était juste, car toutes étaient justes. Il m’avait fallu du temps avant de comprendre ce qu’il voulait dire, et dans les bois quand j’allais chasser je me répétais ses paroles pour en percer le sens. Puis un matin je compris qu’une multitude d’entrées existaient et qu’il suffisait d’arriver au bon moment pour que l’une d’entre elles se révèle. C’est pourquoi partout dans le monde d’autres chevaliers avant moi avaient pu accéder aux terres enflammées pour approcher l’horreur glaciale de Lucifer. L’érudit m’avait confié une amulette ensorcelée qui réagissait par des vibrations de plus en plus fortes à l’approche d’un passage. De forme ronde, sur ses faces on voyait le relief d’une bouche et d’yeux mal agencés ; je la sentais dans ma main battre comme le coeur d’un petit animal. Elle me rapprochait de Soma, celui que j’aurai à tuer.
3. Je me réveillai dans le monastère sans Fionn à mes côtés. Pourtant ses affaires étaient là mais je ne ressentais pas sa présence. Je l’appelai ; elle ne répondit pas. Dans la tourmente, je l’imaginais déjà morte. La mort de Fionn arrivait trop tôt et je craignis de mourir moi-même ; mon épée ni l’amulette ne m’immunisaient. J’explorai les ruines à sa recherche. Les cadavres des religieux possédés montaient au ciel et leurs âmes formaient des colonnes de lumière. J’abandonnai l’idée de la retrouver ici et poursuivis ma route tout en prenant garde aux assauts imprévus. Je me retournai une dernière fois vers les ruines pour observer les colonnes de lumière s’évanouir. Les chemins allaient par des paysages que les cartes ne rendaient pas. Un vagabond croisa ma route et s’arrêta à ma hauteur. « Je suis heureux car je vais vivre éternellement », me dit-il. Sous sa capuche, je vis son visage barbouillé de sang et des restes d’un corps jeune. D’un revers d’épée je tranchai son torse et priai pour purifier ce coup fatal. Je compris que cet homme était bon mais qu’on l’avait corrompu par les maux qui atteignent à l’esprit et aux sens, et je priai une nouvelle fois son âme afin qu’elle rejoigne le ciel. Son visage s’apaisa et les marques de sa folie s’estompèrent sous sa peau ; de sa large blessure s’élevaient des cendres. Les dangers sauraient trouver leur voie jusqu’à mon coeur, aussi me fallait-il rester brave. J’avançai ; les toits du prochain village noircissaient les vertes prairies.
(« C’est le même diable qui trône depuis toujours, mais plus personne n’ose l’appeler par son nom. »)
1. Mon aventure débuta après avoir empoigné une épée et un bouclier. L’épée venait de ma mère, qui la tenait d’un ancêtre chevalier dont le passe-temps principal avait été le massacre de démons. Sa lame était trois fois plus longue que mon dos et il me fallut du temps pour la manier d’une seule main. Le bouclier, je l’avais trouvé dans un coffre en bois et il ne portait aucune armoirie. Je sortis du manoir qui avait appartenu à ma famille et pris la route à pied vers Midgar, petit village spécialisé dans la confection de paniers et où coule une rivière dont j’ai oublié le nom ; j’espérais y trouver un compagnon. Dans une auberge, je rencontrai Fionn, jeune homme brave et fiable coiffé d’un casque, qui se révéla être une jeune femme une fois son casque ôté ; cela m’allait. Elle accepta de m’accompagner si je jurais de l’entraîner ; elle avait à venger une parente assassinée par les démons, et en cela sa quête rejoignait la mienne. Nous discutions dans les prairies qui voisinaient notre route, et je faisais parfois la sieste à l’ombre des arbres. Il faisait encore chaud à cette période, donc j’allais tête nue et sans armure. Après trois jours de marche, nous arrivâmes dans un monastère en ruines infesté de démons. Je les tuai tous en les éventrant, en les décapitant ou en les fendant en deux, et ils n’opposèrent aucune résistance. Nous apprîmes ensuite avec Fionn que les prêtres avaient été transformés en goules volantes par un démon supérieur, mais Dieu je crois ne me tint pas rigueur de les avoir délivrés de ce sort aussi brutalement. Nous dormîmes à côté d’un feu de camp, d’une traite en ce qui me concerne.
J’ai lu Tueries, Forcenés et suicidaires à l’ère du capitalisme absolu, de Franco « Bifo » Berardi (trad. P. Dardel), qui est un livre étrange car il paraît ne pas concrétiser les idées de l’auteur. Le titre français, Tueries, renforce le malentendu, quand le titre original est Heroes.
Je m’attendais à lire un essai sur les meurtres de masse, et, même si l’ouvrage commence bien ainsi, très vite il dérive sur le suicide mondial généralisé, lié à l’extrême précarité des travailleurs. Il me semble que faire un lien de fait entre les suicides post-fusillades de James Holmes ou Pekka-Erik Auvinen, et celui de l’employé anonyme de France Télécom, est largement questionnable ; et pourtant, Bifo défend que tout cela partage le même terreau commun : le capitalisme absolu. Bref, pendant la moitié du livre, je lis finalement autre chose que ce que je m’attendais à lire (sentiment souvent frustrant).
Ce qui manque surtout dans le livre, c’est un au-delà aux grilles de lecture politiques, sociologiques et historiques : une lecture peut-être plus sacrée de ces événements, car je crois qu’il est difficile de ramener un concept comme la mort à une causalité logique et concrète ; autre chose se passe, de difficile à approcher, et qu’on peut seulement pressentir dans des oeuvres comme Elephant, Des os dans le désert, 2666, ou la saison 3 de Twin Peaks. J’attendais qu’un essai explore ces contrées méconnues, j’attendrai encore.
Je pense que Bifo bifurque vers une lecture contemporaine du suicide car il ne parvient justement pas à mettre le doigt sur l’aporie des meurtres de masse, et qu’il lui faut trouver une issue de secours. Il dit à la fin avoir écrit « un livre horrible ». Quand je pense livre horrible, je vois Peter Sotos, William T. Vollmann ou Sergio Gonzalez Rodriguez. Là, j’aurais plutôt dit « un livre peureux ».
« La mort est belle, elle est notre amie : néanmoins, nous ne la reconnaissons pas, parce qu’elle se présente à nous masquée et que son masque nous épouvante. » – François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe.
Dans l’ensemble, les intrigues doivent rester simples, pour pouvoir plus facilement graviter autour. Dans la vie, il est très rare que les choses soient compliquées, vues de l’extérieur ; c’est notre cerveau qui les complique. L’auteur, c’est le cerveau, mais aussi la vie. Rester simple permet au lecteur de garder l’idée en tête. S’il n’a plus l’idée en tête, il ne sait plus de quoi vous parlez, et il finit par se foutre de savoir de quoi vous parlez. Le mieux, c’est de rester simple pour se foutre du lecteur.
Ce qui domine essentiellement notre monde, c’est la mort. Pourtant, personne ne veut le voir, parce que c’est beaucoup trop cliché. La mort a dépassé le concept métaphysique pour devenir un truc un peu chiant sur lequel plus personne ne veut s’attarder. La mort, en quelque sorte, s’est tuée elle-même en tant que concept. C’est pour ça que les milliers de femmes qui sont assassinées au Mexique chaque année n’ont plus d’importance. Parce que la mort n’a plus d’absolu ; c’est juste un peu de terre, de sable, de sang, de chair, le tout enfoui dans des fosses quelconques ou déposé sur des trottoirs comme dans toutes les villes.
Quelque chose se produit en moi lors des nuits trop courtes, un sentiment d’inconfort persistant qui m’affaiblit et ralentit le temps du matin, m’oblige à d’interminables détours pour trouver l’occupation la plus saine dans de telles conditions, et finalement se solde toujours par une solution décevante vers laquelle je me porte un peu par paresse, un peu par hasard, dans l’espoir que, la journée avançant, je puisse y voir plus clair.
Hier soir, j’ai relu de nombreux passages du Miroir qui revient, premier tome des Romanesques, l’entreprise pseudo-autobiographique de Robbe-Grillet ; un autre livre lu trop tôt. J’ai beaucoup d’affection pour la littérature de Robbe-Grillet, même si je pense qu’il était pervers au mauvais sens du terme, ce qui ternit son image d’homme, et même si son oeuvre est réticente à la relecture, moins à cause de son aridité que d’une complexité de regards.
Le style y est beaucoup plus classique, sans doute à cause du sujet, bien qu’il tente de brouiller les pistes à travers l’histoire du comte Henri de Corinthe. Le propos suit la même pente, et révèle de stimulantes ambiguïtés, telles le positionnement politique de ses parents, anarchistes d’extrême-droite, l’influence capitale de Camus malgré son image épuisée, son rejet absolu de Balzac et son admiration pour Sterne, Diderot et Flaubert, ou encore l’ennui profond que lui inspirent ses études alors qu’il va vers ses premières ambitions d’auteur, terme qu’il voit déjà comme réactionnaire. L’ensemble avance en spirales par d’incessants aller-retour, manière de lien avec ses romans.
C’est bien foutu, et il y a pourtant toujours quelque chose qui retient chez lui, une espèce de posture d’insincérité qu’il cultive et qu’il espère faire passer pour le contraire par des tournures préliminaires rousseauistes comme : « Je n’ai jamais parlé d’autre chose que de moi. Comme c’était de l’intérieur, on ne s’en est guère aperçu. » ou « Je ne suis pas homme de vérité, ai-je dit, mais non plus de mensonge, ce qui reviendrait au même. » En somme, c’est quelqu’un qui déteste se dévoiler, par peur surtout, non par modestie (il est prétentieux).
La grande obsession des antagonistes principaux de Jojo, c’est le Temps. À partir de Stardust Crusaders, chaque combat final se solde par une réflexion sur sa maîtrise et ses pouvoirs.
Grâce à The World, DIO parvient à arrêter le temps pendant une durée de plus en plus longue (d’abord une seconde, puis deux, puis cinq, etc.), et Jotaro ne le vainc qu’en faisant évoluer son propre stand Star Platinum vers des pouvoirs identiques : il peut bouger dans le temps figé, et finalement figer le temps lui aussi. Son stand devient d’ailleurs Star Platinum: The World.
Grâce à Killer Queen: Bites The Dust, Kira peut faire que quiconque voit son stand explose et se retrouver prisonnier d’une boucle temporelle qui le destine à exploser sans cesse au terme d’un parcours identique. Kira est obsédé par sa tranquilité (il ne veut pas qu’on dérange ses meurtres en série de femmes), et enfermer ses ennemis dans le temps est le meilleur moyen de les plonger dans l’oubli.
Grâce à King Crimson, Diavolo peut anticiper dix secondes dans le futur, et effacer ce laps de temps de la réalité. En somme, il crée des trous temporels. Quand Giorno réveille le requiem de Gold Experience, son pouvoir devient inverse : il rétablit les choses à la normale et les fait retourner à leur point zéro. La volonté de Gold Experience: Requiem devient plus forte que la prescience de King Crimson, et annule dès lors toutes ses projections.
Enfin, grâce à Made In Heaven, considéré par DIO comme le stand ultime, Pucci peut accélérer le temps à tel point que l’univers connaît sa fin et passe par un nouveau point singulier, qui crée un univers alternatif dont Pucci est le noeud. Quand Pucci est finalement tué par Emporio et Weather Report, l’univers dont il est le noeud disparaît, mais un autre voit le jour, dont Pucci n’a jamais fait partie.
Stone Ocean, sixième arc de la série, clôt l’univers mis en place avec Phantom Blood, en déréglant peu à peu les données temporelles, et en révélant qu’aucun homme, même aidé de son stand, ne peut contrôler cette force divine.
Cette obsession va de pair avec une autre, toute aussi démentielle : le désir d’immortalité. Mais ce qui vaut pour les antagonistes vaut doublement pour l’auteur, Araki, car il rend ainsi son oeuvre immortelle : elle peut sans cesse renaître sous d’autres formes, altérer les mêmes personnages, et faire de JoJo une somme artistique dont la diégèse ne connait pas de fin, car elle échappe à toute forme de saisie dans le temps. Le véritable utilisateur de Made In Heaven, c’est Araki lui-même.
Une semaine sur deux, ma mère faisait en Audi A3 gris métallisé le trajet de chez elle, à Taden, jusqu’à mon lycée, à Lamballe, matin et soir, pour me déposer et me ramener. Parfois, le soir, elle ne pouvait pas me ramener, alors je prenais le TER par Landébia, Plancoët et Corseul, et je marchais en ville pour aller passer quelques heures chez mes cousins à Dinan à jouer ou ne rien faire. Ces trajets en voiture me reviennent pour y avoir passé un temps fou, plus d’une heure par jour, sans jamais réellement parler à ma mère, à qui je ne voulais pas réellement parler, à regarder par la fenêtre, comme on fait quand on a dix-sept et qu’on croit que rien ne compte sauf celle qui nous attend et nous aime (peut-être) dans une ville où nous ne sommes pas, à penser à ces choses qui ne concernent que nous et qu’on oublie dès le lendemain. Le seul souvenir qu’il me reste de ces trajets sont les morceaux qui passaient, en 2008 et 2009, sur des radios populaires qui aimaient à se définir comme pop-rock, RTL 2 et Europe 2 en tête, et que ma mémoire volontairement, petit à petit, délaisse et entasse dans un coin qu’elle cherche le plus vite possible à vider, pour des raisons multiples qui se comprennent toutes et que je peine à avouer. Et je ressens pourtant des émotions profondes, enfouies, à l’écoute de certaines chansons de Luke (Soledad, La sentinelle), Matmatah (La cerise), Noir Désir (Le vent nous portera), chansons que je n’écoute plus pourtant, que j’ai même du mal à considérer (qui considère Matmatah ?) et qui désormais servent uniquement de fuel pour ma turbine à mélo ; chansons qui en côtoient d’autres de Radiohead, Mud Flow ou Nada Surf, que des amis proches me faisaient découvrir alors, et qui par leur qualité tiennent l’épreuve du temps et du goût. Mais que puis-je faire de toutes ces chansons dont plus personne ne veut, et qui pourtant chaque jour m’ont aidé à supporter, à endosser, la tristesse maternelle, et reparaissent, au hasard d’écoutes qui sortent comme du néant, pleines d’une vie sincère, vraie, qui est la mienne, entièrement la mienne ; et tristement, peut-être, uniquement la mienne.
Après avoir trompé pendant plus de six mois son mari avec Rodolphe Boulanger, et s’être en quelque sorte repentie en pleurant, Emma Bovary imagine que Charles est peut-être finalement bon à quelque chose et, soutenue par Homais, l’engage à pratiquer une opération inédite : rectifier un pied-bot. Elle espère grâce à cela augmenter la notoriété de Charles et du même coup leur train de vie.
On sait, on comprend très vite, que Charles est un médecin moyen, qui fait certes correctement son travail, applique ce qu’il a appris, mais n’a pas la stature d’un précuseur. On pressent que cette opération est une mauvaise idée (le soin de bon élève avec lequel Charles se plonge dans les livres chaque soir ne trompe personne), d’autant que le cobaye n’est autre qu’Hippolyte, garçon d’écurie, un bon bougre loin des bassesses sociales de Yonville, et qui n’en demande pas tant.
On promet à Hippolyte le succès auprès des femmes, mais surtout, cette opération ne lui coutera rien : pourquoi s’en priver ? L’opération a lieu, presque comme si de rien n’était, et tout le monde se félicite avant même que d’avoir apprécié les résultats. Quelques jours plus tard, Hippolye est dans un état lamentable et de son pied très vite vient la gangrène. Elle se prolonge à tel point sur sa jambe qu’on appelle Canivet, un autre médecin de Neufchâtel, plus qualifié, qui se moque de l’état du jeune homme et déclare l’amputation inévitable.
De son côté, Charles reste prostré dans son salon, face à sa cheminée, tandis qu’« Emma, en face de lui, le regardait ; elle ne partageait pas son humiliation, elle en éprouvait une autre ; c’était de s’être imaginé qu’un pareil homme pût valoir quelque chose, comme si vingt fois déjà elle n’avait pas suffisamment aperçu sa médiocrité ».
Toute cette scène m’a plongé dans une tristesse sincère : que l’insatisfaction d’Emma vienne comme contaminer et altérer définitivement l’intégrité de personnages secondaires qui mènent leur vie à leur façon et, au fond, ne pensent pas à plus, j’ai trouvé cela injuste. Hippolyte est broyé dans tous les sens du terme : en plein milieu du roman (point de bascule), des expérimentations médicales et des aspirations sociales. Qu’en plus Emma rejette sa faute sur l’erreur de Charles, et la coupe est pleine ; elle retrouvera Rodolphe le soir-même (la rancune est évidemment oubliée), sans plus aucune précaution envers son mari.
Il ne reste plus dans la grand rue de Yonville et l’esprit des lecteurs que les cris du jeune Hippolyte, bientôt un membre en moins, perdu dans les méandres d’une dérisoire intrigue sociale dont il ne soupçonne rien.
Finalement, cette version de Rivage n’est toujours pas ce que je veux faire. Enfin ça va, c’est bien, mais pas assez bien, ce n’est pas suffisant (désolé Benoit). Je ne sais pas si je m’impose une plus forte éthique de publication depuis La Ville fond, ou si je suis simplement plus lucide sur mes capacités d’écriture. Le processus est long parfois pour arriver à un résultat qui nous convienne.
Dernièrement, on a eu une conversation intéressante avec Fabien sur les relectures possibles d’un texte (d’un roman, en l’occurence). Aujourd’hui, notre sentiment est que les romans sont beaucoup faits pour être lus une seule fois : style outrageusement singulier (« trouver sa voix » devient surtout manière de la forcer à l’extrême), intrigue qui s’épuise d’emblée, visions redites du même présent ou du même futur. Le livre lu, on le repose, on l’oublie, on s’en débarrasse, la soupe est bue, le prix payé.
Le choc littéraire omniprésent, je crois, dit bien cela, qui veut une fracture dans l’ennui, mais à ce point monumentale qu’à peine refermée elle nous replonge déjà dans l’indifférence. Il nous faut des chocs prolongés, des chocs patients, des failles qui comme celle de San Andreas sont une perpétuelle menace.
Imaginer d’« audacieux » principes stylistiques n’est plus tellement un enjeu, un défi, tant désormais tout le monde publie partout ; mais à imaginer comment un texte travaille dans le temps, il y a sans doute la clé qui pourra contrer du même coup la fadeur contemporaine et la surproduction éditoriale.
Flaubert écrit à Du Camp, en octobre 1851 (je souligne) : « Si je publie, ce sera le plus bêtement du monde, parce qu’on me dit de le faire, par imitation, par obéissance et sans aucune initiative de ma part. Je n’en sens ni le besoin ni l’envie. Et ne crois-tu pas qu’il ne faut faire que ce à quoi le coeur vous pousse ? le poltron qui va sur le terrain, poussé par ses amis qui lui disent : “Il le faut !” et qui n’en a pas envie du tout, qui trouve que c’est très bête, est, au fond, beaucoup plus misérable que le franc poltron qui avale l’insulte et reste tranquillement chez lui. Oui, encore une fois, ce qui me révolte c’est que ça n’est pas de moi, que c’est l’idée d’un autre, des autres, preuve peut-être que j’ai tort. Et puis, regardons plus loin : si je publie, ce ne sera pas à demi. Quand on fait une chose, il la faut bien faire. »
Peu avant dîner, je retrouvai la détective Casca, que je reconnus dès mon entrée dans le café à ses vêtements qu’elle n’avait pas changés. Elle se trouvait assise à la terrasse qui débordait derrière le commerce, face à l’océan de nuit. D’autres clients étaient répartis par petits groupes, et je crus un instant reconnaître Midgar chez un homme moustachu.
Le temps que le serveur prépare mon cocktail, j’entendis les bruits venir de la plage, d’animaux, d’arbres, des uns dans les autres. Je m’installai face à la détective, qui me dit cordialement bonsoir. Je crois qu’au fond j’avais plaisir à la revoir dans d’autres circonstances que celles qui nous avaient réunies l’après-midi ; l’ambiance des lumières nocturnes mêlées aux néons intérieurs me faisait du bien.
Ce que je vais vous dire doit rester entre nous, dit Casca. Je bus une gorgée du cocktail, que je trouvais bon. Je suis arrivée il y a quinze jours déjà pour enquêter sur un meurtre qui n’existait pas, me dit-elle. C’est-à-dire ? demandai-je. Elle reprit : Depuis quinze jours on me mène chaque matin dans la zone où nous nous sommes rencontrés tout à l’heure, mais ce n’est que depuis ce matin qu’il y a un cadavre à l’endroit prévu.
J’ai toujours été très sensible aux mystères, qui me plongent dans des états inconfortables. La saveur de mon cocktail, après les confidences de Casca, sembla virer ; je me souvins d’une nuit où j’étais seul et où j’ai eu peur. J’avançai une idée que j’aurais préféré retenir : Vous pensez que ce cadavre est lié à mon arrivée ? Elle déporta son regard vers le rivage et l’océan, toujours immobile autour de Palmyre.
Relire des textes et me forcer à en extraire quelques mouvements et idées dans de brèves analyses personnelles (même si, soyons honnêtes, elles ne volent pas bien haut), m’aide à mieux conserver en mémoire mes impressions de style et de propos quant à ces oeuvres que j’aime, et que j’abordais jusque-là essentiellement comme des entités fantomatiques dont l’aura avait une influence irréfléchie sur mon travail et ma pensée.
Dans Du côté de chez Swann, il y a un passage que je trouve très émouvant, même s’il est à priori anodin. Le narrateur parle d’un certain M. Legrandin, ingénieur à Paris, qui ne peut passer qu’un jour plein à Combray par semaine, du samedi soir au lundi matin. Il semble regretter cette vie, d’autant qu’à côté de son métier, il se révèle être un homme d’une certaine sensibilité autant que d’une profonde honnêteté (il déteste la vie mondaine). Cet extrait, mélancolique (je souligne) :
« — Salut, amis ! nous disait-il en venant à notre rencontre. Vous êtes heureux d’habiter beaucoup ici ; demain il faudra que je rentre à Paris, dans ma niche. Oh ! ajoutait-il, avec ce sourire doucement ironique et déçu, un peu distrait, qui lui était particulier, certes il y a dans ma maison toutes les choses inutiles. Il n’y manque que le nécessaire, un grand morceau de ciel comme ici. Tâchez de garder toujours un morceau de ciel au-dessus de votre vie, petit garçon, ajoutait-il en se tournant vers moi. Vous avez une jolie âme, d’une qualité rare, une nature d’artiste, ne la laissez pas manquer de ce qu’il lui faut. »
Je vois cet homme comme une figurine à l’allure banale, qui passe à côté de tout (et notamment d’un rôle plus important dans cette oeuvre maîtresse), et aspire à quelque chose de simple et beau qu’on l’espère atteindre un jour.
Legrandin revient, une petite centaine de pages plus loin, toujours avec sa touchante obsession du ciel. Il cite et répète un vers imaginaire du tout aussi imaginaire Paul Desjardins (Les bois sont déjà noirs, le ciel est encore bleu) puis s’adresse au narrateur (je souligne) :
« Que le ciel reste toujours bleu pour vous, mon jeune ami ; et même à l’heure, qui vient pour moi maintenant, où les bois sont déjà noirs, où la nuit tombe vite, vous vous consolerez comme je fais en regardant du côté du ciel. »
C’est un personnage triste autant qu’optimiste ; rêveur dans le bon sens du terme. Et sa sortie de scène est parfaite : « Il sortit de sa poche une cigarette, resta longtemps les yeux à l’horizon. « Adieu, les camarades », nous dit-il tout à coup, et il nous quitta ». Parfois, je me demande s’il n’est pas une sorte d’émanatation, de reconstitution, du Voyageur contemplant une mer de nuages.
Ce que je vois comme la seconde partie de Pym débute par un ensemble de descriptions encylopédiques, façon pré-_Moby Dick_, d’oiseaux et d’îles du Pacifique sud. C’est un morceau à mon avis assez chiant qui a le seul mérite d’annoncer que nos héros s’aventurent dans des contrées encore inexplorées, prolongeant les expéditions de Cook ; mais sans doute les lecteurs des années 1830 devaient y déceler comme un avant-goût d’aventure.
En Antarctique, Arthur et ses nouveaux compagnons du Jane Guy découvrent des milliers d’autochtones, sauvages évidemment, dont ils s’empressent de récolter les richesses et de saccager la faune (notamment les fameuses biches de mer), sans rien leur échanger de significatif. Retour de karma, ils se font tous massacrer juste avant de quitter le continent glacé, et Arthur se retrouve à nouveau seul avec Peters, un de ses premiers compagnons de galère.
Et c’est là que ça devient intéressant, car il y a comme une triple sortie au roman.
D’abord, au fond d’une crevasse, sous terre, les deux hommes découvrent qu’ils arpentent des couloirs ayant la forme de symboles, jusqu’à finalement tomber sur des inscriptions dont ils ignorent l’alphabet. Plus tard, après avoir finalement quitté l’Antarctique dans une embarcation volée aux autochtones, le récit s’achève sur la confrontation en mer avec une silhouette blanche colossale (« de proportions beaucoup plus vastes que celles d’aucun habitant de la terre »). Enfin, en guise d’épilogue, on apprend la signification cachée des symboles.
Je disais que, dans la première partie, le savoir, la connaissance, révélait progressivement son danger, et comme dans tout roman de formation Arthur se retrouve peu à peu confronté aux horreurs humaines et naturelles. La fin du roman complète cette confrontation du narrateur pour entraîner à son tour le lecteur, grâce à cette triple ouverture énigmatique.
Comment des symboles éthiopiens peuvent-ils dessiner les couloirs d’une caverne polaire, des hiéroglyphes être gravés au fond de cette même caverne, et quelle est cette forme hostile qui les contemple ? Il est dit qu’à la publication du livre, Peters est toujours en vie, réside dans l’Illinois, mais demeure introuvable. Arthur est mort selon des circonstances bien connues du public.
En somme, on nous laisse un espace à explorer à partir de pistes impossibles autant qu’hostiles. Qui voudrait aller voir ce qu’il en est réellement (quand bien même on saurait désormais que c’est faux). Un roman comme celui-ci aurait de nos jours ouvert mille topics enfiévrés sur les forums ; il suffit de voir le nombre de théories élaborées suite à la publication de La Maison des Feuilles. Tout amène, dans cette conclusion, à vouloir savoir. Mais le pressentiment est fort que ce savoir nous entraîne à la mort.
Arthur a été capable de se confronter au charnier flottant ; est-on, lecteurs, capables d’assumer les mêmes visions prophétiques pour se confronter aux êtres ténébreux ?
Au milieu des Aventures d’Arthur Gordon Pym (qui est un de mes livres préférés parce que son aura de mystère ne faiblit jamais), il y a une scène incroyable, qui est un travelling parfait avant l’heure, travelling terrifiant, épouvantable.
Les quatre rescapés de la mutinerie du Grampus, presque morts de faim et de fatigue après des heures d’une tempête terrible, voient arriver, au loin, il faut imaginer la caméra derrière les quatre hommes, un brick-goélette. Certains pleurent, d’autres agitent les bras frénétiquement, car c’est leur porte de sortie du chaos.
Ce brick arrive très lentement, parce que lui aussi a subi la tempête : il lui manque plusieurs éléments, et il n’y a pas de vent. Sa lenteur donne aux rescapés l’occasion de fantasmer, d’autant que sa conduite est imprécise ; il va de droite à gauche, et parfois semble agir comme s’il ne les avait pas vus. Finalement, il arrive sur eux, et Arthur, le narrateur, distingue trois hommes : deux allongés sur des voiles, le dernier à la barre. Là, il faut imaginer que le cadre se resserre sur ces hommes.
Seulement, il y a une odeur, qui les prend tout de suite de nausées. Le cadrage commence à se décaler et à superposer les deux bateaux : le Grampus au premier plan, le brick étranger au second. Et Arthur écrit, alors, que leurs regards à tous les quatre donnent directement sur le pont, où stagne un charnier de vingt à trente corps.
À quelques mètres de distance, quatre hommes regardent des dizaines de cadavres entassés ; le plan est large, et les rescapés verticalement sous le charnier (prémice de leur mort à venir).
Puis le brick continue sa trajectoire, et le gaillard qu’ils imaginaient à la manoeuvre, quand ils le voient de dos, se trouve en réalité à l’équilibre sur diverses planches, dévoré par une mouette énorme, qui déchire sa chair par de larges plaies ouvertes. Son visage ne laisse plus apparaître que les dents ; les yeux ont déjà été mangés.
Le corps s’écroule finalement et vient compléter la masse des cadavres. Le brick continue d’avancer lentement en frôlant le Grampus, et repart comme il est arrivé, sur la même ligne, au loin. D’un point de l’horizon à l’autre, un aperçu minuté de l’Enfer.
La première partie du roman est un travail d’élucidations : rétrospectivement ou sur le coup, on tente par le narrateur de comprendre ce qui arrive, et cette compréhension offre d’abord des échappatoires (Arthur, de clandestin inexpérimenté, finit d’une certaine manière maître du Grampus). Ici, la compréhension, symbolisée par ce brick qui, d’un seul mouvement, apparaît puis disparaît, est le pire qui pouvait arriver aux rescapés, et décuple leurs souffrances. Le désir de savoir aspire parfois dans des tourments inenvisagés. Et c’est, je crois, justement tout le propos de la seconde partie du roman.
« Mais alors se produisit un tournoiement dans mon cerveau ; une voix imaginaire et stridente criait dans mes oreilles ; une figure noirâtre, diabolique, nuageuse, se dressa juste au-dessous de moi ; je soupirai, je sentis mon coeur prêt à se briser, et je me laissai tomber dans les bras du fantôme. » – Edgar Allan Poe, Aventures d’Arthur Gordon Pym (trad. C. Baudelaire).
Midgar me fit écouter les enregistrements qui lui semblaient suspects. La conversation qu’il tenait avec son contact californien ne faisait pas grand sens pour moi ; les données échangées se révélaient trop techniques ou trop confuses. Il me sembla pourtant que quelque chose de plus nourrissait leur conversation, que Midgar en somme ne faisait pas preuve d’une sincérité entière, considérant le propos dissimulé de sa discussion.
Après quelques minutes, en effet, d’étranges interférences vinrent perturber les transmissions. Il me fallait plus qu’une première écoute pour en saisir le sens, et je me contentai de prendre de brèves notes. Midgar restait assis face à moi, mais un bref coup d’oeil de ma part suffit pour voir se dessiner sur son visage une grimace d’épouvante. L’antenne n’est pas endommagée ? demandai-je en retirant mon casque. Non, répondit Midgar, nous l’avons inspectée avant votre arrivée.
Maxim attendait toujours à l’extérieur et ne semblait pas s’impatienter. Je posai d’autres questions à Midgar, qui imaginait les interférences causées par des espions étrangers curieux de nouvelles informations à propos des sous-sols de Palmyre. Selon lui, il ne s’agissait ni d’espions japonais, ni d’espions mexicains, mais il était incapable d’argumenter cette intuition par une explication logique qui me satisfasse.
Je ne restai pas plus longtemps en la compagnie de Midgar car je compris qu’il n’était sans doute pas la personne la plus apte à répondre à mes questions ; il me paraissait de bonne volonté mais tenu volontairement à distance des informations essentielles. Par qui, je ne le savais pas encore. Dehors, Maxim me demanda si j’avais résolu le problème. Non, lui répondis-je, ce genre de problème ne se résoud pas tout de suite. Il me déposa en voiture devant mon bungalow et me souhaita une bonne soirée. Il laissa le moteur tourner alors que je rentrai, et ne quitta pas les parages avant qu’une quinzaine de minutes aient passé.
La détective Casca s’entretint tout de suite avec moi à l’écart des autres hommes. Vous devriez vous méfier, dit-elle, de drôles de choses se passent ici. Elle regardait par-dessus mon épaule pour s’assurer que personne ne nous rejoigne. Retrouvez-moi ce soir dans le petit café qui fait face à la plage, je vous expliquerai. De retour près du groupe, je regardai le corps et discutai de choses et d’autres. Je comprenais encore mal ce que ce meurtre avait comme lien avec l’espionnage radiophonique.
Les histoires de meurtre, ça me fascine, me dit Maxim. C’est la première fois qu’on retrouve un corps sans connaître son meurtrier, c’est pour ça que je voulais vous le montrer. Palmyre est petite, il n’y a jamais beaucoup de suspects, et jamais beaucoup de mystères. Pourtant, dit-il, le mystère est important, même sur une petite île. Je regardai la route devant moi et les virages qui la tordaient. D’autant plus sur une petite île, dit-il enfin, comme pris d’une illumination.
Le poste de télécommunication était plus proche de la côte, à l’écart tout de même des espaces naturels pour ne pas effrayer les rares touristes avec la gigantesque antenne parabolique installée là. Je rencontrai le fonctionnaire chargé des écoutes dans un petit bureau identique à ceux des grandes villes. Le fonctionnaire s’appelait Midgar et portait la moustache. Elle lui allait bien, sans plus.
Maxim sortit pour nous laisser discuter seuls. Nous le voyions aller et venir lentement par la fenêtre qui donnait sur la plage. Sympa ce Maxim, n’est-ce pas, me dit Midgar, davantage sur le ton de l’affirmation que de la question. J’acquiesçai. Il vous a montré le corps ? me demanda Midgar. Oui, dis-je, juste avant de venir ici. Midgar triait quelques papiers en vrac sur son bureau. Ce n’est jamais un très bon présage que de retrouver une victime sans retrouver son tueur, dis-je. Au contraire, s’exclama Midgar, c’est un excellent présage.
Le lendemain matin, je ressentis en prenant mon petit-déjeuner que quelqu’un m’observait. En ouvrant la porte du bungalow, je reconnus Maxim qui se tenait debout devant moi, immobile comme s’il était statufié. Je lui demandai depuis combien de temps il attendait là, et il me répondit quelques minutes seulement. Je compris aussitôt qu’il mentait, et me rends compte en l’écrivant que ce mensonge était le premier d’une longue série d’autres de plus en plus inquiétants.
Maxim voulait me présenter à une personne arrivée quelques jours plus tôt pour travailler sur une affaire en lien avec mes propres recherches. Il me conduisit en voiture à l’écart de la côte, dans une zone ambigüe qui rappelait autant les alentours d’une centrale électrique que les plus vastes hangars portuaires. Une telle zone dans une île comme Palmyre avait quelque chose d’inconfortable, et j’interrogeai Maxim sur son existence.
Il me dit qu’elle avait été créée presque à l’origine de Palmyre, non pas à son origine terrestre, qui remontait évidemment à des millions voire des milliards d’années, mais à son origine technologique, qui avait marqué l’entrée de l’île dans le monde moderne. Palmyre, avant qu’un groupe d’aventuriers n’y découvre une forte concentration d’énergie, n’était qu’une petite lande de terre vierge d’aspect semblable aux dizaines d’autres qui parsèment l’océan Pacifique. En dehors de ce bref historique, Maxim ne me dit rien, notamment de l’utilité de la zone, qui était ce qui m’intéressait en premier lieu ; l’histoire des espaces m’indiffère vite car je suis très peu sensible au temps.
La femme que Maxim tenait à me présenter s’appelait Casca et enquêtait sur un meurtre particulièrement macabre découvert la semaine passée dans cette zone. Des ouvriers avaient révélé ce corps sous un hangar en déplaçant une série de poutres métalliques entreposées : un cadavre d’homme déjà largement dégradé par l’eau et la poussière, dont l’état laissait à penser que sa mort remontait à plusieurs jours voire, considérant l’odeur, plusieurs semaines.
« Une vague de souvenir remontant de la nuit des temps les envahit. L’origine de la pensée. Le processus magique émergeant de l’obscurité de l’espace. Des lois qui étaient encore floues et semblaient donc être abrogées. Des métaux modelables comme la cire, fondus par le feu sans se solidifier. Du bois flexible comme un roseau. Des corps qui n’ont ni poids ni forme. Des pierres flottantes. Des montagnes magnétiques. Un ciel qui se voûte au-dessus de la terre. Le renversement des sens. Le grand royaume de l’aléatoire. » – Hans Henny Jahnn, Le Navire de bois (trad. R. Radrizzani).
L’homme qui m’accueillit au bout du ponton s’appelait Maxim. Je dis « s’appelait » car depuis mon retour sur le continent je n’ai plus de nouvelles de lui, dans le sens où il semble n’être plus apte à pouvoir en donner. Il paraissait heureux de me voir ; soulagé serait peut-être un terme plus exact. Tout de suite, j’ai compris que Maxim en savait plus sur cette histoire qu’il ne voudrait bien me le dire par la suite, et qu’il agissait d’une manière qui pourrait me mettre en danger si je n’étais pas vigilant.
Palmyre me fit forte impression car je n’avais jamais eu l’occasion d’aborder aucune île, et le moindre détail sortant de l’ordinaire me faisait tout de suite l’effet d’une merveille autant que d’une énigme. L’eau délimitait les frontières de manière égale et les palmiers couvraient la plage conformément à l’image que je m’en faisais. Je ne ferai pas de description détaillée de Palmyre car je n’ai aucune formation de géographe, que le détail cartographique m’inspire peu, et que l’objet de ma venue occupait à ce point mes pensées que le réel de l’île s’est bientôt confondu avec les nouveaux paysages que j’y projetais.
C’est donc par honnêteté que j’omets les peintures des lieux. Il y a aussi que l’île a beaucoup changé entre mes dates d’arrivée et de départ, et qu’il me semble donc de peu d’intérêt de détailler un environnement qui n’existe plus comme je l’ai connu. Il est simplement important de savoir qu’aussitôt j’ai ressenti qu’elle cachait quelque chose de bien plus grand qu’elle ; immensément grand sont les termes qui me sont venus alors. Maxim m’a aidé à porter mes valises puis m’a conduit en voiture jusque dans un bungalow aménagé de meubles en série et décoré de toiles amateures.
Je n’avais pas faim et j’ai préféré passer cette soirée seul, pour relire des documents, noter mes premières impressions et imaginer par où je commencerais mes recherches le lendemain matin. J’entendais les vagues qui allaient et venaient mollement sur la sable ; des groupes de jeunes îliens qui finiraient la nuit moins seuls que moi. Il me prenait une nostalgie que je n’avais jamais ressentie jusque-là. À présent j’ai la nostalgie de Palmyre, mais elle a un goût semblable à celle que j’éprouvais alors.
L’histoire que je vais raconter eut lieu en 2004 sur l’île de Palmyre. Il n’y en a pas d’autre témoin que moi, qui ne m’en souviens pour tout dire qu’assez mal. L’île de Palmyre est petite et aujourd’hui il n’y vit plus grand monde. En 2001, la population était de 115 habitants, qui sont pour la plupart morts ou disparus suite aux événements dont je vais parler.
Le jour de mon arrivée en bateau les activités sur l’île étaient habituelles mais je sentais déjà qu’une présence malfaisante allait perturber cette tranquilité. J’arrivais suite à l’appel d’un fonctionnaire chargé d’écouter les transmissions radio vers la Californie. Il s’inquiétait du relevé d’ondes inconnues enregistrées lors d’une conversation secrète entre lui et son homologue californien, et anticipait la fuite possible de données sensibles.
Entre 1999 et 2004, Palmyre a fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des États-Unis, du Japon et du Mexique, car il avait été rapporté aux oreilles des dirigeants de ces trois pays que les sous-sols de l’île cachaient l’accès vers un immense territoire inconnu. Rien n’indiquait s’il s’agissait de nouveaux continents, de créatures malfaisantes ou de portails vers des dimensions métaphysiques ancestrales, et c’est justement je crois ce qui les obsédait tant.
Palmyre maintenait donc en permanence un contact téléphonique avec Los Angeles, Tokyo et Mexico pour tenter de négocier une certaine paix en calmant les imaginations. Cette île était au coeur de tensions diplomatiques constantes et épuisantes pour ses habitants, vivant du petit commerce alimentaire et d’un tourisme respectueux de son écosystème rare. Si les conversations privées étaient interceptées, le secret diplomatique se trouvait rompu, et Palmyre à l’aube d’une guerre dévastatrice.
J’ai relu La Presqu’île de Gracq (juste la nouvelle, pas le recueil entier), qui est quand même un texte incroyable, et après j’ai relu des choses sur la vie de Gracq, parce que mon gros défaut c’est que j’oublie tout, et j’ai pensé après que j’avais sans doute lu La Littérature à l’estomac trop tôt, alors qu’il y a plein de regards portés lucides qu’on pourrait calquer à l’égal sur nos années 2010 (en tout cas que je rejoins entièrement, après plusieurs années à arpenter dans le détail le contemporain) :
« Pour tout dire, on a rarement en France autant parlé de la littérature du moment, en même temps qu’on y a si peu cru. »
« On ne sait s’il y a une crise de la littérature, mais il crève les yeux qu’il existe une crise du jugement littéraire. »
« La demande harcelante de grands écrivains fait que presque chaque nouveau venu a l’air de sortir d’une forcerie : il se dope, il se travaille, il se fouaille les côtes : il veut être à la hauteur de ce qu’on attend de lui, à la hauteur de son époque. Le critique, lui, n’en veut pas démordre : coûte que coûte il découvrira, c’est sa mission — ce n’est pas une époque comme les autres — chaque semaine il lui faut quelque chose à jeter dans l’arène à son de trompe […] »
« (L’écrivain français, quand il a commencé à publier, ne cesse jamais d’écrire, pas plus que l’acteur de jouer, tant qu’il le peut ; on n’a pas encore fini chez nous de s’ébahir du scandale Rimbaud — rien de plus fréquent au contraire en Amérique que de voir un écrivain changer de « job ».) »
« Car l’écrivain français se donne à lui-même l’impression d’exister bien moins dans la mesure où on le lit que dans la mesure où « on en parle ». »
« Ce qui fait pour nous qu’une oeuvre « compte », comme on dit, ayons le courage de nous avouer que c’est parfois — que c’est aussi — le nombre de voix qu’elle totalise […] »
« Quiconque en France s’est trouvé une fois édité, si son début a été seulement honorable, a toutes chances de l’être toujours : il y a compte d’ailleurs, et ne pourrait voir dans un refus qu’un affront ou une ténébreuse manoeuvre. »
Gracq a plus loin quelques considérations sur la durabilité de ceux qui sont entrés dans le jeu littéraire (même après quinze ans d’absence, le milieu ne vous oublie pas), que je trouverais à modérer désormais, tant la machine éditoriale broie de la pire des façons : si le flux n’est pas maintenu, l’individu disparaît ; mais surtout, la curiosité s’éteint vite. Le pauvre Alexis Jenni, Goncourt pour son premier roman il y a à peine dix ans, n’est désormais plus qu’une ligne sur la page Wikipédia du prix.
« Le grand public, par un entraînement inconscient, exige de nos jours comme une preuve cette transmutation bizarre du qualitatif en quantitatif, qui fait que l’écrivain aujourd’hui se doit de représenter, comme on dit, une surface, avant même parfois d’avoir un talent. »
« nous sommes entrés […] dans une ère d’instabilité capricieuse où les constellations risquent de se bousculer et de se remplacer assez vite, car l’actualité dévore sans pitié ses objets »
Bref, le livre est plein d’excellents pressentiments sur le devenir du littéraire dans la société. Aujourd’hui, c’est toute une chaîne (auteurs, libraires, éditeurs, médiateurs) qui se retrouve captive de rituels délétaires à chaque étage, mais sans doute surtout pour la littérature en premier lieu. La surproduction n’aura pas rendus visibles plus de bons textes, simplement plus de textes, et surtout plus de supercheries. On ne comprend plus bien ce qui fait la qualité d’un livre, et tout le monde semble brouiller les cartes à dessein. Il faut se forcer à sortir d’un cycle et retrouver une honnêteté autant dans la démarche de création, que dans l’exigence de la réception.
(Tout ça tient de pressentiments que je tente de formaliser, autant pour trouver des pistes de sortie à mon insatisfaction que pour dresser un portrait honnête de ce que devient la littérature contemporaine.)
Toujours dans le même livre, je découvre deux mots marrants, qu’on pourrait assimiler à des anglicismes : lovelace et cancellés (prononcez à la française).
Si on me posait la question « C’est quoi ton style ? », je me trouverais bien incapable d’y répondre, non pas que je doute d’avoir les clés pour analyser mes propres procédés d’écriture et tropismes, mais simplement car je n’ai pas le sentiment d’avoir un style propre, ou plutôt pas un style discernable dans la masse affreuse des auteurs du contemporain ; pas assez discernable, en tout cas. C’est comme si je n’assumais pas de postulat total, et pourtant je suis convaincu que le style doit être un postulat total qui ne fait sens d’abord que pour celui qui l’assume.
J’ai jusque-là avancé sans trop y réfléchir, me laissant porter par les textes qu’il me plaisait d’écrire. Les Relevés en témoignent, je me cherche beaucoup et peux passer d’une chose à l’autre sans que je m’y tienne résolument. Au fond, je ne sais pas choisir. C’est inhibiteur de réfléchir à ce qu’est ou pourrait être son style, et le meilleur moyen de ne jamais rien accomplir ; mais cette question tourne désormais en arrière-fond et je n’arrive plus à m’en dépêtrer.
Qu’est-ce qui fait que je suis moi ?
Dans le troisième livre de Vie de Rancé, Chateaubriand explique une sorte de dispute qu’il y a eu à la fin du XVIIe entre Rancé et un autre religieux qui s’appelait Mabillon. C’était une dispute respectueuse par livres interposés. Grosso modo, la dispute était que pour Mabillon les religieux devaient se consacrer à l’étude, tandis que pour Rancé non, ils devaient se consacrer entièrement à Dieu.
Et Chateaubriand explique que « l’éloignement pour les lettres » revendiqué par Rancé s’est retrouvé chez plusieurs hommes de son époque comme Boileau, qui a écrit à Brienne (je ne sais pas trop qui c’est, peut-être Marie de Brinon) deux choses. La première : « C’est très philosophiquement et non chrétiennement que les vers me paraissent une folie. » ; et la seconde : « si je fais peu de cas de mes ouvrages, j’en fais encore bien moins de ceux de nos poètes d’aujourd’hui, dont je ne puis plus lire ni entendre pas un, fût-il à ma louange [là il pousse un peu] ».
Après Chateaubriand fait le faux modeste et écrit : « je sais bien que je ne dépasserai pas ma vie », alors qu’il dépasse déjà très largement sa vie avant même d’être mort.
Mais il écrit quelque chose de beaucoup plus intéressant à la fin du même paragraphe : « On déterre dans les îles de Norwége quelques urnes gravées de caractères indéchiffrables. A qui appartiennent ces cendres ? Les vents n’en savent rien. »
L’idée de rendre la littérature au néant est fascinante et ma parle particulièrement ces derniers temps. Pourtant, autant Rancé, Boileau que Chateaubriand ont écrit des livres qui restent là depuis des siècles. Donc : quel est l’artiste dont le talent peut vraiment disparaître et n’être plus qu’un fantôme derrière des urnes enneigées ?
« Lorsqu’on erre à travers les saintes et impérissables Écritures où manquent la mesure et le temps, on n’est frappé que du bruit de la chute de quelque chose qui tombe de l’éternité. » – François-René de Chateaubriand, Vie de Rancé.
En ce moment, je parcours les Leçons sur la langue française de Guyotat, que j’ai sorti un peu au pif de ma bibliothèque, parce que Cécile m’en a parlé d’un coup je ne sais plus pourquoi. Je relis surtout les cours sur le XVIIIe (Rousseau, Diderot, Buffon) et le début du XIXe (Chateaubriand), parce qu’en ce moment j’aime bien cette période, et que j’ai l’impression de mieux comprendre ce qui s’y écrivait.
Pour ne pas trop me perdre, une chose qui me frappe tout de suite à la lecture de ce livre, c’est comme Guyotat répète que les phrases sont belles, les images également, etc., enfin à quel point c’est beau et juste quoi ; ce qui témoigne, à cette époque, d’une attention à l’artisanat de la langue, à son façonnage, qui me semble finalement un peu oublié désormais, parce qu’on tombe dans deux travers opposés, soit une sécheresse stérile qui apprauvit la langue, soit une espèce de boursouflure stylistique qui se réclame d’un certain classisisme mais qui rend surtout roman de seconde zone sous la troisième République.
Par exemple, je prends ces deux exemples comme ça me vient, mais quand je lis Graciano, il y a une attention à la langue certes, mais qui dénote surtout d’une mécanique, d’une routine, et au fond, autant j’ai pu prendre plaisir à lire deux de ses livres, autant désormais son style m’épuise par avance dès que j’ouvre une page au hasard de ses nouvelles parutions. Alors que, je dois bien le reconnaître, je peux ouvrir Les Confessions des tonnes de fois sans que jamais les phrases de Rousseau ne me lassent.
Je ne sais pas trop si on voit où je veux en venir.
Dernièrement, j’ai relu L’Île Atlantique de Duvert, je ne sais pas pourquoi non plus, à part que ça me faisait envie. Stylistiquement, j’ai retrouvé quelque chose du XVIIIe remis au goût du jour (notamment dans les jeux de montage), mais finalement la référence de Duvert c’était surtout Guy des Cars, et donc on voit que pour moi, Duvert qui fait son Guy des Cars, ça se rapproche plus de Rousseau que Graciano. Je ne sais pas trop si ce que je dis fait sens mais j’essaie de me comprendre en l’écrivant.
Là où je veux en venir, vous l’aurez compris je crois c’est : pourquoi la langue française actuellement ne me vend pas tellement du rêve. Et je reconnais bien volontiers que, moi le premier, je ne me vends pas tellement du rêve. Enfin quand je vois ce que dégagent les phrases de Rousseau, et qu’après je lis les miennes je me dis quand même : pas ouf gars. C’est con de voir les choses comme ça mais en même temps c’est la réalité donc c’est vrai.
Et, si je dois être honnête, je me dis ça pour presque tout ce que je lis dans le contemporain, à des degrés divers bien sûr, et à part deux-trois (littéralement) exceptions près. J’ai relu un bout de Rimbaud le fils de Michon y a pas longtemps aussi, parce que j’avais lu beaucoup de lettres de Rimbaud, et en vrai de vrai, c’est pas dingue. Enfin c’est assez chiant, ça se regarde beaucoup écrire quoi. Je trouve pas ça très sincère ni très juste.
Au fond tout ça c’est assez subjectif je le reconnais mais enfin.
Parce que le but, vous l’aurez compris, c’est pas tout d’un coup de tous se mettre à écrire comme Rousseau, évidemment, de toute façon ça serait impossible, mais plutôt, ça serait quoi la langue de Rousseau au XXIe, c’est-à-dire une langue qui peut se lire et se relire sans lasser en découvrant toujours de nouvelles parcelles de sa pensée.
C’est colossal comme objectif, mais c’est peut-être ça la littérature.
Et j’ai beau lire des tonnes de trucs chaque année, qui me passionnent dans la langue ou le propos, au bout du bout, il se passe toujours que je redeviens le vieux con qui ouvre une page au hasard de Rousseau, Chateaubriand, Montaigne, Marie de France ou Proust et pense : c’est juste les boss en fait.
Et je ne sais pas vraiment pourquoi, si ce n’est que leur langues sont comme ultimes.
Bon.
Un jour j’arriverai à comprendre ce qui m’insatisfait.
Je me suis connecté à MSN et j’ai vu le nom de Simon dans ma liste de contacts. Il était en ligne et je ne comprenais pas comment. En ouvrant la fenêtre de dialogue j’ai senti qu’une aura malfaisante se dégageait de mon écran, et que je ne devrais pas être en train de faire ce que je faisais. Une fois en vacances j’avais lu dans un livre que les fantômes aimaient la technologie parce que l’électricité était un parfait conducteur de leurs sentiments, et qu’il valait mieux se tenir à distance des ordinateurs et des téléphones qui cachaient tout ce monde obscur qui doit rester fermé. J’ai commencé à lui parler et il m’a répondu comme s’il s’agissait du vrai Simon, mais je pense que c’était un double ou un robot, une sorte d’intelligence artificielle qui avait parfaitement compris qui il était à force de scanner tous les messages qu’il envoyait à ses amis. Ce bot Simon était capable de dire les mêmes choses qu’aurait dit Simon s’il avait encore été là, et sans visage ses émotions étaient sincères. Ce que je ressentais en lui écrivant était vrai, et je me suis même demandé pendant un moment si ça n’était pas un robot ou un double mais plutôt Dylan qui avait récupéré ses identifiants et m’écrivait depuis Madrid. Plus tard, Simon m’a demandé si on avait bien retrouvé son corps. Je lui ai dit qu’il avait été retrouvé par la police mais qu’elle avait toujours refusé de dire où et dans quelles conditions. Il m’a fait comprendre que la police avait menti et que son corps était toujours dans la ville quelque part. Il n’y a pas de corps dans le cercueil qui porte mon nom, m’a-t-il dit. Dylan sait où je suis caché, m’a-t-il dit ensuite. Je ne voulais pas parler de la mort de Simon à Dylan, sinon je sais qu’elle serait revenue et que cela m’aurait fait du mal. Je crois qu’il faut accepter que tu sois mort, ai-je dit à Simon. Je ne peux pas être mort si vous ne m’avez pas retrouvé, a-t-il dit juste avant de se déconnecter. J’ai commencé à imaginer que Simon était encore en vie et que c’était bien lui qui m’avait écrit là, et que si ce que j’éprouvais était si vrai c’est parce qu’il me disait les choses réellement. J’ai envoyé un email à Dylan dans lequel je lui demandais si elle avait bien vu le corps de Simon avant son enterrement. Je le regrettais à peine l’avais-je envoyé. Je suis sorti faire un tour et je suis passé par le cimetière où j’ai vu la tombe de Simon et son nom sur la pierre. Une femme plus loin lavait la tombe d’un proche et changeait l’eau des fleurs qui étaient dessus. J’ai senti mon portable vibrer dans ma poche et j’ai vu que Dylan m’avait répondu. Tout est subitement redevenu très calme. J’ai lu son email dans lequel elle disait que Simon ne méritait pas qu’on s’acharne à ce point, et que je devrais sans doute sortir de mes obsessions. Elle finissait son email en me disant qu’elle revenait ici quelques jours durant les prochaines vacances et qu’on pourrait se voir si j’en avais envie. Je n’ai pas répondu tout de suite et j’ai marché encore plusieurs heures dans la ville jusqu’à ce que la nuit tombe.
Un autre soir durant le même été, je suis allé me promener autour du plan d’eau pour me changer les idées. Des images de la soirée chez Dylan me revenaient et j’avais honte d’y être allé. Je suis parti pour un continent qui n’a pas de limites. J’imaginais comment était Lisbonne parce que le nom avait quelque chose de rassurant. Simon ne voulait pas que je parte et je crois qu’il m’en aurait voulu de savoir que j’avais quitté la ville. Au départ j’ai traîné un peu parce que je pensais qu’il restait encore quelque chose pour moi ici. On me donnait rendez-vous derrière les quais et j’expliquais mes secrets à des inconnus. Dylan serait venue avec moi si elle m’aimait encore. Je me réveillais le matin avec des bleus sur les jambes mais je ne pleurais pas. Ma mère me pansait avec des bandages de son enfance et me disait des choses qu’on ne dit qu’aux vieux qui vont mourir. Au début les autres m’ont fait croire que Simon était parti à Oslo, jusqu’à ce qu’on retrouve son corps et que je comprenne qu’il avait été à côté de moi depuis le début. Je m’en voulais de ne pas l’avoir senti. Je restais dans ma chambre et je regardais des clips de groupes qu’il aimait bien, même s’il ne les avait jamais vus en concert. J’ai porté certains de ses vêtements pendant quelques semaines, et parfois des gens me prenaient pour lui dans la rue. Au lycée on m’a dit plusieurs fois que c’était pas bien ce que je faisais. Je crois que ça excitait Dylan mais qu’elle ne voulait pas me le dire. Un soir elle m’a écrit pour savoir si j’avais encore ses sweats Nike, qu’elle aurait bien aimé m’en emprunter un. Je lui ai dit qu’elle pouvait les prendre tous parce qu’ils sentaient le cadavre. Je ne l’ai jamais vue les porter. Un soir elle m’a envoyé une photo d’un feu dans son jardin et j’ai compris qu’elle y brûlait les vêtements de Simon. Elle a toujours su qui l’a tué. Elle est partie à Madrid pour ne jamais avoir à le dire. Les policiers ont dit que c’était un suicide et je crois que cette version convenait bien à ses parents. Son grand frère n’a pas supporté sa mort et il a disparu. Il a laissé une lettre dans laquelle il explique que la ville le répugne et qu’il part pour un continent qui n’a pas de limites. On le retrouvera mort lui aussi tôt ou tard, c’est le destin de tous les disparus. J’ai réécouté l’album de Dirty Beaches que Dylan écoutait tout le temps à l’époque où elle croyait que sa vie était une reproduction d’un thriller thaïlandais des années soixante, ou quelque chose comme ça. Elle m’avait dit qu’elle avait vu un concert du chanteur à côté de la plage un soir dans une roulette et qu’il avait pété les cordes de sa guitare. Je crois qu’elle mentait parce que ça lui faisait plaisir de jouer un jeu qui n’intéressait qu’elle. Au fond, je crois que j’ai compris un peu ce qui nous animait à cette période-là, et pourquoi Dylan est réellement partie. Elle n’a pas laissé de lettre parce qu’il y a une route vers Madrid, mais plus personne ne se donnera la peine de la rejoindre. Je vis pour toujours dans une ville que nous avons tous connus par coeur mais dont moi seul conserve la mémoire.
Je me suis réveillé avec un léger mal de tête. J’ai eu des sueurs froides et des courbatures au milieu de la nuit mais je ne sais plus pourquoi. J’ai lu le début des Lettres aux amies et amis proches de Dickinson dans lequel on voit très tôt son obsession pour sa mort et celle de ses proches. J’ai préparé avec Lucie et Émilien un projet artistique pour l’année prochaine et répondu à des mails. J’ai fait une vaisselle et mangé des crêpes faites par Cécile et des pâtes à la sauce tomate faites par moi. J’ai regardé plusieurs heures de TFT sur Twitch. J’ai parlé avec Fabien des livres que j’achèterai quand les librairies ouvriront. Dans le lot il y a des romans du Moyen Âge à propos du Diable et des essais à propos des fantômes et des tueries. J’ai réécrit un peu de Rivage au rapport mais j’entre dans cette phase désagréable où je pense tout abandonner (encore). Je me dis que j’aimerais être érudit sans savoir exactement quelle réalité ça recouvre. J’ai imaginé qu’écrire des choses factuelles m’aiderait à avancer.
J’aimerais bien voir vos bureaux d’ordinateurs. Si vous voulez, envoyez-moi un screen de votre bureau par mail.
Stéphanie Saturday (version 8 bits) à fond dans ma Ferrari rouge, avec une femme blonde sur le siège passager que je ne connais pas, sur des trois voies infinies bordées de palmiers, au milieu du désert, ou dans les montagnes, à 293 km/h sans jamais manquer d’essence.
Parfois le cerveau est vraiment complètement sec. On se dit : tiens j’aimerais bien écrire un truc, mais en fait on ne sait pas quoi écrire, on n’en a même aucune idée, et non seulement on ne sait pas de quoi parler, mais en plus on serait profondément incapable de trouver comment le dire, si ce n’est bien, tout du moins avec le minimum de qualité nécessaire. Pourtant, autour de nous, quand on voit le nombre de livres et de trucs du genre qui se publient, il est évident que tout le monde a vraiment des caisses de choses à dire, et que tout le monde s’en bat profondément les couilles de ne pas savoir quoi écrire, parce que quoi écrire n’est pas une question, et comment l’écrire encore moins, et sincèrement je me demande comment les gens font pour trouver quoi écrire et pour moralement accepter l’idée que ce qu’ils ont à dire mérite que d’autres le lisent, au fond c’est affolant cette idée, tous ces trucs racontés sans aucun recul ni aucune maîtrise, qu’est-ce qu’on s’inflige quand même quand on y pense, dans tous les sens du terme, qu’est-ce qu’on bouffe c’est incroyable, on dirait qu’on n’est jamais gavés, et que nous-mêmes, obèses de tout ce bruit, on trouve encore la force d’imaginer concevoir quoique ce soit de potable, je trouve ça dingue, là j’y pense vraiment plus en détail mais c’est dingue au fond, cette overdose éternelle de trucs dits et mal dits, ou pas dits, ou pas à dire, enfin je sais pas, de trucs qui mériteraient sans doute de rester dans le même coin du web que ce bout de texte là, pour être oublié d’ici une semaine, et qu’on n’en parle plus, on devrait tous faire une cure sur le long terme et peser chacun des choix que l’on fait, ça serait cool.
Pour vous dire, y a pas longtemps, j’ai fait un tri dans ma bibliothèque. J’ai dégagé au moins 50 bouquins sans aucun remord. Vous imaginez, 50 bouquins, de minimum 200 pages, c’est dingue, c’est parfois même pas ce que des gens lisent dans une vie, et moi j’ai ingurgité ça sans pression pour finalement tout virer à peine cinq ans plus tard. Est-ce qu’à un moment donné j’aurais pas pu me poser et me dire : tu es sûr de vouloir lire ça ?
Parce que non, désormais, je ne suis pas sûr de vouloir continuer à lire tout ça.
Comme on a perdu l’habitude d’écrire des lettres ou des cartes postales, on perd l’habitude d’écrire des mails.
Hier soir, j’imaginais la vie que j’aurais si j’étais millionaire, pas petit millionaire mais plutôt avec des revenus annuels entre 30 et 60 millions. J’aurais un manoir néo-baroque au Nouveau Mexique, avec du marbre et des tableaux hyper chers. En fait, tout serait paisible. Il y aurait une piscine et des transats. Je conduirais une grosse voiture. C’est un modèle de vie, mais un peu indescriptible.
Tous ces agrégés sur Twitter qui partagent des captations audio d’Antoine Compagnon ; une certaine vision du gouffre littéraire français.
Antoine Compagnon porte une Apple Watch avec un bracelet orange en plastique.
Les premiers mois j’ai continué à lui écrire comme d’habitude. Elle ne me donnait aucune nouvelle de sa vie à Madrid et moi je n’en prenais pas, je continuais à faire comme si elle n’avait rencontré personne de nouveau là-bas, et qu’elle vivait elle aussi avec le souvenir des années au lycée, et surtout des derniers mois avant l’été, quand la découverte du corps de Simon dans la rivière nous a rapprochés, même si ça n’était pas pour les bonnes raisons.
Il ne faut pas se décourager. Il fallait 4 versions à Rivage au rapport pour que je trouve quelle histoire raconter, et comment la raconter. Avant que j’écrive cette 4ème version de Rivage au rapport, j’ai écrit une version 3 qui est un livre entier. C’est comme si j’avais écrit deux livres qui s’appelaient Rivage au rapport, mais que l’un était nul et l’autre bien. C’est un livre qui au début est sympa puis qui ne l’est plus parce que la prise de conscience du mal transforme tout. En ce moment je suis triste parce que je sais que mes personnages sont perdus.
Si quelqu’un me demandait qu’est-ce que tu préfères chez toi ? je pense que je répondrais mon site internet. C’est pour ça que je ne le montre à personne.
« Peu après le voici à la porte d’entrée, il respire normalement, et ouvre aux quatre hommes qui sont arrivés. Ceux-ci saluent d’un mouvement de tête (qui cependant dénote du respect) et observent avec des regards obscènes l’intérieur plongé dans la pénombres, les tapis, les rideaux, comme si depuis le premier instant ils cherchaient et évaluaient les endroits les plus aptes à se cacher. Mais ce ne sont pas eux qui vont se cacher. Ce sont eux qui cherchent ceux qui se cachent. » – Roberto Bolano, Étoile distante (trad. R. Amutio).
À un moment, dans sa chanson Ghosts, David Sylvian dit : just when i think i’m winning, when i’ve broken every door, the ghosts of my life blow wilder than before. Je crois que Dylan aimait bien cette chanson, même si elle ne la connaissait pas, et même si elle n’avait jamais vraiment prêté attention aux paroles. Je sais qu’elle est partie à Madrid pas très longtemps après une soirée qu’elle avait organisée chez elle en juillet. Il y avait du monde mais je crois que je n’avais pas été officiellement invité, c’est un ami d’ami qui m’avait dit de venir. Je ne sais pas si c’était volontaire de sa part à elle de m’avoir oublié, mais je me souviens de la tête qu’elle a fait quand j’ai sonné vers les 20h30 et qu’elle a ouvert, une tête du genre : qu’est-ce que tu fous là, avec du regret en plus, ou plutôt, non, une sorte de lassitude, comme si elle s’était attendue à ce que je vienne quoiqu’il arrive, car elle savait que son pouvoir sur moi était trop fort pour que je puisse y résister. C’était la dernière soirée ici avant que je parte en vacances assez loin, et je ne savais pas si j’allais la revoir à la rentrée. En fait, je me souviens m’être dit que cette fête était un peu comme un adieu, en quelque sorte, que moi je tenais à faire, bien qu’elle n’y tienne pas du tout, ou pas spécialement, vu les conditions dans lesquelles j’avais finalement été invité. Je me souviens que ce soir-là dans sa maison il y avait vraiment un paquet de monde, la plupart que je ne connaissais pas d’ailleurs, je me souviens m’être fait cette réflexion : je ne connais personne, à part deux trois amis, dont celui qui m’avait invité, mais que je ne retrouvais pas. Je me souviens qu’après m’avoir ouvert Dylan m’a dit : fais comme chez toi, et qu’elle a disparu. Au fond je savais, dès le moment où j’ai accepté l’invitation jusqu’à ce que je sonne chez elle et que je voie l’expression sur son visage, que c’était une mauvaise idée que je vienne, mais une fois que j’ai eu passé la porte c’était trop tard, il fallait que je reste jusqu’au bout.
« Je m’égarai dans un bois miniature
Et découvris une grotte azurée…
Est-il vrai que je suis réel
Et que la mort réellement viendra ? » – Ossip Mandelstam, La Pierre (trad. F. Kérel).
Je suis retombé sur une chanson d’Arab Strap que j’avais envoyée à Dylan en 2010. La chanson s’appelle One Day, After School. Dylan m’avait répondu en m’envoyant une chanson de Eels mais je ne me souviens plus laquelle. Je crois que j’avais trouvé ça moins bien, comme si sa chanson à elle n’était pas à la hauteur des sentiments que je mettais dans ma chanson à moi. Je pensais à tout ça, à la réciprocité des chansons, un truc dans le genre, je crois, dans le TER, matin et soir, pendant vingt minutes à chaque fois, en plus du chemin qui séparait la gare du lycée. Je me disais : toutes les chansons que je lui envoie sont plus fortes que les siennes, et après je me disais : ça ne pourra jamais marcher entre nous. Mais en fait, maintenant, je crois que ces chansons n’étaient destinées qu’à peut-être, quoi, 40% à Dylan, et qu’elles m’étaient destinées à 60% à moi, pour que je me réveille, ou quelque chose dans le genre, pour que j’arrête de transférer en elle mes propres sentiments et ce que j’aimerais que quelqu’un d’autre fasse spécifiquement pour moi et que moi seul pouvait faire, car moi seul m’aimais assez pour m’adresser la bonne chanson. Je me souviens que tout ça, je ne me le suis pas formulé très clairement sur le moment, parce que, je crois, c’était indécent de me le formuler comme ça à cet âge-là que j’avais, en fait je crois que je n’en étais tout simplement pas capable, parce que c’était une relation égoïste que je vivais avec moi-même dans la tête et dans le coeur des autres, et c’était insupportable autant pour moi que pour les autres. Quand je réécoutais cette chanson d’Arab Strap, je m’aimais à travers Dylan parce que je ne savais pas comment m’aimer moi, et j’étais heureux à travers elle de m’être adressé cette chanson. Il m’est arrivé de pleurer, et sur le moment je croyais que c’était de chagrin, le chagrin évident de ne pas être aimé par celle qu’on aime à 17 ans, mais aujourd’hui je crois que je pleurais parce que je n’étais pas capable de m’aimer moi, parce que c’était une douleur terrifiante autant qu’insupportable. Et aujourd’hui je me dis : si je m’étais suffisamment aimé à l’époque, comment l’aurais-je aimée elle, c’est-à-dire : avec quelle chanson ?
J’ai de grandes difficultés en ce moment à comprendre ce que je dois faire. J’éprouve immédiatement les limites du numérique, qui n’est, un peu partout, qu’un pâle alibi. Les structures culturelles ont un mal de chien à proposer du contenu d’intérêt, tout simplement car elles n’ont jamais réfléchi aux spécificités du numérique. Alors partout : podcasts, vidéos, images, sans rien derrière. On fait semblant de partager, mais on n’a même pas commencé à réfléchir à la question : c’est quoi, créer sur internet ?
« [La] violence ne s’exerce pas seulement entre violents ; des innocents périssent ; des brutes restent impunies. Pis encore, des êtres sincères et bons, comme Candide, se trouvent entraînés malgré eux dans le cercle de la violence. Il n’est pas aisé de s’y retrouver : dans ce jeu de massacre, le pouvoir effectif n’est jamais détenu pour longtemps, et, à voir successivement tomber le baron, le Grand Inquisiteur, le Révérend Père Commandant, l’amiral anglais, le récit prend le sens d’une destitution générale, qui atteint non seulement les détenteurs de l’autorité civile et religieuse, mais l’autorité comme telle, c’est-à-dire ce qui fonde en légitimité l’exercice du pouvoir. » – Jean Starobinski, Le remède dans le mal, Critique et légitimation de l’artifice à l’âge des Lumières.
dylan m’envoie un sms : c’est parce que je reste loin que tu m’aimes.
« Elle ne va pas jusqu’à la plage, elle s’allonge dans l’allée, la tête sur la paume de sa main, accoudée sur le sol, dans la pose d’une liseuse, elle ramasse du gravier et le jette au loin. Puis elle ne jette plus de gravier, elle déplie son bras, elle pose son visage sur ce bras allongé et elle reste là. » – Marguerite Duras, Le vice-consul.
(Gauthier Roussilhe, Une erreur de “tech”.)
Jour 17 de confinement
Jeanne Dark regarde un film dans sa cabine privée. Un pikachu habillé d’un chapeau marron mène une enquête dans une ville qui ressemble à New-York, sans les immeubles. C’est une production hollywoodienne produite avec l’accord de Nintendo. Les hommes de Jeanne Dark pillent une deuxième villa et installent un campement dans la chambre maritale. Ils profitent d’un magnifique coucher de soleil sur Saturne. Une fois que la lumière a disparu, il fait froid.
(Arthur Perret, Pour un autre carnet de recherche numérique : « Mon site fête sa première année ce mois-ci : un an, c’est le temps qu’il m’aura fallu non pas pour inventer les solutions à mes problèmes d’écriture ou d’édition mais pour trouver le temps de les inventer. Et puis on ne fait pas ça sur son temps de vacances si on n’est pas un peu mordu de balisage et de typographie. Tout le monde n’a pas le temps de développer une culture de l’écrit au sens de Guichard, c’est pour cela que j’y vois un enjeu d’enseignement plus que de formation professionnelle : pour tous ceux qui ne sont plus à l’école ou à l’université, il faut des médiations, des mécanismes qui permettent de démocratiser la technique. »)
(Julien Dehut, En finir avec Word ! : « Or, il faut reconnaître que la production des documents à partir du Markdown en conjonction de Pandoc demande dans un premier temps un certain investissement, en tout cas une motivation quotidienne, et peut-être quelque chose d’une résolution indéfectible. Cet investissement nous semble pourtant la contrepartie indispensable dont on doit s’acquitter dans le dessein de s’approprier, au sens de faire sien, ce qu’est devenu l’écrit dans notre société aujourd’hui. »)
Jour 16 de confinement
Détective Pikachu ne reçoit plus de courriers du meurtrier. Il en invente de nouveaux pour donner de la consistance à son enquête. Ils ne font pas aussi vrais, pense-t-il. Après avoir tué les propriétaires d’une première villa, les hommes de Jeanne Dark profitent de la piscine et des parasols. Saint Pepsi est sourd à toutes les prières car il n’est pas exactement Dieu. Le virus est invisible et inodore.
(Plus je trouve de contenu à ajouter à mon agrégateur RSS, et moins je ressens le besoin de retourner sur Facebook et Twitter. Je remplace des habitudes vides par de la matière.)
Jour 15 de confinement
Deux enfants à la plage attendent que leurs parents reviennent. La marée est très basse et ils voient à peine l’eau. Des vaisseaux dans le ciel disparaissent derrière de gros nuages. Il fait assez chaud pour que les enfants portent des casquettes et des bobs. Jeanne Dark est nostalgique. Quand elle aura fini de tuer les dirigeants, elle retournera sur Terre. Elle ira dans une maison qu’elle connaît bien et dans laquelle plus personne ne vit. Elle y dormira une ou deux nuits les volets ouverts ; le lendemain, elle repartira.
(J’essaie en ce moment de créer un projet en développant un site statique avec Jekyll. Comme c’est bien plus compliqué que prévu, je me rends compte que je n’y connais rien. Et je n’ai plus le temps pour apprendre ces nouveaux langages. Il y a dix ans j’avais le temps. Maintenant je pense que je suis bon à rien.)
Jour 14 de confinement
Parmi les trésors du gallion, on découvre une disquette avec des enregistrements datant du paléolithique. Sur une île, deux parents battent leur enfant. Le meurtrier nargue Détective Pikachu en lui envoyant des photos des corps qu’il continue à tuer. Saint Pepsi contemple d’un seul regard tous les univers. Le vaisseau de Jeanne Dark aborde Saturne et une première vague d’hommes armés de sulfateuses s’en va à bord de navettes. Sur TOI 700 d, les animaux ne font rien de spécial.
(Être libre à l’époque du numérique : « Si nous voulons être maîtres de nos machines, il faut que nous soyons capables de leur demander ce que nous voulons ».)
(Dernièrement, je découvre beaucoup de sites personnels ou carnets de travail en ligne, de designers, chercheurs et chercheuses, autres. Souvent, ces auteurs et autrices ont des comptes Twitter, que je vais voir par curiosité. Systématiquement, ces comptes se révèlent être décevants, inconsistants : promotion, liens sans contexte, aucun approfondissement de pensée, dialogues obscurs entre spécialistes, etc. Je ne retrouve rien de ce qui me stimule tant dans leurs écrits, le partage de connaissances et d’expériences. Je ne sais pas pourquoi on continue à brasser du vent sur ces plateformes. Faisons confiance au bouche-à-oreille et cessons cette publicité permanente, envahissante autant pour nous que pour les autres. Ceux dont on demande la lecture nous lisent déjà ; les autres arriveront en temps voulu.)
« Ce qui l’avait attiré dans l’activité littéraire du temps de sa jeunesse, ce n’était ni la gloire ni la célébrité, mais la conscience de ses propres forces et de sa capacité d’écrire, de créer quelque chose de nouveau, bien à lui, que personne d’autre ne pourrait faire. »
Jour 13 de confinement
Un intellectuel relit 1984 pour mesurer l’ampleur de la situation et se rend compte qu’il s’agit en fait d’une fanfiction homo-érotique entre Huxley et Orwell. Au marchand, Jeanne Dark passe commande de 300 sulfateuses. Détective Pikachu se regarde dans le miroir et comprend que tous les dirigeants vont bientôt mourir. Au bord de la piscine d’un loft derrière Saturne, un serveur avertit discrètement un homme en costume que Jeanne Dark arrive. L’homme dénoue un peu sa cravate.

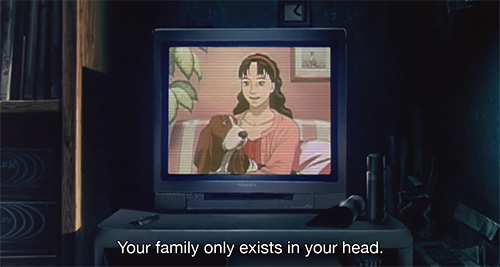

Jour 12 de confinement
Finalement, les animaux n’étaient pas morts. Ils ont simplement trouvé une exoplanète habitable avant les hommes. Sur la boîte vocale, un message dit : on pourrait peut-être se remettre ensemble ? Aoi se cache dans un centre où sont soignées les jeunes victimes d’une maladie cybernétique. Détective Pikachu appelle son meilleur ami et lui raconte sa journée. Dans l’espace, deux navettes spatiales s’affrontent et une explose. Jeanne Dark se signe.
(Je me dis que c’est ça qu’il me faut. Une page claire.)
« D’ailleurs, être libre et vivre en liberté, ce sont deux choses différentes. Adulte, je n’ai jamais été en liberté, mais j’ai toujours été libre. » – Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma (trad. S. Benech, C. Fournier, L. Jurgenson).
Jour 11 de confinement
Lors d’une transe nocturne, Jeanne Dark parle avec Saint Pepsi en citant mot pour mot le livre de Job. Détective Pikachu repêche une lettre du meurtrier. jE suIS PluS foRt qUe vOuS. Le sous-marin finit de récupérer les 133 trésors du gallion. Après quatre millénaires de confinement, l’humanité se décide enfin à partir par la porte de derrière. Là, Platon dit : bravo les gars, vous avez fait le plus dur. Platon se prend une balle de sniper en pleine nuque. Le sniper dit : pardon, je visais le mec à côté.
Jour 10 de confinement
Le bleu disparaît. À la télévision, un homme déclare avoir vu un siège propulsé hors de la fusée juste avant son explosion. Le soleil fonctionne toujours normalement. Très loin d’ici, au large des Açores, Détective Pikachu scrute la surface de la mer depuis une barque. Il retransmet la seconde partie de son enquête en live sur Twitch. Jeanne Dark est fondamentalement inspirée par l’idéologie nano-troskiste. Elle et les 10 000 prisonniers libérés vivent dans un vaisseau fantôme. La j-popstar Mima comprend enfin qui elle est.
(It’s time to get personnal et I miss webrings. Let’s bring them back and make websites about people again!)
Jour 9 de confinement
Jeanne Dark libère tous les prisonniers et forme une armée de mech-pilot. Ils s’envolent vers Uranus où ils combattent un trou noir qui a la forme d’un homme normal. Le trou noir dit : je vais vous absorber dans le néant. Un sous-marin se dirige vers les abysses et découvre une épave de gallion. Le flubber profite de la désertion des stations alpines pour s’essayer au snowboard. Un chasseur dans les bois le croise sur une piste noire et lui demande son nom. Plaxmol, répond-il.
Jour 8 de confinement
Tous les humains ont été remplacés par des robots experts en visioconférences. Le courant de poésie majoritaire est post-millénariste. Les barbecues sont autorisés. Un vieil homme meurt sans avoir révélé le secret de la pierre philosophale. Call of Duty: Modern Warfare est le jeu de simulation de guerre préféré des français. Une fusée part vers la Lune et explose avant d’avoir dépassé l’atmosphère. Le meurtrier se trouvait à l’intérieur. Détective Pikachu ne résoudra jamais l’enquête.
Jour 7 de confinement
À trois ans d’écart, deux adolescents amoureux empêchent les habitants d’un petit village de mourir pulvérisés par des éclats de comète. La Fête du Printemps s’achève sur un sixième meurtre. Les distances de sécurité réglementaires sont désormais de quatre-vingt mille kilomètres entre chaque personne. Une boîte vocale recueille tous les appels de détresse. L’hologramme d’un héron se pose sur un toit. Les gens s’habillent comme des mafieux de 1980.
Jour 6 de confinement
La j-popstar Mima tente une carrière d’actrice. Les plaies faites au couteau transforment le sang en liquide jaunâtre visqueux. Dans la taïga, des prisonniers minent de l’or. Détective Pikachu est formel : Seamus est la cinquième victime du même meurtrier. Les bananes sont toutes enveloppées dans du cellophane. Des dizaines de ferries en route vers des îles qui n’existent pas. En fin de soirée, une femme reçoit un fax sur lequel est écrit Traitor traitor traItor TRAiTor TrAItoR TraITor.


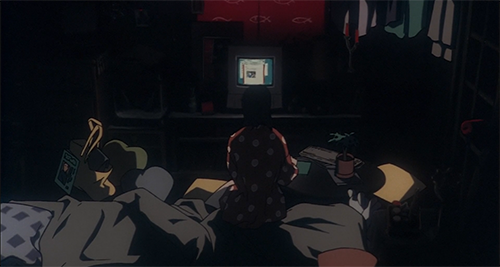

Jour 5 de confinement
Détective Pikachu enquête sur la mort de Seamus mais ne trouve rien (pour l’instant). Depuis les immeubles à Shanghaï, on s’échange des informations classées Top Secret par signaux lumineux. Jeanne Dark devient en même temps nouvelle égérie Dior et porte-parole officielle de Saint Pepsi. Les vrais confinés sont dans les cercueils, déclare un mort à la radio. Les masques à gaz sont désormais pourvus de capsules filtrantes aromatisées. Le virus n’a encore fait aucune victime.
Jour 4 de confinement
Une météorite disparaît dans un trou noir et réapparaît deux heures plus tard dans le salon d’une des résidences secondaires de Phil Collins. Le corps de Seamus est enterré sous la base martienne et un hommage lui est rendu. Saint Pepsi devient le nouveau guide spirituel de l’Humanité. Jeanne Dark tue des hommes importants un peu au hasard. Un voyageur découvre un château abandonné et s’installe à l’intérieur. Dans l’ensemble, ça va.
Jour 3 de confinement
La population ne prend pas du tout la mesure de la situation. Des visites guidées en quad sont organisées dans la Vallée de la Mort. Après trente kilomètres de route, un groupe tombe sur un cowboy en train d’enterrer une vache. Elle ressuscitera sur Pluton, leur dit-il. Des dérogations imprimables permettent d’être cryogénisé. Jeanne Dark arme son fusil à neutrons. On décapite un homme par erreur.
Jour 2 de confinement
Seamus est retrouvé poignardée dans la base martienne du quartier nord. Sur le parking d’un Auchan abandonné, une Tesla grise. Une version pirate de Windows XP circule au marché noir. Dans cette version, remporter une partie de Démineur permet d’accéder à une reconstitution du Purgatoire en trois dimensions. Les supplices infligés y sont réels, mais les entités impalpables. Les gens font leurs bagages dans des malles en osier et partent à pied.
Jour 1 de confinement
Tous les animaux sont morts. Les premières fusées sont parties vers Mars. Dans les campagnes, l’eau a monté de trois niveaux. Une cellule de stégosaure retrouvée en arctique a permis de créer un nouveau spécimen vivant. Les êtres humains vivent masqués. Sur Mars, les déserts et les montagnes ont été aménagés en complexes commerciaux. Nike est le symbole de la liberté. On ne voit plus Uranus. Autour de la Terre, l’enceinte de détritus empêche la lumière du Soleil de parvenir.
Par exemple, il est essentiel d’acheter un maximum de PQ. Tout le PQ qui existe est fait pour être acheté. Comme les gens achètent beaucoup plus de nourriture, ils vont beaucoup plus souvent aux toilettes, et s’essuient proportionnellement davantage. S’ils mangent épicé, c’est pire. S’ils sont stressés, c’est pire aussi. Manger beaucoup épicé en période de stress c’est l’assurance de consommer 6 à 7 rouleaux de PQ par jour, d’où l’intérêt d’en remplir trois caddies entiers à chaque déplacement au supermarché. Le PQ est une ressource limitée et pourtant la merde est illimitée. Quand tout le monde aura acheté tout le PQ disponible les gens auront les slips sales en permanence et l’industrie du slip sera cotée en bourse devant Microsoft et Amazon. Tout le monde investira dans le slip. Les slips remplaceront les ordinateurs, car les gens devront en permanence remplacer leurs slips. Pour éviter de gaspiller le PQ et endiguer la montée inévitable de l’industrie du slip, il faut faire comme me disait mon grand-père : deux feuilles pour le pipi, quatre pour le caca. L’économie du PQ est primordiale. Dépasser quatre feuilles pour le caca c’est criminel en temps de crise. Il faut passer par une prise de conscience globale. S’enrouler la main de feuilles n’est plus responsable. Le risque de boucher les toilettes est minime comparé au risque de pénurie mondiale de PQ. Le PQ vient d’une faute humaine comparable à celle d’Eve croquant la pomme et qui est la disparition du bidet. Les hommes connaissaient le paradis à l’heure du bidet car il abondait en rinçage et évitait la souillure des slips. Mais aujourd’hui les bidets ont disparu, tout comme les dodos. Les bidets et les dodos nous regardent depuis l’univers des entitées disparues. Et le bidet dit : je vous avais prévenus. Le bidet ne peut plus rien pour nous. Le PQ est désormais la nouvelle force maléfique qui a pour projet de nous dominer par sa disparition, qui remplace soudainement son évidente présence rassurante et délicate. Le PQ savait. Il s’est enrichi sur notre dos. L’épuiser, c’était le renforcer. Nous avons vécu dans le déni beaucoup trop longtemps. Bientôt, nous rejoindrons le bidet et le dodo, car nous aurons été fautifs. Et nous serons jugés.
Le chevalier approcha d’un immense palais fait de trente rangées de colonnades. Sur le montant était gravée une longue inscription qui le dissuadait d’avancer davantage. Les alentours du palais étaient vides. Il y avait un désert, et dans ce désert des flammes monumentales qui allaient de droite à gauche comme pour carboniser le ciel.
Tout à l’heure, j’imaginais, quand on sera sorti de la société capitaliste, et que les bâtiments construits durant son âge d’or composeront comme une sorte d’archéo-technologie dans laquelle nous puiserons toutes les images mystiques (comme avant, les ruines romaines) de notre contemporain.
dylan m’a dit : tu devrais prendre un peu de recul. juste, prends le temps d’y réfléchir. c’est pas contre toi. c’est juste que, je le sens pas. on peut continuer à se voir si tu veux. même si je pense pas que ce soit une bonne idée. t’es plus vraiment le même. et puis moi non plus. on vit plus les mêmes choses. tu sais, j’ai rencontré des gens à la fac. on sort, on voit des films. on fait des trucs quoi. j’ai peur que tu sois trop resté dans ta tête. cet été on va partir en italie. l’année prochaine je vais sans doute changer de ville. je sais pas si on aura beaucoup l’occasion de se revoir. tu devrais voyager toi aussi. je pense que ça te ferait du bien. partir un ou deux mois. tu peux pas rester comme ça. dans cet appart. tout seul. à attendre que le temps passe en jouant à la xbox. tu passes à côté de plein de choses. y a plein d’autres filles que moi dans le monde. je t’ai jamais rien promis. ça me fait de la peine de te laisser dans cet état, mais je vois pas trop quoi faire de plus. bon. je vais te laisser. à la prochaine. prends soin de toi.
ensuite, dylan est partie.
salut
pour être honnête
ce soir
je me sens un peu
mal
je vais changer de métier
retourner chez burger king
faire mes heures en silence
rentrer chez moi
regarder la télé
m’endormir
pour recommencer
pareil
le lendemain
je vivrai jusqu’à ne plus en pouvoir
je serai mort mais je serai là
je parlerai à des gens
qui n’auront aucune estime pour moi
je cuisinerai des burgers
qui n’existent pas
à partir d’ingrédients
qui sont le poison de notre monde
j’ouvivrai une chaîne twitch
pour partager mes parties de call of
j’aurai 30 viewers à tout casser
qui ne parleront pas
notre monde rend malheureux
parce qu’il n’est fait pour personne
on ne peut rien créer
on ne peut pas parler
on subit la destruction simultanée
de toutes les espérances
on finit en pleurs
dans des salles vides
qui ressemblent à des couloirs
des dizaines d’années passent
on finit de pleurer
mais on n’a aucune solution
personne à qui parler
la vie persiste
et nous dedans
on pense à de grandes étendues
de champs, de collines et de montagnes
des villes éteintes la nuit
une ombre qui nous parle
et qui a le visage de quelqu’un qu’on aimait
mais qui est perdu
car tout ce qui avait du sens
on nous l’a volé
Aujourd’hui, je suis tombé par hasard sur deux sites qui utilisent la même ergonomie que les Relevés, et qui n’ont pourtant rien à voir avec la littérature : les Notes de Marien Fressinaud, et les Weeknotes de Thomas Parisot.
Dans sa première entrée, Marien Fressinaud estime que ce format lui permettra de documenter des « pensées » qui pourraient être utiles à d’autres, s’entraîner à écrire et faciliter une certaine prise de recul pour son moi-futur. Il a appelé cette section Journal.
Ces notes sont brèves et utilisent un séparateur pour marquer le changement d’idée, comme ici. Je me rends compte qu’il s’agit du format que je préfère lire en ligne. J’ai lu ses cinq pages de notes en un rien de temps, entre autre grâce au format. On y trouve autant de sincérité que de concision.
Plus tard, je découvre également les Notes hebdo de Julie Brillet. Ces trois personnes ont commencé à utiliser ces formats au plus tôt à partir de janvier 2020. Il y a peut-être quelque chose qui résonne avec l’air du temps. En tout cas, je me réjouis de trouver dans la même journée trois sites à ce point en accord avec ma conception de l’écriture sur internet.
Ce que j’aime beaucoup également, c’est le renvoi en fin d’articles vers ce que les autres ont écrit durant la même semaine (« Ailleurs »). C’est une utilisation plus que bénéfique de l’hypertexte, pour produire grâce au lien une cartographie des pensées et des actions de différentes personnes sur un même segment temporel (ou, autrement dit, remplace parfaitement la question : et toi, quoi de neuf ?).
salut
j’ai décidé de me lancer dans la musique
j’ai trouvé un producteur
il m’a dit qu’il pourrait me prêter
son studio
j’ai déjà écrit trois chansons
que j’aime bien
sur des prods d’un dj new-yorkais
dont j’ai oublié le nom
si tu veux venir me voir
pendant un enregistrement
je te laisse l’adresse du studio
tu verras le producteur est sympa
il s’appelle steve
il mange toujours du réglisse
et porte une casquette
pepsi
King Krule - Airport Antenatal Airplane
Tatsuro Yamashita - Dancer
Les romans devraient arrêter de tenter de décrypter le monde. Il ne faut pas chercher à le comprendre, il faut trouver une issue. La fiction c’est le chemin pour s’en sortir. Si on perd tous notre temps à s’attarder sur l’état des choses, par où est-ce qu’on s’échappe ? Il ne faut pas étudier la composition des murs de la prison, mais chaque jour un peu plus l’attaquer à la petite cuillère.
« Je pense qu’[Emily Dickinson] a peut-être choisi d’entrer dans l’espace du silence, un espace où le pouvoir n’est plus une question, le genre n’est plus une question, la voix n’est plus une question, où l’idée d’un livre imprimé paraît un piège. » – Susan Howe, La marque de naissance.
Cécile m’a offert un livre du genre un peu développement personnel, The Art of Simple Living (chez Penguin). Elle m’a dit : j’ai pensé que ça te ferait du bien. Elle a complètement raison, même si, dès que les conseils deviennent trop abstraits, j’ai le sentiment d’avoir affaire à du zen macroniste.
Je me disais, de toute façon, il n’y a pas de mode d’emploi pour aller bien, pour vivre bien, et ça se voit. On vit tous comme des cons, on cultive des cancers d’anxiété dès la vingtaine, on passe en permanence à côté de ce qui est essentiel et évident, et sur quoi personne ne parvient à mettre le doigt.
Certains gestes malgré tout s’inscrivent dans une routine bénéfique. Je sais que me coucher tôt me permet de me sentir bien le lendemain matin. Presque toute ma journée est conditionnée par mon état mental au moment du lever. Commencer par là : me coucher tôt, et voir comment le reste suit.
« Ils l’entraînent loin de là pour le mener
au troisième champ,
plein de misère et de douleur,
de gémissements et de pleurs.
Il y avait là une foule de gens
de tous les âges,
couchés sur le ventre ou sur le dos,
fichés au sol par des clous de fer enflammés,
de la tête aux pieds.
Les clous sont si nombreux sur tous les membres
qu’on ne pourrait toucher le corps
sans rencontrer un clou. » – Marie de France, Le Purgatoire de saint Patrick (trad. L. Harf-Lancner).
Le plus important sur un site, ce n’est pas la mise en page, c’est le texte. Vous ne saurez sans doute pas au début ce que vous voulez dire précisément, et c’est normal, cela prend du temps. Mais il ne sert à rien de créer un site si vous n’avez rien à dire. Créez une maquette basique en html et css, ça suffira amplement. Faites des sites simples, avec les outils initiaux du html. Déjà, choisissez une police, des marges, et écrivez. Ensuite, vous verrez.
Une autre chose que je me disais : j’en ai marre d’être mon propre publicitaire. Devoir parler des choses qu’on a dites, faites, dans l’espoir qu’elles bénéficient d’un peu plus de visibilité. Pourquoi cherche-t-on à ce point à vendre.
Quelque chose ne va pas. Par exemple dernièrement je me dis : c’est débile d’avoir ce site avec mon nom dans l’url. Il faudrait une autre url pour me cacher derrière. Je me dis : les réseaux sociaux ne me veulent que du mal. Je me dis : pourquoi est-ce que j’ai le même pseudo sur tous les services. Je me dis : il y a des caméras partout, dans les bus, dans les métros, dans la rue. Je me dis : on sait où je suis rien qu’en suivant mes paiements. Je me dis : je ne sais pas qui est on, et c’est sans doute le plus terrible. Je me dis : où est la vie que les publicitaires ignorent. Je me dis : toutes les entreprises veulent nous asservir depuis des siècles. Je me dis : je deviens paranoïaque. Je me dis : mon téléphone est mon ennemi. Je me dis : mon ordinateur est mon ennemi. Je me dis : qui m’écoute. Je me dis : qui m’observe. Je me dis : je ne suis plus en sécurité nulle part. Je me dis : un jour l’état policier va tous nous emprisonner. Je me dis : l’état policier est la prochaine démocratie française. Je me dis : la liberté n’a jamais existé. Je me dis : le compromis n’a jamais existé. Je me dis : la liberté est depuis toujours broyée par la sécurité, et depuis toujours le compromis cherche à nous faire croire le contraire. Je me dis : quelque chose ne va pas. Je mme dis : par où commencer. Je me dis : la révolte c’est la dissimulation. Je me dis : sur internet, il n’y a que des espions.
salut
hier sur unity
j’ai modélisé une villa genre californienne
avec des escaliers en marbre
et des statues monumentales
je voulais faire un golf aussi
mais y avait pas de texture herbe
donc j’ai mis de l’eau à la place
ça fait un grand lac
avec rien dedans
c’est hyper paisible
j’y vais pour me ressourcer
pour oublier le taf
et toutes les merdes qui m’arrivent
quand je vais mourir j’aimerais bien
qu’on me modélise dedans
Dans mon nouveau texte, les personnages disent tout le temps putain parce qu’en vrai on dit tout le temps putain. Tout ça c’est pour faire réaliste.
salut
je suis retourné dans le palais
enfin je dis palais
l’espèce de ruine sans porte
derrière la rocade
j’y suis allé à pied
à un moment il fallait traverser l’autoroute
j’ai cru que j’allais crever
dans le palais j’ai dormi trois heures
sur un matelas dégueulasse et plein d’eau
j’ai bien dormi
j’ai fait des rêves normaux
dont un notamment
j’étais dans un supermarché
je faisais mes courses
j’achetais des fruits
et ils étaient bons
quand je me suis réveillé
il faisait nuit
mais je me sentais bien
Quand on aura tous enfin admis le fait qu’on écrit des livres de merde, peut-être qu’on pourra se poser un peu et commencer à envisager le fait d’en écrire des bons.
Finalement j’abandonne le flux rss, c’est trop chiant à actualiser manuellement, et en plus il réagit bizarrement. Je garde en tête que le xml est un super format, mais c’est comme s’il correspondait pas du tout à mon usage. Ou alors il faudrait coder un micro-script qui recopie chacun de mes posts du doc html dans le doc xml, et ça, bof.
salut
hier j’étais de passage à denver
je me suis arrêté pour faire le plein
dans une station-essence vide
j’avais quitté mon hôtel à peine deux heures plus tôt
je ne savais pas où aller
j’ai suivi des noms de villes sur les panneaux
à un moment j’ai lu miami
j’ai pensé que c’était une bonne idée
une autre voiture s’est garée derrière moi
qui avait ses phares éteints
et le conducteur fumait
sa main dépassait de sa portière
il m’a regardé faire le plein pendant trente secondes
ensuite je suis allé payé
et quand je suis sorti de la boutique
il était debout à côté de la pompe
de loin j’ai cru qu’il me parlait
et qu’il ressemblait un peu
à bruce willis
salut
je ne sais pas si je viendrai ce soir
ça me faisait envie
mais je me sens vraiment crevé
peut-être une prochaine fois
je porte un masque de luchador
deux soirs par semaine je vais me battre
dans une salle à l’extérieur de la ville
tous les participants sont masqués
on a des noms de scène
le mien c’est keanu reeves
je me bats surtout avec les poings
je n’ai pas une technique formidable
mais je me débrouille
en fait on est tous des amateurs
et les combats
c’est surtout pour s’amuser
après on va boire des bières
et le lendemain on retourne au bureau
comme si de rien n’était
salut
je me promenais dans un parc
hier soir
j’ai croisé un type
près des toilettes publiques
en train de boire au robinet
une sorte d’eau noire
qui avait l’air dégueulasse
et j’ai repensé au camping
où on était l’été dernier
et où déjà des groupes de gens du coin
allaient boire dans une rivière souillée par les détritus
là où les bêtes mortes flottaient
transportées lentement par le courant
vers la plage où les carcasses s’entassaient
et où une fille en bikini m’a dit :
la terre a pourri
et pourtant nous vivons dessus
salut
sur dofus j’ai croisé quelqu’un
qui avait ton nom
comme pseudo
et qui m’a parlé de trucs
que t’es la seule à connaître
des trucs vraiment intimes
que j’ai dits à personne d’autre
je sais pas trop à quoi tu joues
je savais pas que t’étais sur dofus
dis-moi si un jour tu veux
qu’on farm des scara ensemble
ça peut être cool
j’aurais aimé jouer
dans une sitcom des années 90
pour que tout le monde se souvienne de moi
avec nostalgie
Je ne cherche plus des livres bien écrits, je cherche des livres écrits aussi sincèrement qu’un journal intime de lycéenne. Je cherche des livres remplis de fautes mais vrais. Je cherche une littérature qui se débarasse des postures pour toucher à l’essentiel.
En ce moment, je me sens particulièrement fatigué. Je ne sais pas pourquoi le quotidien est ressenti comme un tel poids. Le travail est harassant mentalement, et quand je rentre du bureau évidemment tous les problèmes irrésolus me suivent. J’aimerais retrouver le plaisir d’être chez moi, de faire les courses, à manger, de lire, écouter de la musique, voir des amis, écrire, me promener, jouer, etc. Toutes ces choses, je les fais déjà, mais avec peine, alors qu’elles devraient être au coeur de chacune de mes journées. Je ne sais pas pourquoi on passe tous désormais à côté de ces moments-là. Est-ce que c’est la ville, est-ce que c’est le travail, est-ce que c’est une question de volonté ou de paresse. Est-ce que je ne pourrais pas aller au plus simple, au plus concret. Je sais qu’il y a quelque chose de mieux à approcher, et je veux l’approcher, je veux vivre dedans, je veux rompre avec ce que je crois être ma réalité.
Je regarde mon ordinateur, trop fatigué pour envisager autre chose.
je vis dans une maison
elle n’a pas de fenêtres
elle est faite de bois et de pierre
c’est une maison pour de faux
dans un DLC de minecraft
que je viens d’installer
d’autres joueurs me rendent visite
ils me disent :
belle maison
et moi je leur dis : merci
et tous les sentiments que j’éprouve
quand on complimente ma maison
je les éprouve vraiment
salut
si t’as un peu de temps tout à l’heure
hésite pas à passer à l’appart
j’ai préparé assez de pâtes
pour deux
j’avais plus de sauce tomate
alors j’ai juste mis de l’emmental râpé
c’est pas incroyable
mais pour ce soir
ça devrait aller
ah oui aussi
si tu pouvais me rapporter mon livre
j’y tiens un peu
c’est mon père qui me l’a offert
voilà
tu me diras ce que t’en as pensé
j’ai l’impression d’oublier un truc
enfin peu importe
ça devait pas être important
Je reviens de la librairie où j’ai acheté les 5 derniers volumes de Diamond is Unbreakable. Je suis complètement pris par le format feuilletonesque de l’intrigue. Je me demandais si écrire des romans sur le même format était encore possible. Imaginer des romans de, genre, 50 ou 60 pages, avec une intrigue continue et des cliffhangers dans tous les sens, qui paraissent tous les 3 mois. Je sais pas si on peut faire des romans comme ça, si les lecteurs seraient pris de la même manière (sans parler de la viabilité économique).
L’autre chose, dans JoJo, c’est que le lecteur est constamment tenu à l’écart des pensées les plus utiles des personnages principaux. On les entend sans problème parler de conneries, mais dès qu’il s’agit de stratégies de combat, tout devient opaque. Le lecteur partage le rôle des ennemis, constamment surpris d’être pris au piège. Et, en toute franchise, j’adore ça.
« Quand je veux me détendre, je lis de la poésie », dit Macron.
Juste devant la Maison de la Poésie, une équipe de chantier a creusé un trou, un bon trou même, assez profond, on ne peut y descendre que par une échelle, et on ne voit le fond qu’en se collant aux grillages. Je me dis : ce trou, c’est une opportunité en or.
Vous allez rire, mais le flux rss ne marche pas (et je ne sais pas pourquoi). Peut-être que c’est idiot pour de bon de vouloir intégrer du rss à une page statique.
J’écoutais tout à l’heure Paranoid Android (Remastered).
À la fin de Stardust Crusaders, DIO quitte son palais et part à la poursuite des quatre héros encore en vie.
Sous terre des personnes programment la réalité. Tous les accès sont au Groenland. Je vais créer un site internet qui cartographiera les points d’entrée et les horaires de passage. Un autre site internet permettra aux aventuriers de documenter leur voyage. Quand tout le monde aura écrit sa partie, on intitulera l’ensemble ARCHIPEL 3000, en référence à l’an 3000 qui n’arrivera jamais. Les serveurs seront nos derniers scribes. Dans les bunkers souterrains on trouvera des machines qui clignotent. L’adresse pour le futur mène chez toi. Ton père m’a ouvert la porte et m’a invité à regarder la télé. J’y voyais la vie que je mène actuellement du point de vue interne. Je me trouvais sympa. J’étais à deux doigts de comprendre quelque chose d’important sur l’univers, mais je passais systématiquement à côté. Je lisais tous les mots et après je partais. Dans l’Antiquité, on avait déjà conçu le réseau ADSL. Le passé lointain boucle avec le futur lointain. Toutes les rues ont été construites par le même architecte. Si Dieu avait une bonne config PC, il pourrait régler beaucoup plus de problèmes.
Vous voyez, depuis que j’ai repris le boulot, je n’écris presque plus ici. Le salariat, c’est l’enfer.
Ce que j’ai écrit en fin d’année dernière a entraîné quelques réactions. Suite à quoi Joachim m’a envoyé un email. Quand je vous parlais de dissolution. Des propos écrits ici sont diffusés par fragments sur Twitter, avant de me revenir par email sous une autre forme encore. Alors que chacun aurait pu prendre le temps d’en discuter calmement dans son propre espace, en utilisant cette invention formidable que tout le monde encore une fois semble avoir oublié : le lien hypertexte.
Et franchement, qui arrive à suivre une conversation sur Twitter ? Il faut cliquer sur 30 tweets différents pour visualiser chaque ramification et recomposer ensuite la discussion. C’est réellement un outil du diable.
Pour préciser ma pensée, donc.
L’avantage des blogs, c’est leur porosité. Chacun peut écrire de son côté, et ces écrits sont reliables grâce aux liens (balise ) ou à la citation (balises ou <blockquote>). Je n’ai pas d’espace commentaire ici, mais d’autres blogs en ont. J’invite plutôt les gens à m’écrire par email, car je n’aime pas hiérarchiser les pensées. Être en commentaire me donne toujours l’impression d’écrire des choses moins pertinentes (ou moins valables) que le texte source.
En plus des blogs, je pense qu’il faut également redévelopper des espaces de conversation informels (cf. conversations XMPP, serveurs IRC, forums, etc.), avec des communautés plus ou moins élargies en fonction des questions soulevées. Par exemple, cela pourrait être, si l’on part de ce que j’écris ici : conv. privées sur mes derniers paragraphes > conv. groupée sur les outils à utiliser/les habitudes à adopter > salon irc sur littérature et informatique > salon irc sur la littérature contemporaine > sur la littérature transséculaire > etc.
(J’aime voir les conversations comme des boîtes qui s’imbriquent et s’adaptent.)
À mon avis, ce sont des outils tellement marginaux qu’ils résistent comme des espèces de contre-pouvoir (enfin ne nous emballons pas non plus).
Tous ceux qui vous vendent Amazon, Youtube, Facebook et Twitter comme des espaces d’innovation littéraire n’ont rien compris à rien. Ces entreprises sont vides de sens. Ce sont des espaces marchands. C’est comme si vous expérimentiez à Intermarché ou chez General Motors. Au début vous vous pensez subversif et à la pointe, et puis vous finissez forcément déguisé en mascotte à vendre des paniers garnis à -50%.
Si vous voulez faire de la vidéo, très bien, hébergez vos vidéos, comprenez quel poids ça a (matériellement, en tant qu’objet), agencez-les dans un espace qui vous convient, avec un lecteur sur mesure. Prenez le temps de fabriquer vos propres outils. Céder aux services préconçus, c’est la paresse ultime de celui qui se prétend créateur.
Moi, ce que je dis, c’est qu’il faut tester. Donc créez-vous des comptes XMPP, vous ajoutez mon adresse, on teste ensemble, on voit comment ça avance, on s’entraide. Il faut toujours commencer quelque part.
Poétique partout, poésie nulle part.
Je vais être obligé de faire ce qui s’apparente pour beaucoup à une cure, une cure de l’ordinateur et de son usage inutile, son mésusage. Ne pas l’ouvrir systématiquement, l’oublier, faire autre chose, etc. L’allumer quand il me semble qu’une idée pointe qui mérite d’être écrite, ou consultée, ou communiquée. Arrêter de l’allumer pour voir, parce qu’en réalité il n’y a rien à voir, et je le sais déjà avant même de l’allumer. Je me convains qu’il y a quelque chose à voir, mais il n’y a rien. Il y a simplement des centaines de personnes comme moi qui attendent de voir ce qui n’est pas là, et qui errent inutilement plutôt que de partir.
« Toutes les formes actuelles d’activité tendent vers la publicité, et la plupart s’y épuisent. Pas forcément la publicité nominale, celle qui se produit comme telle — mais la forme publicitaire, celle d’un mode opérationnel simplifié, vaguement séductif, vaguement consensuel (toutes les modalités y sont confondues, mais sur un mode atténué, énervé). Plus généralement, la forme publicitaire est celle où tous les contenus singuliers s’annulent dans le moment même où ils peuvent se transcrire les uns dans les autres, alors que le propre des énoncés « lourds », des formes articulées de sens (ou de style), est de ne pouvoir se traduire les unes dans les autres, pas plus que les règles d’un jeu. » – Jean Baudrillard, Simulacres et simulation.